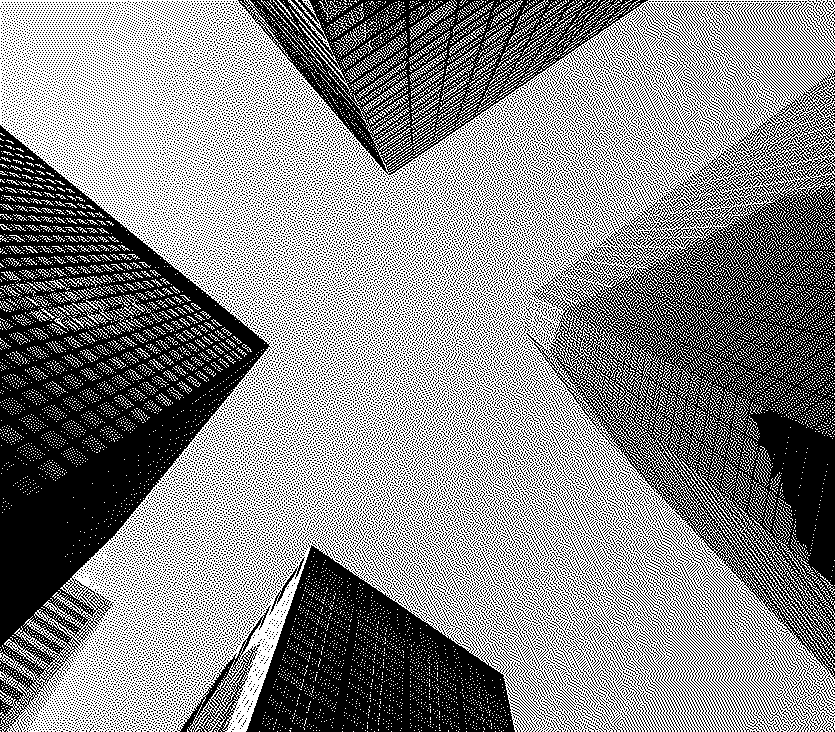L’hypothèse implicite est que la dette publique peut être accrue sans que cela pose problème. Selon nous, le jugement devrait être plus nuancé. Les niveaux de dette publique sont déjà très élevés dans les économies développées, si on les compare à ceux atteints par le passé en temps de paix et, dans le cas de la France, ils sont même supérieurs à ceux atteints par ses partenaires de la zone euro.
Que nous apprennent la théorie économique et l’histoire sur ce genre de situations et quelles sont les stratégies envisageables ? Quelles sont les différentes stratégies envisageables pour le futur ? L’examen de ces questions incite au réalisme : la liquidation de la dette n’est pas un dîner de gala et les économistes n’ont pas de repas gratuit à offrir.
Des niveaux de dette publique historiquement très élevés en temps de paix
Entre l’année 2009 où la crise financière mondiale commence (Global Financial Crisis – GFC) à faire sentir ses effets sur les économies développées, et l’année 2019 où le monde est frappé par la pandémie du Covid-19, les dettes publiques s’accroissent d’environ 30 points de PIB aux États-Unis et au Japon, et de plus de 20 points de PIB au Royaume-Uni (Tableau 1). Cette évolution reflète l’impact mécanique de la GFC sur les recettes et dépenses publiques et l’adoption de politiques de soutien de la demande agrégée se traduisant par d’importants déficits publics, peu ou pas compensés par des politiques d’ajustement lorsque la croissance reprend, soit à partir de 2010–2011 dans ces pays. En zone euro, l’augmentation de la dette publique est beaucoup plus modérée au cours de cette période (environ 5 points de PIB), en raison de la réduction du ratio de dette allemand à partir de 2013, qui passe en-dessous de 60%, conjuguée à une croissance allemande supérieure à celle de la moyenne de la zone euro. Incidemment, l’expérience allemande montre à cette occasion qu’il est possible de réduire le poids de la dette et de respecter les engagements européens sans pénaliser la croissance dans l’Union européenne. Dans les autres pays de la zone euro, les ratios de dette augmentent parfois très fortement (environ 45 points de PIB en Espagne, il est vrai très durement touchée) mais en général significativement (16 à 17 points de PIB en France et en Italie). La période que traverse la zone euro entre 2011 et 2014 est importante car c’est celle dite de la crise des dettes souveraines. Cette crise fait prendre conscience aux investisseurs qu’un défaut souverain n’est pas exclu parmi les économies développées (il s’en produit un en Grèce en 2012) et aux émetteurs que le risque de crédit qui en découle a un coût à la fois pour eux et pour leurs économies. En effet, les taux d’emprunt des émetteurs privés d’un pays, qui n’ont pas le pouvoir de recourir à l’impôt, sont généralement supérieurs à ceux de leurs États, qui en disposent.
Avec la pandémie, les ratios de dette publique bondissent de nouveau, de 10 points (Allemagne) à 20 points de PIB (Espagne, États-Unis, France, Japon, Italie), avec l’adoption de politiques de soutien de la demande, fondées notamment sur des prévisions de reprise économique lente en 2021. Cette évolution ne paraît pas appelée à se corriger significativement puisque la Commission européenne prévoit une augmentation des ratios de dette publique dans la plupart des économies, notamment au Japon. En zone euro, une légère réduction des ratios interviendrait certes, mais ce serait par augmentation du dénominateur plus rapide que celle du numérateur.
| 2009 T3* | 2019 T4* | 2021 T3* | 2023** | |
| Etats-Unis | 81,3 | 104,0 | 123,5 | 129,8 |
| Japon | 182,4 | 210,9 | 233,5 | 253,3 |
| Zone euro Allemagne France Italie Espagne | 79,1 72,3 81,5 117,8 49,5 | 83,6 58,9 97,5 134,3 95,5 | 97,7 69,4 116,3 155,3 121,8 | 97,0 68,1 112,9 151,0 116,9 |
| Royaume-Uni | 59,5 | 83,8 | 102,3 | 104,9 |
Le cas du Japon mérite que l’on s’y arrête car il est souvent cité comme exemple d’une économie qui, en « nationalisant » sa dette publique, se serait protégée de l’influence jugée déstabilisatrice des marchés financiers. De fait, les taux d’intérêt des emprunts publics à 10 ans s’y maintiennent proches de 0% alors que la dette publique y représente 2,3 fois le PIB. Toutefois, il faut y voir le résultat de circonstances particulières et pas forcément enviables. Après une vingtaine d’années de « quantitative easing » et cinq ans de politique de contrôle de la courbe des taux à 0% par la Banque du Japon (Bank of Japan – BoJ), le marché de la dette publique japonaise est très largement administré, avec environ 60% de la dette publique japonaise détenue par la BoJ, qui s’endette en contrepartie auprès des banques résidentes. De plus, le taux de croissance potentiel du Japon est très faible, en partie parce que le « quantitative easing » a incité les entreprises les plus vulnérables à consolider leur dette plutôt que de procéder à des investissements (Hong et al., 2022). Enfin, la faible détention de titres publics japonais (environ 10% de l’encours contre près de la moitié en France) rend improbable une spoliation des épargnants (voir troisième partie) dans un pays où les titres publics servent de réceptacle aux retraités et futurs retraités, ce qui diminue le risque de crédit. Ce n’est donc pas parce que les non-résidents ne détiennent qu’une faible part de la dette publique japonaise qu’elle est faiblement rémunérée, comme le voudrait un narratif populaire ; c’est au contraire parce qu’elle ne rapporte presque rien tout en étant difficile à trouver que les non-résidents l’achètent si peu.
Les États-Unis peuvent eux aussi être vus comme un cas particulier, dans la mesure où ils sont émetteurs de la principale monnaie de réserves, ce qui fait de leur dette publique un instrument de placement privilégié par les banques centrales et les grands investisseurs internationaux.
C’est donc à ses voisins de la zone euro, dont elle partage la monnaie, que la France doit être comparée : avec un ratio de 15% supérieur à celui de la zone euro, la position de notre pays apparaît certes moins fragile que celle de l’Italie mais guère brillante, particulièrement si on la compare à celle de notre voisin allemand.
Que nous disent la théorie et l’histoire ?
Malgré des développements récents, entrepris notamment à l’occasion et dans la foulée de l’adresse présidentielle d’Olivier Blanchard au congrès de l’American Economic Association en 2019 (Blanchard, 2019), les apports de la théorie restent plutôt décevants, tandis que l’histoire de la dette publique française incite à la prudence.
À grands traits, la théorie économique énonce qu’évinçant le financement de projets d’investissement privés, la dette publique a un coût en termes de bien-être social. Cependant, il y a intérêt à s’endetter dès lors que le taux d’intérêt sur la dette est inférieur au taux de croissance de l’économie, soit r g(Blanchard, 2019). Aux États-Unis, c’est la situation la plus courante (les années 1980 où r > g sont plutôt une exception historique, liée à la lenteur d’acquisition d’une bonne réputation monétaire, après les errements des années 1960–1970). Cependant, Wyplosz (2019) indique que n’est pas une norme parmi les pays de l’OCDE.
Par ailleurs, il n’existe pas une théorie complète de la soutenabilité des finances publiques, dans la mesure où, dans la théorie économique, le défaut n’existe pas, sinon comme un choix délibéré (défaut « stratégique »). Implicitement, la capacité d’endettement des pouvoirs publics est supposée infinie et son renouvellement automatique à l’occasion des tombées d’échéances, ce qui est en contradiction manifeste avec les enseignements historiques, y compris sur la période récente. De même, l’absence de théorie du défaut n’a pas empêché de multiples spoliations des épargnants par le passé (voir infra).
Pour autant, à la limite de la théorie et de la pratique, des observations utiles pour la conduite des politiques économiques ont pu être dégagées :
- Tout d’abord, lorsque les taux d’intérêt remontent et que r > g, dégager des excédents publics primaires (i.e. avant paiement des intérêts) est nécessaire pour éviter un « effet boule de neige » (i.e. une augmentation explosive de la dette), là où la dette est élevée, particulièrement si les marchés financiers anticipent un défaut (cas de la crise européenne des dettes souveraines) et si la dette publique se renouvelle rapidement du fait d’une échéance moyenne courte. Or, r – g est très volatil (Wyplosz, 2019). Cela suggère pour les pays fortement endettés d’utiliser la marge de manœuvre budgétaire dégagée par la diminution des charges d’intérêt afin de réduire leur dette lorsque les taux sont bas, en anticipation de leur remontée ;
- En outre, il y a des conditions où une spoliation des épargnants par l’inflation est économiquement – mais pas nécessairement politiquement – payante pour l’Etat : l’inflation ne doit pas être anticipée – pour ne pas se répercuter sur les taux d’intérêt – et l’échéance moyenne de la dette publique doit être longue – pour ne pas se répercuter rapidement dans le coût moyen de la dette publique.
Dans l’histoire française, les recours à la spoliation des épargnants sont nombreux. Comme d’ailleurs dans la plupart des économies alors les plus développées, ils interviennent en général à l’issue de guerres (particulièrement lorsqu’elles sont perdues, occasionnant le paiement de tributs et l’entretien des troupes d’occupation), dans un contexte où l’instrument de financement privilégié est pendant longtemps en France la dette perpétuelle. À grands traits là aussi, ils prennent deux formes principales :
- Manipulations monétaires : jusqu’à la Première guerre mondiale, ces manipulations prennent la forme d’un « faux-monnayage » (baisse du contenu des pièces en métal précieux) et de suspensions de la convertibilité de la monnaie légale en métal, suivies d’une dépréciation de la monnaie légale. À partir de la Première guerre mondiale et de l’adoption du cours forcé, la spoliation des rentiers intervient via le recours à la dévaluation (80% lors de la dévaluation Poincaré en 1928 !) et à l’inflation importée qui en découle. À partir de la Deuxième guerre mondiale, jusque dans les années 1980, les manipulations monétaires combinent dévaluations, répression financière (i.e. imposition de contraintes strictes à l’affectation et à la rémunération de l’épargne financière) et dominance budgétaire (i.e. situation où la politique monétaire, menée par une banque centrale qui n’est pas indépendante, a pour objectif de procurer à l’État les meilleures conditions d’emprunt possibles et non la stabilité des prix) ;
- Conversions forcées, impliquant une restructuration de la dette publique : lorsque la dette publique et le déficit budgétaire sont importants et que les taux d’intérêt sont faibles en raison d’une croissance lente, l’Etat ne parvient à dégager des excédents primaires qu’en plaçant les épargnants devant l’alternative suivante : le remboursement au nominal ou l’échange contre des titres (le plus souvent de même durée, donc perpétuels) portant un intérêt plus faible. La conversion peut aussi être optionnelle, ce qui lui enlève sa composante de répression financière, au risque d’être un échec à la fois économique et politique.
Deux grands enseignements peuvent être tirés de l’expérience historique pour la période actuelle :
- Les expédients cités ci-dessus ne peuvent dans l’ensemble plus être employés de nos jours, pour des raisons qui relèvent de facteurs institutionnels (monnaie européenne unique, indépendance de la banque centrale et appartenance à l’UE rendent moins plausibles respectivement la dominance budgétaire et le recours à la répression financière, en particulier le contrôle des mouvements de capitaux), d’une défiance des épargnants ayant conduit au raccourcissement de l’échéance moyenne de la dette publique par rapport à l’avant-Première guerre mondiale et du niveau très faible des taux d’intérêt depuis plus de dix ans, rendant sans objet une conversion forcée. Nous revenons sur certains de ces points dans la suite du texte ;
- Au XVIIIe et XIXe siècles, la gestion de la dette publique britannique, beaucoup plus orthodoxe qu’en France et reposant elle aussi sur l’émission de rentes, se traduit par des taux d’emprunt sensiblement plus faibles, le plus souvent entre 2% et 4%, contre 3% à 7% pour la France. L’orthodoxie paye.
Une longue exception toutefois dans l’histoire de notre dette publique est la période 1815–1914, « âge d’or » du rentier (Lutfalla, 2019). En particulier, la Restauration (1814–1830) et la IIIe République une fois passés les déficits résultant de la guerre avec la Prusse, voient mener des politiques d’excédents primaires, sans recours aux manipulations monétaires ou à la conversion forcée. La dette publique française passe ainsi de 115% du PIB, soit le niveau actuel, au milieu des années 1880, à près de 60% du PIB à la veille de la Première guerre mondiale. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle est acquise pendant la « longue stagnation » (1873–1897). La leçon que l’on peut en tirer est double : d’abord la France s’est déjà montrée capable d’un ajustement soutenu pendant des décennies ; ensuite, si la croissance aide évidemment, c’est avant tout la ténacité et la longueur de vue qui payent en matière de réduction de la dette publique.
Les différentes stratégies envisageables
Nous distinguons trois catégories de stratégies : l’approche orthodoxe, consistant à rembourser sans spolier, l’approche tragique qui recourt au défaut, et l’approche opportuniste, consistant à rembourser moins que l’on a emprunté.
La première voie pour rembourser sans spolier consiste à récupérer les créances sur les entreprises constituées lors de la pandémie (130 milliards de PGE distribués à fin décembre 2020, soit 5,4% du PIB français de 2019). Dans l’ensemble, cela ne devrait pas poser de problèmes aigus : la Banque de France estimait qu’à fin octobre 2021, les entreprises françaises disposaient de 913 milliards de trésorerie, tandis qu’en septembre 2021 42% des TPE et 54% des PME (contre respectivement 39% et 52% à fin 2019) disposaient de dépôts supérieurs aux crédits.
Plus fondamentalement, la question qui se pose à l’approche orthodoxe est de consolider sans inhiber excessivement la croissance économique. La réponse suggérée par Alberto Alesina, Carlo Favero et Francesco Giavazzi est « l’ajustement budgétaire expansionniste ». Celui-ci passe principalement par des économies sur les dépenses sociales, notamment dans le cas français un recul de l’âge de la retraite et/ou un relèvement du nombre d’années nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein, pour prendre en compte à la fois notre situation démographique et l’environnement européen (par exemple, l’âge de la retraite est de 67 ans en Italie et de 65 à 67 ans en Allemagne selon l’année de naissance, contre 60 à 62 ans en France selon l’année de naissance). En effet, ce type de réformes contribue à relever l’offre donc les perspectives de croissance, ce qui améliore la soutenabilité des finances publiques. En outre, la baisse des primes de risque de crédit que l’emprunteur doit payer annule en partie, voire complètement en cas de crédibilité initiale faible, l’augmentation du taux d’intérêt d’équilibre liée à la révision à la hausse des anticipations de croissance. Dans cette approche, les privatisations offrent la possibilité d’un double dividende : recette budgétaire et effet d’offre si les conditions de reprise de l’activité par le secteur privé permettent de dégager des gains de productivité.
Dans l’approche tragique, ce qui est préconisé n’est en général pas un défaut général, qui couperait les emprunteurs publics d’un accès aux marchés financiers pendant plusieurs années et qui serait très impopulaire auprès d’une proportion significative du public (les contrats d’assurance-vie en euros sont pour l’essentiel investis en titres publics de la zone). Il s’agit plutôt d’un défaut sélectif, vis-à-vis de la banque centrale, supposée produire un « argent magique » n’ayant pas besoin d’adossement. Cependant, cette voie conduit à une autre tragédie, celle de l’inflation très élevée, voire de l’hyperinflation. En effet, Thomas Sargent (1982) montre que ce n’est pas tant la quantité de réserves créées par la banque centrale en contrepartie de l’achat de titres publics ou la quantité de monnaie circulant dans l’économie qui détermine une inflation forte (supérieure à 100% l’an dans les cas qu’il étudie). C’est plutôt la crainte que les réserves perdent leur adossement si les créances détenues par la banque centrale sur l’Etat ne devaient pas être remboursées. En conduisant à une « fuite devant la monnaie », un défaut de l’Etat sur les titres publics détenus par la banque centrale, ou la simple crainte de ce défaut, serait ainsi facteur d’inflation, voire d’hyperinflation. Cette expérience s’est produite de multiples fois dans le passé et encore récemment en Argentine, au Venezuela ou au Zimbabwe. Une leçon que l’on peut en tirer est que la meilleure contribution que les Etats puissent apporter à la stabilité monétaire est de conserver des finances publiques saines.
L’approche opportuniste peut revêtir deux formes :
- Le recours à l’inflation : ici, la question est de savoir comment la faire repartir durablement à des niveaux suffisamment élevés (par exemple, comparables à ceux des années 1970, soit entre 10 et 15% l’an), pour avoir un impact conséquent sur le stock de dette, mais sans que cela se répercute dans les coûts d’emprunt. En effet, bien qu’en augmentation sur les décennies récentes, les durées moyennes d’emprunt de l’Etat (un peu plus de 8 ans en France) sont beaucoup plus courtes que jusqu’à la Première guerre mondiale. Par ailleurs, les banques centrales, désormais indépendantes et dotées d’objectifs de stabilité des prix, ne pourraient pas ne pas réagir si les anticipations d’inflation menaçaient de se « désancrer » et l’augmentation de ces anticipations pousserait elle-même les taux de marché à la hausse. Le gain procuré par l’inflation serait alors compensé rapidement par la hausse des taux d’intérêt. Cette voie n’est donc pas praticable ;
- Le jeu de bonneteau, consistant à escamoter une partie de la dette publique en tirant partie de ce qu’elle est portée à titre a priori définitif par d’autres agents, même si ce n’est pas l’objectif principal, l’escamotage se produisant en quelque sorte de manière adjacente. Deux voies dans ce sens peuvent être mentionnées. La première est le recours à des institutions supranationales qui empruntent pour accorder des dons aux Etats participants. En effet, les chiffres de dette publique, sur lesquels l’attention publique et les textes officiels se concentrent, sont ceux de la comptabilité nationale, d’ailleurs utilisés ici. Toutefois, lorsque les institutions emprunteuses sont supranationales, leur endettement échappe par construction à l’instrument de mesure. Cette voie a été poursuivie avec les 312,5 milliards (soit 2,3% du PIB de l’UE) de dons de la Commission européenne, partie du plan de relance européen arrêté en 2020 par les chefs d’État et de gouvernement. Une deuxième voie, qui nécessite la coopération de la banque centrale, est l’augmentation permanente du bilan de la banque centrale. Bien sûr, pour ne pas être facteur de perte de crédibilité, ce qui se ressentirait dans les conditions emprunteuses, cette augmentation doit être justifiée par de sérieux motifs. Elle pourrait prendre deux formes. La première est le maintien par la banque centrale d’une liquidité abondante. Celle-ci permet notamment aux banques de répondre plus facilement aux exigences de liquidité qui leur sont imposées par la réglementation prudentielle. La deuxième forme est l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) « de détail », c’est-à-dire à destination du public comme l’est de nos jours le billet, avec notamment l’objectif de maintien d’une relation directe avec le public alors que l’usage du billet s’étiole. Le surplus de liquidité épongé par l’émission de MNBC, au passif du bilan de la banque centrale, aurait pour contrepartie à son actif la conservation totale ou partielle du stock de titres publics acquis dans le cadre de ses opérations de « quantitative easing »). L’adossement systématique de l’émission fiduciaire à des titres publics est d’ailleurs le fait de la plupart des banques centrales (dans le cas de la Banque d’Angleterre, c’est même une obligation statutaire). Du point de vue de l’État, le prêt ainsi consenti par la banque centrale aurait le double avantage d’être perpétuel, l’émission de MNBC et les besoins de liquidité des banques ne pouvant a priori qu’augmenter sur la longue période, et très peu onéreux (voir note 4 de bas de page).
Pour formuler une opinion sur ces différentes options, il faut rappeler les points suivants :
- Même réussi, un ajustement comporte toujours un coût à court terme, sauf à se trouver « le dos au mur », c’est-à-dire dans une situation proche de l’effondrement ;
- Un défaut est généralement très coûteux, en raison de la perte d’accès aux marchés financiers qu’il entraîne ;
- Une inflation non anticipée ne peut de nos jours procurer qu’une bouffée d’oxygène aux finances publiques, tout en étant coûteuse politiquement ;
- La répression financière n’est possible que si elle incorpore une réglementation des mouvements de capitaux, ce qui conduit à se priver des avantages pour les emprunteurs de s’adresser à l’épargne mondiale, d’où des coûts plus élevés pour les finances publiques, une éviction des projets d’investissement privés et une croissance ralentie ;
- Comme les banques devraient trouver, vraisemblablement sur les marchés financiers, des ressources alternatives aux dépôts, la désintermédiation induite par la MNBC de détail renchérirait le crédit, pesant sur la croissance et finalement sur les recettes fiscales.
On peut également se demander s’il sera possible de préserver longtemps le schéma comptable d’une dette européenne non prise en compte dans les comptes nationaux.
Il ne semble pas que l’on doive encore s’alarmer de l’augmentation de notre dette publique. Cependant, si les orientations actuelles devaient se poursuivre, il paraît inévitable que nos gouvernants se trouvent, lorsque l’on aura de nouveau r > g, devant l’alternative suivante : soit mettre en place des mesures de répression financière, éventuellement assorties de changements dans les traités, notamment européens, de façon à inclure des restrictions aux mouvements de capitaux ; soit mettre en œuvre des politiques d’offre. La première possibilité serait facteur de tensions politiques fortes, de mauvaise allocation du capital et de ralentissement de la croissance potentielle, déjà très faible. La deuxième possibilité contribuerait au contraire à une meilleure allocation des ressources et à un relèvement des perspectives de croissance. Il serait dommage d’attendre de se trouver « au pied du mur » pour trancher l’alternative, alors qu’anticiper permettrait d’éviter une crise en engrangeant une marge de manœuvre à un coût beaucoup plus faible en termes de croissance. Plus que le niveau de la dette souveraine, ce qui compte est la capacité à dégager des excédents primaires, à orienter les dépenses publiques vers des usages productifs et à mener des réformes structurelles. C’est d’autant plus le cas de nos jours qu’avec la résorption probable des achats nets de titres publics par les banques centrales la pression à la baisse sur r devrait s’estomper et que la croissance potentielle n’a cessé de diminuer, en France comme dans les autres économies développées, au cours du dernier demi-siècle. Le risque résultant d’une dette élevée est double : hausse de r et baisse de g.
Références
- Alesina A., Favero C., Giavazzi F. (2019), Austerity, Princeton University Press.
- Blanchard O. (2019), « Public Debt and Low Interest Rates », American Economic Review, 6. 1197–1226.
- Board of Governors of the Federal Reserve System (2022), Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation.
- Hong G. H., Igan D ., Lee D. (2022), « Zombies on the Brink : Evidence from Japan on the Reversal of Monetary Policy Effectiveness », BIS Working Papers, No 987.
- Lutfalla M. (2019), Une histoire de la dette publique en France, Garnier.
- Pfister C. (2022), « Monetary Sovereignty in the Digital Era », in Digital Assets and the Law: Fiat Money in the Era of Digital Currency, sous la direction du Professeur Filippo Zatti et de Rosa Giovanna Barresi, Routledge-Giappichelli, à paraître.
- Sargent T. J. (1982), « The End of Four Big Inflations », in Inflation: Causes and Effects, sous la direction de Robert E. Hall, University of Chicago Press, 41–97.
- Wyplosz C. (2019), « Olivier in Wonderland », Blog Vox EU, 17 juin, file:///C:/Users/chris/Documents/Public%20Debt/Olivier%20in%20Wonderland%20_%20VOX, %20CEPR%20Policy%20Portal.html