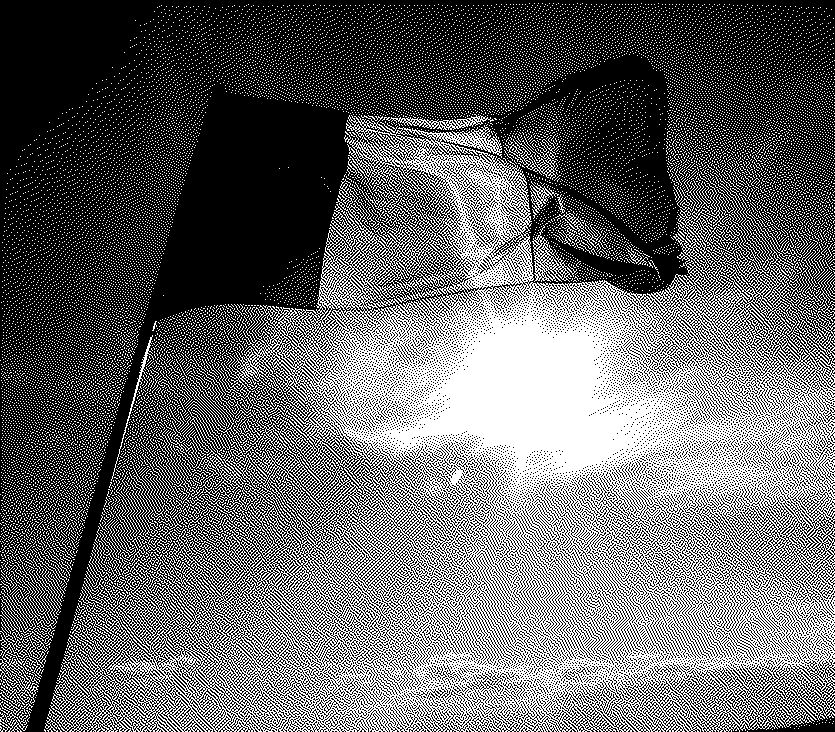Le livre de Julia Cagé et Thomas Piketty sur les élections et les inégalités sociales en France, met en œuvre une méthode déjà éprouvée dans de précédents ouvrages : construire des séries statistiques longues permettant de renouveler l’approche d’une question en prenant du recul historique. Ici, l’ambition est d’observer le vote sur plus de deux siècles, grâce à la richesse et à la continuité des archives françaises, et d’éclairer les déterminants des choix électoraux en échappant aux impressions momentanées et inévitablement partielles du commentaire électoral au fil de l’eau. Les auteurs présentent leurs résultats, justifient leur démarche, donnent accès, via un site internet dédié, à leurs statistiques, développent leur interprétation dans un livre-somme particulièrement abondant. Ils affichent aussi d’emblée leur volonté de formuler, à partir de leur thèse, une stratégie électorale de reconquête pour la gauche.
Le point décisif de cette démarche réside dans la construction des catégories pertinentes sur la longue durée. Il faut en effet pouvoir mettre dans la même catégorie l’électeur de 1789 et celui de 2020 pour obtenir des séries cohérentes. Et, de même, il faut rassembler sous des catégories homogènes les partis politiques qui se sont présentés aux suffrages des Français à travers les Républiques, les Empires et les monarchies constitutionnelles. Les auteurs font preuve à ce sujet d’une grande prudence méthodologique et multiplient les expressions de leurs scrupules. Mais ils font aussi des choix. Car il faut bien trancher le débat méthodologique : choisir la longue durée, c’est élargir la perspective d’analyse mais aussi, pour cela, recourir à des catégories temporellement stables, au détriment de catégories historiquement datées. On perd en finesse d’analyse ce qu’on gagne en vue d’ensemble. Un gain pour un coût. Qu’y gagne-t-on ?
On reconnaîtra sans difficulté un bénéfice certain de cette méthode dans la formulation d’un métarécit original concernant la tripartition et la bipolarisation de la vie politique française. « Sur longue période, résument les auteurs, on observe différentes formes de tripartition entre 1848 et 1910 (autour d’un triptyque composé de socialistes et radicaux-socialistes à gauche, de républicains modérés et opportunistes au centre et de conservateurs catholiques et monarchistes à droite), puis une bipolarisation gauche/droite de plus en plus marquée de 1910 à 1992, et finalement un retour graduel à une nouvelle forme de tripartition entre 1992 et 2022, alors que de multiples facteurs se combinaient pour affaiblir la bipolarisation (effritement de la gauche socialiste et communiste, montée en puissance de l’enjeu européen et écologique, émergence de nouveaux clivages migratoires et identitaires) ». La tripartition actuelle oppose un bloc social-écologiste, un ensemble libéral-progressiste et un pôle national-patriote. La thèse que souhaitent en outre démontrer les auteurs est que les progrès sociaux les plus importants ont été acquis dans les périodes de bipartition de la vie politique (durant laquelle les clivages territoriaux s’estompent) et que la tripartition actuelle est associée à des choix de politique économique défavorable aux plus modestes, en réalité une victoire de l’égoïsme bourgeois.
Comme il est impossible de rendre compte et de discuter de l’ensemble des données présentées dans cette somme, nous nous proposons ici de nous interroger sur trois points particuliers : la description des forces politiques, le découpage géographique en quatre types de territoires et enfin la stratégie de reconquête des classes populaires.
Les partis politiques et les conflits idéologiques
Un premier choix consiste dans la présentation des forces politiques. Même si les auteurs prennent le soin de préciser que « les conflits politiques sont toujours multidimensionnels et ne peuvent jamais se réduire à un axe unidirectionnel gauche/droite », ils défendent pourtant l’idée que celui-ci reste le plus pertinent et que le retour à une bipolarisation est le mieux à même de représenter les intérêts des classes populaires. « L’hypothèse centrale explorée dans ce livre est que la configuration bipolaire gauche/droite de type classiste est la plus favorable, du point de vue aussi bien du fonctionnement démocratique que du développement socio-économique ». Trois forces politiques se distinguent à travers l’histoire : socialisme, libéralisme, nationalisme et permettent selon les auteurs de rendre compte de la « dizaine de nuances politiques significatives [répertoriées] lors de la plupart des scrutins législatifs qui se sont déroulés entre 1848 et 2022 ». La pertinence de ces catégories est justifiée à partir de leur positionnement par rapport à la question sociale. C’est celle-ci, en effet, qui, tout au long du livre, émerge comme la véritable variable explicative du vote, bien que de longs chapitres très documentés soient consacrés à l’éducation, aux identifications religieuses et à la géographie.
Cette prédominance de la question sociale explique la mise à l’écart des enjeux proprement démocratiques du conflit politique français depuis 1789, c’est-à-dire le conflit sur la légitimité même du système démocratique. C’est d’ailleurs cohérent avec la décision de ne pas inclure la catégorie des extrêmes (extrême gauche et extrême droite) dans la description des forces politiques nationales, justifiée d’un trait rapide (« il n’existe quasiment aucun acteur politique choisissant de se désigner comme extrême »). Dans la typologie de l’ouvrage, cela signifie que l’extrême-droite est assimilée à la « droite nationale-patriote ». Deux choix théoriques importants sont donc assumés. Le premier consiste à considérer qu’on peut retracer deux siècles de vie politique française en tenant pour marginal le débat sur la forme politique elle-même, c’est-à-dire les institutions mais aussi, plus fondamentalement, la source de la légitimité démocratique, ce que la droite monarchiste et catholique, contre-révolutionnaire, ne pouvait admettre, pas davantage d’ailleurs que les forces socialistes révolutionnaires de la fin du XIXe (puis communistes) qui considéraient la fin de la République comme un préalable et refusaient la « compromission » avec les forces républicaines bourgeoises.
En apparence, les partis d’extrême-droite, en s’installant durablement dans la vie politique, en acceptent fondamentalement les règles du jeu et ne contestent donc plus le régime républicain en tant que tel. Les auteurs prennent acte de ce ralliement au système électif : « Quelles que soient les insatisfactions générées par le système institutionnel en place, aucun mouvement politique de premier plan ne propose sérieusement de remettre en cause le principe électoral lui-même et d’en revenir à un régime autoritaire ou dynastique ». Or, ce ralliement parfait de l’extrême droite à la démocratie est loin d’être démontré. Il suffit d’observer la manière dont les régimes néo-autoritaires s’y prennent pour limiter la régularité du jeu électoral dans des pays membres de l’UE comme la Hongrie ou la Pologne ou de se souvenir des tentatives de coup émeutier à Washington et à Brasilia… Certes, le Rassemblement national joue la carte de la « normalisation » et profite de ses succès électoraux. Pour autant, la simple lecture de leur programme invite à la prudence. La contestation des principes démocratiques y est toujours aussi virulente à travers la mise en cause de la séparation des pouvoirs, d’institutions garantes de la démocratie comme le Conseil constitutionnel et des règles fondamentales de l’Etat de droit. Le conflit idéologique, en particulier sur la souveraineté, est omniprésent dans ses prises de position. La réalisation de son programme, y compris son programme économique et social, repose entièrement sur un prétendu « rétablissement » de la souveraineté et de l’intérêt national conduisant explicitement une remise en cause de la position de la France comme une démocratie ouverte, européenne, engagée dans un système international multilatéral. Les conflits proprement idéologiques n’ont donc pas disparu. On peut même soutenir qu’ils sont redevenus tellement prégnants que des courants politiques qui semblaient acquis aux principes essentiels de la démocratie libérale, comme les conservateurs par exemple, semblent prêts à y renoncer en raison de ce qu’ils perçoivent comme la pression de leur électorat tenté par le basculement à l’extrême droite. On peut comprendre l’effort volontariste, qui est sans doute celui des auteurs, pour remettre la question sociale au centre du débat politique. Mais il ne doit pas pour autant occulter une part essentielle de la manière idéologique (ou proprement politique) dont le « conflit politique » s’organise actuellement – puisque tel est l’objet du livre.
Les classes géo-sociales
Un deuxième choix structurant concerne la manière de rendre compte du vote. Pour bénéficier de données cohérentes sur la longue durée, l’enquête repose sur les données électorales par communes. Les caractéristiques socio-économiques étudiées sont donc celles de la commune et non celles des électeurs. Les auteurs reconnaissent que cela peut constituer un problème méthodologique dans la mesure où ce sont des moyennes qui sont observées et non des données individuelles. C’est pourquoi la catégorie pertinente retenue pour l’analyse est celle de « classe géo-sociale » qui, arguent les auteurs, n’est pas réductrice dans la mesure où elle permet d’intégrer la multiplicité de processus économiques et de facteurs sociaux qui entrent en interaction pour caractériser finalement la situation socio-économique des individus. Nous ne traiterons pas ce point de méthode ici (discuté par ailleurs), afin de nous concentrer sur l’étape ultérieure du raisonnement.
Les caractéristiques de classes géo-sociales sont appréhendées à l’échelle de la commune, dont le nombre n’a guère bougé dans la longue durée (de 37 000 au début du XIXe siècle à 35 000 actuellement), c’est-à-dire à une échelle assez fine. Mais, pour les besoins de la présentation, les auteurs décident de regrouper les communes en quatre grandes catégories d’habitat, dans une construction assez contre-intuitive. Ils retiennent en effet comme catégories pertinentes « les villages, les bourgs, les banlieues et les métropoles », quatre ensembles assez équilibrés d’après eux en 2022 : « 12 millions d’habitants dans les villages, 22 millions dans les bourgs, 21 millions dans les banlieues et 11 millions dans les métropoles ». En outre, ils proposent de considérer que les villages et les bourgs représentent « le monde rural », c’est-à-dire la moitié de la population française, l’autre moitié étant « le monde urbain ». Au terme de ce « travail » sur les catégories, on obtient un « paysage globalement stabilisé » opposant monde rural et monde urbain comme deux moitiés à peu près équivalentes de la France en 2022.
Cette reconstruction est toutefois fort éloignée des catégories reconnues. Selon l’Insee, le monde rural regroupe en effet, d’après la nouvelle nomenclature adoptée en 2020, un tiers de la population française. Mais 80% de ces « ruraux » vivent en réalité dans la couronne périurbaine d’un pôle urbain. Selon un autre mode de calcul, le monde rural entendu au sens de l’ancienne définition de l’INSEE (commune de moins de 2000 habitants) compte pour 18% de la population. Ou encore, si l’on compte les espaces ruraux comme les espaces situés hors de l’aire d’attraction d’une ville (autre définition possible), ils ne représentent alors que 6% de la population. Sans même mentionner l’idée selon laquelle, pour nombre de géographes, nous sommes dans une réalité d’« urbain généralisé » où le monde rural ne subsiste que dans nos représentations affectives nostalgiques. Dans tous les cas, considérer que la moitié de la population française est « rurale » est un choix qui surévalue très largement la réalité rurale en France aujourd’hui. Symétriquement, la réalité urbaine est très largement sous-évaluée. Quant aux métropoles, elles rassemblent pour l’INSEE un tiers des Français et non un quart.
Cette distorsion est peut-être le prix à payer pour rendre des données comparables sur la longue durée. Mais elle conduit clairement à déformer la réalité démographique française en surestimant très largement le monde rural, en minimisant la réalité métropolitaine et en faisant comme si les spécificités de Paris et de la région parisienne (qui ressortent de toutes les analyses spatiales) ne devaient pas être prises en considération. Dans la couronne parisienne, les auteurs sont amenés à faire entrer environ 400 communes dans la catégorie « banlieue » dès 1789, alors que celles-ci appartenaient au monde rural au XVIIIe : quand il voulait fuir la ville pour retrouver la nature, Jean-Jacques Rousseau se promenait à la campagne à… Belleville, aujourd’hui une des zones urbaines les plus denses d’Europe… L’opération qui permet d’arriver à ce résultat consiste à oublier simplement le phénomène territorial prédominant sur la longue durée : la périurbanisation. Or, ce phénomène de transformation des espaces ruraux sous l’influence de l’extension urbaine brouille depuis longtemps les catégories de ville et de campagne. C’est dans la transformation territoriale et l’entre-deux, ni ville ni campagne, que notre géographie a changé. Le livre affirme que la « polarisation » territoriale et même une « très forte ségrégation résidentielle caractérisant la structure de l’habitat en général » est à l’œuvre alors que les espaces de plus forte mixité, les métropoles, sont délibérément sous-estimés. Décrire des villages et des bourgs ne permet absolument pas de comprendre les réalités des habitants des espaces périurbains, de leurs difficultés sociales, de leurs aspirations, des inégalités qu’ils vivent, et probablement pas non plus leurs profils politiques. Sans doute l’oubli de ce monde périurbain est-il cohérent avec une autre grande absence (dans le chapitre intitulé « Une marche limitée et tumultueuse vers l’égalité »), celle des classes moyennes, dont l’émergence et les mutations sont tout de même un phénomène important des deux derniers siècles, notamment dans la consolidation des institutions démocratiques. Les espaces périurbains sont justement caractéristiques d’une aspiration des classes moyennes au logement individuel et à un mode de vie particulier de « la ville à la campagne ». On comprend dès lors comment ce double mouvement conduit à un schéma politique réducteur qui, après avoir éliminé les classes moyennes et les espaces périurbains, oppose les pauvres ruraux aux riches urbains et regrette que, malgré leurs intérêts économiques convergents, les pauvres des bourgs et les pauvres des banlieues n’unissent pas leurs forces pour porter les partis de gauche au pouvoir (objet du chapitre 13, à partir de la page 728).
La reconquête électorale
L’analyse de la dynamique en cours, celle qui peut avoir un impact sur les prochaines évolutions politiques, identifie un retour à la tripartition (depuis 1992) mais espère un retour à la bipolarisation. La description du mouvement d’émergence de la tripartition hésite sur deux points. Elle considère d’une part qu’elle « émerge » en 2022 mais qu’elle a « commencé » en 1992. D’autre part, l’étude se concentre sur les élections législatives, puisqu’elles permettent de s’inscrire dans la longue durée, mais considère que la date charnière pour notre nouveau paysage politique est liée à un référendum, celui portant sur les enjeux européens en 1992 (référendum européen sur le traité de Maastricht) préfigurant la coalition des « électeurs socialement privilégiés » qui porteront ensuite Emmanuel Macron au pouvoir. Un point essentiel ici concerne le statut accordé à la montée du Front national à partir de 1986 et à son rôle dans la tripartition qui semble caractériser la période. En effet, la principale force politique ayant bousculé la bipartition et même construit une grande partie de son message politique sur le rejet de l’alternance entre la gauche et la droite (« UMPS ») est en réalité le Front national, bien avant En marche. Or, comme nous l’avons vu plus haut, l’extrême droite n’est pas considérée comme une force distincte de la droite nationale dans la typologie construite par l’ouvrage. Quel est donc précisément son statut ? Cette question nous conduit à l’intersection des deux premiers sujets : la caractérisation des forces politiques et le choix d’une géographie marquée par le clivage rural/urbain. En effet, le phénomène majeur à expliquer pour les auteurs est le passage, entre l’émergence du vote FN en 1986 et sa confirmation lors des législatives de 2017 et 2022, d’un vote FN concentré dans les banlieues et métropoles à un vote RN principalement établi dans les villages et les bourgs (selon la typologie des auteurs). Comment expliquer cette inversion ? Par le recul de la motivation xénophobe des électeurs d’extrême-droite, qui votaient par rejet des étrangers vivant près d’eux dans les banlieues et métropoles dans les années 1980 et qui seraient désormais plutôt séduits par un discours stigmatisant l’assistanat en général et qui accompagnerait leur modeste et laborieuse progression sociale dans le monde rural notamment pavillonnaire.
La typologie territoriale privilégiant la division ville/campagne et la mise en valeur de clivages entre « classes géo-sociales » débouche sur la description originale de deux profils électoraux opposés : les « sociaux diplômés » (p. 555-564) et les « petits moyens » (p. 582-594). Les « sociaux diplômés » sont « les personnes ayant les revenus les moins élevés parmi les diplômés du supérieur » qui occupent des emplois dans le secteur social (santé et éducation) et la fonction publique. Ils accordent leur vote plutôt à la gauche et représentent, dans le classement des auteurs, les classes populaires urbaines. A l’opposé les « petits moyens » n’ont pas mené d’études supérieures, occupent un emploi plutôt d’ouvrier ou d’indépendant dans les espaces « ruraux » et misent particulièrement sur l’accès à la propriété. Ils valorisent les trajectoires de réussite personnelle, le mérite et l’effort, dont l’accès à la propriété est une sorte de confirmation et de couronnement. Méfiants vis-à-vis des politiques sociales de gauche, vues comme indifférentes au mérite personnel (voire complaisantes avec les « assistés »), mais distantes de la droite conservatrice assimilées aux classes urbaines privilégiées, ces « petits moyens », intermédiaires entre les classes populaires et classes moyennes, ont porté la progression récente du Rassemblement national depuis son inflexion « sociale ». Ce sont les classes modestes du monde rural. Cette épure donne l’équation politique à résoudre à partir de « la nouvelle division politique entre les classes peu diplômées mais largement propriétaires du monde rural et les classes diplômées mais locataires du monde urbain ». Quelle alliance entre ces deux classes sociales ? Quel socle programmatique pour les convaincre et les réunir ?
L’ouvrage aborde alors la prospective stratégique. Pour les auteurs, la tripartition actuelle est instable et néfaste puisqu’elle favorise les intérêts égoïstes (punchline : le vote Macron est « le plus bourgeois de l’histoire », comme l’ont retenu nombre d’organes de presse en rendant compte du livre). Un retour au bipartisme est à la fois désirable (parce qu’il permet l’alternance politique) et probable puisque le bloc libéral-progressiste repose sur une base sociale trop étroite. Mais deux scénarios sont possibles : soit un nouveau clivage opposant les sociaux-écologistes à un bloc libéral-national, soit la confrontation d’un bloc libéral-progressiste à un bloc national-social. Le premier scénario suppose un élargissement du bloc social-écologique. Mais comment pourrait-il convaincre les électeurs populaires « ruraux » ou leurs voisins abstentionnistes ? Où sont les intérêts communs des pauvres urbains et des « abandonnés » des campagnes ? La stratégie de reconquête du vote populaire rural proposé par le livre repose sur « un plan d’ensemble de rattrapage des services publics à l’échelle de tous les territoires » pour répondre au sentiment d’« abandon » qui prévaudrait dans les villages et les bourgs. Mais il semble y avoir ici un quiproquo sur le sujet du « recul » des services publics, qui assimile la réorganisation territoriale de l’offre en raison de l’urbanisation massive à un retrait de l’Etat social. C’est un fait que les grandes structures hospitalières sont installées « en ville » et non « à la campagne » et que les lignes de TGV relient des métropoles et non des bourgs (p. 743). Mais cela n’illustre aucunement un recul des services publics, plutôt une difficulté à adapter, pour certains services publics, une offre homogène dans des situations territoriales qui ne le sont pas. Les Français ont beaucoup bougé en deux siècles et les services publics les ont suivis. Mais c’est ce que masque la description territoriale (défendue par le livre) en quatre ensembles à peu près équilibrés en taille, et marqués par la summa divisio urbain/rural. La répartition des dépenses publiques ne peut que paraître injuste tant qu’on se donne une représentation faussée de la géographie nationale.
En complément, puisque le vote RN « rural » est fortement corrélé à la petite propriété individuelle, le bloc social-écologique devrait prendre la défense de l’accession individuelle à la propriété en dépassant la contradiction, aujourd’hui néanmoins insoluble, entre les priorités écologiques de limitation de l’étalement urbain (politiquement important pour les « sociaux-écologistes ») et les aspirations des « petits moyens » à vivre en pavillon. L’alliance espérée des écolos diplômés urbains et des petits propriétaires ruraux supposera un intense effort programmatique… Elle semble pourtant réalisable aux auteurs dans la mesure où elle s’est déjà produite lors de la première bipolarisation gauche/droite qui s’est mise en place à partir de 1910, quand les clivages territoriaux opposant les ruraux aux urbains ont reculé et que les clivages sociaux ont pris le dessus. C’est ainsi qu’une alliance des milieux populaires par-delà le partage territorial (urbains/ruraux) a pu s’accomplir.
L’autre scénario de retour à la bipartition politique verrait le bloc national-patriote mené par le RN absorber la droite conservatrice. C’est pourquoi le RN n’est pas considéré comme une « troisième force », comme il a pu l’être dans la longue histoire de l’extrême-droite française, mais comme l’actuel centre de gravité de la droite et le noyau de sa transformation en bloc « social-national ». Dans ce scénario, il faut imaginer le RN capable d’élargir sa base populaire en s’adressant aux abstentionnistes des villes et en développant des éléments de programme capables de séduire la gauche populaire urbaine. Etant donné la logique de tension et de stigmatisation qui caractérise toujours le discours du RN, cette possibilité d’élargissement semble tout de même limitée. En outre, pour les auteurs, la perspective d’augmenter les impôts, seul moyen crédible de lutter contre les inégalités socio-territoriales et de séduire les électeurs urbains modestes, est exclue de l’horizon programmatique de l’extrême-droite, ce qui rend l’ensemble de ce scénario peu crédible. Au final, le retour à la bipartition opposant la gauche et la droite, c’est-à-dire le bloc social-écologique et le bloc libéral-national paraît, au terme de ce long parcours, le plus souhaitable et le plus vraisemblable…
Cet ouvrage, qui a le mérite de proposer des données inédites surabondantes et d’expliciter l’ensemble de ses partis pris et de ses arguments, suscite une large discussion. La thèse défendue par le livre est que la lutte contre les inégalités sociales n’est pas aussi centrale qu’elle devrait l’être dans notre vie politique du fait d’une tripartition de l’offre partisane qui marginalise la voix des classes populaires en les divisant. Cependant la description de ces classes populaires et de leurs difficultés à partir de leur situation territoriale parait trop schématique pour la période contemporaine, où les conflits opposeraient au bout du compte des catégories binaires riches/pauvres, villes/campagnes. La longue durée postule une stabilité géographique locale alors que les Français n’ont cessé de bouger en deux siècles et de transformer leur rapport à l’espace (modes de vie, mobilité, accès à la propriété…). Elle construit une géographie nationale qui paraît artificielle, reposant sur des catégories anachroniques (bourgs), surévaluées (campagnes), sous-estimées (métropoles) ou négligées (région parisienne, espaces périurbains).
Sur la base d’un diagnostic fragile, la stratégie politique paraît hasardeuse. On ne comprend pas bien comment on passe de la masse de données, exposée à travers force tableaux, graphiques et cartes, à des préconisations stratégiques visant des profils géo-sociaux extrêmement variés, ramenés à quelques situations type. La France en quatre-quarts est sans doute une reconstitution élégante sur la longue durée mais elle conduit à fausser la perception des territoires et des attentes des électeurs vis-à-vis des inégalités d’accès aux services publics ou des opportunités d’emploi. Elle conduit également à minimiser la réalité de la mixité urbaine et périurbaine, et par conséquent à manquer la cible des électeurs auxquels des forces progressistes devraient s’adresser pour contrer les logiques de stigmatisation développées par l’extrême-droite.