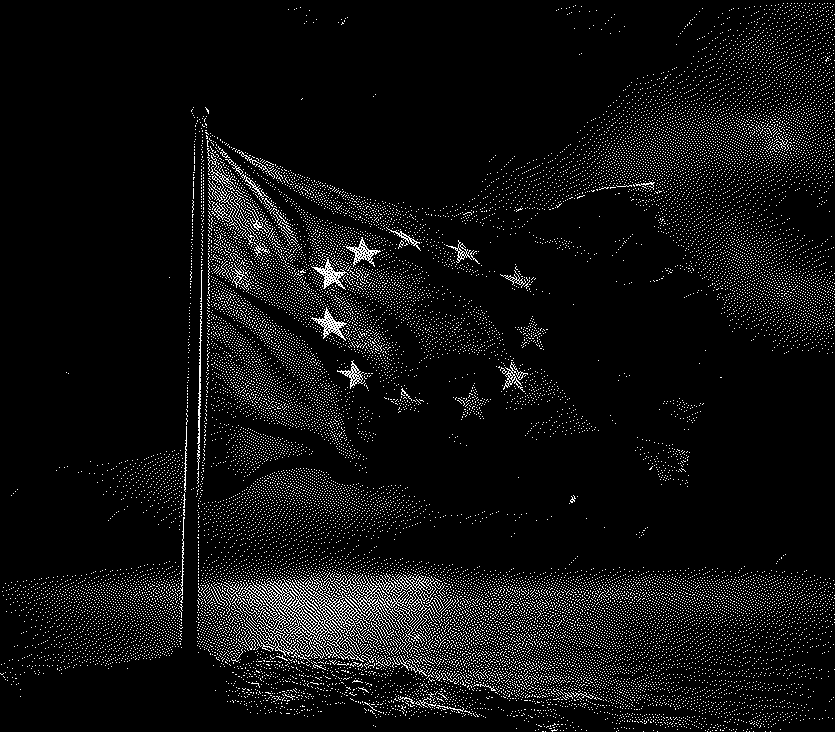Il y a parfois des articles qu’on préfèrerait ne pas écrire quand on est un proeuropéen convaincu. Celui-ci en est un puisqu’il s’agit d’expliquer pourquoi l’avenir de l’Union Européenne parait sérieusement compromis par une conjonction de menaces internes et externes. Mais comme le disait Antonio Gramsci, il faut savoir allier le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté : seule une compréhension précise des difficultés qui nous attendent peut en effet permettre de les surmonter.
Les évènements des derniers mois semblent pourtant avoir conforté l’Union Européenne et lui ouvrir un avenir prometteur. Face à la pandémie de COVID-19, passé un cafouillage initial compréhensible compte tenu de la nature inédite de l’évènement, la réaction des institutions européennes a été plutôt à la hauteur. Alors que l’Union n’a aucune compétence en matière de santé, l’achat en commun de vaccins, monté en un temps record, a permis d’atteindre en quelques mois seulement une couverture vaccinale qui a permis le retour à la normale dans la vie sociale et économique. A cette occasion, l’Union Européenne a également brisé un tabou essentiel en s’endettant pour la première fois en commun à un niveau substantiel, 750 milliards d’euros, pour amortir les conséquences économiques et sociales de la pandémie tout en accélérant les transitions énergétiques et numériques. Cette initiative, impensable quelques mois auparavant, a finalement été quasi unanimement saluée.
De même, face à la l’invasion de l’Ukraine, l’Union Européenne a été capable de se passer en moins d’un an de quasiment tout le gaz, le pétrole et le charbon russes dont son économie dépendait pourtant très fortement. Et cela sans subir les ruptures d’approvisionnement énergétique qu’on pouvait légitimement redouter au début du conflit. L’Union a pu aussi organiser une riposte vigoureuse en termes de sanctions et de soutien à l’Ukraine, malgré le puissant frein que constitue la règle de l’unanimité en matière de politique étrangère. Là aussi l’Union a brisé des tabous en fournissant une assistance militaire importante à un pays en guerre et en entraînant massivement les soldats ukrainiens. Elle a même pour la première fois mis en place un mécanisme d’achat en commun de munitions pour venir en aide à l’Ukraine tout en reconstituant les stocks européens. Bref, contrairement à ce qu’escomptait Vladimir Poutine, loin de se diviser et d’être paralysée, l’UE a fait face sans faiblir.
On dit toujours que c’est dans les crises que l’intégration européenne progresse. Ces dernières années ont confirmé cet adage. Dans un monde devenu plus incertain et manifestement plus hostile, l’europhobie a reculé et la « sortie de l’Europe » ne tente plus grand monde. Même Marine Le Pen ou Giorgia Meloni ont abandonné ce cheval de bataille.
Pourquoi dans ces conditions s’inquiéter de l’avenir de la construction européenne ? Parce que de nombreux nuages s’accumulent dans trois directions à la fois : sur le plan de la dynamique politique interne de l’Union, sur le plan géopolitique et enfin sur le plan économique. Et il semble aujourd’hui improbable que l’Europe puisse faire face efficacement à cette conjonction.
1. Une dynamique interne inquiétante
Nous assistons tout d’abord à une droitisation générale de l’opinion européenne. Partout la social-démocratie recule et les écologistes marquent le pas. Ce mouvement se double d’un phénomène tout aussi inquiétant : les digues ont cédé entre la droite traditionnelle et l’extrême-droite et la droite classique préfère désormais le plus souvent gouverner avec l’extrême droite plutôt qu’avec le centre gauche quand elle est amenée à devoir choisir.
L’extrême droite est ainsi au pouvoir ou associée au pouvoir en Suède, en Finlande, en Lettonie, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie et en Italie et elle le sera aussi probablement demain en Espagne. Le FPÖ domine le paysage politique autrichien et l’AfD est devenue le second parti allemand dans les sondages. Tandis qu’en France, la politique d’Emmanuel Macron et l’incapacité de la gauche à offrir une alternative crédible renforcent chaque jour le Rassemblement national.
Cette vague de fond de droitisation résulte largement des dégâts commis au sein des sociétés européennes par 40 ans de mondialisation dérégulée et de politiques européennes essentiellement guidées par un culte naïf de la concurrence et du libre-échange. Mais malheureusement cette droitisation n’aide pas réellement à corriger les méfaits du néolibéralisme puisqu’elle freine au contraire les progrès indispensables de l’intégration européenne en matière de droits sociaux, de transition écologique, de budget et d’impôts communs. L’extrême droite ne prône certes plus généralement la fin de l’Union Européenne mais elle reste bien déterminée à en changer la nature et les politiques. Cette droitisation aggrave également, nous y reviendrons, les relations de l’Europe avec ce qu’on appelle désormais le « Sud Global », enjeu essentiel de la période, par les politiques xénophobes qu’elle impulse. Même si elle n’y est pas parvenue jusqu’ici, il n’est pas exclu que cette dynamique conduise aussi prochainement à bloquer ou tout au moins à limiter fortement l’aide européenne apportée à l’Ukraine.
Face à cela, l’Allemagne et la France sont les deux principaux pays dont les gouvernements restent théoriquement attachés à faire progresser l’intégration européenne. Mais en Allemagne, la coalition au pouvoir est extrêmement fragile et en chute libre dans les enquêtes d’opinion. De plus, elle est verrouillée par la présence en son sein du petit parti libéral FDP, désormais lui aussi proche de l’extrême droite, et très hostile à tout progrès en matière de solidarité européenne, de social ou d’environnement. Quant à la droite allemande, les héritiers d’Angela Merkel ont été battus au sein de la CDU au profit d’ultralibéraux qui ne veulent pas non plus entendre parler de solidarité européenne.
Du côté de la France, Emmanuel Macron n’a plus de majorité à l’Assemblée nationale et il est à la merci des Républicains, devenus eux aussi très proches de l’extrême droite. Ceux-ci revendiquent même désormais de s’affranchir des Traités européens. Et de toute façon, au-delà de ses grands discours, Emmanuel Macron n’a guère été en mesure de faire avancer des dossiers européens concrets du fait de son incapacité à construire des coalitions. En pratique, son gouvernement a plutôt cherché d’ailleurs à freiner ou à bloquer plusieurs projets européens sous la pression des lobbies industriels ou agricoles.
Dans ce contexte, on ne voit pas bien d’où, de quelles forces politiques et de quels pays, pourrait partir une impulsion vers davantage d’intégration européenne, capable de corriger les multiples dysfonctionnements hérités de la période néolibérale initiée par l’acte unique de 1986.
Pourtant, avec la guerre contre l’Ukraine, la question de l’élargissement de l’Union Européenne à la Moldavie et à l’Ukraine ainsi qu’à la plupart des pays des Balkans occidentaux se pose de façon urgente désormais. La situation géopolitique oblige en effet à les intégrer rapidement à l’Union. A 27, les institutions européennes actuelles sont déjà largement dysfonctionnelles, mais à plus de 30, leur fonctionnement serait à coup sûr quasiment paralysé. La question de la refonte des Traités se pose donc. A supposer qu’on parvienne à enclencher ce processus, il est difficile d’imaginer, dans le contexte interne actuel de l’Europe, qu’il puisse déboucher sur des progrès substantiels en matière de solidarité, d’écologie et de démocratie.
2. Un contexte géopolitique dégradé
La guerre contre l’Ukraine a fortement resserré les liens entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. Après l’ère Trump, la vigueur de l’engagement américain aux côtés des Ukrainiens a été une divine surprise pour les Européens. Sans nos alliés d’Outre-Atlantique, il ne fait guère de doute en effet que Vladimir Poutine l’aurait déjà emporté en Ukraine.
Pour autant, l’avenir devrait être moins idyllique. Tout d’abord, l’épisode ukrainien n’a pas modifié la vision stratégique des Américains qui considèrent, toutes tendances politiques confondues, la Chine comme leur adversaire principal. Ils n’acceptent pas qu’elle soit devenue elle aussi une grande puissance et souhaitent lui contester ce statut. Et la concurrence politique interne aux Etats-Unis conduit à une surenchère permanente dans la confrontation avec la Chine.
Or l’Europe, et en particulier l’industrie allemande, dépendent très fortement du marché chinois. Marginalement présente dans le Pacifique, l’Europe n’a pas forcément les mêmes intérêts que les Etats-Unis : beaucoup d’Européens ne considèrent pas la Chine comme une menace directe même si des frictions existent. La plupart des Européens ne souhaitent pas en tout cas être embarqués dans une surenchère permanente pouvant conduire à une guerre avec la Chine. Ils espèrent au contraire plutôt, même si cet espoir est sans doute naïf, que ce pays puisse contribuer à amener Vladimir Poutine à se retirer d’Ukraine. Sur ce terrain les divergences d’intérêt et d’approche entre les Etats-Unis et l’Europe qui sont d’ores et déjà patentes risquent de s’aggraver à l’avenir.
Par ailleurs, le rapprochement entre l’Union Européenne et les Etats-Unis est étroitement lié à l’administration Biden. Or les dernières mid-terms ont montré s’il en était besoin que le pays reste divisé à 50/50. Si une administration républicaine devait succéder à celle de Joe Biden, même si ce président n’est pas Donald Trump, le soutien massif des Etats-Unis à l’Ukraine et leur implication dans l’OTAN pourraient être rapidement remis en cause. Et, pour des raisons notamment économiques sur lesquelles nous reviendrons, les Européens ne sont guère en mesure d’augmenter du jour au lendemain leurs capacités autonomes de défense. Sans l’aide américaine, la situation pourrait donc changer rapidement sur le front ukrainien et d’autres, comme la Turquie d’Erdogan, pourraient être tentés de tirer profit à leur tour de cette faiblesse européenne pour raviver leurs rêves d’empire.
Enfin, les stratégies mises en œuvre pour accélérer la transition énergétique en Europe, avec le Green Deal et le Fit for 55, et aux Etats-Unis avec l’Inflation Reduction Act (IRA), divergent radicalement et induisent, nous y reviendrons, une logique d’affrontement commercial entre les deux côtés de l’Atlantique. Sur tous ces terrains, les relations entre les Etats-Unis et l’Europe risquent donc fort de se dégrader dans les mois qui viennent.
Parallèlement, la guerre contre l’Ukraine a mis en lumière l’ampleur du fossé existant entre l’Occident, et donc l’Europe, et ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « Sud Global », même si ce terme recouvre en pratique des réalités très diverses et des intérêts souvent divergents. Bien que l’agression russe constitue manifestement une violation flagrante des principes de base de la Charte des Nations Unies dans une logique classiquement impérialiste et colonialiste, des pays du Sud importants ont refusé en effet de condamner la Russie aux Nations Unies. L’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Inde, le Sénégal et bien sûr la Chine ont préféré s’abstenir. Et surtout, très peu des pays de ce « Sud Global » se sont associés aux sanctions décidées par les Occidentaux, au point que leur efficacité en a été sérieusement affaiblie.
Le gouffre semble très large entre « the West » et « the rest » même si ce reste n’est pas non plus purement et simplement aligné sur Moscou. Aux reproches traditionnels contre l’Occident liés à la période coloniale, sont venus s’ajouter ceux liés aux autres initiatives malheureuses des Occidentaux au cours des dernières décennies. Avec bien sûr la guerre en Irak mais aussi a contrario l’abandon des Syriens. Du fait de leur incapacité à articuler une politique globale efficace au Sahel au-delà de la dimension sécuritaire, la France et l’Europe y ont aussi subi un échec cuisant. Celui-ci a nourri un puissant sentiment anti-français et anti-occidental dans toute la région. Ce sentiment est bien entendu alimenté par la propagande russe mais on aurait tort d’en sous-estimer la profondeur dans la population de la zone. A cela vient s’ajouter le reproche de double standard, ravivé notamment par la passivité des Occidentaux face aux exactions de plus en plus graves du gouvernement d’extrême droite en Israël.
Ces reproches ont été également dopés au cours de la dernière période par le sentiment qu’ont donné les Occidentaux de laisser tomber les pays du Sud face à l’épidémie de COVID-19 pour ne s’occuper que de leurs ressortissants, notamment dans la gestion des vaccins à l’échelle mondiale. A cela viennent aussi s’ajouter les difficultés récurrentes rencontrées dans les négociations climat pour que les Occidentaux acceptent de mettre la main à la poche afin d’aider les pays du Sud à s’adapter au changement climatique et à accélérer leur propre transition énergétique malgré la responsabilité historique évidente desdits pays Occidentaux dans l’existence de cette menace majeure.
Dans la mesure où sa domination relève de l’histoire ancienne et où elle n’assume plus aujourd’hui le rôle souvent perçu comme impérial que jouent les Etats-Unis, l’Europe pourrait en théorie espérer échapper plus aisément que nos alliés américains à cet opprobre et retisser des liens avec le « Sud Global ». Mais dans le contexte politique interne évoqué précédemment, l’Union Européenne n’est manifestement pas prête à faire le nécessaire pour y parvenir : elle se crispe plus que jamais dans une attitude de « forteresse Europe » sur le terrain des migrations, prête seulement à faire quelques exceptions pour piquer aux pays du Sud leurs médecins et leurs informaticiens, et elle n’est pas prête à accroitre son budget et donc l’effort qu’elle consacre à aider les pays en développement, en particulier sur les sujets de climat et d’énergie. Le Global Gateway, qui est censé être sa réponse aux Nouvelles routes de la soie chinoise est devenu un objet de dérision dans les pays du Sud : il ne s’agit que d’une coquille vide sur le plan du financement. Malgré ses beaux discours sur le multilatéralisme, l’Europe n’est pas davantage réellement en mesure de jouer un rôle moteur dans l’indispensable restructuration du système onusien pour y accroitre la place des pays du Sud. Cela impliquerait en effet qu’elle y perde des positions en s’y substituant à ses Etats membres ou encore en cédant la présidence du FMI à des pays du Sud. Un sujet sur lequel ses Etats membres, et notamment la France, bloquent.
Bref, entre l’unilatéralisme américain, ses divisions internes et les relations de plus en plus difficiles avec un « Sud Global » qui se tourne plus volontiers vers la Russie et la Chine, on ne voit pas bien pour l’instant comment l’Europe pourrait devenir véritablement « le troisième pôle » entre la Chine et les Etats-Unis qu’Emmanuel Macron appelle de ses vœux.
3. Des perspectives économiques difficiles
Cette dynamique interne inquiétante et ce contexte international dégradé sont encore renforcés par des perspectives économiques difficiles, celles-ci étant elles-mêmes étroitement liées à ce contexte intérieur et extérieur.
On voit mal tout d’abord comment la principale économie de l’Union Européenne, celle de l’Allemagne, ne pourrait pas être sévèrement et durablement affectée par la conjonction des tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et de la montée en puissance des véhicules électriques, segment sur lequel son industrie est très en retard, à la fois sur les constructeurs américains et sur les constructeurs chinois. Or c’est aujourd’hui cette industrie qui structure très largement toute la puissance industrielle et exportatrice allemande, y compris les secteurs amonts des machines, de la mécanique, de la chimie, de l’acier…
L’industrie allemande est entrée de ce fait durablement dans une zone de fortes turbulences. Elle en a certes déjà connu de nombreuses et elle a su à chaque fois rebondir en faisant preuve d’une résilience remarquable (liée notamment à la gouvernance participative imposée par la codétermination) mais cette fois la menace semble particulièrement sérieuse.
Cet affaiblissement prévisible du cœur industriel de l’Europe se combine aux effets du retard considérable accumulé dans tous les domaines de la haute technologie (économie des plateformes, intelligence artificielle, semi-conducteurs, technologies vertes, biotechs…) du fait de l’absence de politiques industrielles européennes souveraines. L’Union Européenne a pu malgré cela continuer à peser dans ces domaines grâce à ce qu’on appelle l’« effet Bruxelles », sa capacité à définir des normes qui s’imposent aux industriels du fait de la taille de son marché intérieur. Mais cet effet ne cesse de s’amenuiser au fur et à mesure que les marchés émergents prennent de l’ampleur et, à terme, il n’est de toute façon pas possible de demeurer un faiseur de normes sans maitriser soi-même les technologies concernées. Après quarante ans de politiques guidées essentiellement par le culte de la concurrence et du libre-échange, l’Europe est en voie de vassalisation technologique très avancée.
Sur ce terrain, la prise de conscience des faiblesses européennes et de leurs (lourdes) conséquences potentielles a beaucoup progressé ces dernières années, « grâce » notamment à l’épidémie de COVID-19. Pour autant, la réaction demeure très loin d’être à la hauteur des enjeux parce que ceux-ci impliqueraient d’accepter des transferts importants de souveraineté – des instances européennes devraient décider de soutenir telle ou telle filière – et la mise en commun de moyens significatifs pour ce faire. Or pour l’instant, la dynamique politique interne évoquée précédemment reste totalement bloquante sur ces deux aspects.
Des mesures ont certes été annoncées mais en réalité les moyens qui y sont associés demeurent insignifiants : aucun budget additionnel n’a été mobilisé, il s’agit toujours d’utiliser le reliquat non encore dépensé de l’opération Next Generation EU. Il n’a pas été politiquement possible en effet de renouveler cette émission de dette commune pour faire face à la guerre contre l’Ukraine et à ses conséquences malgré le défi considérable que cela représentait.
Et il n’y a à ce stade aucune raison de penser que la négociation du prochain cadre financier pluriannuel de l’Union post 2027 ne s’engagera pas sur les mêmes bases que d’habitude autour de la question : comment pourrait-on diminuer le budget communautaire ? Quant au débat sur les ressources propres de l’Union, il n’a pas progressé d’un iota depuis que le sujet avait été écarté en 2020 au moment de l’adoption du Next Generation EU.
Le seul domaine dans lequel des évolutions significatives semblent possibles à court terme est celui de la libéralisation de l’encadrement, jusqu’ici très strict, des aides versées aux entreprises par les Etats membres de l’Union. Mais à vrai dire, cette « solution » risque fort d’être pire que le mal. Dans ce contexte, en effet, les inégalités de situation financière entre Etats vont creuser davantage encore les écarts au sein de l’Union et aggraver les tensions internes. Cet effort national étant de toute façon inefficace au global du fait de sa dispersion et de l’absence de coordination suffisante à l’échelle européenne.
Pour ne rien arranger, la politique européenne de transition énergétique, le Green Deal et son ajustement avec le paquet législatif Fit for 55, à peine finalisés, semblent déjà condamnés du fait de l’Inflation Reduction Act américain. Pour accélérer la décarbonation de nos économies, les politiques publiques peuvent jouer sur plusieurs leviers. Les normes tout d’abord en imposant des conditions plus strictes pour la mise sur le marché de véhicules neufs, la construction ou la rénovation de logements… Cela n’implique pas directement les finances publiques mais ces normes ont néanmoins un impact économique majeur en renchérissant bien souvent le coût des produits qui y sont soumis.
Les Etats peuvent ensuite dissuader l’usage des énergies fossiles en en renchérissant le coût via un prix du carbone, le « carbon pricing » en anglais. Ils peuvent aussi à l’inverse encourager le développement des alternatives décarbonées en les subventionnant. Ces deux options sont équivalentes en termes économiques mais politiquement elles ne le sont pas du tout : il est bien entendu plus aisé de « vendre » des subventions que des taxes supplémentaires même s’il faut ensuite réussir à éviter une dérive des finances publiques.
Les politiques publiques de transition énergétique reposent toujours sur un mix de ces différentes options. Mais dans ce mix les dominantes diffèrent. En Europe, nous avons mis l’accent depuis le départ sur les normes et le prix du carbone. Les normes, c’est le métier de base de l’Union Européenne. Et le prix du carbone, c’est l’objet du système de quotas et d’échanges mis en place en 2009 auquel sont soumis les principaux émetteurs industriels.
Ce système vient d’être considérablement renforcé avec le paquet législatif Fit for 55 qui prévoit une extension de ces quotas aux acteurs qui vendent des énergies fossiles aux ménages pour le chauffage et les transports, et la suppression progressive des quotas gratuits alloués jusqu’ici aux entreprises. A quoi s’ajoute une baisse plus rapide du nombre de ces quotas alloués. Ces réformes ont d’ores et déjà multiplié par quatre le prix de la tonne de CO2 qui est passé de 20 Euros en 2020 à 80 Euros aujourd’hui.
Quant aux subventions, elles ont toujours été quasi inexistantes à l’échelle européenne et réservées à l’échelon national, l’Union Européenne s’efforçant d’en limiter l’usage au maximum. Une tendance que la crise de la zone euro avait beaucoup renforcée entre 2008 et 2015 en mettant les finances publiques de nombreux Etats, et particulièrement ceux du Sud de l’Europe, sous une très forte pression. Ce qui avait entraîné un coup d’arrêt durable à la transition énergétique en Europe, contribuant à lui faire perdre son leadership mondial dans ce domaine et à faire disparaître de nombreux acteurs européens, notamment dans le solaire.
Cette politique centrée avant tout sur des normes strictes et un prix du carbone élevé pose des problèmes importants de compétitivité coût pour l’industrie européenne. Elle était justifiée cependant par le fait que l’Union Européenne ne serait ainsi qu’à l’avant-garde d’un mouvement que les autres suivraient nécessairement en mettant eux aussi en place un prix du carbone, amené à converger à terme avec celui de l’Europe. Dans un tel contexte, l’Europe n’aurait fait que prendre de l’avance sur le mouvement global ce qui lui aurait donné au final un avantage compétitif malgré son désavantage initial.
Malheureusement ce n’est pas du tout ce qui est en train de se passer. L’option du carbon pricing reste toujours très peu retenue à l’échelle mondiale. Et avec l’Inflation Reduction Act, les Etats-Unis, le second émetteur mondial de gaz à effets de serre, sont en train d’imposer la voie inverse, celle des subventions au développement et à la mise en œuvre des technologies vertes.
Et ils le font à un niveau si massif, accompagné de strictes mesures protectionnistes sur la fabrication des produits concernés, que la menace est immédiate pour l’industrie européenne avec des annonces de transfert de productions et d’investissements qui se multiplient. Le paquet législatif Fit for 55 a certes prévu quelques éléments de réponse au dumping environnemental pratiqué par des acteurs extérieurs qui n’auraient pas de prix du carbone avec le Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Mais sa mise en œuvre effective, prévue en 2025, risque de se heurter à une forte opposition de nos principaux partenaires commerciaux et de ne concerner au final qu’une faible fraction de nos échanges.
Malheureusement, pour les raisons déjà évoquées, l’Union Européenne n’a pas d’alternatives. Nous avons réussi à nous mettre d’accord sur une politique de carbon pricing parce que, justement, celle-ci n’impliquait pas de dépenses publiques supplémentaires à l’échelle européenne alors qu’elle permettait au contraire d’espérer quelques rentrées additionnelles. L’Union Européenne n’a politiquement strictement aucun moyen pour l’instant d’entrer dans une course aux subventions à l’économie verte avec les Etats-Unis.
A cela viennent s’ajouter les difficultés rencontrées dans la réforme du Pacte de stabilité. Celui-ci, dont chacun reconnait désormais le caractère impraticable, est suspendu pour l’instant mais il doit théoriquement être rétabli l’an prochain, en 2024. La proposition de réforme présentée par la Commission Européenne n’offre que des marges de manœuvre supplémentaires très limitées aux Etats. Elle ne prend pas en compte en particulier la proposition de sortir des calculs de déficit les éléments liés aux investissements publics dans la transition écologique. Les possibilités d’améliorer cette proposition semble cependant très faibles, compte tenu en particulier de l’attitude rigide du ministre des Finances libéral du gouvernement allemand sur ce sujet, identitaire pour sa formation politique.
Par ailleurs, dans le contexte de la guerre contre l’Ukraine, les gouvernements européens sont amenés à accroitre sensiblement leurs dépenses militaires. Dans un cadre budgétaire toujours aussi rigide et avec un dumping fiscal intraeuropéen toujours aussi présent, cela risque fort de se traduire par une pression accrue à la baisse des dépenses pour le social, les services publics ou encore l’environnement. Quant à la banque centrale européenne, tant que l’inflation reste aux niveaux actuels, il est difficile d’espérer qu’elle adopte une politique monétaire plus accommodante.
Bref, dans de telles conditions, on ne voit pas comment l’Union Européenne pourrait engager l’effort d’investissement considérable qui serait indispensable pour à la fois rattraper son retard technologique et industriel et accélérer sa transition écologique. Il est délicat d’anticiper les effets qu’auront les difficultés économiques prévisibles de l’Europe sur l’Union, mais il parait raisonnable de considérer qu’elles risquent surtout d’accroitre encore les tensions internes.
Si ces éléments de diagnostic sont justes, il va donc falloir une forte dose d’« optimisme de la volonté » pour réussir à faire progresser quand même la construction européenne dans une direction plus écologique, solidaire et démocratique au cours des années qui viennent. On peut cependant espérer que l’avenir démentira ces sombres prévisions sur plusieurs points. Par ailleurs l’Europe et les Européens ont déjà montré que, dans l’adversité, ils étaient capables de sursauts qu’on pensait pourtant impossibles a priori.