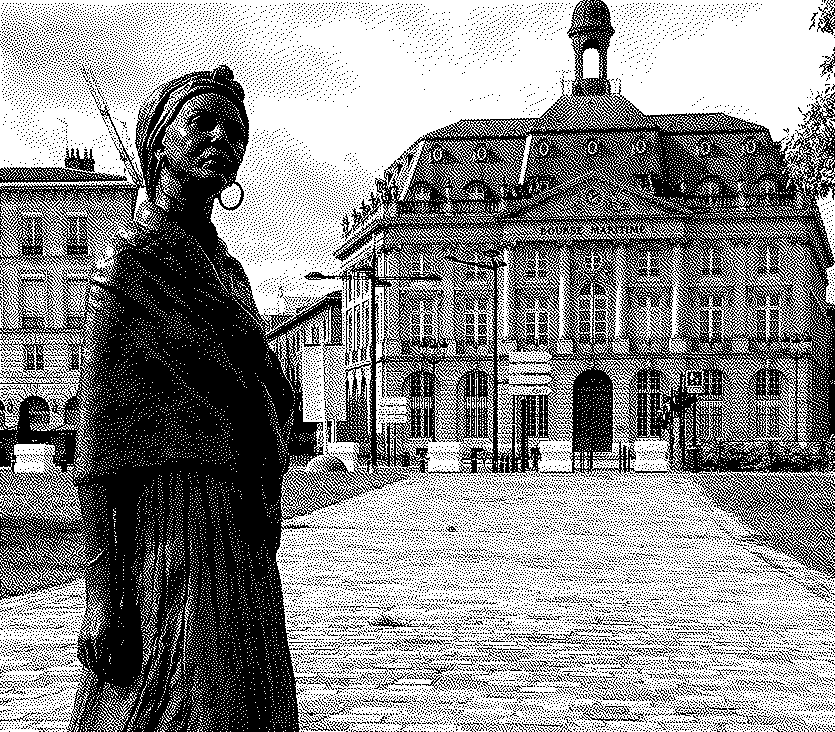La nomination surprise de Pap Ndiaye au ministère de l’Education nationale a suscité de nombreuses réactions politiques. L’extrême-droite a multiplié les messages alarmistes, y voyant une « provocation », signe d’une volonté de « déconstruction » de la France. Sans s’embarrasser de nuances, Marine Le Pen a synthétisé tous les reproches, dans une approximation à large spectre, en parlant du nouveau ministre comme d’un « indigéniste », promoteur du « racialisme » et du « wokisme ».
Cela revient à traiter Pap Ndiaye comme un militant, aveuglément attaché à une cause, installé dans une posture de revendication victimaire. Or, Pap Ndiaye est un universitaire et un chercheur, rare dans ses interventions publiques, prudent dans son expression, tout à l’opposé de la caricature qui s’est déversée dans les heures et le jours qui ont suivi sa nomination. Un de ses objets d’étude – la situation minoritaire des Noirs en France – le conduit à traiter en effet de sujets controversés comme la mémoire de l’esclavage ou les revendications identitaires, sans pour autant adopter les points de vue dont il traite en historien. Une confusion singulière s’est donc instaurée d’emblée, dans le contexte hautement politisé de la composition du nouveau gouvernement et du début de la campagne des élections législatives, entre les thèmes de recherche et les positions politiques, dont Pap Ndiaye, en historien avisé des controverses contemporaines, prend soin de se démarquer dans ses ouvrages. Trois grandes questions s’entremêlent confusément dans les interpellations adressées au nouveau ministre : quel usage politique peut-on faire aujourd’hui de la notion de « race » quand on veut lutter contre les discriminations ? Comment la mémoire de l’esclavage peut-elle être prise en compte dans les demandes de justice de minorités sociales en France ? En quoi les revendications de visibilité actuelles interpellent-elles l’universalisme républicain à la française ?
1. « Racialisme » ?
Que dit Pap Ndiaye dans son livre dont bien peu, parmi ses détracteurs, semblent avoir pris connaissance, même de manière sommaire ? Ouvrons donc le livre posé devant nous pour voir si l’on peut y trouver les positions identitaires et anti-françaises qu’on attribue au nouveau ministre. Comme son titre l’indique, la Condition noire se propose de décrire une situation sociale. Par le choix du sous-titre, « essai sur une minorité française », l’auteur prend une position à la fois originale et nuancée dans le débat scientifique et politique portant sur la place à accorder respectivement aux conditions sociales (l’appartenance à des classes sociales) et aux revendications identitaires. La volonté de décrire une « situation minoritaire » accompagne un déplacement du regard de l’historien des mobilisations antiracistes qui ont caractérisé les années 1980 et 1990 vers la prise de conscience des discriminations raciales qui s’est affirmée au cours des années 2000. Dès l’introduction de son livre, Pap Ndiaye se démarque explicitement des approches des « cultural studies » qui, centrées sur les identités collectives, développent une perspective « postcoloniale » au sens de demandes de reconnaissance. Il préfère pour sa part une « perspective historique et sociologique » prenant en compte les discriminations vécues au présent par des groupes se trouvant en situation minoritaire dans la société. Exit donc les sous-jacents « racialistes » soi-disant importés de son expérience américaine qu’il aurait fait passer en contrebande dans le débat scientifique français. Cela en dit long sur les amalgames et les automatismes de certains critiques qui ne peuvent s’empêcher d’associer mécaniquement l’évocation d’une minorité nationale avec des revendications identitaires potentiellement séparatistes.
Comment peut-on faire l’histoire des Noirs en France sans recourir aux notions d’identité ou de communauté ? Ce point est décisif car il explique la démarche de l’ouvrage. L’historien choisit le terme de « condition » parce qu’il désigne la situation sociale d’une minorité, « c’est-à-dire d’un groupe de personnes ayant en partage, nolens volens, l’expérience sociale d’être généralement considérées comme noires
». Comme le rappelle l’historien, la « race » n’existe pas, ce n’est pas une notion scientifique, ce n’est pas une catégorie valable pour décrire des groupes. Pour autant, il ne faut pas en déduire a contrario que la société n’est faite que d’expériences individuelles et que les représentations collectives n’existent pas. L’énigme pour l’historien est en effet la suivante : comment expliquer que les « races » existent dans les imaginaires et « ont donc survécu à leur invalidation scientifique
»? Ce qui intéresse l’historien, ce n’est pas une identité noire mais cette expérience partagée de l’hétéroperception : « ils sont noirs parce qu’on les tient pour tels ». Mais cette expérience est elle-même relative : « selon les moments et les lieux, elle n’inclut pas les mêmes personnes. Cela n’implique pas non plus que les personnes concernées se définissent nécessairement comme telles
».
Le fait d’être vu comme noir est d’autant plus significatif – là est le nœud du sujet – que cette perception s’accompagne souvent, implicitement ou explicitement, d’une réticence à les considérer comme des Français à part entière. Cette expérience de « l’identité française contestée » est le point fédérateur et difficilement compréhensible par celui qui n’en a pas fait l’expérience directe et répétée. D’ailleurs, pourquoi insiste-t-on autant sur le séjour américain du ministre ? Pourquoi écrit-on à son propos qu’il est « français d’origine sénégalaise » ? Choisie ou subie, l’appartenance à une catégorie peut encore prendre deux formes, développe Pap Ndiaye, reprenant des catégories de l’anthropologue Clifford Geertz. On peut distinguer une « identité épaisse », qui renvoie à une culture commune, une langue, des traits d’appartenance forts, et une « identité fine » qui délimite un groupe « qui n’a en commun qu’une expérience de l’identité prescrite, celle de Noir en l’occurrence, qui a été historiquement associée à des expériences de domination subie, et qui peut s’accompagner de la conscience du partage de cette expérience ».
On voit donc la série de déplacements opérés par ce livre : prendre en compte les discriminations (et pas seulement le racisme), faire l’histoire d’une minorité (et non d’une communauté), observer une expérience commune (et non une identité), accepter que « l’analyse des rapports de classe ne suffit pas, à elle seule, à rendre compte de toutes les formes de domination ». Il faut donc constater que l’avalanche de reproches adressés au nouveau ministre sont, comme on dit à l’Education nationale, hors sujet : il suffit d’ouvrir son livre pour constater qu’il n’adopte pas les positions « racialistes » ou « indigénistes » et, encore mieux, qu’il défend et développe une vision alternative, permettant de rendre compte d’une expérience sociale partagée sans tomber dans un militantisme communautaire, une revendication identitaire ou un essentialisme noir.
On est donc, par exemple, consterné de lire sous la plume d’un chercheur comme Pierre-André Taguieff (sous la forme, il est vrai, de propos rapportés dans la presse) que Pap Ndiaye serait un « extrémiste à visage modéré » militant pour « prendre au sérieux la notion de race, la redéfinir et analyser la réalité sociale à travers son prisme pour déconstruire le ″privilège blanc″ », une expression par ailleurs explicitement rejetée par Pap Ndiaye dans son livre et ses interventions publiques.
2. « Indigénisme décolonial » ?
Qu’en est-il de la position de l’auteur vis-à-vis de l’histoire française ? Peut-on dire que Pap Ndiaye promeut une pensée « décoloniale » ? Le terme lui-même n’apparaît pas dans son livre. Sa définition reste incertaine et discutée mais le mot semble désigner la critique d’une hégémonie occidentale poursuivie sous d’autres formes depuis la colonisation. Plus simplement, et en préalable, la question posée par l’historien est de savoir si l’on peut faire l’histoire des populations noires de France. L’exercice constitue le troisième chapitre de La Condition noire et se présente comme lacunaire tant on manque de sources documentaires, de monographies et de travaux d’enquête. C’est pourquoi l’essai en appelle à de futurs travaux de recherche qui viendront combler ces lacunes de notre histoire nationale. Qu’une telle démarche de connaissance puisse être stigmatisée comme une « dérive américaine » ou réduite à « un simple positionnement tactique » laisse songeur sur la relation au savoir, utilitaire ou cynique, des militants politiques qui s’expriment contre le travail de Pap Ndiaye.
L’historien aggrave d’ailleurs probablement son cas en constatant qu’on ne peut faire sur ce sujet qu’une « histoire transnationale » dans une « perspective atlantique », et non nationale, des Noirs en France puisque deux grands moments historiques conduisent à nouer la relation entre le territoire hexagonal et les populations noires. Tout d’abord, la traite négrière, bien sûr, et sa relation triangulaire entre le continent africain, les caraïbes et les grands ports français. Les deux conflits mondiaux ensuite, avec l’arrivée sur le sol national des tirailleurs dits « sénégalais » et des troupes américaines qui vont profondément marquer les mouvements de lutte pour l’émancipation et l’indépendance en Afrique d’une part, et les luttes contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, d’autre part. L’enquête historique consacre ensuite de longs développements aux migrations de travail depuis l’après-guerre.
Là encore, il ne s’agit pas pour l’historien, sans masquer les difficultés des migrations, de construire des équivalences anachroniques entre exploitation coloniale et les situations de domination sociale vécues par les travailleurs et travailleuses immigrées. Il ne reprend d’ailleurs pas le terme d’« indigènes » utilisé aujourd’hui dans des cercles militants et il s’en explique. Ce terme ne sert pas seulement à désigner « les personnes issues des anciens mondes coloniaux africains ». Il vise également à caractériser une situation de domination sociale vécue par les populations noires, en mettant en parallèle l’indigénat et des situations contemporaines de contrôle social. « Mais ce terme peut difficilement servir de point d’appui robuste à la description des situations sociales contemporaines, puisqu’il tend à assimiler le présent au passé et trivialise le fait colonial, qui devient ainsi une simple référence métaphorique ». En outre, fait-il remarquer, personne dans les enquêtes qu’il a menées ne reprend le terme à son compte. C’est donc un vocable exclusivement militant, limité à quelques cercles radicaux de faible influence. Il relève d’ailleurs chez ses interlocuteurs interrogés dans le cadre de son enquête la volonté de s’inscrire dans « une histoire partagée (…) qui n’a pas simplement été celle d’une domination, mais aussi de rencontres, d’échanges, de construction d’un espace colonial puis postcolonial commun ». Relevons-le encore : on ne voit pas dans ces propos ce qui peut justifier les craintes d’autoflagellation et de « repentance ».
3. « Multiculturalisme »
Le titre de l’article du Figaro consacré à la nomination du nouveau ministre résume beaucoup de choses : « Multiculturalisme, décolonialisme, racisme structurel : ces querelles que réveille la nomination de Pap Ndiaye ». Parmi tous ces termes lourdement chargés de sens, le plus révélateur y est sans doute aussi le plus banal : c’est le verbe « réveiller ». Il exprime en effet le désir qu’on laisse ces querelles dans le silence qui devrait naturellement les entourer. De fait, c’est bien l’aspect le plus contrariant des demandes de justice qu’elles viennent troubler un consensus social pour ne pas voir certains problèmes. Telle est bien la problématique de l’invisibilité. Pourquoi parler de « condition noire » alors que l’égalité des citoyens est, dans notre tradition, volontairement aveugle aux particularités (color blind), ce qui constitue la meilleure garantie d’un traitement strictement égalitaire des individus ? L’invisibilité n’est-elle d’ailleurs pas l’aboutissement souhaitable d’une politique de justice : que la couleur de peau ne soit plus un stigmate, qu’elle n’ait pas plus de signification que la couleur des cheveux ou des yeux ?
Il semble donc contradictoire d’attirer l’attention sur une situation minoritaire et de demander des politiques correctrices tout en revendiquant une égalité sociale qu’une heureuse indifférence aux particularités semble bien garantir. Mais qui a la parole sur le sujet ? Qui décide qu’une revendication ne mériterait même pas d’être entendue ? Il faut bien écouter ceux-là mêmes qui subissent les discriminations avant de décréter que la couleur de peau n’est plus un problème chez nous. Or, il y a une demande de justice qu’il faut entendre. Il convient d’écouter « ce que les personnes racialement discriminées ont à dire à propos de leur situation personnelle
». Renvoyer simplement à l’excellence idéale du modèle républicain, c’est opposer une fin de non-recevoir qui n’éteint pas les revendications. C’est pourquoi, sans renoncer à une position universaliste, il faut prendre garde « que cet universalisme ne soit pas une manière de nier le problème des inégalités subies par les minorités ethno-raciales, ni d’administrer des leçons à ceux qui les pointent, comme si cela relevait d’une manie étrange et suspecte !
». En ce sens, historiciser la « condition noire », c’est bien contribuer à renforcer la capacité d’intégration de la République.
On est surpris de voir, d’autre part, évoqué à propos de cette démarche un reproche d’« islamo-gauchisme » ou d’atteinte à la laïcité, alors que rien de tout cela n’a à voir avec l’islam ni avec la séparation des Eglises et de l’Etat ! Il semble que le terme de « laïcité », dans ce type d’occurrence, doive être compris comme une sorte de synonyme de l’expression « universalisme républicain », par un effet de contiguïté mal maîtrisé où la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions instituées, au lieu de protéger la liberté de conscience, imposerait une neutralité de conviction à l’ensemble de la société. Un contresens complet au regard des garanties fondamentales de la liberté d’expression. A moins que la « laïcité » ne désigne finalement, dans certains discours militants, la culture majoritaire. Le ministre de l’Education nationale est pour sa part, bien entendu, tenu de respecter les règles de la fonction publique, et même de façon exemplaire. La conviction républicaine, la retenue publique et le sens des nuances de Pap Ndiaye ne peuvent être mises en doute aujourd’hui que par un procès d’intention particulièrement déplacé.
4. Y a-t-il un paradoxe Ndiaye ?
Une dernière critique, plus élaborée, veut prendre le parcours personnel de Pap Ndiaye comme preuve de la vacuité de sa démarche. N’est-il pas lui-même l’exemple vivant que l’intégration républicaine fonctionne, que le mérite personnel est reconnu par-delà les apparences ou les appartenances, que l’égalité des chances est garantie par un système scolaire assurant toujours la promotion sociale ? Or, en parlant de « discriminations », le ministre risquerait, selon ce point de vue, de fragiliser le bel édifice qui lui a rendu possible son parcours scolaire exemplaire, une belle carrière universitaire et, finalement, sa nomination comme ministre.
L’excès même des réactions politiques à la nomination de Pap Ndiaye, qui ne reposent que sur des contre-sens et des falsifications, comme nous l’avons vu, montre au contraire une force de résistance à la promotion sociale plus intense que ne le promet le récit enchanté de la République « aveugle aux différences ». Rarement une telle logique du soupçon aura accueilli un nouveau venu à son poste. Quand il fait preuve de nuance dans son livre, on lui reproche ses « ambiguïtés ». Quand il mène un travail de recherche comparatiste, on l’impute à « sa fascination pour le modèle américain »…
Il ne suffit pas de répéter en boucle que « tout le monde peut réussir » en France pour invalider les études chiffrées dont on dispose désormais pour documenter la réalité des discriminations. Les rapports annuels du Défenseur des droits, les enquêtes de testing menées par le ministère du Travail sur l’accès à l’emploi ou d’autres enquêtes sur l’accès au logement sont sans appel. Il s’agit bien désormais d’aller plus loin et de demander comment corriger ces discriminations. C’est ici qu’on en revient à la question difficile, mais pas insurmontable, des catégories. On rejette trop souvent le principe même d’un débat sur ce sujet en France en parlant d’américanisation ou de politique des quotas. Or, la démonstration est faite, l’avant-dernier chapitre du livre de Pap Ndiaye (« Penser les discriminations raciales ») y contribue, qu’on peut mettre en place des politiques réparatrices sans créer de ghettos identitaires, sans intégrer de catégories raciales dans le recensement et sans imposer de quotas. Une démarche d’« auto-déclaration » permettrait aux individus de désigner la manière dont ils se sentent perçus. On parle aussi d’auto-hétéroperception quand « on demande aux personnes de quelle manière elles sont généralement considérées par des tiers ». On peut ainsi, si l’on veut bien cesser de pousser des hauts cris avant même d’entamer le débat, défendre « une politique de factualisation des discriminations » sans entrer dans une perspective multiculturelle. Là encore, Pap Ndiaye présente dans son livre la position la plus équilibrée faisant droit à la demande de justice des personnes discriminées en raison de leur couleur de peau aussi bien qu’à la préoccupation de ne pas créer de catégories juridiques stigmatisantes.
Pap Ndiaye a finalement décrit lui-même par avance la difficulté réelle de sa nomination. A la fin de son chapitre 5, il consacre un dernier développement aux nominations politiques n’apportant que des « satisfactions symboliques ponctuelles aux populations minorées
». Constatant le décalage entre « la réitération des propos aimables sur la France métissée
» et les maigres progrès touchant l’ouverture du monde politique lui-même, il pointe un risque de tokenism « c’est-à-dire l’inclusion très limitée de minorités visibles dans les cercles du pouvoir afin de donner l’illusion de la diversité ». En soi, une nomination peut contribuer à faire progresser notre démocratie car « la démocratisation de la vie politique française passe par son ouverture à des groupes peu ou pas représentés et aux situations sociales qu’ils représentent ». Mais pour aller au-delà du geste symbolique, il faut que la diversité de représentation permette l’élargissement des thèmes d’action publique et la diversification des revendications reçues comme légitimes dans l’espace public. Les chantiers du ministre, particulièrement ardus, n’en seront que plus difficiles.