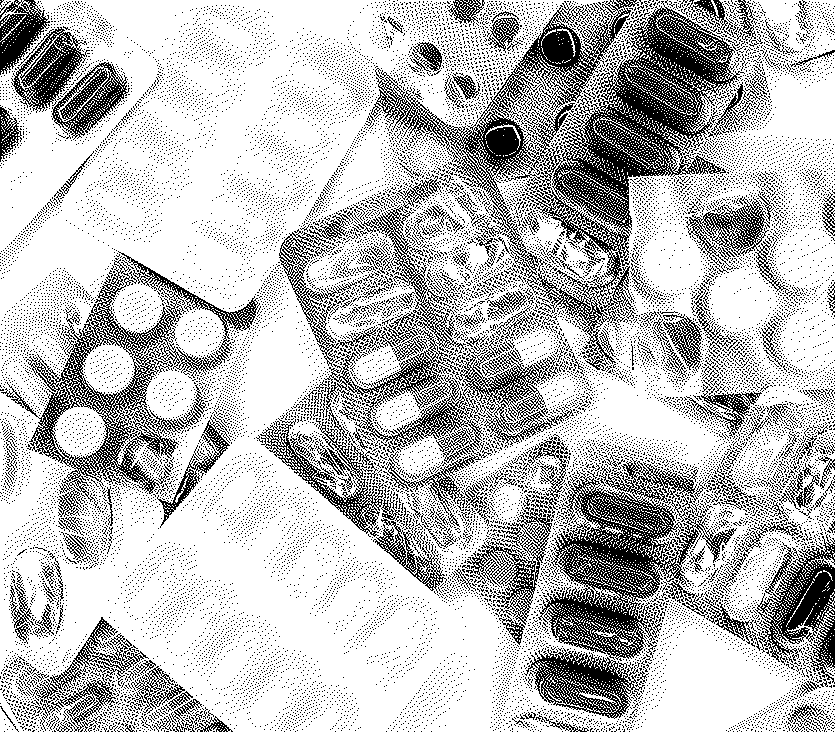L’actualité des annonces de l’exécutif sur la santé semble en curieux décalage avec la réalité des parcours de soins complexes que vivent les Français. D’un côté, nos concitoyens déclarent dans un récent sondage que la capacité du gouvernement à répondre à leurs inquiétudes en matière de santé sera le deuxième critère sur lequel ils jugeront le nouveau Premier ministre, juste derrière le pouvoir d’achat. De l’autre, la position des autorités semble être, à l’opposé, qu’un certain nombre de problèmes de santé se règleraient d’une façon simple si seulement les Français commençaient par balayer devant leur porte, se ressaisir, et renoncer à leur désinvolture à l’égard du système de soins. Le mot d’ordre est simple : responsabiliser les patients ! La difficulté de trouver un rendez-vous médical ? Un problème de « lapins », imputable à la désinvolture des usagers. La croissance des dépenses ? Un problème de surconsommation de médicaments. La saturation des urgences ? Trop de visites indues. « On consomme trop de médecine », a dit sans fard le président de la République lors de sa dernière conférence de presse le 16 janvier. A croire que les malades se soigneraient par plaisir ou confort. La prochaine étape sera-t-elle de voir les pénuries de médicaments imputées au mésusage des patients ?
Ces messages culpabilisateurs, sur fond de réarmement moral et civique, ramènent à certains égards le patient français vingt ans en arrière : les virulents opposants à la loi Kouchner de 2002, tenants des « devoirs » des patients plutôt que des droits que la loi voulait leur reconnaître, ne défendaient pas autre chose que cette vision paternaliste d’un patient infantile, porté aux abus, à qui il conviendrait de faire prendre conscience des responsabilités qui lui incombent plutôt que des droits qui lui reviennent.
En plaçant la « responsabilisation » du patient au cœur de son discours, l’exécutif fait aujourd’hui le choix d’un discours qui revient en arrière, au mépris des évidences comme des valeurs. En 2010 déjà, Didier Tabuteau écrivait : « la « responsabilisation » des assurés sociaux, supposés être des consommateurs abusifs de soins, est devenue le leitmotiv du discours politique présidentiel et gouvernemental. La création des « franchises » (en 2008), c’est-à-dire d’un ticket modérateur forfaitaire et plafonné dans l’année, était inscrite dans le programme du candidat élu à la présidence de la République. Leur inscription dans le code de la sécurité sociale pour les médicaments, les actes des professionnels paramédicaux et les transports sanitaires, a donné lieu à un débat politique dans lequel les défenseurs de la mesure soulignaient les vertus des sommes restant à la charge des malades ».
L’inquiétude, à l’époque, était claire : augmenter les sommes restant à la charge des assurés sociaux pour contenir l’évolution des dépenses, c’est conduire une politique de « maîtrise de la demande » qui pose la question de la responsabilité de chacun à l’égard de son état de santé et ouvre la voie à des restrictions sur le périmètre de prise en charge par la solidarité nationale. Le discours le plus marquant à cet égard fut celui du président de la République Nicolas Sarkozy en septembre 2007, quelques mois avant d’instituer le dispositif des franchises : « L’assurance maladie n’a pas vocation à tout prendre en charge, sans rien contrôler et sans rien réguler. C’est pourquoi je vais ouvrir un grand débat sur le financement de la santé. Qu’est-ce qui doit être financé par la solidarité nationale ? Qu’est-ce qui doit relever de la responsabilité individuelle à travers une couverture complémentaire ? ». En déclarant, pour justifier le doublement des franchises, qu’« on consomme trop de médecine », est-ce cette même voie que veut approfondir Emmanuel Macron ?
Responsabilité et responsabilisation
Le débat sur la « responsabilisation » des patients occupe le monde de la santé, des sciences sociales aux médecins en passant par les parlementaires, les responsables politiques, l’administration sanitaire et les patients, depuis plus de deux décennies. Les polarités de la discussion sont classiques pour ce secteur : on opposera la liberté individuelle au bien commun ; les droits du malade aux devoirs du soigné, lesquels portent en creux les droits du soignant ; le secouru, bénéficiaire de la solidarité, au contribuable ; ou encore la liberté des prescripteurs à la licence laissée aux patients d’être « compliants » (l’anglicisme désigne le fait pour un patient de suivre les recommandations de son prescripteur). On le voit : le débat superpose une polarité entre le soigné bénéficiaire et l’assuré social contributeur, et une polarité entre la responsabilité, à l’égard du financement socialisé, du soignant prescripteur et du patient consommateur.
En effet, comme l’ont montré, on le verra ci-dessous, de nombreux commentateurs de ce débat, il n’est possible de parler de « responsabilité » des patients quant aux soins qu’ils reçoivent qu’en affaiblissant la responsabilité des prestataires, médecins prescripteurs, qui seuls sont en position d’engager la demande de soins remboursés et d’en être donc les obligés.
Choisir un discours de responsabilisation des patients, dans cette histoire, est donc tout sauf anodin : c’est consacrer, en portant l’obligation d’intérêt général du côté des soignés plutôt que des soignants, l’héritage du paternalisme médical que vingt ans de démocratie sanitaire ont combattu. La notion d’une « responsabilité » du patient était en effet au cœur des controverses politiques qui ont entouré la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : compenser la reconnaissance de ces droits par l’énoncé de devoirs du malade, voilà qui était l’objet du plaidoyer conservateur de défense de l’autorité médicale. Rappelons combien l’élaboration de cette loi, qui aura duré dix ans sous la houlette de Didier Tabuteau, aujourd’hui vice-président du Conseil d’Etat, a représenté, selon les mots de son prédécesseur Jean-Marc Sauvé, « un défi pour le législateur : il s’agissait non seulement de rétablir la confiance, mais également de garantir une meilleure qualité du système de santé, de jeter les bases de la démocratie sanitaire, d’affirmer les droits des malades, de concevoir et consacrer un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité ».
Cette loi de progrès pour les droits des malades a été écrite « en réaction au paternalisme médical ». L’expression est de Didier Tabuteau, qui en a relaté la genèse : « au fil des jurisprudences reconnaissant un droit à l’information et au consentement, et de la montée en puissance d’un mouvement associatif représentant les malades, une demande sociale, puis politique, d’autonomie accrue de l’individu en matière de santé s’est exprimée. Les états généraux de la santé de 1998-1999 en ont été la caisse de résonance et la loi du 4 mars 2002 la résultante. Désormais le malade a, en droit, la liberté (…) prendre « les décisions concernant sa santé » » !
Ce progrès des droits s’est heurté durant l’élaboration de la loi de 2002 à de nombreuses réticences, dont les mots « responsabilité », « responsabilisation » et « devoirs » des patients ont naturellement été les étendards. Citons par exemple le professeur Bernard Glorion qui écrivait en 2001, en tant que président d’honneur de l’Ordre des médecins et membre de l’Académie de médecine : « Il faut (…) rappeler sans cesse que, les uns et les autres, nous avons des droits, mais ils n’existent que si l’on reconnaît aussi avoir des devoirs », détaillant : « Les explications données par le médecin sur le choix d’un traitement, sur la nécessité de respecter les protocoles, sur le signale- ment des effets secondaires sont des notions connues. (…) Ainsi éclairé, le patient devient un partenaire responsable par son implication active dans les limites de ses possibilités et de sa volonté ».
Or le fait est que, sous la pression notamment du Sénat, cette notion de « responsabilité » des patients a finalement bel et bien été consacrée par la loi de 2002, en miroir du progrès des droits qu’elle portait. Anne Laude, spécialiste de droit de la santé et ancienne co-directrice de l’Institut Droit et santé avec Didier Tabuteau aujourd’hui conseillère Recherche et enseignement supérieur au cabinet du président de la République, a décortiqué avec précision dans un papier de 2013 les imprécisions et contresens qui ont conduit le législateur de 2002 à inscrire à l’article L.1111-1 du Code de la santé publique la phrase suivante, réputée obscure par de nombreux commentateurs mais toujours en vigueur aujourd’hui : « Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent de responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose ».
Cet article est le fruit d’un amendement de la Commission des affaires sociales du Sénat ainsi justifié dans le rapport : « ce texte (de loi), malgré sa volonté affirmée de rééquilibrer la relation patient-médecin, risque en réalité de créer un déséquilibre au profit du patient », de sorte qu’« il est apparu à votre rapporteur significatif et regrettable que, dans le projet de loi, l’affirmation d’un droit des malades ne s’accompagne pas, en miroir, de l’énoncé des «obligations » ou du moins des responsabilités des patients et usagers ».
Lors des débats en commission, les sénateurs font clairement le lien entre les « responsabilités » qui seraient celles des patients et leur statut de consommateurs d’un financement socialisé dont il s’agit de préserver la soutenabilité en les « responsabilisant » contre une supposée propension à abuser de leurs droits. C’est notamment le glissement qu’opère le sénateur LR Alain Vasselle, affirmant : « Ne pensez-vous pas ce texte puisse avoir des effets pervers, en donnant le sentiment à l’ensemble de nos concitoyens qu’en définitive, au regard de la loi en ce qui concerne les services de santé, ils n’ont que des droits, mais n’ont aucun devoir ou responsabilité ? Je pense en particulier à cette responsabilité qui devrait être la leur au regard des dépenses de santé qu’ils engendrent de par la consommation des services et des soins. Je pense à ces malades qui vont voir dix médecins différents parce qu’ils ne sont pas satisfaits de tel ou tel. A mon sens, il faut placer les patients à un certain niveau de responsabilité au regard des services de santé ».
Une confusion des registres
Dans son analyse juridique de l’article L.1111-1, Anne Laude montre d’abord que sont ici confondues responsabilité et responsabilisation qui sont deux notions distinctes : l’une renvoie à l’idée de responsabilité juridique, qui se définit comme « l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires », alors que l’autre fait référence à un concept moral et désigne l’action de faire prendre conscience à une personne de la nécessité d’utiliser les droits ou la confiance qui lui sont accordés avec discernement et sans abus. En réalité, lors des débats de 2002 et depuis, le discours politique de « responsabilisation » des patients confond des registres très différents : sous couvert, dans un registre politique, de ne reconnaître de droits qu’assortis de devoirs, ce qui se glisse là dans le Code de la santé publique c’est une idéologie paternaliste de la discipline du patient convoqué à l’observance des prescriptions qu’il reçoit, avec à l’horizon une police utilitariste du comportement des assurés sociaux supposés peu scrupuleux, insouciants ou hypocondriaques. Anne Laude, tout comme Didier Tabuteau, ont en tête la possibilité de voir le remboursement des soins conditionné à une surveillance de l’observance : ils sont, entre 2013 et 2015, parmi les commentateurs vigilants d’un arrêté ministériel qui conditionnait la prise en charge des appareils à pression positive continue dans l’apnée du sommeil à une télé-surveillance de leur bonne utilisation par le patient : une piste de restriction du remboursement que le Conseil d’Etat puis la Cour de cassation ont finalement écartée, mais qui aura donné un sens très concret, pour tous les acteurs de la santé, à ce que peut signifier la « responsabilisation » du patient. Pour Anne Laude en 2013, cet arrêté a motivé une inquiétude sérieuse : « L’introduction d’un véritable “principe de causalité” dans la législation d’assurance maladie pourrait être préconisée par les défenseurs d’une approche moralisatrice des systèmes sociaux ».
En réalité, la notion d’une « responsabilisation » des patients ne peut pas désigner une responsabilité au sens juridique du terme : il ne peut y avoir de responsabilité à l’égard de soi-même, de ses comportements ou de son état de santé, rappelle Anne Laude, car il n’y a d’obligation au sens civil qu’entre deux parties distinctes. En revanche, le discours qui s’impose à travers ce terme de « responsabilité » des patients, c’est bien celui de la pénalisation financière des comportements. Celui-là même qui fonde l’augmentation des tickets modérateurs, des forfaits et des franchises. Comme l’a écrit Didier Tabuteau1, la justification de telles mesures est alors recherchée « dans la propension de l’assuré social à négliger la prévention, à développer des comportements à risque, et, en cas de maladie, à exprimer une demande accrue de soins, dès lors qu’une protection sociale atténue ou réduit le coût des prestations et biens de santé. Les campagnes d’information de la Cnamts ont popularisé cette menace de comportements insouciants, peu scrupuleux ou hypocondriaques, par le slogan “la Sécu c’est bien, en abuser ça craint” ». De telles démarches de pénalisation financière, de mise en garde et de contrôle avivent selon lui les craintes de voir l’assurance maladie se muer progressivement en une véritable « police des mœurs ».
Et Anne Laude de plaider, en 2013, pour la réécriture de cet article L.1111-1 du Code, arguant : « l’effet pervers de l’article L. 1111-1 du code de la santé publique est, du fait de sa rédaction ambiguë, d’introduire l’idée d’une mise en cause de la responsabilité du patient à l’égard de son comportement, voire plus généralement de son état de santé. (…) Ainsi, ne serait-il pas opportun, à l’occasion de la loi de santé publique annoncée pour 2014, de réécrire ce texte en supprimant le lien qu’il introduit entre responsabilité et responsabilisation, qui risque à terme de fonder des actions en responsabilité d’un comportement considéré par certains comme non vertueux ?? Ne convient-il pas au contraire d’affirmer que la responsabilité du patient envers lui-même n’est pas possible ?? ».
Un grand retour en vogue
Or non seulement cet héritage paradoxal de 2002 n’a pas été réécrit dans la loi ou clarifié à ce jour, mais on peut même dire que le discours paternaliste de la responsabilisation des patients trouve aujourd’hui une vigueur renouvelée au plus haut niveau de l’Etat. Et, faute de pouvoir donner quelque substance raisonnable à la notion de responsabilité du patient envers lui-même, le glissement sémantique s’opère de nouveau : le registre moral des droits et devoirs du patient est plus que jamais confondu avec ce qui s’avère n’être qu’une logique de pénalisation financière des comportements non vertueux de l’assuré social « responsabilisé » par une sanction au portefeuille. En passant sous silence que, par définition, il n’engage le financement socialisé de la santé que sur prescription médicale.
La responsabilisation est de fait le mot-clé de bon nombre d’aspects du discours politique sur la santé aujourd’hui : taxe « lapin » sur les rendez-vous non honorés, franchises, engorgement des urgences, la maîtrise du comportement consumériste des patients serait une clé. Ainsi, lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024, le président de la République a fait valoir cet axe de justification sur deux thèmes majeurs : la fréquentation des urgences et la hausse des franchises sur les médicaments.
Concernant la réponse à l’engorgement des urgences, il a défendu la généralisation des services d’accès aux soins et l’approfondissement des nouvelles divisions du travail entre soignants médicaux et paramédicaux ; mais il a également affiché la nécessité d’aller plus loin pour « mieux responsabiliser celles et ceux qui ont recours de manière indue aux urgences : c’est quelque chose qu’on est en train de regarder avec les hôpitaux. Quand vous avez des gens qui, même pour des petits bobos, continuent d’aller deux, trois fois aux urgences, il faut pouvoir les responsabiliser. C’est-à-dire qu’il y ait un reste-à-charge. Parce que sinon ça ne va pas »2.
Quelques minutes plus tard, en réponse à une question sur le pouvoir d’achat et la perspective d’augmentation des franchises, il a de nouveau fait valoir la responsabilisation des assurés sociaux, en des termes très directs : « Il nous faut conjurer une forme de fatalité française, qui est qu’on consomme trop de médecine, en même temps qu’on a l’une des médecines les plus socialisées du monde, c’est-à-dire où ce n’est pas le consommateur qui paye. Mais c’est toujours pareil, il n’y a pas d’argent magique, quand ce n’est pas le consommateur qui paye, c’est le contribuable. Et donc au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, pour la vie quotidienne : se dire qu’on va passer de 50 centimes à 1 euro pour une boîte de médicament, je n’ai pas le sentiment qu’on fait un crime terrible. Je pense que ça responsabilise, et que c’est une bonne mesure. Et il faut responsabiliser sur la consommation ». Concluant, après avoir réaffirmé la nécessité de garantir le plafond annuel de 50 euros pour les patients chroniques en affection de longue durée (ALD), que « nous allons faire là quelque chose de juste, je crois, c’est-à-dire qu’on responsabilise », il insiste sur le fait que « la médecine, ça ne coûte pas rien, on prend déjà beaucoup en charge, quasiment tout. Et donc oui, moi je pense que c’est une bonne chose de passer de cinquante centimes à un euro par boîte de médicament, franchement, ça ne me choque pas, quand je vois ce que coûtent beaucoup d’autres éléments qui sont moins essentiels que le médicament quand il est prescrit. Parce qu’il faut responsabiliser, c’est une bonne chose »3.
Dans un registre voisin, c’est sur les rendez-vous médicaux non-honorés par les patients que le Premier ministre a quant à lui voulu insister lors de sa déclaration de politique générale : « il y a encore aujourd’hui trop de rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Pour les médecins, il est insupportable d’avoir chaque jour des patients qui ont un rendez-vous et qui ne se présentent pas. Pour les Français, il est insupportable de savoir que des millions d’heures sont perdues, alors qu’ils attendent parfois des mois pour un rendez-vous. Je souhaite un principe simple qui se traduise par des mesures claires dès cette année : quand on a rendez-vous chez le médecin et qu’on ne vient pas sans prévenir, on paye ».
La presse a désigné sous le nom de « taxe-lapin » la mesure annoncée, que Gabriel Attal, alors ministre délégué chargé des comptes publics, avait déjà défendue dans Ouest-France en avril 2023 : « Si vous ne vous présentez pas, le remboursement du rendez-vous suivant serait minoré d’une certaine somme qui pourrait être de 10 euros. Cinq euros iront au professionnel de santé et cinq euros à l’Assurance maladie ». Il s’agit donc bien d’une sanction, adossée à une restriction de remboursement par la solidarité nationale, conçue pour lutter contre un comportement non-vertueux, dont on impute la responsabilité à des patients trop insouciants. Ils sont, au passage, tenus pour comptables du temps médical perdu et donc des difficultés d’accès aux soins.
C’est bien là le sens que le président de la République donne lui aussi à cette « taxe lapin » qu’il appuie de longue date : « il faut responsabiliser mieux les patients : ceux qui ne viennent pas aux rendez-vous, on va un peu les sanctionner », avait-il annoncé dans son interview au Parisien, le 23 avril 2023. Un écho de ses vœux aux soignants, prononcés le 6 janvier précédent : « Trop de temps médical est gaspillé par un excès d’imprévoyance, de la désinvolture, avec en particulier des rendez-vous non honorés. Et pour supprimer cette perte sèche de temps médical, là aussi sera engagé un temps de travail avec l’Assurance maladie pour responsabiliser les patients lorsqu’un rendez-vous ou plusieurs ne sont pas honorés, ou lorsqu’il y a un recours abusif à des soins non programmés »4.
Un manque de fondements empiriques
Or il se trouve qu’un point au minimum fait consensus : les malades ne se soignent ni par goût ni par confort. Et la littérature n’appuie pas l’idée selon laquelle leur souci de protéger leur portefeuille des banderilles culpabilisatrices de l’action publique les amènerait à se soigner tout aussi bien en consommant moins des soins qui leur sont prescrits. Le discours de « responsabilisation » des malades a ainsi notamment été pourfendu par exemple par Marisol Touraine au Sénat en novembre 2014 : « L’accès aux soins est notre priorité et, je le dis avec force, je ne crois pas à l’idée erronée d’une « responsabilisation » des patients, qui revient à considérer que les malades se soignent par plaisir. Dans le contexte financier contraint que nous connaissons, nous refusons tout transfert de charges vers les patients : ni déremboursement, ni forfait, ni franchise ».
La question, de fait, est désormais ancienne et bien documentée : il n’y a aucune raison scientifique de croire que le discours et les mesures punitives dites de responsabilisation des patients ont un impact positif sur les finances publiques. Concernant l’augmentation des franchises, La grande conversation a déjà publié ici en octobre 2023 avec Florence Jusot une analyse de la littérature disponible et notamment des travaux d’économie de la santé de l’IRDES. Rappelons que la franchise dont le doublement est aujourd’hui acté s’applique sur les boîtes de médicaments (0,50 €), les actes paramédicaux (0,50 €) et les transports sanitaires (2 €). Certains s’étonnent peut-être que de « petites sommes » soient censées avoir un impact sur les comportements. D’autres rappelleront qu’en France nous avons, c’est heureux, un « reste à charge » parmi les plus faibles d’Europe, en moyenne. Reste que le discours politique qui consiste à justifier le doublement des franchises par la « responsabilisation » du malade consiste de fait à souhaiter que le soin devienne fonction du coût et non plus du besoin.
L’argument d’une surconsommation choisie, que l’effet-prix, lié à l’augmentation des franchises, pourrait avantageusement dissuader, est difficile à soutenir lorsque l’on parle de médicaments prescrits par des professionnels de santé. Il est en outre difficile de supposer que les franchises conduiraient les patients à ne supprimer de leur ordonnance que les médicaments « inutiles » qui leur sont prescrits, et non à supprimer des médicaments essentiels pour leur état de santé. L’asymétrie d’information entre médecins et patients est la base intangible de toute approche du sujet.
D’ailleurs, les experts académiques et administratifs du médicament eux-mêmes retiennent classiquement que la définition du « bon usage » du médicament se rapporte aux pratiques de prescription des médecins, et non aux pratiques de consommation des patients : la récente mission dite Borne sur la régulation du médicament statue par exemple que « le bon usage des produits de santé consiste en leur juste prescription, c’est-à-dire le bon traitement pour le bon patient au bon moment ». Toute l’approche politique dite de « maîtrise médicalisée des dépenses de santé », qui gouverne l’action publique de santé depuis les ordonnances Juppé de 1996, repose sur l’idée que ce sont les prescripteurs, et non les malades, qui engagent par leurs pratiques le financement socialisé de la santé. La Cour des comptes rappelle ainsi que cette approche « se concrétise, essentiellement, par des mesures incitatives visant à améliorer les prescriptions ». S’il y a surconsommation, c’est donc aux ordonnances des prescripteurs qu’il faut s’intéresser, non aux consommations des patients ainsi ordonnancées. Certes, notre histoire de la médecine, comme l’a retracé Didier Tabuteau, a consacré comme un principe indépassable la « liberté de prescription » des médecins ; la limiter, ne serait-ce que par des recommandations de bonnes pratiques comme s’y attachent le législateur et l’action publique depuis la création de l’ANAES en 1996 (dont Didier Tabuteau fut le directeur) remplacée en 2004 dans cette mission par la HAS, est une ambition évidemment délicate. Force est, même pour la Cour des comptes, de rappeler dans son rapport de 2023 sur la « maîtrise médicalisée des dépenses » que « cette forme de régulation des dépenses ne contrevient pas au principe de liberté dont jouissent les médecins dans leurs actes et prescriptions ». Que la puissance de cette liberté de prescrire cantonne l’action publique, en la matière, à une obligation de moyens (des recommandations de bonnes pratiques) plus que de résultats (les recommandations restent non-opposables) : c’est un point que l’histoire de la HAS et des négociations conventionnelles ont très largement documenté depuis vingt ans. Mais ce n’est pas une raison pour s’attaquer, à la place, à une supposée trop grande licence des patients dans leur « consommation » des soins qui leur sont prescrits.
En outre, comme le démontre par exemple l’économiste de la santé Brigitte Dormont, l’augmentation des franchises sur les soins est un « choix politique difficile à défendre » parce qu’orthogonal avec la philosophie même de notre sécurité sociale : en faisant porter une charge de financement sur la consommation de soins, c’est-à-dire sur les malades seuls, elle porte un coup au principe cardinal de la sécurité sociale, qui est la solidarité entre les malades et les bien-portants. Enfin, bien sûr, une telle stratégie de pénalisation des malades est réputée contre-productive pour la santé publique, même en garantissant un bouclier pour les malades chroniques en ALD avec le plafonnement annuel des franchises : comme le notait par exemple Anne Laude en 2013 déjà, « nombre d’études ont montré en effet les effets inégalitaires et souvent préjudiciables à la santé publique des mesures visant à la responsabilisation de l’assuré social. On a souligné le caractère inéquitable de ce transfert qui renforce les inégalités de santé ». Dès 2002 du reste, Étienne Caniard, défendant le projet de loi Kouchner devant la Commission des affaires sociales du Sénat déjà citée, soulignait : « Je ne crois pas tellement à une responsabilité financière individuelle. L’expérience du ticket modérateur a tourné à l’échec ; il y a une unanimité pour dire qu’il s’agit d’un ticket d’exclusion ». Et Didier Tabuteau écrivait de même en 2010 : « Cette responsabilisation individuelle manque singulièrement de fondements théoriques. Si l’accroissement du reste à charge peut éviter certaines consommations abusives, il reste que la consommation médicale est, pour l’essentiel – hospitalisations, accidents, affections de longue durée, etc. –, contrainte et subie. Elle dépend principalement de l’évaluation de l’état de santé par le médecin et des prescriptions qui en résultent. Si les excès de consommation médicale imputables aux patients et le nomadisme injustifié méritent attention et doivent être contrecarrés, leur impact sur l’évolution des dépenses ne peut être que marginal ».
Le même déficit de preuves se retrouve concernant les autres sujets d’actualité de l’exécutif. D’où vient ainsi le chiffre de 27 millions de créneaux médicaux sacrifiés par la désinvolture de patients absentéistes ? Le thème de la « perte séche » liée aux rendez-vous manqués est un lieu commun du syndicalisme de professions libérales rémunérées à l’acte. Les unions régionales de professionnelles de santé (URPS) créées en même temps que les ARS par la loi HPST de 2009 organisent la représentation territoriale des professions libérales de santé ; elles ont depuis quelques années déployé un plaidoyer conséquent sur les rendez-vous manqués. Le syndicat Union française pour une médecine libre, de même, a fait de cet enjeu un cheval de bataille depuis 2018. Les « études » citées à l’appui de ces plaidoyers ont servi à extrapoler le chiffre des 27 millions de rendez-vous manqués, en dépit d’une qualité méthodologique limitée. L’Ordre des médecins et l’Académie de médecine, dans un communiqué commun de janvier 2023, ont ainsi appelé à la mobilisation tout en reconnaissant en filigrane la faiblesse des données mobilisées : « Plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez-vous non honorés par an ». Par exemple, une enquête souvent citée a été réalisée par Odoxa pour la MNH et France Info en 2019 : publiée sous le titre « Rendez-vous non-honorés : un fléau pour les médecins », elle relève qu’un échantillon de 189 médecins de ville, toutes spécialités confondues, déclare à 97% qu’il lui est « déjà arrivé qu’un patient ayant pris rendez-vous ne se présente pas sans prévenir ». Ce qui, à l’échelle d’une vie professionnelle, reste peu surprenant. Dans l’échantillon des 1001 patients interrogés, ils ne sont cependant que 15% à avoir déjà commis, à l’échelle d’une vie, cet acte, avouant dans près d’un cas sur deux l’avoir fait par oubli. Mais l’enquête met en avant que les médecins, eux, sont 53% à juger, lorsqu’on les interroge sur les raisons qui selon eux amènent leurs patients à un tel comportement, que c’est « parce qu’ils s’en fichent, n’avaient plus besoin de rendez-vous et n’ont pas jugé utile de prévenir ». Cette enquête, conduite auprès de 189 médecins libéraux, a été relayée par le Quotidien du médecin en 2019 sous le titre : « Rendez-vous non honorés : les « lapins » se banalisent et pourrissent l’agenda médical (et les patients le savent !) ». Une autre enquête, réalisée par l’URPS Ile-de-France en 2022 rapporte 2 rendez-vous non honorés par semaine en moyenne chez les 2000 premiers répondants. Et l’URPS Grand-Est a publié en mars 2022 les déclarations de 517 médecins libéraux répondants, sur 9000 adhérents interrogés à ce sujet par mail : si, rapporté à pareil dénominateur, il y a des raisons de penser que les répondants, dont la moitié sont des généralistes, sont biaisés par leur fort intérêt par le sujet, il reste que 76% des répondants « subissent 1 à 5 rendez-vous non honoré par semaine » et 77% imputent ce comportement à « un manque de considération ». Dans 68% des cas, ce comportement concerne un premier rendez-vous, hors de la patientèle habituelle donc. Ces différentes données, bien que de qualité méthodologique faible, ont conduit François Braun, rapporteur peu avant d’être nommé ministre d’une « mission flash » publiée en juin 2022 sur l’accès aux soins, à y inscrire la nécessité de « réfléchir aux moyens de lutter résolument contre les rendez-vous non honorés par une responsabilisation du patient ». La plateforme Doctolib, de son côté, ne retrouve que 0,4% de rendez-vous non honorés côté praticiens, et 3% côté patients, pour les 10 millions de téléconsultations qu’elle gère auprès des 9.600 médecins généralistes qui l’utilisent en tant que plateforme de téléconsultation.
Même fragilité des données concernant les passages non pertinents aux urgences : le Sénat déclarait déjà en 2017 dans un rapport d’information qu’il s’agissait d’un débat ancien mais d’un « faux problème ». « Résumés en termes peu policés, note le Sénat, les termes du débat sont les suivants : les services d’urgences feraient face à un accroissement des demandes relevant de la « bobologie », qui auraient le double tort de contribuer inutilement à l’engorgement des services et d’entraîner des dépenses élevées, alors même qu’elles pourraient obtenir une réponse à moindre coût en ville ». Phénomène « qui a déjà fait couler beaucoup d’encre », le sujet est en réalité difficile à documenter. Dans une étude de 2014, la Cour des comptes avait ainsi établi qu’il existait « une réorientation éventuellement possible de l’ordre de 3,6 millions de passages annuels vers une prise en charge en ville », estimant la possible économie associée à quelques 500 millions d’euros. Sur un plan méthodologique, la notion de passage « inutile » elle-même apparaît difficile à définir, sinon a posteriori , ce qui la rend difficilement opérante. La Cour des comptes s’appuyait quant à elle, à partir des travaux de la Drees, sur le critère de la gravité de l’état des patients , évaluée au travers du référentiel de la classification clinique des malades aux urgences (CCMU) établi par la société française de médecine d’urgence (SFMU). Cette approche est parfois croisée avec celle reposant sur le taux d’hospitalisation : en moyenne, seuls 20 % des patients accueillis aux urgences présentent un état de santé nécessitant une hospitalisation. Mais il apparaît difficile de distinguer l’urgence médicalement justifiée de l’urgence ressentie, ou simplement de l’urgence constituée par l’absence de solution identifiée de prise en charge alternative . Le livre blanc édité en 2015 par l’association Samu-Urgences de France l’exprime en ces termes : « l’urgence en matière de santé est définie par le patient lui-même ou par son entourage, inquiet devant des signes d’apparition brutale, mais aussi lorsqu’il ne trouve pas de réponse ailleurs à son problème de santé ». Dans le cadre de son enquête de 2013, la Drees a pu recueillir des éléments d’information sur les motivations des patients à recourir aux urgences : près de huit patients sur dix décrivent leur venue aux urgences comme « clairement décidée pour un motif médical » ; l’absence d’autre solution de prise en charge identifiée est par ailleurs avancée par un patient sur cinq. Au total, concluait le Sénat, « s’ils existent bel et bien, les recours motivés par de strictes raisons de convenance personnelle apparaissent largement minoritaires ».
De fait, une étude française portant sur près de 30.000 patients adultes parue en 2019 dans le BMJ concluait que le recours « inapproprié » aux urgences est souvent associé à des critères de vulnérabilité sociale. Les auteurs, médecins urgentistes, interrogeaient aussi « la notion de passage inapproprié aux urgences, dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’urgence ressentie par le patient et de l’éventuelle absence d’alternative ». « On passe notre temps à culpabiliser les patients. L’étude met en cause le concept de visites inappropriées qui est couramment avancé pour expliquer la surcharge des urgences, alors que l’on a affaire souvent à des patients vulnérables sur le plan socio-économique et qui n’ont pas d’autre choix », précisait ainsi Youri Yordanov, urgentiste à Saint-Antoine et coordonnateur de l’étude pour la Société française de médecine d’urgence.
Autant dire, au vu des données disponibles sur le sujet, que les acteurs de santé qui ont suivi les débats des dix dernières années ne peuvent que s’étonner d’entendre le président de la République déclarer qu’« on est en train de regarder avec les hôpitaux » le sujet des « gens qui, même pour des petits bobos, continuent d’aller aux urgences » au point qu’« il faut pouvoir les responsabiliser ».
Fréquentation des urgences, surconsommation de médicaments prescrits, rendez-vous non honorés : le levier de la responsabilisation des patients est de l’ordre de l’antienne et de l’invocation classiquement conservatrice. Plus grave, c’est un discours culpabilisateur dont la littérature disponible tend à démontrer l’ineptie, et la contre-productivité potentielle en termes de santé publique par son impact inéquitable sur les plus fragiles. Plus grave encore, c’est un discours conservateur et paternaliste qui va à rebours des valeurs de la sécurité sociale, de la maîtrise des pratiques médicales, et de deux décennies de progrès des droits des patients.
La conclusion revient à Didier Tabuteau écrivant en 2009 : « entre le leitmotiv de la « responsabilisation» du patient et l’alibi de l’information du consommateur, la santé publique peut se diluer dans une démarche incantatoire et moralisante ».