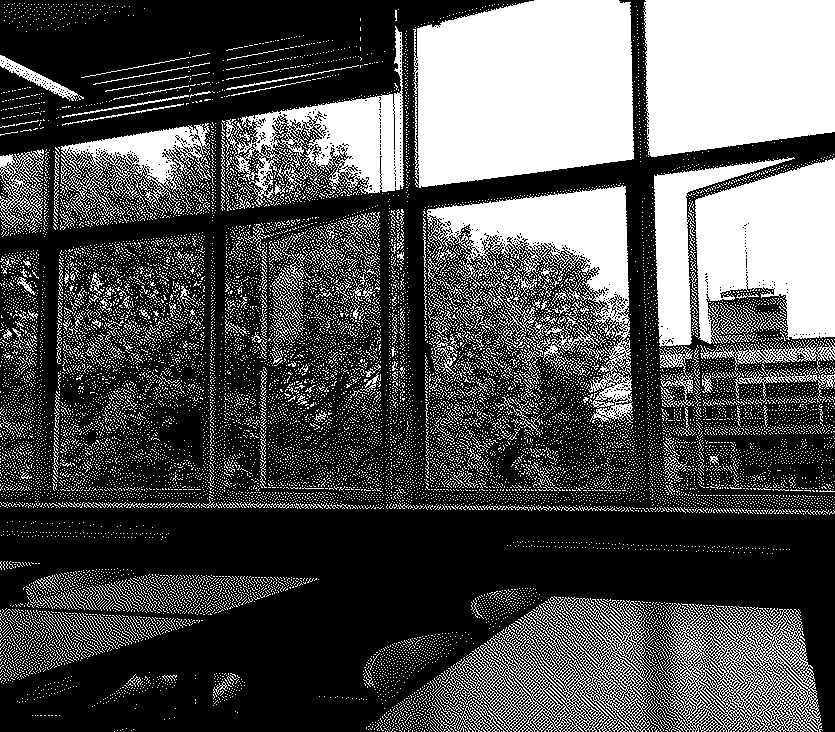LGC : Comment peut-on décrire la manière dont, sur la longue durée, les enseignants ont conçu leur métier ? Peut-on dire que l’exercice du métier s’est toujours pensé comme préservant une grande indépendance des enseignants ?
François Dubet : Il faut d’abord distinguer deux mondes. Le monde du primaire, d’une part, qui a été un monde plutôt sacerdotal. Sans ironie à leur égard, on peut dire que les maîtres d’école de la IIIe République ont été formés sur le modèle des séminaires : recrutés à seize ans, formés filles et garçons dans des écoles séparées, dans des institutions à part, avec une inculcation républicaine très forte et des méthodes pédagogiques très robustes. Les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices étaient à la fois des écoles professionnelles et, en quelque sorte, des séminaires laïques, en rivalité avec l’Eglise catholique qu’il s’agissait d’affaiblir. C’est pourquoi les enseignants avaient une conception très vocationnelle de leur métier. La vocation ne signifie pas seulement qu’ils aimaient leur métier, mais qu’’ils tiraient leur autorité de principes perçus comme sacrés. De la même manière que le prêtre parle au nom de Dieu, la maîtresse ou le maître d’école parlait au nom de la Nation, de la République, du Progrès. Ce modèle a duré très longtemps, sans doute jusque dans les années 1960. Cette conception très forte du métier était en même temps très individuelle parce qu’on présumait que chaque enseignant, dans sa classe, faisait la même chose que son voisin ou son collègue. Ils utilisaient tous les mêmes manuels, les mêmes méthodes, ils partageaient la même formation, ils vivaient souvent la même promotion sociale. La seule variable, au fond, c’était la personnalité, le style individuel. Mais dans un cadre dont l’unité était assurée par ce modèle de la vocation enseignante.
Le monde du lycée, d’autre part, est assez différent. Ce sont des gens qui sont sélectionnés sur leurs compétences académiques. Jusque dans les années 1980, ils commençaient leur carrière directement dans la classe, sans véritable formation pédagogique. Celle-ci paraissait superflue parce qu’on faisait l’hypothèse que le professeur de lycée s’adressait dans sa classe à des élèves qui ressemblaient à l’élève qu’il avait été. C’était une sorte d’évidence qui justifiait l’absence de formation professionnelle. La tradition pédagogique du cours magistral suffisait.
Ce double modèle s’est aujourd’hui défait. Tout d’abord, du côté des professeurs de lycée, avec la massification scolaire. L’ouverture du collège à tous a été confiée aux enseignants du secondaire. Ce qui n’avait rien d’évident. Dans les années 1970, la question était ouverte : fallait-il confier le collège aux instituteurs, en le considérant comme le prolongement de l’école élémentaire ? Ou bien aux professeurs, en en faisant un « petit lycée » pour tous ? Le choix de René Haby a été de le confier aux professeurs pour des raisons pédagogiques, mais sans doute aussi pour des raisons politiques, pour affaiblir la Fédération de l’Education nationale (FEN), syndicat qui était à l’époque en situation quasi-hégémonique.
Quand ils arrivent au collège aujourd’hui, ces professeurs découvrent que les élèves ne ressemblent absolument pas aux élèves qu’ils ont été. Cette nouvelle situation va montrer les limites des « arts et traditions » pédagogiques qui y prévalaient jusqu’alors. La « reproduction » ne fonctionne plus et les enseignants se plaignent de l’hétérogénéité des classes. Il n’est pas rare que des professeurs agrégés, sélectionnés pour leur compétence dans leur discipline et qui choisissent ce métier par exemple par amour des Lettres ou des Humanités classiques, se retrouvent dans des classes de sixième où une partie des élèves ne maîtrise pas bien la lecture. Les enseignants sont donc confrontés à des difficultés auxquelles ils ne sont pas préparés. Et l’exercice individuel du métier ne leur facilite pas la tâche.
LGC : Chacun était présumé enseigner comme son voisin, mais était-ce vraiment le cas ? Que sait-on à ce sujet ?
François Dubet : En ce qui concerne les instituteurs, on a des études historiques qui montrent que c’était bien le cas. L’école élémentaire a fonctionné de cette façon. L’unité du système n’est pas assurée par le travail collectif mais par le fait que chacun est supposé faire la même chose dans sa classe. Il n’y a pas besoin de coordonner le travail des instituteurs puisque tous suivent les mêmes programmes, en s’aidant des mêmes manuels, en partageant une même vision de leur mission. Il existe toujours une variable individuelle, des gens plus chaleureux ou plus talentueux. Mais, pour l’essentiel, c’est un modèle bureaucratique qui fixe des règles générales que tout le monde est supposé suivre à la lettre. Michel Crozier a bien expliqué ce fonctionnement dans Le phénomène bureaucratique. Dans un modèle de ce type, votre autonomie professionnelle est garantie. Les enseignants, une fois fermée la porte de leur classe, se sentent autonomes. Ils suivent des règles très détaillées, par exemple dans le contenu du programme. Mais les règles générales qui valent pour l’ensemble des enseignants, restent des règles extrêmement lointaines. Ils ne sont pas soumis au regard de leurs collègues ni à celui des parents. Formellement, ils sont sous le regard d’un inspecteur qui fait, à intervalle régulier mais très espacé, une évaluation de conformité dont les critères sont très codifiés et qui a peu d’impact sur le développement de la carrière. Dans ce système, le chef d’établissement n’est qu’un relais bureaucratique : il n’a aucune prise sur ce qui se passe dans la classe.
Dans ce système où tout le monde est supposé faire la même chose que son collègue, les enseignants bénéficient d’une formidable autonomie professionnelle en échange d’une soumission à des règles bureaucratiques lointaines. A l’école élémentaire, le directeur ou la directrice n’a aucune fonction d’autorité : c’est simplement un ou une collègue qui bénéficie d’un mi-temps pour faire un travail administratif longtemps tenu pour ingrat. Dans le modèle du secondaire, le chef d’établissement ne peut pas intervenir non plus sur la pédagogie.
Évidemment, plus le métier se désorganise, plus la personnalité, le style, la manière de s’en sortir prennent le dessus, et donc plus vous avez d’hétérogénéité.
Ce modèle est extrêmement singulier, comme le montrent les comparaisons internationales. Un tiers des enseignants français déclare, par exemple, ne jamais participer à une réunion de travail avec des collègues. En outre, 25 % des enseignants français ne se sentent pas appartenir à une communauté éducative. Chez nos partenaires européens, les chiffres sont plutôt autour de 80%. Les syndicats enseignants ont longtemps défendu ce modèle : un mode d’affectation indifférent aux profils individuels puisque tout enseignant est substituable à un autre ; une inspection lointaine ; un proviseur sans pouvoir, etc.
LGC : Mais ce modèle semble désormais remis en question. Observez-vous l’émergence d’une demande en faveur d’un exercice plus collectif du métier ?
François Dubet : Le métier a changé. Il est devenu beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que les publics sont hétérogènes, c’est évident. Parce que le niveau d’exigence imposé à l’école a considérablement augmenté. On accumule les injonctions : que les élèves s’instruisent, bien sûr, mais aussi qu’ils s’épanouissent, qu’ils développent des projets et encore qu’ils adhèrent à des valeurs communes perçues par ailleurs comme menacées ou déclinantes. Il faut en outre apprendre à dialoguer avec les parents. De plus, d’un point de vue culturel, on peut dire que l’enfance et l’adolescence sont entrées à l’école. A l’école élémentaire, ça s’est plutôt bien passé mais beaucoup plus difficilement au collège. Que faire à l’école de la « culture jeune » qui s’est développée partout : la musique, les marques, les écrans, les réseaux sociaux… ? On ne peut plus dire simplement, comme le faisait le philosophe Alain, qu’il faut laisser l’enfance à la porte de l’école et ne considérer en chaque élève que sa part de raison, sa part universelle.
LGC : Comment cela s’est-il passé dans l’école élémentaire ?
François Dubet : L’enfance est entrée à l’école. On a vu les classes se transformer. On a vu les élèves assis en rond, en groupes… Ils peuvent se déplacer, prendre la parole… Les enseignants – en grande majorité des enseignantes – y ont trouvé une forme de gratification et de singularisation par rapport au reste du monde enseignant. Paradoxalement, après avoir tant fait pour accueillir l’enfant à l’école, nous sommes aujourd’hui menacés par un retournement du problème : le triomphe de l’élève sur l’enfant. Je veux dire par là que l’obsession de la réussite est devenue si forte que l’éducation scolaire envahit les familles. On reprochait à l’école de trop « materner » des enfants, aujourd’hui à l’inverse nombre de parents se transforment en coaches scolaires.
Dans le secondaire, ce qui a changé, c’est que la légitimité de l’enseignant ne va plus de soi. Elle est à conquérir. L’idée de l’école républicaine obligatoire et laïque, fondée en concurrence avec l’école religieuse et défendant les valeurs universelles, ne suffit pas à installer l’autorité du prof. Celle-ci doit se construire et se démontrer tous les jours. Les élèves ne voient pas leur maître d’école comme représentant la Raison, la Science, la Nation, la Culture et lui devant, de ce fait, obéissance et respect. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que les enseignants eux-mêmes se considèrent aujourd’hui comme les représentants de ces valeurs universelles. Mais c’est épuisant de devoir fonder son autorité sur soi-même. C’est épuisant parce qu’il faut convaincre, menacer, séduire, se mettre en scène pour instaurer l’autorité et un climat propice au travail. La nature du chahut a d’ailleurs changé. Avant la massification, le chahut était une forme de déviance tolérée qui permettait au système de fonctionner. Aujourd’hui, le chahut est un désordre sourd et continu. C’est d’ailleurs un écart désormais significatif entre un collège très défavorisé et un collège très favorisé. Le temps passé à installer l’ordre dans la classe représente localement presque un quart du temps scolaire, ce qui fait pour un élève d’un collège défavorisé, au bout de quatre ans, une année scolaire de moins que son camarade d’un établissement favorisé. Se présenter devant la classe, c’est donc fatiguant et c’est une mise à l’épreuve personnelle. C’est la mise à l’épreuve de la vocation, du talent, de la personnalité. Mais c’est aussi un bonheur parce que chaque fois que ça marche, c’est une confirmation personnelle, une réussite personnelle.
LGC : Le métier est plus difficile, c’est un constat universel, mais pourquoi est-il ressenti plus difficilement en France que chez nos voisins ?
François Dubet : Parce qu’on cultive l’imaginaire de ce métier tel qu’il était naguère, avant le choc de la massification. Pendant très longtemps, les syndicats majoritaires défendaient ce modèle de l’enseignant seul dans sa classe, avec une inspection lointaine, des parents tenus à l’écart, un chef d’établissement sans pouvoir scolaire, des élèves considérés comme préservés des influences du monde extérieur… Notons que les problèmes sont un peu du même ordre dans l’Église.
Pour faire face aux difficultés, s’installe l’idée qu’une manière de s’en sortir, c’est de travailler ensemble. En commençant par fabriquer ce qui n’a jamais véritablement existé en France : des établissements scolaires. Jusqu’aux années 1980, l’établissement scolaire comme communauté éducative n’existe pas, c’est un simple relais administratif. Le proviseur est le relais entre l’établissement et le rectorat, lequel est le relais avec le ministère et, au-delà, avec la République. A partir des années 1980-1990, des injonctions ministérielles portent sur la constitution de communautés pédagogiques, il faut que l’établissement existe, il faut faire du travail collectif.
L’appel qui est fait à la communauté éducative se heurte cependant à deux obstacles. Le premier, c’est le mode d’affectation des enseignants qui se fait selon des règles générales et impersonnelles et pas sur un projet d’établissement. Parfois, des établissements fonctionnent comme des communautés parce que les gens apprennent à s’apprécier et à travailler ensemble. Mais ce n’est pas toujours le cas. Les enquêtes internationales rappellent que la France est le pays dans lequel un collègue n’entre quasiment jamais dans la classe d’un autre.
LGC : Mais comment expliquer cette forme d’individualisme dans une profession traditionnellement très syndiquée et engagée par ailleurs dans des formes d’action collectives comme le mutualisme ?
François Dubet : Ce sont, plus exactement, des professions extrêmement corporatistes. On peut d’ailleurs ressentir une forme de nostalgie pour ce monde militant : inscrit à la Maif, qui s’équipait à la Camif, etc. La profession est extrêmement homogène mais le métier est complètement individuel. Dans ce monde enseignant, le vote, le choix du conjoint, les loisirs, les références culturelles… étaient très homogènes. Mais, une fois dans sa classe, l’enseignant fait ce qu’il veut. Les deux dimensions se renforcent mutuellement. Plus la corporation est forte, plus elle protège le travail individualisé. Cela n’a rien de paradoxal. Aujourd’hui, la corporation est beaucoup moins forte et l’hétérogénéité du travail a explosé. Les enseignants le vivent comme une difficulté. C’est le retournement de la situation.
LGC : Existe-t-il un clivage générationnel sur ce sujet ? Les jeunes enseignants sont-ils plus demandeurs d’un exercice plus collectif du métier ?
François Dubet : Les syndicalistes disent que oui, mais moi je n’ai pas d’enquêtes me permettant de l’affirmer. L’âge n’est probablement pas la seule variable. Il y a aussi l’endroit où l’on travaille. Les enseignants les plus expérimentés finissent par être affectés dans des établissements plus tranquilles, où l’ancien modèle reste viable. Dans un bon établissement de centre-ville, le travail collectif n’a rien d’indispensable pour arriver à faire cours. Si vous enseignez dans une zone d’éducation prioritaire, ça peut être bien plus important. Dans certains établissements, si vous êtes seul dans votre classe, sans soutien du reste de l’équipe enseignante, vous risquez de vous trouver en difficulté. Cela dit, ce sont aussi les jeunes profs qui sont le plus souvent dans les établissements les plus difficiles.
C’est pour cela que la question de l’exercice collectif du métier est posée. Concrètement, cela renvoie à trois sujets : la formation, l’autonomie des établissements et le mode d’affectation des enseignants.
Tout d’abord, la formation initiale : l’enseignement est un métier, et un métier, ça s’apprend dans une école professionnelle. Cela veut dire que les étudiants devraient pouvoir faire assez tôt dans leur cursus le choix d’une formation professionnelle dédiée à l’enseignement, dans laquelle on apprendrait simultanément la discipline que l’on enseigne et le métier qui consiste à l’enseigner. C’est ce qu’on appelle le modèle simultané. On sait que les pays qui ont adopté ce modèle simultané neutralisent un peu mieux la crise des vocations. Quand on propose, comme c’est le cas en France, aux étudiants de prendre la décision en Master, c’est souvent trop tard parce que les meilleurs étudiants ont d’autres opportunités et parce que les jeunes des milieux populaires ont déjà été découragés avant d’arriver à ce stade. Dans le système actuel, les élèves passent le Capes en Master puis ils font un rapide stage. On est donc dans un modèle successif : formation académique dans une discipline jusqu’au Master puis petit stage. Les enseignants se sentent assez bien préparés dans leur discipline mais 20% d’entre eux seulement se disent bien préparés pour leur métier, du point de vue de la pratique pédagogique.
Le second problème, c’est évidemment l’autonomie des établissements, c’est-à-dire la capacité de construire collectivement un cadre pédagogique. Cela suppose de passer de la logique des programmes à une logique des curriculums. C’est à dire que vous définissez le collège par ce que doit savoir et savoir faire tout élève qui sort du collège. Il ne s’agit plus de donner des programmes détaillés mais de fixer des objectifs. Ensuite, c’est aux professionnels de décider comment s’y prendre collectivement. Cela suppose de l’autonomie pédagogique, avec un mode de contrôle adapté. L’inspection ne doit pas s’assurer de la conformité des pratiques mais de l’efficacité des pratiques. Ce qui change tout.
Enfin, le sujet de l’affectation. Comment peut-on développer le travail collectif tant que le système d’affectation interdit que choisir l’équipe dans laquelle vous allez travailler ? C’est ce que réclament les établissements expérimentaux. Il n’y en a pas beaucoup en France mais ils ont de bons résultats. Les collègues qui travaillent ensemble ont été choisis et se sont choisis. La difficulté est alors de répondre aux différences considérables de qualité d’accueil et de qualité du travail. Et aux écarts d’attractivité. Il sera plus facile de recruter dans l’académie de Bordeaux ou de Toulouse que dans des académies plus difficiles du Nord de la France ou de la région parisienne. Mais le problème existe déjà, comme on le voit dans l’académie de Créteil-Versailles. Pour répondre à la crise actuelle du recrutement, il va falloir se confronter à ces sujets. Et, par conséquent, revoir les conditions de travail, voire les conditions de rémunération, d’avancement de carrière. Dans le système actuel, un jeune débute dans un collège difficile. Généralement, il travaille avec ses collègues avec beaucoup d’enthousiasme, mais il s’en va quand même le plus vite possible. Les taux de turn-over sont considérables dans les zones d’éducation prioritaire. Si bien que la communauté éducative ne cesse de se défaire. En revanche, des communautés éducatives se créent dans les établissements de centre-ville où tout se passe comme naguère. Voilà trois chantiers d’équité, de justice sociale.
On commence à aménager ce modèle avec les Master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) où les étudiants font un master 2 qui oriente vers les métiers d’enseignement pour préparer le concours de professeur des écoles. Pour ceux qui ont fait un parcours en sciences de l’éducation avec des stages, on note une tendance à la professionnalisation. Celui-ci, pour le moment, n’affecte pas véritablement l’enseignement secondaire. Il faudrait franchir vraiment le pas en recrutant un an après le bac. C’est ce que fait la Finlande en proposant une formation professionnalisante. Un tiers du temps est consacré à la pédagogie, la psychologie, les sciences humaines nécessaires au métier ; un tiers du temps se passe dans des établissements scolaires où des collègues vous prennent en charge, vous forment, etc. Et le troisième tiers est consacré à deux disciplines. Puis, une fois que vous avez le diplôme, vous êtes candidat à des recrutements dans les établissements, c’est-à-dire que ce n’est pas le ministère qui vous affecte, c’est vous qui êtes candidat dans des établissements. Et une fois que vous êtes recruté, vous n’êtes plus jamais inspecté. On considère que vous êtes comme un ingénieur ou un médecin, vous savez faire votre boulot. Il n’y a pas de raison de venir vérifier si votre pratique est conforme aux règles bureaucratiques. Les pays qui fonctionnent de cette manière ont quand même des résultats meilleurs que le nôtres.
LGC : Les médecins, comme vous le dites, ne sont pas inspectés mais ils ont une obligation de se former en permanence, sous la forme du « développement professionnel continu » qui passe par un exercice collectif, notamment des groupes d’analyse des pratiques, c’est-à-dire le regard des pairs. N’y a-t-il pas là une voie de développement d’un exercice collectif du métier qui pourrait aussi être intéressant ?
François Dubet : Là aussi, les comparaisons internationales montrent que la formation continue est très faible en France. Notamment pour des raisons purement pratiques. La formation doit-elle se dérouler dans le temps scolaire ? Comment organiser des remplacements ou des rattrapages ? Ou alors pendant les vacances ? En outre, l’offre institutionnelle n’est pas adaptée. Les enseignants qui ont participé à une formation déclarent qu’elle leur a peu apporté. C’est le double jugement : on n’en a pas assez et ça ne nous apporte pas grand-chose.
La formation continue semble plus efficace quand c’est une formation collective. Sinon, une nouvelle méthode se perd rapidement quand elle est mise en œuvre de manière isolée. Le prof motivé par une formation va changer sa manière de faire mais s’il est tout seul à le faire dans son établissement, l’impact de la formation qu’il a reçue s’efface au bout de quelques temps. En revanche, si vous formez tous les profs de maths d’un établissement, vous avez un impact démultiplié.
Il convient donc non seulement développer la formation continue, mais de faire en sorte que la formation continue touche des collectifs de travail réels.
LGC : Comment progresser dans cette direction ? On touche ici non seulement à des habitudes mais aussi à des principes d’organisation liés à une vision républicaine de l’école, à une idée de l’égalité, de l’unité du système etc.
François Dubet : En effet,je ne crois plus au thème de la grande réforme. Plusieurs se sont perdues dans les sables des routines. Beaucoup de ces sujets donnent lieu à des débats « théologiques » qui n’ont pas lieu d’être. Il faut sortir de cette dramaturgie qui crée des blocages. La stratégie pourrait être de développer l’expérimentation, en laissant les établissements expérimenter par exemple le recrutement. Il faut ouvrir aussi le système de formation. On ne peut pas dire du jour au lendemain qu’on recrute à partir du bac ou un peu après. Mais on voit une amorce intéressante de professionnalisation avec le master MEEF. On pourrait descendre progressivement vers cette idée d’une formation simultanée. Je crois que le système est aujourd’hui beaucoup moins défensif qu’il ne l’a été.