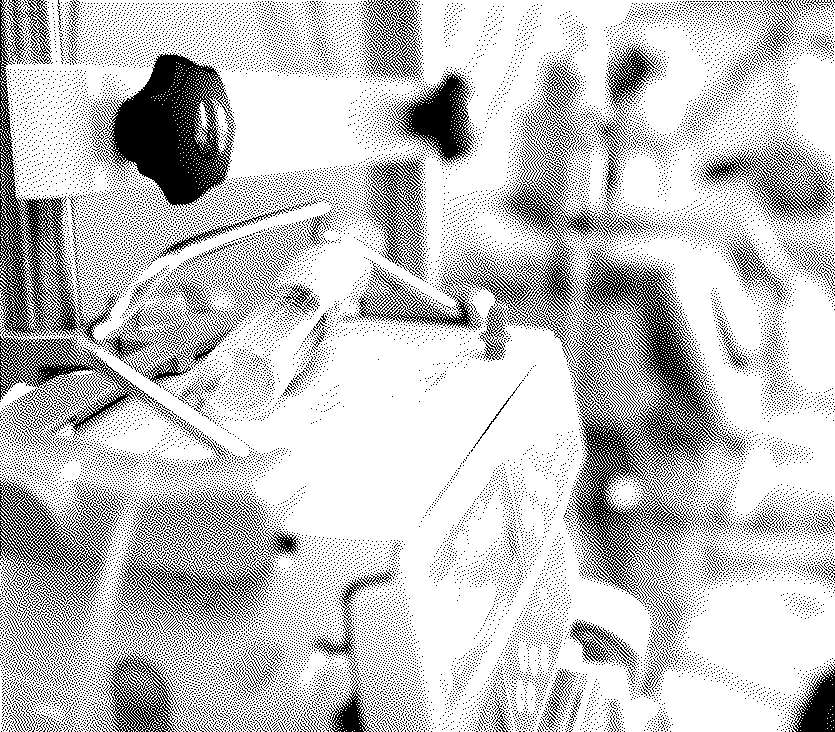Accédez au dossier complet : Fin de vie : quel cadre juridique ?
Ce texte est issu de l’audition de Corine Pelluchon par le CCNE qui a eu lieu le 14 septembre 2021, à Paris.
Les citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur la fin de vie sont invités par la Première ministre à répondre à la question suivante : « Le cadre d’accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? »
.
Quand on s’interroge sur une décision qui concerne la société entière et doit instituer le bien commun, il ne s’agit pas de donner son avis personnel qui peut refléter ses craintes et être lié à ses croyances ou dépendre de son vécu. Tout cela est important, bien sûr, et nous savons que, sur ce sujet, il y a des divisions. Ces divisions concernent essentiellement ce que le patient est en droit d’attendre de l’institution médicale. Elles sont également liées à la manière dont les professionnels de santé appréhendent leur mission et incluent ou non dans le soin l’autorisation et l’encadrement de l’aide au suicide, que celle-ci prenne la forme de l’euthanasie (les soignants administrent la substance létale au malade), du suicide assisté (ils prescrivent cette substance que la personne ingère elle-même) ou qu’ils se bornent à délivrer, après examen, une ordonnance laissant au patient la possibilité d’ingérer ou pas le produit létal (comme c’est le cas avec le Death With Dignity Act mis en place dès 1997 dans l’État de l’Oregon, aux Etats-Unis).
Pourtant, ce n’est pas sur les raisons justifiant ces positions divergentes que je vais insister. Il est important d’expliciter les arguments qui opposent chacun des camps. Cependant, quand on légifère, il s’agit d’aller au-delà de nos différends afin de parvenir à un accord sur fond de désaccords qui ne soit pas un compromis ne satisfaisant personne ni un statu quo, mais une décision permettant d’avancer. Pour cela, il faut bien connaître la législation actuelle, reconnaître, en l’occurrence, les avancées réalisées par la loi du 22 avril 2005 puis par la loi Claeys-Leonetti (2016). On peut alors se demandersi ce dispositif législatif a laissé en suspens quelques questions. Si c’est le cas, il convient de voir comment y répondre en circonscrivant le sujet, c’est-à-dire en disant ce qu’il est légitime de faire, ce qui ne l’est pas, et pour quelles raisons.
Dans le passé, j’ai exprimé quelques réserves à propos d’une ouverture médicale au suicide. Toutefois, dès 2014, j’avais reconnu que la loi Leonetti (2005) laissait en suspens une question qui ne tarderait pas à ressurgir et qu’il faudrait examiner. Quant à la loi de 2016, elle ne répond pas aux personnes en phase terminale ou avancée d’une maladie grave et incurable, qui ne veulent plus avoir recours aux soins palliatifs ou n’en veulent pas, et qui ne souhaitent pas non plus avoir recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Certains malades n’ont pas envie d’attendre d’être éligibles pour pouvoir bénéficier de cette sédation profonde et continue qui est proposée quelques jours avant le terme naturel de sa vie. Que répondre à ces personnes qui demandent une aide médicale à mourir leur évitant de recourir à une solution violente ou douloureuse (empoisonnement, défenestration) ou de partir en Suisse ? J’avais déjà répondu qu’il n’y avait pas vraiment d’argument à objecter à celles et ceux qui sont dans cette situation. Il convenait alors de préciser les modalités que pourrait prendre cette aide médicalisée à mourir. Le fait de prendre en considération est également nécessaire pour nous prémunir contre une loi brutale venant en réaction à l’absence de réponse apportée aux malades qui ont des demandes persistantes de mort. À force d’écarter tout dialogue, on risque, en effet, de laisser le champ libre à celles et ceux qui demandent l’ouverture d’un droit au suicide assisté ou à l’euthanasie s’étendant aux personnes souffrant de la vie, aux schizophrènes, aux vieillards déments et à toutes les personnes fragilisées par la maladie et auxquelles il est facile d’induire une demande de mort. Enfin, l’une des questions à se poser est de savoir s’il existe un risque de confusion des genres lorsque le suicide assisté et l’euthanasie sont réalisés par des soignants à l’endroit où ils prodiguent des soins.
Selon moi, une évolution de la loi ouvrant la possibilité pour certains malades de bénéficier d’une aide médicale à mourir est envisageable, à condition qu’on la présente comme un ultime recours, et non comme l’expression d’un « droit » à mourir dans la dignité ni même d’une liberté. Il s’agit du choix, finalement assez rare, de quelqu’un qui est en phase avancée ou terminale d’une maladie et qui, sachant que ses jours sont comptés, n’a pas envie de mourir déshydraté ou préfère que les choses se passent un peu plus vite, de façon moins stressante pour lui et pour son entourage. Nul ne peut savoir à l’avance comment il réagira à l’approche de sa mort ni prévoir les maladies dont il souffrira. On parle de la fin de vie, mais il y a des fins de vie, qui sont toutes différentes parce que les personnes sont uniques, mais aussi parce que les pathologies posent des problèmes spécifiques et évoluent de manière différente.
Ce préambule un peu long sert à préciser deux choses. Premièrement, on ne doit pas être dans l’idéologie ni s’arc-bouter sur ses croyances ou représentations substantielles du bien si l’on veut instituer le bien commun ou, plutôt, décider d’une loi qui ne fasse pas de mal aux soignants et aux citoyens. Parmi ces citoyens, il y a ceux qui, comme moi, se méfient d’une société où le suicide assisté et l’euthanasie seraient facilités et deviendraient des solutions rapides et économiques à une offre insuffisante en soins palliatifs. Cependant, il s’agit aussi de personnes qui connaissent des malades ayant des demandes persistantes de mort et que l’on n’écoute pas.
Il importe toutefois d’éviter les amalgames et même les analogies, comme celle qui est souvent faite entre l’IVG et l’aide médicalisée à mourir. La législation en faveur de l’avortement a d’abord répondu à un enjeu de santé publique visant à encadrer l’interruption de grossesse et à protéger les femmes des conséquences sanitaires liés aux avortements clandestins. L’enjeu d’une aide médicalisée à mourir est différent parce que, s’il est vrai que certaines demandes d’euthanasie et de suicide assisté viennent de personnes mal accompagnées ou qui meurent dans des conditions déplorables et s’il est possible de prendre en considération les demandes persistantes, on ne peut pas dire que, de manière générale, l’ouverture d’une aide médicale à mourir est la solution pour bien mourir.
En outre, il convient de rappeler le rôle des lois qui ne peuvent se substituer à l’exercice du jugement moral en situation qui est au cœur de la décision médicale et du pacte de soin. Les lois encadrent les pratiques et visent à éviter les abus de pouvoir et les dérives. Mais elles ne peuvent prévoir toutes les situations ni se substituer au dialogue entre un malade et une équipe de soins. Enfin, quand on légifère, on ne peut pas faire l’économie de l’historicité des lois. À ce sujet, la comparaison entre la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie sur la demande expresse des patients en Belgique au début des années 2000 et le dispositif législatif français n’est pertinente que jusqu’à un certain point. Car avec la loi Leonetti et l’encadrement des limitation et arrêt de thérapeutiques actives (LATA), le législateur a posé le problème des limitations et des arrêts de traitements chez les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté. Ainsi, une éventuelle évolution du dispositif juridique doit tenir compte de ce cadre antérieur et conduire à bien circonscrire le sujet en désignant le type de patients que l’aide médicale à mourir pourrait concerner dans l’hypothèse où elle serait autorisée et encadrée par la loi.
Deuxièmement, il est important de prendre en compte le contexte, qui renvoie à l’êthos de chaque pays, mais aussi à l’époque ou à l’air du temps qui s’immisce partout, dans les hôpitaux, dans les urnes, dans les centres de vaccination et dans la rue. Certaines revendications au nom de la liberté sont l’expression de frustrations qui, parce qu’elles ne sont pas entendues par les pouvoirs publics ou qu’elles n’ont pas d’espace pour pouvoir s’exprimer et être métabolisées, se déplacent. Elles se traduisent parfois par des demandes témoignant surtout d’une défiance à l’égard des représentants de l’autorité et donc des corps de métier auxquels est associée l’autorité (médecins, scientifiques, experts, etc). Un tel contexte est favorable à celles et ceux qui récupèrent les sujets de société appartenant à tous et dépassant le clivage droite/gauche (comme c’est le cas des questions dites de bioéthique) pour diviser la société.
Au contraire, légiférer de manière sage suppose de sortir de l’idéologie et d’avoir un esprit constructif. Pour savoir si la loi actuelle doit évoluer, il faut se poser deux questions. La première consiste à se demander quelles personnes seraient concernées par une éventuelle ouverture à l’aide médicalisée à la mort et quelles personnes ne le seraient pas. La deuxième question porte sur les modalités que pourrait prendre cette aide médicalisée à mourir si elle était autorisée. Doit-elle impliquer les soignants et, si oui, dans quelles conditions, avec quelles limites ou restrictions ? Mais d’abord, que répondre aux malades qui ont des demandes persistantes de mort ?
Y a-t-il une objection à formuler à l’encontre des personnes en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable qui demandent l’aide médicale à mourir ? Faut-il adopter une autre loi ou bien ajouter une disposition à la loi existante ?
Les progrès réalisés depuis la loi du 22 avril 2005 dite loi Leonetti sont réels. Les soins palliatifs se sont développés, même si leur répartition est inégale, qu’ils sont proposés souvent tard et que beaucoup de personnes meurent encore aux urgences. L’apport majeur de la loi de 2005 est l’encadrement des décisions de limitation et d’arrêt des traitements chez les personnes incapables d’exprimer leur volonté. Quant à la loi du 2 février 2016, qui a été élaborée en partie dans le contexte difficile de l’affaire Vincent Lambert, elle répond à de nombreux cas.
Comme on l’a vu avec le cas Vincent Lambert, il n’y a pas d’interprétation universellement partagée de l’obstination déraisonnable. Ce cas a aussi souligné les difficultés d’application de la loi Leonetti, laquelle suppose, quand le malade n’a ni directive anticipée ni personne de confiance, que la famille s’entende sur la poursuite ou l’arrêt des traitements et sur ce qu’elle estime devoir correspondre à la volonté du patient. La division existant au sein de cette famille expliquait qu’aucune décision d’interruption des traitements ne pouvait être prise. Cela ne signifie pas que la loi Leonetti soit inadaptée aux malades souffrant des mêmes lésions cérébrales que Vincent Lambert. Mais, dans un contexte général caractérisé par des divisions familiales et par l’érosion de l’autorité médicale, il semblait nécessaire de faire basculer le dispositif juridique associée à la loi Leonetti, dont on a souvent dit qu’il avait été mis en place pour protéger les médecins de toute poursuite pénale, vers une affirmation plus grande de l’autonomie des personnes. Ainsi, la solution était de rendre les directives anticipées (plus) contraignantes, comme cela a été inscrit dans la loi du 2 février 2016.
Quant à l’adjonction, à la version ancienne de la loi Leonetti, de la possibilité d’avoir une sédation profonde et continue en phase terminale pour les malades qui peuvent ainsi s’éteindre en dormant, cela répond à la demande de beaucoup de patients. Rappelons que, dans les soins palliatifs, la sédation palliative est levée pour que le malade redevienne conscient et puisse recevoir ses proches quelques instants. Cette pratique est justifiée par une réflexion qui fait de la mort un processus et de la personne mourante une personne encore en vie, et non déjà morte. Elle est liée aussi à la reconnaissance de l’importance, en fin de vie, du maintien des relations sociales permettant à la personne de dire au revoir à ses proches et à ces derniers de se préparer à la séparation. Cependant, la sédation palliative n’a parfois plus de sens en toute fin de vie, quand la personne est prête à mourir et qu’elle est trop épuisée pour recevoir ses proches. C’est pourquoi beaucoup de malades souhaitent une sédation profonde et continue jusqu’à la mort. Cette sédation peut éventuellement hâter leur mort, laquelle est, de toute façon, imminente.
Toutefois, la sédation profonde et continue en phase terminale que l’on trouve dans la loi du 2 février 2016 ne répond pas à celles et ceux qui ne veulent pas mourir ainsi. Ces patients sont peu nombreux, mais on ne peut pas les exclure. La loi de 2016 ne s’applique, en outre, qu’aux malades en toute fin de vie (avec un pronostic de quelques heures ou de quelques jours), et non aux malades en phase terminale ou avancée d’une maladie ni aux personnes atteintes d’un mal incurable ayant formulé en amont leur vœu de ne pas vivre dans telle ou telle condition. Ainsi, le dispositif juridique actuel comporte une lacune évidente. La question est de savoir comment la combler.
Si un nouveau dispositif prévoyant une aide médicale à mourir est envisagé, doit-il s’appliquer aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais ont développé une maladie incurable, et sont à un stade avancé de cette maladie ? Doit-on aussi inclure les personnes qui sont hors d’état d’exprimer leur volonté et qui ont communiqué dans une directive anticipée leurs souhaits ou dit ce qu’elles n’accepteraient pas ?
Mais, d’abord, y a-t-il un argument pouvant objectivement fonder le refus d’ouvrir une aide médicalisée à un malade en phase terminale ou avancée d’une maladie incurable qui a eu accès aux soins pallaitifs et n’en veut plus ou n’en veut pas, et qui refuse d’attendre le délai le rendant éligible pour une sédation profonde et continue (soit quelques heures ou quelques jours avant le terme naturel de sa vie) ? Si cette aide médicale à mourir est proposée comme un dernier recours, et non comme une solution à mettre sur le même plan que les soins palliatifs ni comme l’expression d’une liberté, pourquoi la refuser à celles et ceux qui la demandent ? Est-il juste d’abandonner une personne à la peur de mal mourir en ne lui laissant comme option que la sédation profonde et continue qui vient tard dans le processus de soins et, dans certains cas, peut entraîner une mort lente et parfois traumatisante pour les proches (déshydratation, dénutrition) ?
Au lieu de présenter l’aide médicale à mourir comme une option qui est un acte de liberté et une conquête, il convient d’insister sur le fait qu’il s’agit d’un dernier recours, c’est-à-dire d’une option qui peut être envisagée dans le contexte médical quand on reconnaît que la mort est proche, que la médecine ne peut plus guérir la personne ni lui offrir des conditions de vie supportables, et que les traitements comme les soins n’ont plus de sens. On permet au patient en phase avancée ou terminale d’une maladie qui le souhaite de mourir avant que sa situation ne devienne vraiment intolérable pour lui et pour ses proches. Le vocabulaire de la fierté et du défi ne convient pas à cette situation qui impose, au contraire, la modestie. Il n’est pas question de prouver que l’on est maître de sa vie, mais d’éviter que les choses ne dégénèrent et ne deviennent terrifiantes, ce qui peut arriver lorsque le corps se décompose. La mort est déjà annoncée, elle est pour ainsi dire visible sur le visage du malade, et on va faire en sorte que la personne qui souhaite mourir plus vite ait accès à une assistance médicale. Ainsi, envisager une ouverture à une aide médicale à mourir suppose que le sujet soit circonscrit aux malades atteints d’une maladie incurable et qui rend la vie de la personne insupportable. Il ne s’agit pas d’aider quelqu’un qui veut se suicider à se supprimer ! Le suicide ne doit jamais être facilité parce qu’il est une tentation, même quand on est en bonne santé.
Par conséquent, respecter la demande d’une personne en phase avancée et terminale d’une maladie incurable qui veut qu’on l’aide à mourir suppose que l’on procède à un examen au cas par cas. Encore une fois, il est important que la loi ne présente pas la demande d’aide médicale à mourir comme l’expression et l’accomplissement de sa liberté. Cette demande n’équivaut pas à un acte libre récapitulant ce que l’on a été. Cette surdétermination de la mort et du suicide assisté n’a pas lieu d’être. Une œuvre m’exprime, voire me justifie. Demander la mort quand on est malade n’est pas un accomplissement, mais un dernier recours. Il traduit l’aveu que les thérapeutiques ont échoué. La volonté ici baisse pavillon. La personne dit qu’elle ne supporte plus les conditions de vie que la maladie et les traitements lui imposent et qu’elle préfère partir. C’est un choix par défaut, et il peut se comprendre. Ainsi, ceux qui font du suicide assisté ou de l’euthanasie une conquête et le sommet de la liberté se méprennent sur l’existence humaine, sur sa contingence et sur le fait qu’on n’a pas à mourir comme on a vécu. On ne meurt pas forcément comme on a vécu.
Si je meurs d’Alzheimer, je ne mourrais pas comme j’ai vécu, puisque j’ai vécu pour la pensée et que, si j’avais la maladie d’Alzheimer, je ne philosopherais pas. Cela ne veut pas dire que je ne serais rien, que je n’aurais plus de dignité, mais je ne serais pas celle que j’ai été ou voulu être. Du côté des palliativistes comme des pro-euthanasie, il y a une surdétermination de ce moment de la mort qui est problématique. Oui, la mort a une autorité. Car c’est parce que nous sommes finis que nous essayons de donner existence à ce qui compte pour nous, et qu’un sentiment d’urgence peut s’installer à mesure que nous vieillissons ou lorsque nous avons failli perdre la vie. De même, c’est surtout quand quelqu’un meurt que l’on saisit ce qui le rendait unique et mérite d’être rappelé. Mais on peut mourir d’un accident de piéton, comme Roland Barthes, ou de voiture, comme Albert Camus, et cette manière-là de mourir ne dit rien de leur génie.
Il faut également se garder de l’expression « mourir dans la dignité » (que l’on trouvait à l’article 4 de la proposition loi du député Olivier Falorni dont seul l’article 1 a été débattu au Parlement en 2021). Encore une fois, il importe de présenter l’évolution législative sur l’aide active à mourir sans en faire une revendication exprimant la liberté de l’individu. Car un tel glissement sémantique préparerait le terrain à un droit au suicide assisté et à l’euthanasie pour tous ceux qui le demandent, ycompris ceux qui sont dépressifs.Toute personne malade ou en proie à une souffrance psychique et demandant une aide médicale pour se supprimer serait éligible si l’on ouvrait un droit au suicide assisté en le considérant comme l’expression d’une ultime liberté.
Pour être légitime, une loi sur l’aide active à mourir ne pourrait donc être que la réponse à des cas auxquels la législation actuelle ne répond pas et qu’elle laisse sur la route. C’est pourquoi il ne s’agit pas de faire voter une autre loi ouvrant le droit à l’aide médicale à mourir, mais de modifier la législation existante en intégrant ce dernier recours que le dispositif actuel n’a pas pris en considération. En outre, il s’agit de l’envisager en rendant possible une évaluation au cas par cas. Cela implique donc conserver le cadre actuel en lui adjoignant cette option considérée comme ultime recours jugé légitime dans certaines conditions soumises à l’évaluation d’un comité de médecins. Il n’est pas question de voter une autre loi contredisant l’esprit des lois existantes et trahissant l’esprit du législateur qui s’est parfaitement exprimé dans la loi du 22 avril 2005 et dans celle de février 2016 en prônant une éthique conforme aux valeurs du soin et en refusant de faire de l’euthanasie et du suicide assisté des réponses banales au problème de la souffrance en fin de vie. En encadrant l’aide médicale assistée et en la présentant comme un utile recours, on considère qu’abandonner les malades auxquels le dispositif juridique actuel ne répond pas serait contraire à l’éthique du soin.
De manière générale, il importe de faire attention à ne pas confondre le mot « dépénalisation » et le mot « légalisation ». Dépénaliser l’assistance médicalisée à la mort dans certaines circonstances précises où c’est un ultime recours n’est pas la même chose que la légaliser. Car il est moins question d’un un « droit » au suicide que de l’accès à une aide médicale à mourir représentant une solution de dernier recours et qui, loin d’être autorisée pour toute personne, reste de manière générale et pour la majeure partie des cas, interdite. Plus précisément, l’idée qui est au cœur de la proposition que je fais en adjoignant au dispositif juridique actuel, qui reste le cadre général, une option comportant l’aide médicale à mourir comme ultime recours est la suivante : l’échec des thérapeutiques et la situation d’impasse dans laquelle se trouvent certains malades en phase avancée ou terminale d’une maladie imposent un discernement moral conduisant à l’invention de conduites appropriées qui satisfont à l’exception que demande la sollicitude envers un malade en trahissant le moins possible la règle, qui est de soigner les personnes et de les accompagner jusqu’à la fin. La loi redonne la main aux principaux intéressés, c’est-à-dire au malade et aux soignants. Ainsi, après avoir évalué au cas par cas les demandes des malades dans le cadre d’une procédure collégiale, on met à la disposition de ceux qui sont éligibles les moyens pharmacologiques et médicaux nécessaires au suicide assisté ou à l’euthanasie, c’est-à-dire qu’on l’accompagne.
Il est très important de veiller à la continuité des lois. Même quand on apporte un complément qui, sur certains points, peut apparaître comme une évolution majeure, il est crucial de ne pastrahir l’esprit des lois existant dans un pays.Cette remarque souligne aussi les limites de la comparaison entre les différents pays : calquer la législation belge ou hollandaise sur le droit français n’a pas de sens. On peut s’inspirer des dispositions que d’autres pays ont prévues (critères de minutie a posteriori, collégialité, etc.), mais il faut tenir compte de l’historicité des lois.
Jusqu’où faut-il aller ? Quelles personnes seraient concernées et quelle forme prendrait cette aide médicale ? Faut-il impliquer les soignants ?
Par le passé, j’étais très réticente au fait d’impliquer les soignants dans cette procédure et je la réservais aux malades en fin de vie, donc aux personnes ayant une espérance de vie de moins de 6 mois, voire de moins de 3 mois. Pour moi, qui ne trouvais pas d’objection à l’ouverture d’une aide pharmacologique au suicide (comme dans l’État de l’Oregon, où le médecin se borne à vérifier que le malade a une demande éclairée et est en fin de vie et où il délivre seulement l’ordonnance permettant au malade d’avoir à sa disposition le produit létal que, parfois, il n’ingère pas), ce dispositif ne pouvait pas impliquer davantage les soignants. Car ces derniers, pour la plupart, ont du mal à inclure dans le soin l’aide médicale au suicide et l’euthanasie. En outre, je craignais une confusion des genres : réaliser ce geste sur les lieux de l’hôpital, donc à un endroit où on demande aux professionnels de santé de tout faire pour sauver une personne, et où l’on réalise des limitations et des arrêts des thérapeutiques actives (LATA), cela faisait de l’hôpital un lieu ambivalent. De manière générale, la priorité, dans un premier temps, est de tout faire pour sauver le malade, puis de réfléchir à ce qui est mieux pour lui, aux traitements qui sont proportionnés à son état et à l’évolution de sa pathologie. Si l’aide active à mourir est facilitée, cela peut conduire, dans le contexte actuel (marqué par un manque de temps, de personnel et de lits à l’hôpital), à ne pas donner toutes les chances au malade.
Il importe d’exclure de l’aide médicale à mourir les personnes dépressives, les schizophrènes, les mineurs. Elle est donc réservée aux personnes en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable qui en font la demande expresse. On reconnaît que ces patients, à un moment donné, jugent que les soins relèvent de l’acharnement et qu’ils n’ont plus de sens. Ils ont eu du sens et il faut tout faire pour que la personne sente qu’ils en ont encore. Cependant, il y a parfois un acharnement dans l’accompagnement et le malade a le sentiment d’avoir une fin de vie qui est absurde.
Dans ce cas, cette demande de mort n’est pas le résultat d’une dépression. La dépression peut résulter de cette situation médicale, mais quand une personne dans un état grave qui est une impasse pour elle et qui a trop duré demande la mort, c’est sa maladie et non la dépression qui explique sa demande. Lui dire qu’elle demande la mort parce qu’elle est dépressive est lui manquer de respect.
La dépression est une souffrance psychique à laquelle il ne faut pas répondre par l’aide médicale à la mort. En effet, la souffrance psychique et la dépression, quand elles ne proviennent pas d’un état objectif lié à une maladie, impliquent par définition l’envie de mourir. Une personne dépressive ou en souffrance psychique qui n’a pas envie de mourir est simplement déprimée. La dépression est un enfer ; elle colore tout en noir, si bien que plus rien n’a de sens. L’accompagnement consiste d’abord à faire comprendre à la personne qui souffre que la dépression est un piège qui lui donne le sentiment d’être dans une impasse ou condamnée à la répétition. Il y a toujours des raisons qui interviennent dans une dépression (les déceptions, les trahisons, les conditions de travail, la souffrance animale, l’écoanxiété, l’engagement, le burn-out, etc.). Mais toutes les raisons de désespérer ne produisent pas une dépression et lasouffrance psychique a cette dynamique, presque délirante, qui fait que tout devient infernal. Mais un jour, on en sort, alors qu’on ne vainc pas un cancer en phase terminale. Un jour, bien que certains problèmes demeurent, on a de nouveau l’énergie pour leur faire face. Pour toutes ces raisons, il ne faut jamais donner à un dépressif les moyens de se tuer. Il faut, au contraire, l’empêcher de passer à l’acte et le confier à un psychologue ou à un psychiatre qui saura l’accompagner.
Le cas des personnes qui ne sont pas forcément dépressives, mais qui n’ont plus du tout l’énergie de continuer à vivre dans les conditions que leur imposent leur pathologie et les effets des traitements, est complètement différent. Elles savent que ces derniers ne font que retarder un état qui empire. Peu de personnes demandent à mourir, mais celles qui le demandent souffrent énormément quand on ne les entend pas, et, comme leurs proches, elles en veulent ensuite au monde entier. Ainsi, parce que beaucoup de malades s’accrochent à la vie et que peu de demandes de mort sont persistantes, il est impératif de les évaluer au cas par cas : la demande de mort doit être persistante et éclairée ; elle doit être le fait de quelqu’un qui a parcouru un long chemin thérapeutique et qui est au bout, et cet examen doit être réalisé par plusieurs médecins, donc de manière collégiale et en suivant une procédure.
Enfin, on doit s’interroger sur la place qu’il convient d’accorder aux directives anticipées. Il importe aussi de se demander comment les directives anticipées peuvent tenir compte du fait que l’on peut changer d’avis au cours du temps.
On connaît le fameux disability paradox : à l’annonce du diagnostic (Alzheimer, par exemple), la personne se dit : je ne veux pas devenir comme cela, donc je rédige ma directive anticipée en demandant la mort. Puis, au fil du temps, l’identité se modifie, et il est possible que la personne qui a exprimé auparavant le souhait de mourir si elle perdait ses capacités cognitives exprime, au stade intermédiaire ou avancé de la maladie, une certaine joie de vivre. En outre, il faut éviter que le suicide assisté et l’euthanasie soient facilités, car ce serait les substituer à l’accompagnement qui est très exigeant. Tout le monde est, avec les maladies dégénératives du système nerveux, dans un royaume d’inconnaissance régi par des intermittences : de temps en temps, le malade d’Alzheimer a un éclair, une présence, puis il n’est plus là. De temps en temps il répond, ses capacités cognitives sont pour ainsi dire allumées, puis elles s’éteignent de nouveau : il vous reconnaît, vous le reconnaissez, puis, le lendemain, il confond sa mère et sa fille.
J’aurais tendance à exclure les malades d’Alzheimer d’un dispositif donnant accès à une aide médicale à mourir au nom du sens du soin et du fait que l’accompagnement de ces malades consiste précisément à leur procurer une vie de qualité au présent. Pourtant, il est possible que certaines personnes, au stade intermédiaire de la maladie, n’aient pas envie de vivre en étant totalement dépendantes et en laissant à leurs proches une image d’elles-mêmes ne correspondant pas aux valeurs qui ont été les leurs.
Quoi qu’il en soit, certains citoyens vont demander à ce que les malades d’Azlehiemer qui ont exprimé en amont dans leurs directives anticipées leur volonté de bénéficier d’une aide médicale à mourir soient inclus dans un dispositif donnant la possibilité de bénéficier d’une aide active à mourir. Dans ce cas, il faudrait tenir compte du fait que les individus peuvent changer d’avis. Aussi, il faudrait pouvoir rédiger des directives anticipées de volonté, comme cela se fait en Allemagne. Celles-ci permettent aux personnes, comme c’est le cas avec les directives anticipées classiques, de dire en amont ce qu’elles souhaitent que les médecins fassent ou ne fassent pas quand elles seront devenues incompétentes. L’idée serait qu’un mandataire désigné par le malade soit chargé de vérifier que la directive anticipée, rédigée au moment où il était compétent, exprime toujours sa volonté une fois qu’il est devenu incompétent.
Dans l’hypothèse où l’aide médicale à mourir serait autorisée comme un ultime recours et dans les conditions précisées ci-dessus, quel devrait être le rôle des soignants ? Nous avons vu que la demande de mort du patient en phase avancée et terminale d’une maladie grave et incurable devait être examinée par un collège de soignants. Toutefois, faire en sorte que l’aide médicale soit réalisée devant un médecin ou que ce soit lui qui administre le produit létal est un pas supplémentaire qui implique complètement l’institution médicale. Il est indispensable, dans ce cas, d’introduire une clause de conscience pour les soignants opposés à toute aide médicale à mourir ou ne voulant pas pratiquer d’euthanasie.
Initialement, j’avais opté pour la solution américaine, parce qu’elle donnait au malade éligible au Death with Dignity Act la possibilité d’avoir à sa disposition le produit létal sans forcément se l’administrer. Une solution reposant sur l’autonomie et la responsabilité de la personne et impliquant peu les soignants, qui n’auraient pas à pratiquer l’euthanasie ni à être présents lorsque le malade ingère le produit, me semblait préférable. Mais est-ce que ce n’est pas plutôt une manière pour les soignants de se défausser ? Est-ce qu’on ne doit pas aussi témoigner du fait qu’on accompagne la personne jusqu’au bout, en l’aidant à mourir, au lieu de la laisser seule à faire ce geste ou de laisser un de ses proches le faire à sa place ?
On m’a souvent dit, après le rapport écrit pour Terra Nova puis après l’article que j’ai publié sur ce sujet en 2016 dans la revue Cités, qu’il valait mieux que l’aide médicalisée soit pratiquée par des soignants et devant eux. L’argument qui m’était opposé n’était pas seulement que certains malades n’ont pas la force de s’administrer eux-mêmes le produit – puisque je préconisais que la personne autorise un tiers à le faire. La question était plutôt celle du lieu où l’acte serait accompli.
Aujourd’hui, j’ai tendance à penser que, si l’on veut faire de l’aide médicale assistée à mourir un ultime recours qui s’inscrit dans la continuité des traitements et des soins, il vaut peut-être mieux qu’il soit encadré médicalement et réalisé dans un lieu médical. En effet, renvoyer le malade avec le produit létal chez lui peut poser des problèmes et même exposer d’autres personnes au risque de l’utiliser. Il faudra donc prévoir un endroit dédié à l’aide médicale à mourir, et penser à un rituel qui permette aux proches de vivre cet événement le moins mal possible.
Si l’aide médicale à mourir est présentée non comme l’expression de sa liberté, mais comme un ultime recours, encadré, circonscrit, comme un acte qui signifie qu’on ne veut plus de traitements ni de soins, alors je crois qu’il est possible que la plupart des professionnels de santé le tolèrent. Certains seront réticents, mais, si on ne les blesse pas dans leur mission et dans leurs valeurs, dans ce qui constitue leur identité narrative, et si l’on présente ce complément au dispositif actuel comme étant un ultime recours, comme un moindre mal (comme étant infiniment mieux qu’une loi brutale ouvrant un droit à euthanasier les bouches inutiles), alors la plupart d’entre eux peuvent l’accepter. De fait, peu de patients demanderont à en bénéficier. Mon expérience est que certaines personnes qui étaient pour l’euthanasie et le suicide assisté n’ont pas voulu en entendre parler, même quand elles ont eu à subir des années de chimiothérapie. D’un autre côté, ceux qui formulent des réserves au suicide assisté quand ils sont bien portants, pourraient être soulagés de savoir que cette possibilité existe, s’ils sont un jour au stade avancé ou terminale d’un cancer du cerveau qui récidive.
Enfin, une évolution de la loi vers l’aide active à mourir n’est acceptable que si, en même temps, les soins palliatifs se développent et que la sédation profonde et continue jusqu’au décès est présentée comme une solution possible et qu’elle est pratiquée dans les règles de l’art. Il est crucial, de ce point de vue, de ne pas mettre en concurrence soins palliatifs et assistance médicale à mourir.
Le problème est que, dans les faits, les soins palliatifs sont inégalement répartis sur le territoire et que la prise en charge évolue avec des personnes qui arrivent souvent dans les derniers jours de leur vie, ce implique un turn-over important des patients. En outre, les besoins en soins évoluent en raison du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’affections dégénératives du système nerveux et de polypathologies. Nous ne savons pas bien comment notre système de santé pourra faire face à ces défis dans les années qui viennent.
On ne peut pas non plus laisser les conditions de travail des soignants à l’écart de ce débat, qu’il s’agisse des salaires, du manque de reconnaissance, de la tension quotidienne qu’ils vivent et qui est parfois liée au management ou, plus généralement à la situation de pénurie que connaît l’hôpital public.
Enfin, un large débat public sur le sujet risque d’être affecté par la crise de confiance qui existe entre les citoyens et les responsables politiques. Il importe de veiller à ce que ce sujet ne soit pas récupéré par des personnes qui s’en serviraient soit pour accuser les représentants d’en faire trop (vous ouvrez un droit de donner la mort), soit de ne pas en faire assez (vous êtes hypocrites et laissez mourir de faim et de soif les malades).
Conclusion
Comme toutes les questions sensibles qui supposent un traitement transdisciplinaire, celle-ci exige aussi que chacun soit ouvert, qu’il se documente et appuie son entendement sur celui des autres. C’est en conjuguant nos talents que nous pouvons parvenir à des propositions qui ne déchirent pas le tissu social, n’érodent pas le sens des institutions et ne contredisent pas les valeurs et principes que, par ailleurs, nous affirmons. La justice n’est pas la somme des intérêts, mais la structure de base de la société. Elle ne se confond pas non plus avec ce que souhaitons pour nous-mêmes parce que, pour vivre ensemble et légiférer, il faut négocier, parvenir à des « accords sur fond de désaccords ». Chaque débat, chaque prise de position, chaque avis doivent être l’occasion de montrer l’exemple pour que s’installe un climat apaisé indispensable à une délibération sage et à une législation adaptée sur ces questions difficiles. Enfin, il faut admettre que nul ne peut savoir à l’avance comment il réagira s’il est en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable et si sa fin de vie est lente et douloureuse. Pour bien délibérer, la sagesse pratique doit donc se laisser instruire par la sagesse tragique qui commande de ne pas s’arc-bouter sur ses certitudes présentes et d’éviter de les défendre de manière dogmatique.