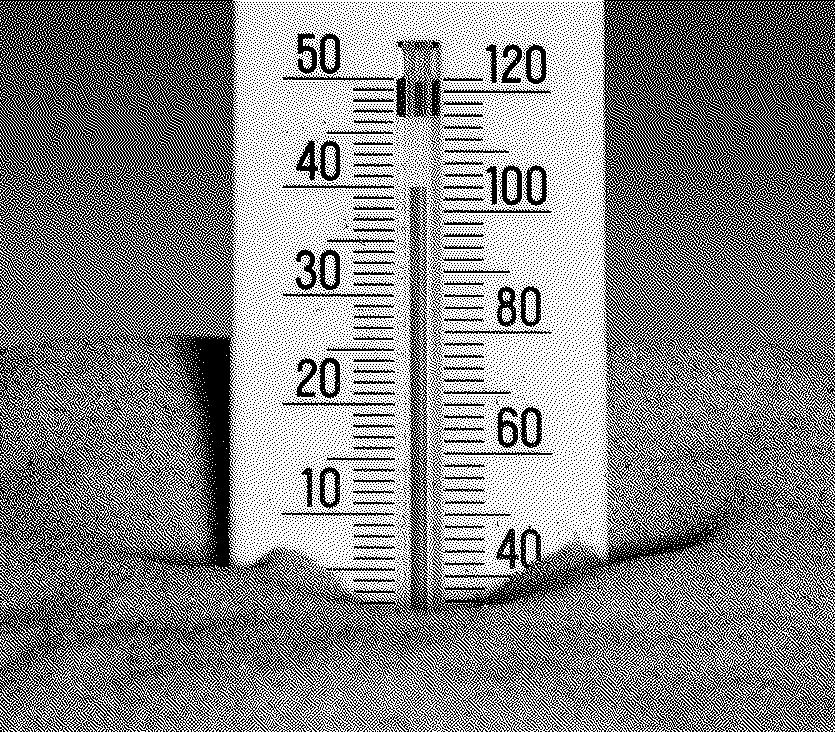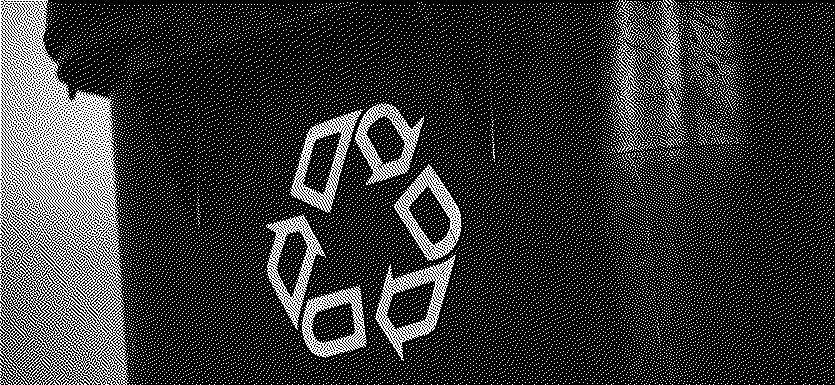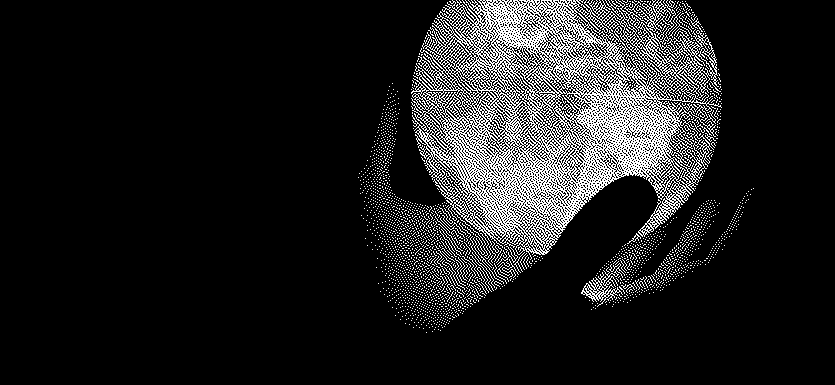Les scientifiques n’ont cessé de nous avertir, avec une intensité toujours plus grande, que la planète se dirigeait à toute allure vers des points de basculement climatiques. Malgré les nombreux engagements pris au niveau international, il est de plus en plus improbable que l’on parvienne à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°c : sur la base des tendances actuelles, ce seuil pourrait même être franchi dès 2028.
Dans le même temps, la perte de biodiversité s’accélère à un rythme sans précédent, avec des conséquences désastreuses pour les communautés vulnérables et pour l’humanité dans son ensemble. Un climat stable et des écosystèmes sains sont inextricablement liés, et leur dégradation induit le risque de catastrophes en cascade.
Certes, des progrès ont été accomplis sur ces deux fronts. L’accord de Paris de 2015 était, en son temps, l’accord climatique le plus ambitieux parmi ceux qui étaient politiquement faisables. Basé sur un modèle « d’engagement et d’examen », il a fixé un objectif global ambitieux mais réalisable et a introduit des mécanismes destinés à assurer une large participation, tout en fixant un cadre permettant d’évaluer les engagements nationaux au regard de l’objectif commun.
En 2022, la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) a adopté le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui suit une approche similaire. Bien que certains grands pays comme l’Inde soient restés loin derrière, on espérait qu’ils finiraient par se rallier à l’initiative à mesure que l’élan mondial se poursuivrait.
Cet optimisme a été de courte durée. Dès le premier jour de son second mandat, le président américain Donald Trump a signé un décret intitulé « Libérer l’énergie américaine » et a annoncé que les États-Unis se retireraient une nouvelle fois de l’accord de Paris, qualifiant le changement climatique de « canular ».
Les gouvernements et la société civile sont désormais confrontés à un défi considérable : élaborer des stratégies viables pour atteindre les objectifs en matière de climat et de biodiversité, en l’absence des États-Unis.
Dans un récent rapport Bruegel-CEPR, nous explorons les moyens d’y parvenir. Nous commençons par observer que si les États-Unis restent un gros émetteur de gaz à effet de serre (GES), leurs politiques sont loin de déterminer à elles seules le sort de la planète. La bataille décisive se livre désormais dans les pays émergents et en développement, qui représentent deux tiers des émissions actuelles et abritent l’essentiel de la biodiversité mondiale.
Ces pays doivent de toute urgence passer à une croissance à faible émission de carbone et respectueuse de la nature. Mais ils se heurtent à des obstacles considérables : des besoins d’investissement massifs, un coût du capital élevé, une marge de manœuvre budgétaire contrainte – et des priorités de développement urgentes.
Une action climatique significative nécessitera donc des partenariats économiques mutuellement bénéfiques qui alignent les objectifs mondiaux en matière d’émissions sur les besoins de développement des pays émergents. Dans notre rapport, nous identifions quatre types de partenariats qui pourraient servir de piliers à un nouveau cadre de coopération. Le premier est une alliance pour la tarification du carbone, étayée par un mécanisme commun d’ajustement carbone aux frontières (MACF).
Si les réglementations et les subventions sont importantes, la tarification du carbone est nécessaire pour inciter les entreprises et les ménages à réduire leurs émissions. Mais sans garde-fous, elle risque de créer des distorsions commerciales en donnant un avantage concurrentiel aux pays qui ne donnent pas de prix au carbone ou qui le fixent à des niveaux trop bas pour inciter réellement à la décarbonation. C’est la raison d’être du MACF de l’Union européenne, qui ne s’appliquera dans un premier temps qu’à une poignée de produits à forte intensité de carbone, comme l’acier et le ciment mais devra graduellement s’étendre.
Pour relever ce défi, nous proposons de créer une coalition climatique de pays développés et de pays en développement qui s’engageraient à fixer tous un prix plancher pour le carbone, différencié selon le niveau de revenu. Les membres bénéficieraient d’exemptions mutuelles du MACF et auraient accès au financement, à la technologie et aux marchés. L’UE, par exemple, pourrait collaborer avec tout pays désireux de fixer un prix du carbone significatif, y compris les États-Unis – s’ils revoient leur position actuelle – et la Chine.
De nombreux pays en développement installent encore des centrales électriques au charbon fortement émettrices, parce que celles-ci mobilisent beaucoup moins d’investissements en capital que des alternatives plus écologiques. Le deuxième pilier doit donc être une coalition de financement climatique dédiée à la décarbonisation de la production d’électricité dans ces pays.
Pour accélérer ce changement, il va falloir combler un énorme déficit d’investissement : les dépenses annuelles consacrées aux énergies propres dans les pays en développement doivent quadrupler d’ici à 2030 pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Mais le coût du capital dans les pays émergents est souvent deux fois plus élevé que dans les économies avancées, ce qui rend les énergies renouvelables artificiellement chères malgré la baisse des coûts des technologies solaires et éoliennes.
Nous proposons des accords par lesquels les économies développées fournissent un financement climatique en échange de l’engagement vérifiable des pays en développement à atteindre des objectifs ambitieux d’émissions nettes nulles. L’UE, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, par exemple, pourraient financer les efforts de décarbonisation du Sud pour un coût annuel inférieur à 0,3 % de leur PIB combiné – un investissement modeste par rapport aux dommages climatiques qu’un tel accord permettrait d’éviter.
Le troisième pilier est un partenariat industriel vert entre l’UE, le Royaume-Uni, la Norvège et certains pays du Sud. Compte tenu de son potentiel limité en matière d’énergie renouvelable, l’Europe continuera à dépendre des importations d’énergie. Mais plutôt que d’expédier de l’électricité verte à travers les océans, il serait plus efficace de délocaliser les productions à forte intensité énergétique dans les pays émergents riches en ressources.
Les politiques industrielles européennes favorisent actuellement les secteurs à forte intensité énergétique et subventionnent leur décarbonation. Une approche plus intelligente consisterait à soutenir les industries à forte valeur ajoutée en aval, tout en supprimant progressivement les protections pour les productions amont, qui ne seront pas compétitives.
Le quatrième pilier est la création de marchés pour l’élimination du carbone et la protection de la nature. Atteindre des émissions nettes nulles implique des émissions nettes négatives après 2050, mais l’élimination du carbone – qu’elle soit technologique ou naturelle – reste insuffisante et fragmentée.
Deux innovations pourraient contribuer à accroître les incitations à l’établissement de ces marchés. La première est l’introduction de certificats de dépollution, qui permettraient aux émetteurs de contracter une dette carbone et de la rembourser sous la forme d’absorptions futures vérifiées, financées à grande échelle par la demande du marché.
Une autre solution potentielle est la création de « actions nature » (nature shares), une nouvelle catégorie d’actifs financiers conçus pour soutenir les investissements à long terme dans les régions riches en biodiversité. Contrairement aux compensations carbone conventionnelles, qui sont souvent confrontées à des problèmes de crédibilité, les actions nature offriraient un flux régulier de dividendes résultant de l’élimination du carbone et de la préservation de la biodiversité, dont le prix serait fixé de manière transparente et qui serait soutenu par une gouvernance publique solide. Ces outils permettraient aux marchés de traiter la nature non pas comme un passif, mais comme un actif.
L’Union européenne joue un rôle central dans l’avancement de ce programme. Grâce à la maturité de son marché du carbone et à sa crédibilité réglementaire, elle est bien placée pour servir de colonne vertébrale aux nouvelles coalitions internationales. À cette fin, elle doit accélérer ses propres réductions d’émissions, étendre le MACF et forger des partenariats industriels significatifs. Dans un monde proche de la catastrophe climatique, c’est une opportunité rare de montrer l’exemple.