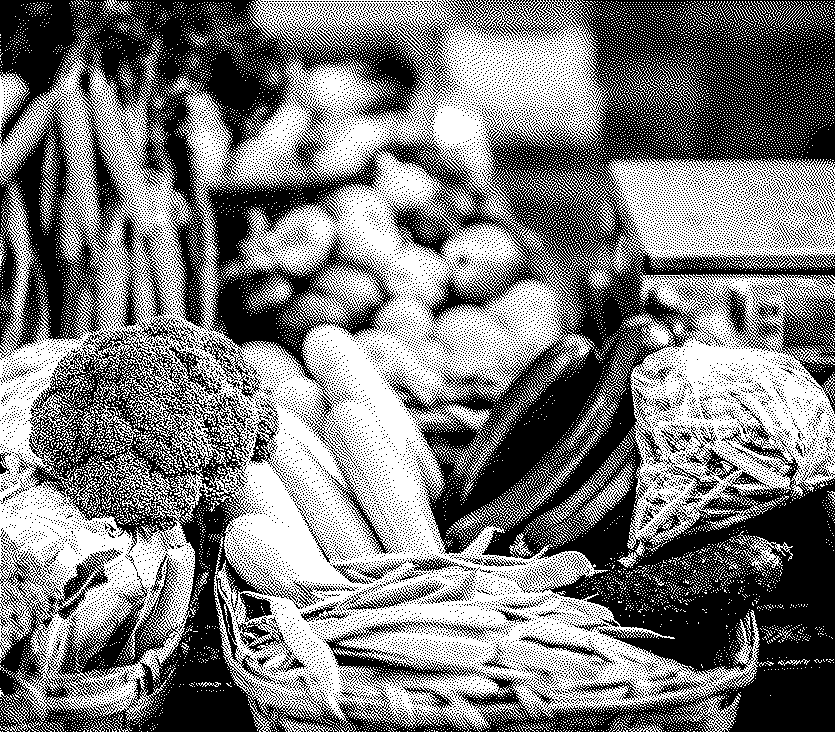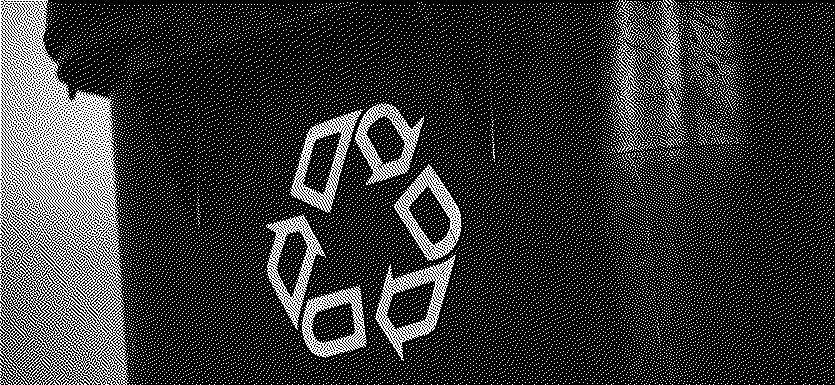I. Une stratégie née d’un processus particulier
La Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat (SNANC) s’inscrit dans une volonté de mieux articuler les enjeux alimentaires, sanitaires et environnementaux. Elle résulte de la Loi Climat et résilience de 2021, qui impose dans son article 265 une date de publication de cette stratégie au 1er juillet 2023. Les orientations stratégiques de la SNANC définissent la politique du Gouvernement pour une alimentation saine et durable à l’horizon 2030 et seront déclinées de manière opérationnelle par les prochains Programme national nutrition santé (PNNS 5) et Programme national de l’alimentation (PNA 4) sur la période 2025-20301. Le processus visant à bâtir cette stratégie est piloté conjointement par trois ministères : Agriculture, Santé et Écologie.
A ce jour, la version définitive de la SNANC n’a toujours pas été publiée.
En novembre 2022, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a été saisi par les trois ministères pour établir un état des lieux de la situation alimentaire en France, et rédiger des recommandations (122, dont 37 prioritaires), des orientations et objectifs stratégiques (17 objectifs) pour la SNANC. En février 2023, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a lui aussi contribué à la réflexion, et son avis a également été intégré en avril 2023, en même temps que celui du CNA. En parallèle, l’IDDRI a publié en avril 2023 une étude intitulée « Environnement, inégalités, santé : quelle stratégie pour les politiques alimentaires françaises ? » qui formulait des propositions concrètes.2
D’autre part, une coalition de 70 organisations sous l’égide du Réseau Action Climat, a adressé en mai 2023 une lettre ouverte à la Première ministre, appelant à une SNANC ambitieuse en matière de santé publique et d’environnement. Parmi leurs demandes figurait notamment le besoin d’objectifs précis et ambitieux sur la baisse de la consommation de viande et de produits trop gras, trop sucrés, trop salés et de produits ultra-transformés.
Les services des ministères de l’Agriculture, de la Santé et de la Transition Écologique, en partenariat avec le SGPE (Secrétariat Général à la Planification Écologique), ont travaillé à la rédaction de la SNANC, dont les ajustements et les versions se sont succédées au gré des réunions interministérielles. En novembre 2024, une version préliminaire de la SNANC datée d’avril 2024, encore à l’état de projet, fuitait dans la presse. Selon les associations environnementales et de santé, les orientations du texte de travail allaient globalement dans le bon sens. Cependant, la version actualisée d’avril 2025 ne s’inscrit plus dans cette dynamique. L’interdiction de publicité pour de la malbouffe à destination des enfants sur Internet et à la télévision n’a pas été maintenue, contrastant avec la décision du Royaume-Uni qui a annoncé cette interdiction à partir du 1er octobre 2025. De même, aucun chiffre sur la diminution de la consommation de viande n’est mentionné, alors qu’il en était question (-12%) dans une version antérieure. Enfin, certaines problématiques liées à l’environnement et l’alimentation ne sont pas ou très peu citées, comme l’usage d’intrants phytosanitaires dans la production alimentaire ou la présence de PFAS dans nos aliments, ou encore le chlordécone aux Antilles3. La SNANC souligne le besoin d’adaptation aux spécificités des Outre-Mer, sans pour autant donner plus de précisions ni de vrais objectifs.
Le texte a ensuite été ouvert à la consultation publique du 7 avril au 4 mai 2025,consultationà laquelle de nombreuses parties prenantes ont répondu : les associations, professionnels (distributeurs, producteurs et interprofessions), citoyens et collectivités. Dans le même temps, le CNA, le Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE), le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE) et la Conférence nationale de Santé (CNS) ont été saisis par le gouvernement pour produire un avis sur le projet de SNANC.
Les ministères ont annoncé vouloir s’appuyer sur les retours de la consultation publique pour réviser le texte, mais sans engagement clair. On reste donc dans une phase d’attente. Cette interministérialité constitue en soi un progrès, reconnaissant la complexité systémique des enjeux alimentaires. Toutefois, elle a aussi révélé des tensions : les visions des ministères sont souvent contradictoires, ce qui peut bloquer l’avancée des négociations et de la préparation du texte. Ce processus permet de prendre en compte des sujets transversaux mais complexifie la prise de décision.
II. Une stratégie trop peu structurante pour les associations… et pas assez ambitieuse pour les distributeurs
De nombreuses ONG environnementales, de santé publique et de solidarité, ont exprimé de vives critiques à l’égard de ce texte. Le grief principal : la SNANC manque d’ambition et de mesures contraignantes. Elle repose quasi exclusivement sur des incitations volontaires, sans fixer d’objectifs opposables ni de mécanismes de suivi. Parmi les mesures proposées : accompagnement à la transition alimentaire, soutien à l’information nutritionnelle, affichage environnemental des produits en restauration collective, encouragement des pratiques durables, valorisation des circuits courts… Mais pas d’obligation sur des points structurants comme la réduction de la consommation de viande, la restriction par voie réglementaire de la publicité alimentaire dans les médias (en particulier à destination des enfants) ou l’encadrement des pratiques commerciales des distributeurs. Finalement, seulement six actions sont contraignantes sur les 80 proposées, et 28 sont uniquement incitatives.
| Axes d’action de la SNANC (version 2025) Assurer une gouvernance coordonnée des politiques en lien avec l’alimentation, la santé et l’environnement à toutes les échelles et agir à celle des territoires : – Mettre en œuvre la SNANC selon une gouvernance nationale coordonnée – Faire des projets alimentaires territoriaux (PAT) des leviers de transition des territoires, en renforçant de manière systémique leurs critères de labellisation Garantir à tous l’accès à des environnements alimentaires et nutritionnels de qualité et durables : – Communiquer et sensibiliser sur une alimentation « saine et durable » – Renforcer l’accompagnement à la diversification des sources de protéines et aux menus végétariens en restauration collective Accompagner les comportements et les régimes alimentaires durables favorables à la santé et à l’environnement : – Expérimenter les modalités d’une extension de l’usage volontaire du Nutri-Score aux denrées non pré-emballées et à la restauration hors foyer Développer la recherche, l’expertise et l’évaluation pour une transition des systèmes alimentaires : – Renforcer la recherche interventionnelle afin d’évaluer l’efficacité des interventions visant à améliorer l’environnement nutritionnel |
Ces reculs résultent des nombreuses actions des interprofessions de la viande et de la charcuterie, qui se sont fortement opposées à l’objectif chiffré concernant la diminution de la consommation de leurs produits, finalement retiré du texte, alors même que les instances consultées pendant la concertation – le CNA, le HCSP ou encore le Haut Conseil pour le Climat (HCC) – préconisaient toutes un objectif de modération. (Voir sur ce sujet le rapport de Terra Nova4).
De nombreux acteurs ont exprimé leur opposition à plusieurs recommandations de la SNANC. Le ministère de la Culture s’est opposé à la restriction de la publicité alimentaire dans les médias, invoquant l’impact négatif qu’elle pourrait avoir sur les recettes des chaînes de télévision. Du côté agricole, la FNSEA et la Coordination Rurale ont rejeté les propositions visant à réduire la consommation de viande, perçues comme une remise en cause des modèles d’élevage. Les industriels de l’alimentation, représentés par l’ANIA et l’ACOFAL, ont quant à eux critiqué les restrictions concernant la publicité à destination des jeunes publics. En somme, les principales fédérations et interprofessions agricoles et agroalimentaires ont largement freiné les ambitions initiales de la stratégie.
Le résultat ? Une stratégie qui propose, mais n’impose rien, laissant le soin aux acteurs privés et aux parties civiles de s’auto-réguler. Ce pari de la responsabilisation, souvent critiqué pour son inefficacité, crée un fossé entre les attentes sociétales et les arbitrages politiques. De nombreuses organisations se sont mobilisées pour souligner combien cette stratégie était insuffisante, la Fondation pour la Nature et l’Homme et la CGT notamment. 54 associations, comme le Réseau Action Climat, la Société Française de Santé Publique ou Générations Futures, ont même réagi en exigeant une « vraie » SNANC dans une note avec 13 propositions qui correspondent, selon elles, à une stratégie efficace et ambitieuse en matière d’alimentation et de climat, contrairement au texte actuel du gouvernement qu’elles jugent ne pas être à la hauteur des enjeux.
Cinq grands distributeurs (Auchan, Carrefour, Coopérative U, Groupe Casino et Groupement Mousquetaires/Intermarché) ont également pris position dans une tribune le 12 juin publiée dans Contexte5. Ils y rappellent que la SNANC est une opportunité d’apporter une réponse aux multiples enjeux de l’alimentation (santé, environnement, rémunération des producteurs), mais surtout de fixer un cap clair et un cadre à la politique alimentaire.
Les points qu’ils défendent ressemblent à la version originale de la SNANC. Ils invitent en effet à restreindre la publicité à destination des enfants pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle et à déployer des campagnes de sensibilisation à l’alimentation durable, expliquant les bienfaits de consommer davantage de protéines végétales et moins de viande. La mesure principale qu’ils proposent consiste en un affichage environnemental harmonisé indiquant au consommateur l’impact environnemental du produit6, permettant de le comparer à d’autres. Les distributeurs se disent prêts à fournir des efforts pour promouvoir les produits les mieux notés en faisant évoluer leurs pratiques de promotion et de mise en avant des produits en magasin ; si l’État s’engage en garantissant une stratégie lisible et à la hauteur des enjeux alimentaires.
III. Farm to Fork et SNANC : des stratégies ambitieuses, des mécanismes insuffisants
La dimension européenne constitue à la fois un levier stratégique et une contrainte structurante pour les politiques agricoles et alimentaires françaises. En tant que compétence exclusive de l’Union, la politique commerciale inclut les volets sanitaires et phytosanitaires. Elle a conduit à une harmonisation poussée des normes alimentaires à l’échelle européenne, qui ne porte pas seulement sur le produit final, mais sur l’ensemble de la chaîne de production : usage des pesticides, traitements post-récolte, mesures de décontamination, prévention des zoonoses, etc. La PACjoue également un rôle déterminant : elle encadre les subventions agricoles (aides couplées ou découplées), oriente les pratiques à travers les éco-régimes et impose des conditionnalités aux aides. À cela s’ajoute la réglementation européenne sur l’étiquetage des denrées alimentaires, les règles d’hygiène, la santé animale, la santé des végétaux. En somme, les marges de manœuvre nationales en matière de politiques agricoles et alimentaires sont largement conditionnées par les décisions prises à Bruxelles.
La stratégie Farm to Fork, présentée en mai 2020 par la Commission européenne dans le cadre du Green Deal, visait à rendre les systèmes alimentaires plus durables, sains, accessibles et respectueux de l’environnement. Cette initiative entendait engager le système agricole et alimentaire européen dans une trajectoire de transition et fixait des objectifs chiffrés ambitieux à horizon 2030 (réduction de l’usage des pesticides, des engrais et des antibiotiques dans l’élevage, développement du bio, baisse des pertes alimentaires etc.). Visant à apporter des changements majeurs, sa mise en œuvre a été confiée à trois directions générales de la Commission Européenne : Santé, Environnement et Agriculture, pour permettre une prise en compte transversale des enjeux.
On voit dès lors les nombreux points communs de la SNANC avec la stratégie européenne. La SNANC cherche à traduire ces ambitions européennes dans le contexte français, en les articulant avec les enjeux spécifiques de nutrition, de santé publique, de climat et de transition agricole. Il est donc essentiel d’analyser les résistances et les freins rencontrés dans la mise en œuvre de la stratégie Farm to Fork. Comme pour la SNANC, la plupart des recommandations formulées dans ce cadre ne sont pas juridiquement contraignantes pour les acteurs du secteur. Début 2024, sur les 27 initiatives prévues (législatives et non-législatives), seules 9 avaient été adoptées, dont 8 simplement sous forme de communications de la Commission, sans effet réglementaire direct, et une unique modification mineure d’une réglementation existante (sur les produits phytosanitaires). 7
L’échec de Farm to Fork est multifactoriel. La forte polarisation des débats sur les questions agricoles, tant en France qu’à l’échelle européenne, a considérablement freiné les avancées. Dès le départ, le Parlement européen et le Conseil ont émis des doutes sur les ambitions de la stratégie. Les deux institutions ont exigé de la Commission des évaluations d’impact approfondies pour justifier les actions annoncées. Le premier cas a été la proposition de révision de la Directive sur l’utilisation durable des pesticides en juin 2022. Les vingt-sept ont adopté une décision pour réclamer à la Commission des données additionnelles sur l’impact du projet de règlement. Des données jugées indispensables pour débuter les négociations entre États sur le cœur de la proposition : réduire de moitié l’utilisation et le risque des pesticides dans l’Union d’ici à 2030. Après deux années de discussion houleuses, la Commission européenne s’est vue dans l’obligation de retirer sa proposition en février 2024. L’idée d’avoir un objectif contraignant de réduction de l’utilisation des pesticides a été de facto abandonnée.
Un autre facteur décisif résidait dans la crainte que la stratégie Farm to Fork puisse conduire à une baisse des capacités de production agricole en Europe. Cette crainte a été soulevée par les résultats des analyses produites par le Centre commun de recherche de la Commission (JRC), le ministère américain de l’Agriculture ou encore l’université de Wageningen et le débat, s’est graduellement focalisé sur la sécurité alimentaire. La guerre en Ukraine a joué un rôle très important dans la tournure qu’ont prise les discussions. Enfin, la compétitivité de l’agriculture européenne a aussi fait l’objet de débats mais moins visibles : l’impossibilité d’un accord sur les profils nutritifs et l’adoption du nutriscore a trouvé ses raisons dans les volontés nationales de protéger leurs industries alimentaires traditionnelles. Les réticences à l’encontre de certains engagements tels que le bien-être animal ou l’utilisation des antibiotiques ont également été motivées par des préoccupations de compétitivité de l’agriculture européenne au plan global.
À cela s’ajoutent une mise en œuvre technique défaillante, des normes trop peu contraignantes, des blocages politiques majeurs et, plus récemment, un changement de cap institutionnel qui a privilégié la « simplification » au détriment des objectifs environnementaux initiaux.
L’ensemble de ces éléments a progressivement vidé la stratégie de sa substance et, en février 2025, la stratégie Farm to Fork s’est vue remplacée par « une vision pour l’agriculture et l’alimentation »8 qui reprend une approche beaucoup plus traditionnelle d’équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales de l’agriculture. Les engagements en matière de qualité de l’alimentation ont quasiment disparu et le lien santé-environnement n’y trouve pas de place. Même si le commissaire à l’agriculture, Christophe Hansen, a indiqué que les deux étaient complémentaires, il suffit de les lire les deux textes en parallèle pour voir que ce n’est pas le cas.
Dès lors, deux questions se posent : quelle portée réelle pour la SNANC si elle n’est pas adossée à une dynamique européenne cohérente ? Et quel est l’avenir de la SNANC avec un précédent européen qui s’est soldé par un échec ? Il est nécessaire de tirer les leçons pour ne pas réitérer cet échec à l’échelle nationale.
Conclusion : une stratégie en quête de cohérence et de courage politique
La SNANC constitue un progrès, en posant une vision transversale de l’alimentation comme levier de santé publique, de justice sociale et de transition écologique. Mais, à ce stade, elle reste en deçà des attentes des acteurs de terrain faute d’objectifs précis, de contraintes, de moyens et d’ancrage européen.
Pour que la SNANC produise ses effets, plusieurs enjeux se dessinent. L’un d’eux concerne la capacité à dépasser l’influence des principaux groupes d’intérêts représentant les bénéficiaires d’un modèle agricole intensif, en intégrant davantage les voix portées par des acteurs engagés dans des pratiques alternatives : agriculture biologique, circuits courts, élevage extensif, etc. Le traitement de l’élevage apparaît également comme un sujet à part entière, distinct des cultures, appelant une approche spécifique.
Pour rendre la stratégie pleinement opérationnelle, il faudra également mobiliser les ressources financières suffisantes pour accompagner le développement des projets alimentaires territoriaux (PAT), présentés comme des leviers essentiels de la transition alimentaire à l’échelle locale, financer des campagnes de sensibilisation à une alimentation saine et durable, soutenir les alternatives à l’aide alimentaire classique et appuyer la transformation de la restauration collective.
Mais les moyens politiques et institutionnels sont tout aussi déterminants. La question de la gouvernance interministérielle est essentielle pour assurer la cohérence des actions publiques. La nomination d’un(e) délégué(e) interministériel(le) dédié(e) à la SNANC, chargé (e) de sa mise en œuvre et son suivi est nécessaire. La SNANC doit constituer un levier structurant, en contribuant à articuler non seulement le Plan national pour l’alimentation (PNA) et le Programme national nutrition santé (PNNS), mais aussi l’ensemble des politiques sectorielles ayant une incidence directe ou indirecte sur l’accès à une alimentation de qualité. Sont concernées les politiques agricoles, au premier rang desquelles la PAC et le Plan stratégique national (PSN), mais aussi les politiques économiques, sociales, d’emploi et de protection sociale, les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
La révision du texte après la consultation publique scellera l’avenir de la SNANC. Si le gouvernement intègre les demandes des ONG, en assumant des objectifs contraignants et en renforçant la gouvernance interministérielle pour éviter la mainmise du MASA et permettre de véritables mise en œuvre, suivi et évaluation, la SNANC pourra devenir une stratégie crédible qui se donne les moyens de ses ambitions. Sinon, elle risque de décevoir les citoyens, les consommateurs et les acteurs durables du secteur alimentaire.