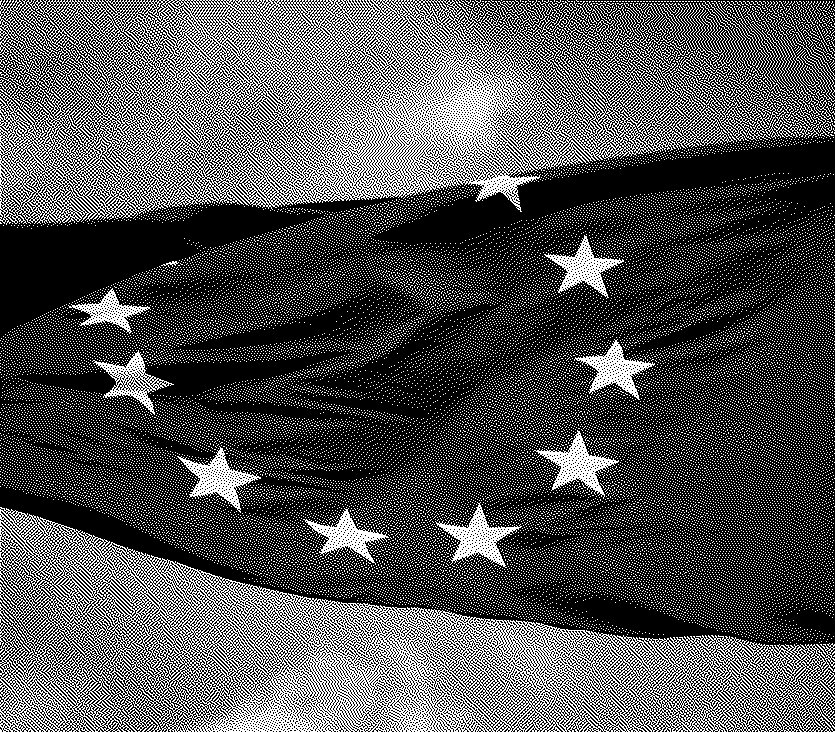Entretien avec Pierre Vimont, ambassadeur de France
Réfléchir sur un nouvel ordre de sécurité européen, alors même que la guerre en Ukraine est en cours, peut sembler malvenu. Vu d’Europe centrale et orientale, parler du “jour d’après” peut paraître prématuré alors que nous sommes englués dans un conflit dont on a du mal à voir l’issue. Plus encore, les pays d’Europe de l’Ouest – la France, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie – ont pu donner l’impression chez nos partenaires de l’Est, au début de la guerre, d’une certaine naïveté voire d’une complaisance à l’égard de la Russie. Aujourd’hui, il semble que les réflexions pour trouver une sortie de conflit favorable aux intérêts de l’Ukraine, et plus généralement de l’Europe, tournent en rond. Les déclarations faites par les uns ou les autres sont d’ailleurs loin d’être cohérentes. D’un côté, il faudrait résoudre ce conflit en évitant de créer un esprit de revanche du côté russe ; de l’autre, les Alliés vont répétant que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Beaucoup de leaders continuent à appeler à la défaite de la Russie tout en restant imprécis sur ce que cela signifie exactement. Sur ce point, on s’en remet à la volonté des Ukrainiens, eux-mêmes en désaccord sur l’objectif final à atteindre, au-delà des déclarations publiques.
Ainsi, peut-être faut-il prendre le problème dans l’autre sens : réfléchir à l’Europe que l’on souhaite mettre en place afin de comprendre quelle serait le meilleur point de sortie de la guerre actuelle. En effet, la question russe est un angle mort de notre politique européenne que nous ne savons pas comment aborder. Dans le cas d’une défaite russe, un revanchisme russe risque de s’installer et d’avoir un effet boomerang à terme. A l’inverse, si la Russie gagne, ce qu’on ne pourrait que regretter, Poutine risque de continuer sa politique « impériale ». Avec un conflit gelé, nous risquons de revenir aux accords de Minsk I et Minsk II, c’est-à-dire une situation où la Russie bénéficiera d’un temps de répit pour mieux attaquer de nouveau quelques années plus tard. Enfin, dernière hypothèse, les deux partis concluent un accord de paix, mais comme l’a dit récemment Radek Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, Poutine violera ce traité dès qu’il l’estimera nécessaire. Le plus délicat dans cette analyse des sorties possibles de la guerre c’est que chacune de ces hypothèses est tout à fait possible.
Pour négocier avec la Russie, de nombreux observateurs affirment qu’il faudrait d’abord que Poutine quitte le pouvoir, mais cela ne relève pas de notre compétence et encore moins de nos capacités d’action. Rappelons en passant que, selon la Constitution russe, le Président Poutine peut être réélu jusqu’en 2036. Allons-nous nous satisfaire d’une Europe dans un état d’instabilité et d’insécurité pendant encore plus de dix ans ?
Dernier élément dans ce survol du cadre général de la relation avec la Russie : depuis le dernier grand élargissement de l’Union européenne (UE) en 2004, qui a conduit à l’adhésion de tous les pays d’Europe orientale et centrale, nous n’avons plus été capables – et Sergueï Lavrov ne se prive pas de nous le répéter régulièrement – de définir une stratégie européenne commune à l’égard de la Russie.
Chaque fois que nous avons essayé de définir une stratégie, cela n’a pas abouti. En 2016, Federica Mogherini, alors Haute Représentante pour la politique étrangère de l’UE, avait réussi à faire adopter ce qu’on a appelé les “cinq principes directeurs” des relations UE-Russie. Cependant, il s’est agi avant tout de faire un constat de la situation qui prévalait à ce moment-là, sans objectif précis pour renouer avec le Russie. En juin 2021, voyant monter les tensions entre la Russie et l’Ukraine, Angela Merkel – alors encore au pouvoir – avait maladroitement proposé d’organiser un sommet européen en présence de Poutine. Les pays d’Europe orientale et centrale s’y étaient opposés et le Conseil européen lors duquel elle avait fait cette proposition s’était conclu dans l’acrimonie générale. La vérité est que nous n’avons jamais su comment agir pour faire avancer la relation de l’UE avec la Russie. C’est donc un sujet auquel il faut réfléchir, avec franchise, pour préparer l’après-guerre et construire une position européenne commune face à la Russie.
Quel pourrait-être un ordre de sécurité européen ? La réponse la plus fréquente, lorsqu’on en discute au sein de la diplomatie européenne, tourne autour de l’idée de construire un ordre de sécurité sur le modèle de la politique de containment mise en place pendant la Guerre froide. Proposé par George Kennan en 1947, cet endiguement est devenu le principe à la base des relations entre les pays occidentaux et l’Union soviétique pendant plus de 40 ans. Cependant, cette proposition nécessite un effort de réflexion historique, puisque le containment a présenté plusieurs visages selon les périodes de la Guerre froide, et a été le nom d’actions politiques très différentes. Dans le cadre de ce concept de containment, on trouve d’abord la politique du rollback – refoulement – qui visait à repousser le communisme et plus seulement le contenir, comme ce fut le cas lors de la guerre de Corée. Puis, des périodes de fortes tensions avec la crise de Berlin ou la crise des missiles à Cuba ont transformé les tenants de cette politique. Enfin, de manière individuelle d’abord, puis de manière collective, des efforts ont été faits pour aller vers ce qu’on a appelé “la Détente”. C’est le fameux triptyque du général De Gaulle “entente, détente et coopération”, puis l’Ostpolitik de Willy Brandt, et enfin les négociations et les accords d’Helsinki en 1975. Ainsi derrière le terme containment s’est développée une série d’initiatives et d’actions diplomatiques très diverses. Qu’entend-on aujourd’hui par un retour à cette politique de containment, et serons-nous tous d’accord pour agir ensemble de manière coordonnée ? Les pays de l’Est – la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, la République Tchèque – par exemple souhaitent avant tout établir un ordre de sécurité contre la Russie. D’autres imaginent un ordre de sécurité sans la Russie ce qui est une notion quelque peu différente. En réalité, les promoteurs de ces deux concepts imaginent en arrière fond de ces approches deux scénarios possibles pour l’avenir de la Russie : soit une Russie sans Poutine dont ils espèrent qu’elle pourrait alors revenir à l’époque de Gorbatchev avec l’espoir d’une nouvelle perestroïka ; soit une dislocation de la nation russe telle qu’elle existe actuellement. En tout état de cause, les Occidentaux n’ont guère de prise sur d’éventuels développements internes et beaucoup d’entre eux s’inquiètent au demeurant de la perspective d’une Russie qui serait de nouveau en proie à de profonds troubles intérieurs. Aussi bien, il est plutôt de notre intérêt de réfléchir à l’ordre de sécurité que nous souhaitons voir advenir après la guerre russo-ukrainienne à périmètre géographique et régimes politiques inchangés. Comment penser cet ordre de sécurité européen ?
Le premier aspect essentiel est de prendre en compte le facteur temps, car l’après-guerre – dans tous les cas de figure – verra se développer beaucoup de ressentiments. Après 1945, les rapports entre la France et l’Allemagne ont éte très distants pendant longtemps. En 1962, lorsque le chancelier Adenauer était venu pour sa première visite officielle d’Etat en France, l’accueil de la population française avait été très froid, malgré les efforts personnels de De Gaulle – reconnus par Adenauer lui-même – de relancer la relation franco-allemande contre l’opinion populaire. Au vu de la violence du conflit actuel, il est probable qu’on assistera à quelque chose du même ordre une fois la guerre terminée. Ainsi, le retour d’un ordre de sécurité en Europe devra se faire progressivement, par étapes successives et sans chercher à forcer le mouvement. Parmi les priorités, il faudra travailler sur la stabilité stratégique, c’est-à-dire reprendre les discussions sur le militaire nucléaire et le conventionnel qui avaient fait l’objet d’accords importants (SALT, START, FCE, Open Sky…) au cours des années 1970 à 1990 avant d’être pratiquement tous remis en cause. Sur ce point, les Etats-Unis eux-mêmes suggèrent sans tarder une approche dite de “compartmentalization” qui pourrait permettre, en dépit du conflit en Ukraine, de discuter avec la Russie de dossiers particulièrement importants pour la préservation du régime de non-prolifération nucléaire. En l’occurrence, il s’agit d’éviter la fin du traité New START (Traité de Réduction des Armes Stratégiques, signé en 2010) dans un contexte où la puissance russe est devenue depuis le début de la guerre en Ukraine un allié de plus en plus proche de la Corée du Nord et de l’Iran, deux pays particulièrement proliférants.
Deuxièmement, il est indispensable de prendre en compte les nouveaux défis auxquels l’Europe doit faire face : les conflits cyber par exemple ou encore les actions de plus en plus nombreuses de désinformation. Avant l’intervention russe en février 2022, plusieurs discussions concernant la désinformation avaient eu lieu au sein des Nations Unies. Il paraît indispensable de les reprendre au niveau européen. Il faudra également discuter des infrastructures critiques, par exemple en matière de transport énergétique, ou encore de la protection des centrales nucléaires dont on a bien vu eu Ukraine comment cette absence de protection et tout simplement d’immunité créait des risques considérables.
Ensuite, il faudra tirer des leçons de nos erreurs passées : au moment d’Helsinki et surtout après la fin de la guerre froide, plusieurs questions n’ont pas été discutées avec la Russie, notamment tout ce qui concerne les zones grises que la Russie considère comme constituant ses sphères d’influence. Il s’agit là d’une problématique qui s’est posée à de nombreuses reprises depuis Helsinki. Pour autant, à chaque fois qu’on a tenté d’entamer des discussions avec la Russie, on s’est heurté à des blocages sinon même à des incompréhensions. Après la guerre russo-ukrainienne, il faudra aborder avec les Russes les questions relatives à sa présence et à son influence dans des pays comme la Géorgie, la Biélorussie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan ou encore une région comme la Transnistrie en Moldavie. Il faudra alors discuter de la question des minorités russophones, ou plus généralement d’autres minorités en Europe, comme le cas des magyars – hongrois – qui créent des différends entre la Roumanie et la Hongrie. Ainsi, la question des sphères d’influence autour de l’existence de communautés minoritaires en Europe devra être abordée, au risque de susciter, faute de solutions, de nouvelles tensions, voire des conflits ouverts.
Enfin, dans le même ordre d’esprit et avec le souci de ne pas laisser sans solution des sources de tension potentielles, un ordre de sécurité ne pourra pas être pensé sans prendre en compte la question de la mémoire historique. C’est un problème latent pour la Russie post-communiste, mais aussi dans certains pays d’Europe orientale et centrale. Il y aura par conséquent un vrai effort à nourrir pour engager une discussion plus sereine au sein de l’Europe sur cette thématique de la mémoire collective que nous avons laissée de côté lors des négociations d’Helsinki et qui est revenue nous hanter depuis lors.
Pour conclure, on peut aussi positionner cette réflexion sur le futur ordre de sécurité en Europe par rapport au débat en cours à propos des déclarations du Président Macron sur l’envoi éventuel de troupes en Ukraine. Le débat est là : comment faire prendre conscience aux opinions publiques européennes que la guerre est de retour en Europe et qu’elle met en péril la paix européenne ? Evidemment, c’est un discours qui peut apparaître anxiogène, et que beaucoup de représentants de la classe politique rechignent à tenir. C’est pourquoi, nous avons besoin d’un narratif plus positif pour justifier notre soutien à l’Ukraine. Et c’est là qu’un débat plus axé sur la nécessité de construire un ordre de sécurité européen plus solide, capable de s’attaquer aux problèmes que nous avons jusqu’ici refusé d’affronter, et de réfléchir en premier lieu à notre relation avec la Russie peut prendre tout son sens. Cela permettrait de recréer du consensus national et, si possible, européen en donnant à notre narratif une ambition plus grande et également plus positive. Je reconnais qu’à maints égards, cela peut paraître déphasé face à la nécessité pressante de renforcer nos industries de défense et d’apporter un soutien plus affirmé à l’Ukraine. Mais il ne me semble pas que ces deux processus soient incompatibles. Les pères fondateurs de l’Europe, y compris Jean Monnet, ont commencé à réfléchir au projet fédéral européen pendant la Seconde Guerre mondiale : nous aurions intérêt à suivre leur exemple.
La Russie est ce qu’on peut appeler une puissance « révisionniste », pas simplement au sens où l’entendent les historiens, c’est-à-dire qui se livre à la réécriture du passé. Comme le dit une plaisanterie russe “Aujourd’hui en Russie même le passé est devenu imprévisible !”. La Russie est aussi révisionniste au sens où l’entendent les spécialistes de relations internationales, soit la remise en cause du cadre de sécurité collective existant. Raymond Aron distinguait les conflits homogènes – où les acteurs s’accordent sur le cadre général au sein duquel ils s’affrontent – et les conflits hétérogènes, où un tel cadre commun n’existe pas. Il semble que les conflits avec la Russie sont profondément hétérogènes. Dès lors, comment peut-on ouvrir le dialogue sur un ordre de sécurité post-conflit, étant donné la spécificité de l’interlocuteur russe ?
LGC
C’est une question centrale : comment faire de la diplomatie avec un interlocuteur qui refuse les règles les plus fondamentales de la diplomatie ? Avant l’intervention de la Russie en février 2022, plusieurs rencontres avec des diplomates russes n’ont jamais permis d’entrer réellement dans la discussion, faute d’interlocuteurs prêts à admettre que chaque partie devait faire preuve d’ouverture, d’esprit de compromis et accepter des concessions mutuelles. Cette grammaire de la diplomatie, assez communément admise auparavant, semblait comme révolue, disparue ou encore ignorée. C’était comme s’il n’était plus possible de parler un langage commun.
Face à cette question, l’histoire est encore une fois d’un grand secours. Pendant la Guerre froide, et notamment lors des crises intenses comme celle de Berlin ou de Cuba, on a cru plusieurs fois qu’on n’arriverait pas à négocier avec l’Union soviétique. Pourtant, le Président Kennedy a fini par trouver un accord. Dans son discours à l’université de Harvard en 1962, il a rappelé que, dans ces moments intenses de face à face, chacun avait dû faire un pas dans la direction de l’autre pour trouver un point de sortie : lorsque l’Union soviétique a retiré ses missiles de Cuba, les Américains ont retiré leurs missiles de Turquie, et c’est ainsi que la crise a pu être dépassée. Il est difficile à ce stade de pouvoir préciser quelles seraient aujourd’hui les concessions réciproques à envisager mais il ne doit pas être impossible d’y parvenir afin d’atteindre un nouvel ordre de sécurité. Au fond, ce qui manque des deux côtés est peut-être tout simplement un peu de créativité et d’esprit d’innovation.
De plus, dans le monde multipolaire ou apolaire dans lequel nous vivons, il existe de réelles marges de manœuvre dans lesquelles une diplomatie européenne agile et active peut se développer, en liaison, je l’espère, avec les Etats-Unis. Par ailleurs, nous devons aussi apprendre à bâtir patiemment un jeu diplomatique plus subtil et élaboré avec la Chine et nos partenaires du Sud, comme l’Afrique du Sud, le Brésil ou l’Inde qui ont des positions souvent différentes de la Russie pour ce qui est de l’avenir de l’ordre mondial. En investissant ces relations diplomatiques, nous pourrions mettre la Russie dans une position plus délicate que celle dans laquelle elle se trouve pour le moment.
Nous devons aborder de front ce problème d’une Russie révisionniste avec laquelle, par principe, nous ne pourrions plus discuter. Il n’y a rien d’évident à cela, mais nous devons nous y préparer dès aujourd’hui et trouver, au sein de la communauté internationale, des partenaires intéressés par une alliance avec nous.
Pierre Vimont
Concernant l’élection de novembre aux Etats-Unis, si Donald Trump venait à être élu, cela susciterait beaucoup d’incertitudes concernant l’ordre de sécurité européen. Avant même d’être le candidat du Parti républicain, il s’est positionné sur le sort de l’OTAN, la contribution de chaque Etat ou encore sa capacité à régler le problème de l’Ukraine en 24h. Comment cette incertitude affecterait-elle l’ordre de sécurité post-guerre ?
LGC
Nous, Européens, sommes partis de l’idée que la victoire de Trump était inéluctable. Or, quand on séjourne aux Etats Unis, il est loin d’être évident, y compris pour la population locale, que cette élection est déjà acquise pour Trump. D’ici les élections de novembre, il est clair que de nouveaux événements peuvent se dérouler et produire des effets inattendus. C’est en réalité l’incertitude qui est le facteur dominant actuellement dans la vie politique américaine au regard de l’élection à venir. Nous gagnerions donc à être plus prudents dans nos analyses. La vraie incertitude n’est pas d’ailleurs liée aux gens qui vont voter Trump – ceux-là ont le plus souvent déjà fait leur choix- mais à ceux, indécis, qui hésitent entre l’abstention ou hésitent encore à voter Biden, voire même Trump.
Deuxièmement, Trump n’est pas un doctrinaire et encore moins un théoricien plein de certitudes et d’idées précises en matière de politique étrangère. Il est avant tout un homme d’affaires habitué à une approche transactionnelle. Les Européens devraient donc commencer à réfléchir aux transactions qui pourraient lui être proposées. Par exemple, concernant l’objectif des 2% du PIB consacrés aux dépenses militaires dans le cadre de l’OTAN, pourquoi ne pas lui proposer de passer progressivement à 2,5 voire 3% selon une trajectoire que, de toute façon, les Européens vont devoir emprunter alors que la guerre en Europe les contraint à des efforts budgétaires indispensables en matière de défense ? C’est en le surprenant que l’Europe pourra avancer avec Trump. C’est ce qu’avait compris Jean-Claude Juncker, lorsqu’il présidait la Commission européenne. Il était allé à Washington pour négocier un accord sur la suspension des tarifs imposés par Trump sur l’acier et l’aluminium européen. Il a échangé cette suspension contre l’achat de soja et de céréales américains, dont les Européens avaient de toute façon un besoin urgent pour des raisons conjoncturelles. Trump avait été très admiratif du style de M. Juncker dont il disait qu’il était un “tueur” : ce type de transactions fonctionne avec Trump. S’il est élu, il est loin d’être acquis que Trump se retirera de l’OTAN. L’Amérique sait – et Trump le premier – que les Européens demeurent les alliés les plus sûrs dont il serait malvenu de se séparer. Après tout, les Etats Unis n’ont pas tant d’alliés aussi loyaux dans le monde d’aujourd’hui. Facteur additionnel, le Congrès américain, qui a bien compris tout l’intérêt de l’Alliance Atlantique et qui est pourtant largement sous l’influence républicaine, a pris des dispositions législatives pour éviter en ce domaine toute décision unilatérale du Président américain. Ce qui montre au demeurant que les Républicains au Congrès peuvent s’opposer à Trump lorsqu’ils le veulent et que la politique intérieure américaine est peut-être plus complexe qu’on ne la dépeint en général.
Pierre Vimont
Une deuxième incertitude concerne la floraison d’un printemps des populismes dans notre continent européen. Cela pourrait aussi faire bouger les lignes sur la capacité d’action et l’agilité de la diplomatie.
LGC
Ce printemps des populismes est en effet le facteur le plus nouveau dans le paysage politique européen. Néanmoins, gardons en tête que chaque populisme en Europe a ses caractéristiques propres : celui de Giorgia Meloni est très différent du populisme de l’AFD (Alternative pour l’Allemagne) ou de celui de Marine Le Pen. En outre, ces différents mouvements populaires sont souvent contraints, dans le cadre des coalitions gouvernementales dans lequel ils s’inscrivent, à faire des concessions notamment en matière de politique étrangère face aux réalités et aux contraintes du pouvoir. Enfin, je ne crois pas que le modèle russe, d’un point de vue culturel et dans le domaine de la politique étrangère, soit particulièrement populaire en Europe : il n’y a pas d’afflux d’étudiants français ou européens vers les universités russes de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Un gouvernement, qui se lancerait dans un rapprochement affirmé avec le régime de Poutine, ne recueillerait probablement pas un large soutien populaire. Ainsi, y compris dans un pays comme la France, si nos partis populistes devaient arriver au pouvoir, je pense qu’ils feraient preuve de prudence de ce côté-là.
Pierre Vimont
L’exemple de la politique du containment rappelle que la force servait aussi à l’équilibre de la terreur, et donc à maintenir une stabilité pendant la guerre froide. Qu’est-ce que cela nous enseigne, nous Européens, dans nos actions face à la Russie ? Au-delà de l’OTAN, comment parvenir à cet équilibre via la dissuasion ou le renforcement de nos capacités vis-à-vis de la Russie ?
LGC
Il me semble que les Européens doivent poursuivre dans la lignée de leurs actions récentes, avec plus de force et d’urgence aussi. Aujourd’hui, la construction d’une défense européenne se fait très lentement, qu’il s’agisse de se doter d’une base industrielle et technologique capable de rivaliser avec les concurrents de l’Europe ou même de mettre en place une force opérationnelle européenne de caractère permanent. Il manque actuellement à l’Europe le sentiment de l’urgence face à la menace russe. Le programme de stratégie industrielle européenne en matière de défense que viennent de présenter Ursula von der Leyen et Thierry Breton passera l’épreuve du feu lors du prochain plan de financement européen qui sera adopté en 2027. Tout cela risque d’arriver bien tard et nous avons besoin d’envoyer aujourd’hui même les munitions et les armements dont a besoin l’Ukraine.
Pour cela, nous devons animer une prise de conscience chez les dirigeants européens et les opinions publiques de la menace que fait peser la Russie sur notre propre sécurité. Comme l’a écrit Jean-Marie Guéhenno, nous faisons la guerre assis confortablement dans nos canapés en regardant nos postes de télévision ou nos portables, sans nous rendre compte qu’elle nous concerne directement. Pour la majorité des dirigeants d’Europe de l’Ouest, d’Espagne ou du Portugal notamment, l’Ukraine est une réalité lointaine. L’action est cependant nécessaire si nous voulons être à la hauteur des défis qui se posent à nous aujourd’hui en Ukraine. Pour cela, l’administration européenne doit changer de mentalité et de braquet. Cette mobilisation ne pourra venir que du niveau politique. Or, l’on ne perçoit pas -en tout cas pas encore pour le moment- d’évolution radicale en matière de prise de conscience des opinons publiques. Nous devons nous mobiliser collectivement, et c’est à l’évidence ce qu’a tenté de faire le Président Macron, en n’excluant pas l’envoi de troupes au sol en Ukraine. Malheureusement, ses propos ont davantage divisé que mobiliser et produit l’effet inverse de celui recherché.
Pierre Vimont
On peut considérer la fin du conflit de trois manières. Tout d’abord, pour reprendre les termes de M. Macron, ne pas humilier la Russie pour ne pas reproduire le syndrome de Versailles, soit les ressentiments de l’Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une deuxième issue serait d’obtenir une défaite de la Russie. Cette défaite ne pourra probablement pas être similaire à celle de l’Allemagne nazie en 1945, quand la défaite militaire a provoqué l’effondrement et la destruction de l’ensemble du régime nazi, permettant ainsi un nouveau départ, la fondation d’un nouveau système politique. La position intermédiaire est de tout faire pour éviter une défaite de l’Ukraine. Dans ce cas, l’objectif ne serait pas l’anéantissement de la Russie et il faudrait envisager un nouvel ordre européen dans lequel la Russie serait présente. Les Européens n’auraient-ils pas intérêt à adopter cette position et faire le maximum pour y parvenir ?
LGC
Au-delà du cas de la Russie et de l’Ukraine, la diplomatie s’enferme de manière générale et de plus en plus dans un mode de gestion de crise à court terme. L’urgence s’impose et c’est naturel mais cela nous empêche trop souvent de nous confronter aux problématiques de fond, et nous nous retrouvons alors avec des crises récurrentes. Les accords de Minsk signés en 2014 / 2015 n’ont pas fonctionné précisément parce que ni les Russes ni les Ukrainiens n’étaient véritablement d’accord avec des dispositions qui s’efforçaient tant bien que mal de parer à l’immédiat – retour à l’intégrité des frontières ukrainiennes et octroi d’une forme d’autonomie aux régions russophones – mais n’offraient pas de réflexion plus générale sur l’ordre de sécurité en Europe et, en particulier, le futur statut et la place de l’Ukraine dans cet ordre européen : neutralité ou adhésion à l’OTAN ? Tous les malentendus ont donc continué de se développer à partir de là. On ne réglera le court terme que si l’on est capable de trouver un accord sur la base d’une idée claire pour l’équilibre de la sécurité européenne à long terme.
La question de la sortie de crise est centrale ici. L’option la plus satisfaisante du point de vue ukrainien comme occidental serait de parvenir à une situation militaire qui contraigne les Russes à négocier. Cependant, pour qu’ils négocient selon nos conditions, il faudrait redoubler d’efforts dans notre aide à l’Ukraine, ce que nous faisons de manière encore trop peu affirmée à ce jour. De surcroît, l’évolution des rapports de force sur le terrain se modifie : on disait volontiers il y a un an qu’aucune des deux parties ne pouvait ni gagner ni perdre cette guerre ; aujourd’hui, on entend davantage les experts avancer que la Russie ne peut pas perdre cette guerre et que l’Ukraine ne peut pas la gagner. Sans doute d’ici la fin de l’année, il y aura un autre type d’équilibre. En tout état de cause, cette incertitude des armes complique la réflexion sur le long terme. Mais elle ne doit pas l’interdire.
Il est évident que nous ne pouvons pas savoir quelle Russie sortira de cette guerre. Cependant, si les Russes sont contraints de s’engager sous la contrainte dans des négociations, cela aura sans doute des répercussions sur le régime. Il y aurait probablement des dissensions et des mécontentements, même s’il est loin d’être écrit que cela changerait forcément la situation personnelle de Poutine. Ce qui semble certain en revanche, c’est qu’une fois sortis de cette guerre, les Etats-Unis reviendront à la charge pour relancer des négociations sur la stabilité stratégique en Europe, quel que soit le régime en place à Moscou. Ils voudront préserver l’accord New START ou, du moins, les dispositions les plus importantes de cet accord. Dès un éventuel arrêt des combats en Ukraine, cette question de la stabilité stratégique se posera de nouveau, tout particulièrement dans sa composante de dissuasion nucléaire. D’ailleurs, le Président Macron n’a cessé de le dire, les Européens devront faire entendre leur voix dans ces discussions et prendre part aux négociations.
Il faut donc réussir à concilier une action de court terme – un soutien immédiat et massif à l’Ukraine – et une réflexion de plus long terme sur l’ordre de sécurité en Europe, à commencer par la question de la stabilité stratégique.
Pierre Vimont
Vous appelez à un nouveau paradigme diplomatique européen. Mais ne pensez-vous pas que la manière dont est conduit l’élargissement actuel – qui est très différent des quatre vagues d’élargissement précédentes – et l’institution de la CPE (Coopération politique européenne) sont des signes que ce nouveau paradigme diplomatique, pensé sur le long-terme, est en train de s’élaborer ? Par ailleurs, vous avez fait allusion au processus d’Helsinki dans lequel les Européens ont joué un rôle déterminant. Quel serait un Helsinki d’aujourd’hui, étant entendu qu’il y a des différences majeures entre la Russie d’aujourd’hui et l’URSS de l’époque ?
LGC
En effet, un nouveau paradigme diplomatique européen s’impose qui doit concerner à la fois la substance même de la politique étrangère de l’Europe, mais aussi ses méthodes et mécanismes diplomatiques. Il est difficile d’ignorer les faiblesses et les difficultés de la diplomatie européenne. Pour autant, ceux qui pensent que la politique étrangère et la défense doivent rester en dehors du cadre de l’Union européenne ne peuvent ignorer que chacun des pays européens tout seul pèse peu dans le concert des nations. Faire de la diplomatie à 27 est un défi permanent mais le raisonnement qui a prévalu au moment de Maastricht en matière d’économie et de monnaie unique vaut aussi pour la politique étrangère. De fait celle-ci est dans la suite logique de cette Union européenne mise en place par le traité de Maastricht. Mais, dès cette époque, certains membres de l’Union – Grande- Bretagne, Danemark – ont pu obtenir des statuts particuliers en matière de sécurité et de défense, et le font encore aujourd’hui. Il y avait par conséquent la reconnaissance de la nécessité d’une forme de souplesse dans la mise en oeuvre de la politique étrangère qui, au demeurant a toujours conservé sa spécificité par rapport au cadre institutionnel classique des affaires communautaires.
Aujourd’hui, il s’agit de décider si l’on est prêt à sauter le pas et à travailler ensemble de manière sérieuse en matière de politique étrangère européenne en prévoyant souplesse de la méthode, rapidité des procédures de décision en même temps que l’Union se dote d’une culture stratégique commune. Le nouveau paradigme de la diplomatie européenne implique aussi d’avancer avec ceux qui y sont prêts, quitte à ce que certains, parmi les 27 pays européens, ne suivent pas. L’initiative tchèque consistant à identifier les munitions disponibles sur le marché mondial a recueilli le soutien de 18 États membres : avançons à 18, sans attendre que les autres ne se décident ! Avec le soutien du budget européen, nous pouvons avancer de cette façon.
Le meilleur exemple de diplomatie européenne a été la négociation de l’accord nucléaire avec l’Iran conclu en 2015 (et malheureusement en difficulté depuis que les Etats Unis de Trump ont décidé de s’en retirer). Tout a commencé avec les trois ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. S’y est ajouté ensuite le Haut représentant à la politique étrangère et de sécurité commune, qui était Javier Solana à l’époque, auquel il a été proposé d’assurer la présidence du groupe et de représenter ainsi les 27 États membres. Puis, ont été adjoints les trois autres membres permanents du Conseil de sécurité. Au départ, c’est donc l’Europe qui a pris l’initiative et a maintenu ce projet à flot quand les discussions semblaient bloquées. Elle est donc capable d’être en initiative, notamment en faisant preuve de souplesse et en avançant si nécessaire à quelques-uns. Pourquoi ne pas renouveler ce genre d’expérience avec un peu d’audace, d’inventivité et d’agilité ?
Prenons l’exemple mentionné plus haut de la probable relance à terme des accords sur le contrôle des armements en Europe. Comme déjà indiqué, il sera nécessaire que les Européens participent à cette réflexion qui sera globale et influera armements conventionnels et nucléaires. La problématique de la dissuasion nucléaire européenne sera alors un des termes de l’enjeu. Ce sont des questions sur lesquelles il faudra bien que les pays européens se concertent. Ce dialogue devra trouver son lieu : pilier européen de l’OTAN ? Conseil européen ? Cadre informel nouveau en nombre restreint ? Dans le passé, certains pays membres de l’Union plus motivés que d’autres ont été capables, sur des questions comme le Moyen-Orient ou les Balkans, de faire des réunions à quelques-uns pour définir une ligne commune et aller ensuite présenter leurs idées aux autres membres de l’UE. Il faut retrouver cette souplesse de réflexion et de gestion qui est devenue indispensable face au poids du nombre.
Concernant la nouvelle procédure d’élargissement, c’est au fond une réflexion de même type sur la nécessaire souplesse qui est en cours actuellement. Au lieu de continuer à avoir un processus d’élargissement monolithique où on passe au tamis de la négociation une trentaine de chapitres avant de faire adhérer le pays candidat chanceux seulement en fin de parcours, l’idée est désormais de faire entrer les pays candidats de l’Union européenne selon une formule beaucoup plus souple, avec une adhésion par étapes. C’est cette formule qui a été proposée dans le cadre de négociations présenté par la Commission européenne pour l’Ukraine et la Moldavie.
En outre, si l’élargissement devient à l’évidence un instrument de la stratégie géopolitique de l’Europe comme on le voit également dans la décision d’ouvrir la négociation avec la Bosnie Herzégovine, il faut en tirer toutes les conséquences et adapter l’outil de l’élargissement à cette réalité politique tout en réfléchissant aux transformations que cela implique pour l’Union européenne. Le marché intérieur européen et les politiques communes devront s’adapter de même que les règles de gouvernance de l’Union. C’est en réalité à une transformation en profondeur du projet européen auquel nous assistons à la fois dans sa nature, son contenu et ses méthodes. Et cette transformation devra prendre en compte à la fois les risques de déclin économique et technologique de l’Europe mais aussi la nécessité de répondre aux défis géopolitiques imposés par le retour de la guerre sur notre continent. L’enjeu est en réalité d’une ampleur supérieure à celui que l’Union avait dû affronter au moment de Maastricht et de la fin de la guerre froide parce que l’Europe d’alors avait des atouts de compétitivité qu’elle a perdus et la chute du monde soviétique pouvait laisser espérer une phase de paix et de prospérité. Il faut aujourd’hui prendre toute la mesure de cet enjeu si l’Europe veut réussir cette profonde transformation.
Pierre Vimont