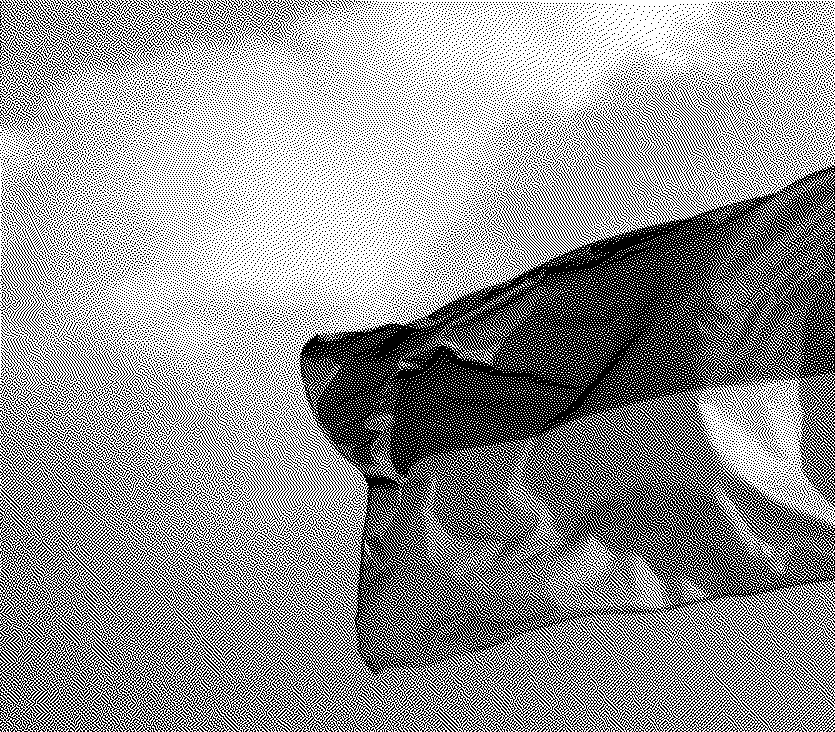Je voudrais tout d’abord expliquer à quel point le déclenchement de la guerre a changé les perspectives sur l’intégration européenne de l’Ukraine. Elle a changé la perception de l’Ukraine tout autant que celle de l’Europe. Avant tout, pour les Ukrainiens, l’intégration européenne est devenue quelque chose de très concret depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens ont déposé une demande d’adhésion à l’UE cinq jours après le début de l’invasion. C’était une étape importante qu’il fallait saisir dans ce contexte tragique. Et les Ukrainiens se sont vus accorder une perspective d’adhésion. De nombreux Etats membres ont semblé quelque peu déconcertés par cette décision car l’Ukraine est impliquée dans une guerre à grande échelle, ce qui pouvait être considéré comme un obstacle à une éventuelle adhésion.
Les Ukrainiens ont toujours eu à l’esprit une distinction très claire de « qui est qui » lorsqu’il s’agit d’organisations ou d’entités internationales. Ainsi, les Ukrainiens ont toujours associé l’OTAN à la sécurité et à la défense, et l’UE au développement, à la puissance économique, aux droits de l’homme, bref, à toutes les questions qui ne sont pas militaires. Néanmoins, le déclenchement de la guerre à grande échelle a remis en question l’image de l’UE et de l’OTAN dans l’esprit des Ukrainiens. La réponse de l’OTAN n’a pas été à la hauteur des attentes d’unité et de puissance des Ukrainiens. Au contraire, l’UE s’est montrée agile, a réagi rapidement et a pris des décisions très courageuses. La mobilisation de l’Union européenne et son soutien à l’Ukraine sont l’une des principales raisons expliquant la résistance de l’Ukraine dès les premiers mois de la guerre et jusqu’à présent.
Lorsque la guerre à grande échelle a éclaté, l’économie ukrainienne s’est effondrée : un grand nombre d’habitants ont fui, les entreprises ont fermé, la production a chuté, etc. L’Union européenne a élaboré un plan d’aide financière, la « facilité pour l’Ukraine », qui fournit un soutien financier à l’Ukraine depuis début 2024 et jusqu’en 2027, pour un total de 50 milliards d’euros1. Ce faisant, la contribution de l’UE a dépassé sa nature économique, lui permettant de se transformer en un acteur de la sécurité.
Deuxièmement, en ce qui concerne le processus de négociation. L’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’adhésion le 22 juin 2022. Ce statut était assorti de sept recommandations du Conseil de l’UE visant à résoudre certains problèmes très urgents en Ukraine, qui étaient principalement liés à son système judiciaire et juridique, mais aussi à des mesures de lutte contre la corruption et à des remarques sur sa cour constitutionnelle, ainsi qu’à certaines questions très spécifiques telles que les questions relatives aux minorités. L’Ukraine a rapidement progressé sur les sept points : un rapport de la Commission européenne datant de novembre 2023 indique que l’Ukraine a rempli toutes ces conditions. Ainsi, en décembre 2023, l’Ukraine a pu entamer les négociations avec l’UE concernant sa future adhésion. À cette époque, la Hongrie était l’un des pays qui s’opposaient à la décision d’entamer le processus d’adhésion avec l’Ukraine en raison de ses liens avec Moscou. La décision a été adoptée, semble-t-il, pendant que M. Orban sortait boire un café.
La première conférence intergouvernementale a ensuite marqué officiellement le début des négociations. L’Ukraine s’est engagée dans le « processus de screening »2 avec l’UE. Ce processus consiste en une étude approfondie de l’ensemble du système juridique et de la législation de l’Ukraine, soit 27 000 pages de législation. À l’issue de cette étude comparative avec les lois de l’UE, des conclusions sont tirées quant à la compatibilité des deux systèmes juridiques. En conséquence, l’Ukraine a fait partie, pour la première fois, de l’évaluation de l’élargissement, tout comme la Moldavie et la Géorgie et, avant eux, les pays des Balkans occidentaux.
Le rapport est une étape clé dans l’intégration de l’UE, il évalue le degré de préparation de l’Ukraine à devenir membre de l’UE pour chaque élément du rapport. D’après ses conclusions, l’Ukraine n’est pas vraiment prête à devenir membre de l’UE. Certains ajustements ne posent pas de problème. C’est le cas, par exemple, de la politique étrangère et de sécurité commune, pour laquelle l’Ukraine était déjà presque entièrement alignée sur l’UE avant même d’être candidate. Cependant, d’autres chapitres sont plus délicats, tels que les chapitres fondamentaux, et plus encore après la réforme de la méthodologie du rapport, qui a été réalisée, soit dit en passant, à l’initiative des dirigeants français. Désormais, les chapitres de négociation sont divisés en six groupes, dont le groupe principal est consacré aux « fondamentaux ». Au sein de ce groupe fondamental, l’Ukraine a le plus de mal avec le chapitre 23, qui porte sur l’État de droit et la justice et qui s’intitule « système judiciaire et droits fondamentaux ». Ce chapitre est le premier à être ouvert lorsque les négociations commenceront et le dernier à être fermé pour s’assurer que les problèmes qui se sont produits avec la Pologne ou la Hongrie en ce qui concerne les droits fondamentaux ne se reproduiront pas avec les nouveaux membres.
La guerre, accélérateur d’intégration ?
L’une des particularités, l’une des caractéristiques spéciales de l’Ukraine dans son parcours d’intégration est le fait que l’Ukraine est en guerre. De toute évidence, cela n’a pas été le cas pour les autres pays dans le processus d’adhésion. Néanmoins, le plus grand défi auquel l’Ukraine sera confrontée au cours de son intégration européenne pourrait être démographique. En effet, environ 8 millions de personnes ont quitté l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022. Il en résulte une énorme pénurie de main-d’œuvre sur le marché du travail ukrainien, et la situation économique de l’Ukraine la rend dépendante de l’aide extérieure. En outre, les salaires du secteur public restent très bas et très peu de personnes sont disposées à rester dans la fonction publique. Confrontés aux épreuves de la guerre et à des situations financières extrêmement difficiles, même les bons fonctionnaires envisagent de partir. Le gouvernement est conscient de la situation et il est de plus en plus difficile de trouver des experts dans l’administration. C’est pourquoi le plus grand défi pour l’Ukraine, en ce qui concerne ses négociations avec l’UE, est de trouver des spécialistes capables de mettre leur expertise au service de l’Ukraine.
Ensuite, l’Ukraine est entrée dans la deuxième partie de l’examen, appelée « examen bilatéral »3, qui représente la majeure partie de la préparation de la procédure de négociation. Selon les experts gouvernementaux ukrainiens, les négociations devraient commencer l’année prochaine, peut-être en février ou en mars, en tout cas sous la présidence polonaise de l’Union européenne, qui est beaucoup plus encline à soutenir l’Ukraine.
Pour revenir au chapitre 23, l’Ukraine prépare actuellement une feuille de route pour l’État de droit et les droits fondamentaux, en s’inspirant du processus mis en place dans les pays des Balkans occidentaux. D’une manière générale, l’Ukraine a, en réalité, très peu de choses à négocier. Il en va de même pour les pays des Balkans lorsqu’on les interroge sur la « philosophie » de ces « négociations ». La réponse est assez claire : il n’y a pas grand-chose à négocier avec l’UE car quand un pays manifeste la volonté d’entrer dans l’Union européenne, c’est à lui de s’adapter à l’Union européenne. Le terrain de négociation concerne davantage la période de transition et les clauses spéciales. C’est sur ces clauses spéciales que l’Ukraine pourrait essayer de négocier pour différentes raisons.
Tout d’abord, la question de la politique agricole commune : l’Ukraine est un concurrent agricole de plusieurs membres de l’UE, dont la France. Sans recevoir aucune subvention européenne, l’Ukraine offre une production agricole à un prix inférieur à ceux des pays européens. Cette question dépasse celle de l’adhésion de l’Ukraine. Certains considèrent que la réforme de la politique agricole commune n’a que trop tardé, comme le prouvent les manifestations récurrentes d’agriculteurs qui ont eu lieu depuis de nombreuses années…
Deuxièmement, la prise de décision de l’Union européenne concernant l’adhésion de l’Ukraine pourrait se heurter à des obstacles sans rapport direct avec les institutions européennes. Les différends bilatéraux entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord illustrent bien ce risque : la Bulgarie demande à la Macédoine du Nord de reconnaitre que sa culture et ses traditions sont des cultures et des traditions bulgares, ce que la Macédoine du Nord refuse de faire. En réponse, la Bulgarie oppose son veto à toutes les négociations avec l’UE. Je crains que l’Ukraine ne soit confrontée à un problème similaire avec la Hongrie, par exemple. Nous ne pouvons que souhaiter que l’UE trouve la possibilité d’écarter les différends bilatéraux qui ne sont pas liés au processus central des négociations.
Leo Litra
Les obstacles économiques et démographiques à surmonter
Vous avez évoqué une question très sensible, celle de l’agriculture. La France occupe une place particulière dans le secteur agricole de l’UE et est réticente à tout changement de politique en faveur de l’Ukraine, étant donné que les agriculteurs français en tirent un grand bénéfice. Mais que se passera-t-il si un compromis n’est pas trouvé entre l’Ukraine et la France en ce qui concerne le système agricole ? Pensez-vous qu’une période de transition soit viable pour que l’Ukraine s’insère sur le marché ? Ou pensez-vous qu’il est difficile pour l’Ukraine de négocier quoi que ce soit en matière d’agriculture ?
La Grande Conversation
C’est une question délicate et je ne suis pas un expert en agriculture. Ce que je sais, c’est qu’il est possible d’avoir une période de transition de dix ans maximum après les négociations. Si la PAC (Politique agricole commune) n’est pas réformée, l’Ukraine aura probablement recours à une telle période de transition. Selon moi, il est difficile d’imaginer une adhésion sans réforme de la PAC. De plus, l’Ukraine n’est pas la seule à être confrontée à ce problème : si la Moldavie entrait dans l’UE, le même problème se poserait en des termes différents (la production de raisins, de pommes et de vin est importante dans le pays et pourrait concurrencer certains États membres de l’UE).
Leo Litra
Vous avez mentionné que la prochaine présidence de l’Union européenne sera la présidence polonaise, plus encline à soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Mais que pensez-vous des récentes déclarations émanant du plus haut niveau du gouvernement polonais, exigeant des excuses de la part de l’Ukraine concernant les massacres de Volhynie durant la Seconde Guerre mondiale et les décrivant comme une condition de l’acquiescement de la Pologne à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE ?
La Grande Conversation
Le ministre des affaires étrangères ukrainien, Andrii Sybiha, s’est rendu récemment en Pologne et a discuté de cette question. La Pologne fait entendre plusieurs voix sur ce sujet. Des dirigeants comme le Premier ministre Tusk et le président Duda reconnaissent que le sujet est à l’ordre du jour mais certifient aussi que la Pologne ne prendra pas la question de l’adhésion en otage lorsqu’elle abordera ces difficultés historiques avec l’Ukraine. D’autres fonctionnaires sont plus critiques et estiment que la tragédie de Volhynia, qui est un contentieux historique majeur empêchant les relations entre l’Ukraine et la Pologne de s’épanouir, devrait être abordé dans le cadre du processus d’adhésion de l’Ukraine.
Mon point de vue sur la question, et je ne parle qu’en mon nom, est que l’Ukraine doit faire un pas vers la Pologne et autoriser les recherches des victimes du massacre de Volhynia. Il s’agissait d’une question centrale pour le président Duda, et nous pensions qu’elle avait été résolue lorsque le président Zelensky avait accepté, il y a quelques années, que des recherches aient lieu en Pologne afin de trouver et d’identifier les restes des personnes décédées. Toutefois, les récents conflits suscités par les textes apposés sur les monuments commémoratifs en Pologne ont mis en péril ces recherches4. Apparemment, aucun changement n’interviendra avant les prochaines élections, car il s’agit d’une question sensible dans les deux pays. Il est donc très important pour l’Ukraine, non pas en dépit de la guerre mais à cause d’elle, de donner le feu vert à ces recherches. Quels que soient les problèmes qui peuvent subsister entre la Pologne et l’Ukraine, y compris des problèmes de mémoire historique, il n’y a rien que les deux pays ne puissent résoudre par le dialogue.
Les relations avec la Hongrie sont très différentes. Dans le cas de la Hongrie, l’Ukraine a fait tout ce que les dirigeants hongrois demandaient. L’Ukraine a même demandé et obtenu l’évaluation de la Commission de Venise en ce qui concerne la loi sur les minorités, ce qui signifie que l’Ukraine s’est alignée sur les normes de la Commission de Venise et du Conseil de l’Europe. Il s’agit là d’une reconnaissance de progrès pour un pays en guerre ! Pourtant, les dirigeants hongrois restent hostiles à la candidature ukrainienne. Il est donc difficile de ne pas soupçonner que les dirigeants hongrois n’agissent pas dans leur propre intérêt mais parfois dans celui du gouvernement russe…
Leo Litra
Dans les prochains mois, les élections présidentielles auront lieu en Pologne. Craignez-vous que, d’une manière ou d’une autre, la candidature ukrainienne à l’UE ne soit politisée lors de la campagne présidentielle en Pologne ?
La Grande Conversation
Il pourrait y avoir des tentatives en ce sens, notamment de la part de petits partis radicaux. Et ce ne serait pas la première fois si cela arrivait.
Le débat sur l’Ukraine en Pologne se concentre sur deux éléments : l’histoire et l’économie. À l’heure actuelle, environ un million de réfugiés ukrainiens vivent en Pologne. Ce mouvement d’immigration a suscité des critiques au sein de la société polonaise sur le thème : « que font-ils ici et pourquoi payons-nous pour eux ? » Mais ce que certains n’ont pas compris, c’est que beaucoup de ces personnes travaillent, paient des impôts et représentent une force de travail importante pour la Pologne, surtout après que de nombreux Polonais sont partis en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d’autres pays. Dans l’ensemble, et en raison de la pénurie de main-d’œuvre, l’immigration ukrainienne est un avantage pour l’économie polonaise. Par conséquent, il serait surprenant, bien que tragique, que le débat ne soit pas plus positif en ce qui concerne l’Ukraine s’il devient partie intégrante du débat de la campagne en Pologne.
Leo Litra
Le calendrier d’adhésion : espoirs et incertitudes
Quel est, selon vous, un calendrier réaliste pour le processus d’adhésion de l’Ukraine ? Il faudra du temps pour reconstruire le pays et un secteur public fonctionnel capable d’appliquer la législation, etc. Cette période correspondra-t-elle aux attentes du peuple ukrainien ou pensez-vous qu’elle pourrait entraîner une sorte de « lassitude » à l’égard de l’adhésion ?
La Grande Conversation
Ce sont des questions très fluctuantes, qui appellent des réponses changeantes, en particulier en ce qui concerne le calendrier de l’intégration de l’Ukraine. Il dépend de nombreux facteurs : quand la guerre prendra-t-elle fin ? L’UE va-t-elle s’accorder sur le prochain cadre financier incluant l’Ukraine ou non ? L’Ukraine, en tant que candidat, va-t-elle bénéficier des fonds de cohésion ou de certains fonds de l’UE qu’elle a essayé d’obtenir malgré sa non-appartenance ?
Ces questions n’ont pas encore trouvé de réponse. Néanmoins, la candidature de l’Ukraine a été couronnée de succès jusqu’à présent. Par exemple, avant le big bang de l’élargissement en 2004, l’Autriche, la Suède et la Finlande ont entamé un processus d’adhésion en 1992 avant de se voir accorder le statut de membre en 1995. La raison pour laquelle l’Autriche, la Suède et la Finlande ont bien réussi leur intégration vient sans doute de leur entrée dans le marché intérieur avant leur demande d’adhésion et par l’incitation de Jacques Delors en 1986 qui a dit : « S’ils ont le droit de s’appeler Européens, qui sommes-nous pour les en empêcher ? »
Pourquoi établir un parallèle entre ces deux cas ? Parce que l’Ukraine peut s’appuyer sur l’accord d’association de 2014. Cela signifie que 10 ans se sont écoulés depuis que l’Ukraine a mis en œuvre l’accord d’association. Depuis, l’Ukraine s’est engagée dans des réformes et a obtenu des progrès dans de nombreux domaines, y compris dans le volet de l’accord consacré à l’intégration du marché intérieur. Sur la base de ces considérations, un calendrier réaliste, à condition que l’Ukraine ne soit pas confrontée à d’autres difficultés inattendues et à de mauvaises surprises, serait de cinq ans.
Cela dit, nous avons toutes les raisons de penser que le processus ne sera pas si facile ni si rapide… Le principal critère qui influe sur le calendrier est évidemment la guerre : plus vite elle se terminera, plus vite l’Ukraine pourra devenir membre de l’UE.
En ce qui concerne la lassitude liée à l’adhésion, je pense qu’elle n’est pas d’actualité. Pour l’instant, tout est allé très vite. L’Ukraine a d’abord soumis une demande de perspective d’adhésion et l’a obtenue en juin 2022. Ensuite, en décembre 2023, l’Ukraine s’est vu accorder le statut de candidat, puis la première conférence intergouvernementale a eu lieu et, aujourd’hui, le screening est en cours juste avant le début des négociations. Le processus a donc été très dynamique.
En outre, les sondages d’opinion montrent que 86 % de la population ukrainienne est favorable à l’intégration européenne.
Leo Litra
La guerre complique considérablement le processus d’adhésion de l’Ukraine. En parallèle, l’Ukraine fait beaucoup pour mettre en œuvre la législation sur la lutte contre la corruption, les oligarques, le blanchiment d’argent et le crime organisé. Pendant ce temps, le secteur public s’affaiblit et l’économie est en recul. Comment mettre en œuvre toute cette législation dans un contexte aussi défavorable ?
La Grande Conversation
Il existe un problème de confiance entre les fonctionnaires ukrainiens et la population. Cette méfiance concerne moins les individus en particulier que le statut, la position que les fonctionnaires occupent dans les institutions et auprès des sphères dirigeantes. En fait, la société ukrainienne semble projeter des stéréotypes datant des années 1990 et du début des années 2000, lorsque de nombreux fonctionnaires étaient impliqués dans des affaires de corruption. Certes, l’Ukraine rencontre encore des difficultés dans sa lutte contre la corruption, mais rien de comparable à ce qu’elle a connu par le passé. Dans ce domaine en particulier, l’aide de l’Union européenne a été décisive grâce à l’agence nationale de la lutte contre la corruption. En d’autres termes, c’est le grand levier d’influence de l’UE sur l’Ukraine qui a permis à la lutte contre la corruption de se dérouler efficacement dans le pays. Simultanément, un autre problème est apparu : l’interconnexion croissante entre, d’une part, les mesures anti-corruption et la réforme du secteur public et, d’autre part, le processus de reconstruction du pays. Le processus de reconstruction devrait être supervisé par les donateurs internationaux, les gouvernements et tous les contributeurs, mais géré localement par les Ukrainiens afin qu’ils s’approprient le processus par l’intermédiaire de leur gouvernement local et des communautés locales.
L’Ukraine est compétente pour exprimer ses besoins et ses aspirations dont la réalisation dépend de l’aide étrangère, c’est indéniable. Mais en même temps, donner aux Ukrainiens la clé de la reconstruction de leur pays s’avérerait être un excellent testpour l’Ukraine, qui montrerait ainsi si elle est capable ou non de se réformer et d’adhérer potentiellement à l’UE. Bien entendu, un processus de reconstruction empêtré dans d’interminables systèmes de corruption, entre autres, compromettrait grandement notre processus d’adhésion à l’UE.
Leo Litra
Le processus d’élargissement fait régulièrement l’objet de critiques. Pensez-vous qu’il devrait évoluer et de quelle manière ?
La Grande Conversation
Les experts ukrainiens sont très favorables à une évolution de la méthodologie de l’élargissement. En fait, cette question est fréquemment débattue avec des représentants de différents pays. Le principal défaut identifié concerne le fait qu’elle n’est pas suffisamment méritocratique. Pourquoi l’ouverture des négociations devrait-elle être conditionnée par quoi que ce soit, alors qu’un pays s’est déjà engagé dans le processus d’intégration ? Pourquoi le processus d’intégration serait-il soumis au vote unanime de l’UE ? Les multiples votes unanimes requis pour l’ouverture, l’étalonnage et la clôture de chaque chapitre du processus d’intégration semblent excessifs et superflus.
En outre, il est nécessaire d’entamer la discussion sur la répartition du futur budget de l’UE lorsque l’Ukraine deviendra membre. Il existe un excellent rapport de Bruegel sur le sujet, qui montre que de nombreux pays, en particulier les pays d’Europe centrale, sont opposés à l’élargissement, craignant qu’ils ne deviennent des contributeurs nets, ce qui nuirait à leur économie. Le rapport Bruegel indique également que l’augmentation du budget de l’UE serait de 0,6 % en cas d’intégration de l’Ukraine.
Il convient également d’attirer l’attention sur les lacunes du marché intérieur de l’UE, notamment dans le secteur agricole, comme indiqué plus haut. Certains problèmes de calcul entre le marché intérieur de l’UE concernant l’agriculture et le retour possible de l’Ukraine à des quotas agricoles sur les exportations pourraient empêcher le pays de se libéraliser et donc de s’intégrer.
En outre, le secteur des transports, et en particulier le transport par camion, est largement dominé par la Pologne. L’intégration de l’Ukraine dans le marché intérieur entraînerait la concurrence des entreprises ukrainiennes de transport routier et il ne fait aucun doute que les entreprises ukrainiennes offriraient des prix plus compétitifs.
En fin de compte, la médiation de la Commission européenne est nécessaire dans ces discussions. Elle est appelée à jouer un rôle essentiel puisque l’Ukraine et la Pologne ne mettront probablement pas de côté leur rancune de leur propre chef, sans parler d’un accord ou d’un règlement satisfaisant sur la question.
Enfin, les normes environnementales constituent un défi pour l’Ukraine. L’économie ukrainienne a hérité de nombreuses normes de l’Union soviétique. Et malheureusement, les Ukrainiens ne sont pas capables de changer rapidement sur ce point. De manière assez ironique, l’agression russe a aidé l’Ukraine à se décarboniser puisque la plupart de ses industries polluantes en termes d’émissions nettes de gaz à effet de serre étaient situées dans la partie orientale du pays et sont maintenant complètement détruites.
Leo Litra
Le défi de la négociation en temps de guerre
Vous avez fait une comparaison entre l’OTAN et l’UE, en disant que l’image de l’UE s’est améliorée grâce à son implication dans les questions de sécurité après l’éclatement de la guerre. Pourriez-vous être un peu plus précis sur l’image de l’OTAN aujourd’hui ?
Deuxièmement, pensez-vous vraiment que l’UE puisse devenir un acteur important dans le secteur de la sécurité, compte tenu des débats internes à l’UE concernant les rôles respectifs de l’OTAN et de l’UE dans ce secteur ?
Enfin, est-il possible pour l’Ukraine d’envisager une intégration dans l’UE avec des territoires encore occupés par la Russie ? Bien sûr, nous ne pouvons pas comparer Chypre et l’Ukraine, mais Chypre est un membre de l’UE qui a des territoires occupés. Est-il possible d’envisager cela pour l’Ukraine ?
La Grande Conversation
La perception de l’OTAN en Ukraine a considérablement changé en raison de son absence aux premiers stades de la guerre. En fin de compte, après toutes les discussions sur l’autonomie stratégique, il s’est avéré que les dirigeants de l’OTAN n’étaient pas assez audacieux pour défendre les principes fondamentaux de la charte des Nations unies. Dès lors, pourquoi les Ukrainiens auraient-ils besoin de l’OTAN ? Ne vous méprenez pas, l’OTAN est toujours considérée comme très puissante. Cependant, les Ukrainiens sont devenus sceptiques en raison de ses choix qu’ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Cela dit, il y a loin de la critique à la désapprobation et les Ukrainiens pensaient simplement que l’OTAN pouvait faire plus.
D’un autre côté, l’attitude de l’UE a été une incontestable bonne surprise : si elle a utilisé l’APC5 et la facilité de soutien à la paix pour aider l’Ukraine, de nombreux pays se sont en outre mobilisés. Le Royaume-Uni et la France ont été les premiers pays à fournir des missiles sérieux à l’Ukraine. L’Union européenne est en train de devenir un acteur important, y compris en matière de sécurité. Cependant, cette implication dépend aussi de l’attitude américaine, qui est désormais plus incertaine, même s’il existe un consensus bipartisan aux États-Unis sur le fait qu’ils s’impliqueront moins en Europe et, par conséquent, en Ukraine.
L’UE doit réagir à ces déclarations d’une manière ou d’une autre et faire ses propres choix. Elle a élaboré une stratégie pour l’industrie européenne de la défense, publiée en mars 2024. Il s’agit d’un document très intéressant dont le seul problème est l’insuffisance des fonds alloués au développement de l’industrie. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars pour s’attaquer aux goulets d’étranglement et aux chaînes d’approvisionnement des entreprises de défense, ce qui est très peu.
Un exemple du côté russe : rien que pour l’usine de poudre kazakhe en Russie, qui fournit à la Russie ses composants en poudre pour les munitions, la Russie a investi 1 milliard de dollars. En comparaison, 1,5 milliard de dollars semble un montant ridicule de la part de 27 pays. Pourquoi ne pas utiliser, à la place, les mécanismes d’emprunt européens, comme cela s’est produit lors de la crise de Covid, mais en les orientant vers votre secteur de la défense au niveau de l’UE ? Le montant n’a pas besoin d’égaler l’énorme somme empruntée pendant la pandémie (800 milliards de dollars), bien sûr, mais il donnerait certainement à l’UE un atout critique dans le secteur et un potentiel pour développer une stratégie de défense crédible. À mon avis, cela fait partie des questions qui doivent être sérieusement examinées au sein de l’UE afin de faire face au défi actuel.
En ce qui concerne les territoires occupés, ils sont l’enjeu de la guerre depuis le début. Il n’y a pas de fatalité, car la question dépend principalement de la persistance du soutien étranger, tant américain qu’européen. Cependant, la définition de la victoire selon l’OTAN diffère de celle de l’Ukraine : l’une consiste à empêcher Poutine de réussir jusqu’au bout, tandis que l’autre se réfère à l’intégrité territoriale. Par conséquent, si cette possibilité d’occupation partielle finit par se concrétiser, il y a des chances qu’elle aboutisse à un scénario similaire à celui de la Corée, avec un parallèle définissant la ligne de démarcation entre l’Ukraine et les territoires occupés par la Russie. Si cela devait se produire, des garanties de sécurité seraient nécessaires, ce que seuls les États-Unis et l’OTAN peuvent offrir à l’heure actuelle.
Mais tout cela est très hypothétique. La question principale serait plutôt : l’UE est-elle prête pour un tel scénario ? À cet égard, on peut raisonnablement douter que le scénario soit attrayant pour les dirigeants de l’UE, tout comme Chypre n’est pas un modèle très attrayant.
Leo Litra