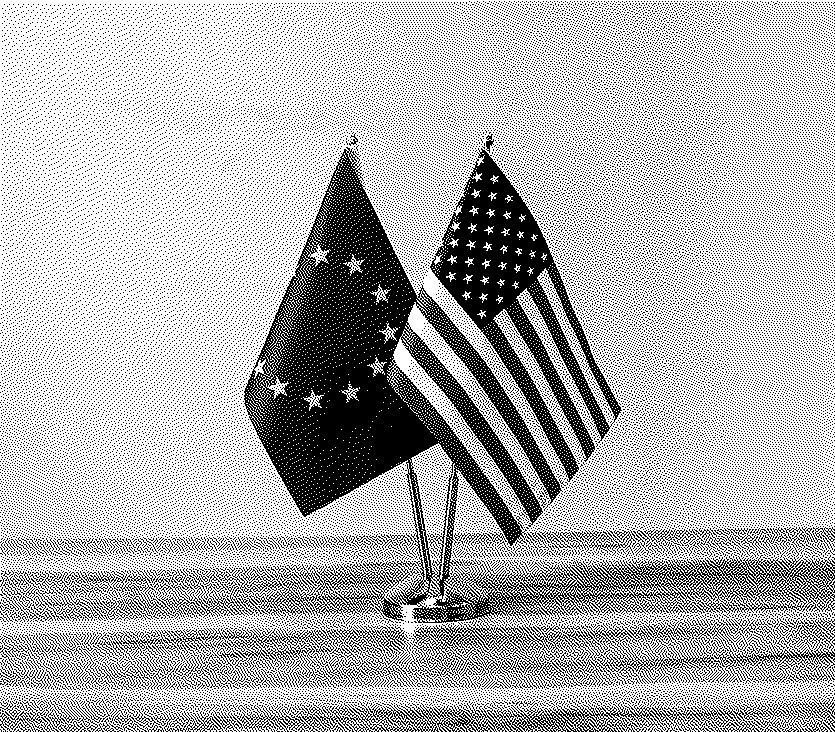Le 27 juillet dernier, dans le golf de Turnberry en Écosse, propriété privée de Donald Trump, le président américain et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que leurs délégations affichaient, tout sourire dehors et pouces fièrement levés vers le ciel, leur satisfaction d’avoir conclu un accord évitant une guerre commerciale, après plusieurs mois de menaces, d’imposition de droits de douane temporaires et d’incertitudes initiées par la partie américaine. Sur la photo1, seules deux personnes font grise mine et gardent les mains croisées : Sabine Weyand, la directrice générale du commerce de la Commission2 et la porte-parole en chef de la Commission Paula Pinho. Elles savent que l’Europe a perdu.
Canossa, « bourgeois de Calais », Munich, capitulation : des précédents historiques peu glorieux n’ont pas manqué d’être immédiatement invoqués. En première ligne pour porter ces jugements sévères et définitifs, beaucoup d’anciens négociateurs commerciaux de la Commission qui n’avaient jamais conclu d’accords aussi déséquilibrés et, bien sûr, les analystes français, même si les autorités françaises ont été relativement discrètes à l’exception d’un tweet tonitruant mais somme toute pertinent du premier ministre en poste en juillet 2025 François Bayrou, écorchant au passage le nom de la présidente de la Commission : « accord Van der Leyen-Trump : c’est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission ».
Plus grave encore que le déséquilibre des résultats, l’accord battait en brèche une promesse de l’UE : son pouvoir de marché était censé lui permettre de promouvoir ses valeurs et de défendre ses intérêts. Cette promesse est désormais dissipée. Dans un monde devenu agressif et où l’économie est mobilisée à des fins géopolitiques, l’UE ne sait, ni ne veut faire la guerre dans le domaine qui est le sien, le commerce.
Appeasement3
L’accord du 27 juillet complété par une déclaration commune en trois pages4 et dix-neuf points datée du 20 août sous la dénomination orwellienne de « cadre pour un accord de commerce équilibré, loyal et réciproque »5 peut être résumé facilement : l’UE baisse sa protection aux frontières en s’engageant à laisser entrer sur son marché les produits industriels américains à droit nul et en accordant des conditions d’accès préférentielles à certains produits agricoles américains importées en Europe ; les Etats-Unis renforcent la leur, imposant aux exportations européennes un « tarif » de 15%, sauf si le droit préexistant aux décisions de Donald Trump – tarif de droit commun dit « NPF »6 s’appliquant à tous les partenaires des États-Unis- dépassait les 15%, auquel cas il continue à s’appliquer7. Certains secteurs correspondants à des intérêts américains (médicaments génériques, produits aéronautiques) échappent à la taxation. En sens inverse, les produits visés par les mesures mises en place par l’administration Trump au titre de la sécurité nationale comme les produits sidérurgiques restent soumis à des droits prohibitifs de 50%.
S’ajoutent des éléments chiffrés d’achats européens à venir de produits énergétiques8 ou de micro-processeurs9 ou d’investissements d’entreprises européennes aux Etats-Unis dans les secteurs « stratégiques »10, sous le registre de la déclaration d’intention (« EU intends », « European companies are expected to invest… »). Ils sont donc en principe non contraignants mais peuvent servir de prétexte à une reprise d’hostilité si la réalité s’avérait sensiblement différente des intentions affichées. L’UE indique également qu’elle prévoit d’accroitre significativement ses achats dans le domaine de la défense. Les engagements sont dans un seul sens.
L’accord est donc clairement et largement asymétrique. Il s’agit d’un « traité » inégal.
L’Europe ne s’est pas contentée de concéder sur ses intérêts. Elle est également revenue sur un des piliers, constamment réaffirmé, de sa politique commerciale : le respect des règles multilatérales définies dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC). En accordant un traitement privilégié aux produits américains, elle déroge à un principe fondateur de l’OMC, la clause de la nation la plus favorisée qui veut que tous les partenaires soient traités sur un pied d’égalité sauf accord de libre-échange en bonne et due forme, ce que n’est pas l’accord du 27 juillet 202511. L’Europe promouvait un monde ouvert et régulé par le droit et essayait tant bien que mal de coller à cette conviction12. Elle a accepté de déroger à sa ligne de conduite.
L’interrogation sur les raisons de l’acceptation par l’UE de cet accord est dès lors de mise, d’autant que les conséquences dommageables de la politique commerciale américaine pour l’Union ne se limite pas à l’accord du 27 juillet et se joue aussi dans les pays tiers. Les accords arrachés par les États-Unis à leurs autres partenaires comportent généralement un volet aéronautique avec des engagements fermes d’acheter des Boeings13. Le carnet de commandes d’Airbus est pour l’heure rempli avec beaucoup de livraisons en attente mais les coups de boutoir américains finiront à un moment ou à un autre par « mordre » et par déséquilibrer la compétition entre les deux premiers avionneurs mondiaux. De plus, les États-Unis cherchent à imposer leurs normes au détriment de celles promues par l’Europe. Ainsi, dans l’accord obtenu récemment de la Malaisie, ils obligent leur partenaire à s’aligner sur leur rejet du système européen d’indications géographiques protégées en matière alimentaire, qui garantit l’ancrage territorial du produit et le respect d’un cahier des charges par le producteur. Le respect de ces indications est souvent un objectif de négociation de l’UE dans ses accords de libre-échange14 et heurte la vision américaine d’une agriculture hors sol. Enfin, plus fondamentalement encore, l’UE est exposée au détournement de flux commerciaux qui ne trouvent plus de débouchés faciles aux États-Unis et qui viennent se placer sur le marché européen.
Si l’orientation de la politique américaine est aussi néfaste, pourquoi l’UE s’y est-elle ralliée ? Un premier point doit être noté. L’acceptation de l’accord euro-américain n’est pas le seul fait d’une Commission qui aurait plus ou moins forcé la main aux États-membres. Avant le 27 juillet, ces derniers se sont succédés à Washington pour plaider la cause de leurs secteurs sensibles et assurer l’administration américaine de leur volonté d’éviter une guerre commerciale. Même la France souvent prompte à endosser l’habit de la résistance en matière de commerce transatlantique est restée discrète. Elle était pourtant moins exposée que d’autres au marché américain mais ses exportations vers les États-Unis sont déterminantes pour quelques secteurs et elle a choisi de défendre – d’ailleurs sans succès – le cognac et les produits de luxe -on serait tenté d’écrire plus explicitement LVMH – plutôt que des intérêts plus stratégiques de moyen ou long terme15. Le Parlement européen qui sera amené à trancher en janvier 2026 au sein de la commission spécialisée « Inta », puis en séance plénière, corrigera peut-être la donne. L’UE a pour l’heure encaissé sa perte.
À décharge de l’UE, celle-ci n’est pas isolée dans sa tentative d’accommoder la puissance américaine. Beaucoup de partenaires commerciaux des États-Unis, même lorsqu’ils n’en sont pas dépendants sur le plan de la sécurité, se sont finalement pliés à la volonté américaine de « rééquilibrage ». Le schéma est généralement le même : des droits très élevés sont mis en place par la partie américaine, des négociations « le pistolet sur la tempe » sont engagées et aboutissent à un accord comprenant des droits plus limités (15% à 20% en moyenne, avec quelques produits privilégiés) et des contreparties accordées aux États-Unis en matière d’accès préférentiel au marché notamment dans le domaine agricole, d’approvisionnements en matériaux critiques ou de suppressions de barrières non tarifaires. Deux pays développés, la Corée et le Japon, ont pris des engagements « durs » d’investissements directs aux États-Unis offrant à ces derniers un droit de regard sur le choix des projets financés, une sorte de tribut en forme de reconnaissance de vassalité. Cette multiplicité d’accords donne en fait du crédit au narratif américain sur l’injustice commerciale dont aurait été victime les États-Unis. Seuls échappent encore à ce schéma les pays qui font ou ont fait l’objet d’exigences politiques comme le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du Sud16, et bien sûr la Chine qui, même après la trêve décrétée à Séoul le 29 octobre, se verra appliquer des droits moyens de 45%, soit 20 points de plus que lors du retour de Donald Trump aux affaires.
Un moindre mal ?
Les arguments avancés par les promoteurs de l’accord se situent tous dans le registre de l’invocation du moindre mal et du pari sur un retour à la raison outre-Atlantique :
- Les 15% moyens appliqués à l’UE sont inférieurs aux droits de 30% annoncés le 2 avril « le jour de la libération »17. L’accord permet de ramener les tarifs visant le secteur automobile de 25 à 15%. Même importants par rapport aux droits préexistants de 2,56% en moyenne18, ils peuvent être répercutés pour partie aux consommateurs, absorbés par les exportateurs ou donner lieu à des recompositions partielles de localisation des chaines d’approvisionnements19. Ponctuellement douloureux, le mal est gérable.
- L’UE est bien traitée par rapport aux autres partenaires des États-Unis, même si le Royaume-Uni a obtenu un accord sur un droit de 10% – son commerce bilatéral de marchandises est équilibré avec les États-Unis – et si le Japon et la Corée sont assujettis à un droit de 15% comme l’UE. Mais, comme précédemment souligné, les accords bilatéraux ne se limitent pas à des concessions en matière douanière et comportent des clauses souvent beaucoup plus draconiennes que celles que l’UE a été contrainte d’accepter.
- L’accord apporte de la stabilité et de la prévisibilité aux entreprises après des mois d’incertitudes et d’annonces erratiques, le président américain s’essayant à la stratégie du fou20[20], chère à un de de ses prédécesseurs, Richard Nixon, qui avait comme lui mis en place un droit de douane général de 10%.
- L’UE a préservé son autonomie législative et n’a pas été conduite à des abandons de souveraineté alors que la liste de courses initiale des États-Unis en la matière était très fournie21. L’accord du 27 juillet, précisé en août, fait mention des préoccupations américaines en matière de réglementations européennes dans le domaine environnemental (règlement déforestation, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières), de responsabilité sociale des entreprises et de « due diligence » (directives CSDDD et CRSD) ou de la sécurité alimentaire, mais l’UE se contente d’un engagement de « meilleurs efforts ». Une partie de ces réglementations est d’ailleurs en train d’être détricotée au niveau européen.
Les arguments à l’appui de la démonstration sont souvent fragiles ou discutables. L’Europe est relativement bien traitée, mais elle n’est ni la Malaisie, ni même la Corée et le Japon, avec tout le respect dû à ces pays. Elle le doit à la taille de son marché et à l’intégration des économies transatlantiques qui créent des intérêts réciproques. La solidité d’un accord pour partie imprécis ou renvoyant à des discussions ultérieures est pour le moins aléatoire. La versatilité d’un président américain, « mercurial » comme l’écrivent les Anglo-saxons, est malheureusement établie et la crédibilité de sa parole sujette à caution. Le fait générateur d’un changement de position peut se trouver totalement hors du champ économique comme l’a montré récemment la remise en cause du compromis trouvé avec le Canada, en raison d’une publicité heurtant la susceptibilité du dirigeant américain. La sanctuarisation de la souveraineté européenne ne tiendra pas longtemps. L’expression des préoccupations américaines et l’engagement des Européens d’essayer de les accommoder sont autant de fils sur lesquels l’administration américaine pourra tirer pour venir contester la liberté de légiférer de l’UE. Le président américain s’est déjà manifesté en ce sens en contestant les réglementations européennes dans le domaine numérique ou les dispositions sur les engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale attendues des entreprises produisant en Europe ou commerçant avec elle. Un répit a été obtenu mais le conflit commercial avec un partenaire imprévisible et impérial ne peut que reprendre sauf à ce que l’UE pratique systématiquement l’auto-censure en intégrant les injonctions américaines dans ses décisions. Le fossé avec le gouvernement américain dépasse d’ailleurs le sujet de la relation bilatérale. Lutte contre le réchauffement climatique, utilisation du dollar : la volonté américaine d’imposer ses vues, peut en permanence déborder dans le champ commercial.
Au final, un seul argument peut être difficilement contré : l’accord était une des contreparties au maintien de l’engagement américain dans le conflit ukrainien, aux côtés de l’Europe. Le lien a été explicitement fait par l’administration américaine aux dires de la négociatrice européenne Sabine Weyand22. Pour reprendre la formule d’un éditorialiste du Financial Times, Janan Ganesh, partisan de l’apaisement : « on ne déclenche pas une guerre commerciale contre une armée qui vous défend »23. Ici aussi, il s’agit d’un pari qui n’est pas gagné. Il est néanmoins possible de constater que le président américain plus fasciné par l’autocrate et l’agresseur Vladimir Poutine que par le résistant Volodymyr Zelensky n’a pas, jusqu’à présent, totalement basculé côté russe.
La fin de la promesse européenne de la puissance par le commerce
Mais au-delà de ses conséquences économiques pour l’Europe, l’accord vient surtout dissiper une des promesses majeures de la construction européenne. Malgré toutes ses limites et ses défauts, l’UE mettait en avant un argument apparemment imparable : la taille de son marché – 13% environ des importations mondiales de marchandises et 22,5% des importations de services commerciaux en 202424 – lui permettait de promouvoir ses intérêts et d’affirmer ses valeurs dans le monde. Le « pacte vert » affichait avec force cette ambition : « la politique commerciale agit comme une plateforme permettant de nouer le dialogue avec les partenaires commerciaux sur l’action en faveur du climat et de l’environnement »25.
À l’évidence, cela n’a pas marché avec les États-Unis ou alors l’UE n’a pas voulu se saisir de son pouvoir de marché. Le rapport de forces est, il est vrai, déséquilibré, avec les États-Unis qui importent plus que l’UE – ils absorbent 16,5% des importations mondiales de marchandises -et dans une guerre commerciale, l’exportateur net à plus à perdre que l’importateur net et l’UE est excédentaire que ce soit dans sa relation bilatérale avec les États-Unis – même rééquilibrée avec les services qui sont plus compliqués à gérer dans un conflit commercial – ou au niveau mondial avec un surplus de 157 Mds de dollars en 202426.
Ce constat est d’autant plus inquiétant que le commerce est désormais « arsenalisé 27» et enrôlé dans la compétition géo-politique entre puissances28.
L’Europe confrontée à deux super-puissances prédatrices29 n’est pas adaptée pour faire la guerre. Elle a été construite à partir d’un projet de paix garantie par le « doux commerce » et l’interdépendance réciproque, modèle ensuite proposé au monde pour l’organisation de la mondialisation30. « La norme sans la force » chère à Zaki Laïdi31 ne fonctionne pas face à la volonté de puissance et d’accaparement des ressources et à la négation des règles du jeu acceptées précédemment collectivement.
Il est vrai qu’au-delà de ses faiblesses institutionnelles bien connues (lenteur de ces processus de décision interne, gouvernance éclatée entre Commission, Parlement et des Etats-membres divisés et aux intérêts contradictoires, moyens propres limités, dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis), l’UE est confrontée à ce que Janan Ganesh, toujours lui, appelle la « malédiction de la géographie »32. Alors que l’économie mondiale appelle toujours plus de ressources matérielles – limitées au niveau planétaire33-, notamment pour son développement numérique et pour la transition écologique, l’UE est dépendante tant sur le plan énergétique que pour l’accès aux terres rares. L’Europe parait dépassée.
« Para bellum »
Il y a certainement un chemin lui permettant de se réaffirmer dans un jeu commercial de plus en plus agressif, la réponse principale, la plus difficile, étant de nature politique.
Pour ne pas se défausser dans un conflit commercial systémique, l’UE doit tout d’abord être en mesure d’accompagner les entreprises victimes des intentions hostiles de l’ancien partenaire. Sinon, elle sera conduite assez systématiquement à arbitrer pour des intérêts commerciaux de court terme, au détriment de ses valeurs ou d’une vision économique plus stratégique. L’Allemagne, jusqu’à présent fortement excédentaire dans ses relations avec le reste du monde, est naturellement la première à plaider pour l’apaisement. Dans les premiers « échanges » avec l’administration Trump en avril 2025, l’UE qui s’apprêtait légitimement à prendre des mesures de rétorsion calibrées sous forme de droits additionnels ciblés sur des produits importés, en réponse aux premières décisions américaines sur l’acier et l’aluminium, a tout abandonné lorsque la partie américaine a menacé l’Europe de contre-représailles ciblant particulièrement les vins et spiritueux, la France n’étant pas la dernière réclamer la suspension des mesures européennes. Dans les années 1980 et 1990, les pays exportateurs garantissaient leurs entreprises contre le risque politique inhérent à la signature de contrats dans un pays tiers. Celui-ci se manifestait principalement dans le défaut de paiement du client, consécutive à l’insolvabilité du pays partenaire. Aujourd’hui, le risque est géopolitique et se traduit par des mesures de restrictions à l’exportation ou par la fermeture de marchés précédemment ouverts. L’UE ou, à défaut, les États-membres doivent proposer un mécanisme assurantiel à leurs exportateurs pour partager avec eux ce risque ou alors prévoir de reverser une partie des droits additionnels perçus dans le cadre d’un conflit commercial aux parties lésées côté européen pour les accompagner dans leur adaptation aux conséquences de la guerre commerciale, à travers un fond d’adaptation à la démondialisation en quelque sorte, miroir du fonds d’adaptation à la mondialisation créé en 2006 dans la phase de « mondialisation heureuse »34.
Exister dans la guerre commerciale suppose également d’être en capacité d’intervenir efficacement et rapidement. Sur ce plan, l’UE a un atout. Elle s’est dotée en novembre 2023 d’un règlement « relatif à la protection de l’Union et de ses États-membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers ». Le règlement bien conçu a un double mérite :
- il définit clairement la coercition économique : l’utilisation du commerce ou des investissements pour obtenir « la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État-membre » (article 2 du règlement)
- il prévoit des mesures de riposte larges et variées comme l’exclusion des marchés publics, des mesures visant le commerce des services, les investissements directs, l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou des restrictions pour les activités bancaires et d’assurance (annexe I du règlement).
Conçu initialement pour réagir face à la Chine, le règlement anti-coercition parait bien calibré pour nourrir un dialogue « musclé » avec les États-Unis.
Mais dans l’hypothèse d’un conflit commercial « chaud » du type de celui que le président américain a engagé avec l’UE, cette dernière va pâtir de ses prudences procédurales. En cas de mesure hostile susceptible de déclencher la mise en œuvre du règlement, la Commission est supposée agir « promptement » et procéder à un examen qui ne doit pas durer plus de quatre mois. Elle invite ensuite le pays tiers concerné à présenter ses observations dans « un délai déterminé ». Le Conseil doit ensuite valider à la majorité qualifiée la décision d’actionner le règlement, là encore « promptement », ici dans un délai de deux mois. Il s’en suit une nouvelle étape de consultations avec le pays concerné puis le constat par la Commission que les actions menées pour trouver une solution n’ont pas abouti dans un « délai raisonnable » avant l’adoption éventuelle de mesures de riposte. Pour résumer, la mise en place de mesures de protection de l’UE va prendre du temps, là où les « partenaires » agissent rapidement et sans se soucier de règles internes35. Les États-membres doivent approuver les propositions de la Commission à la majorité qualifiée positive alors que comme en matière d’instruments de défense commerciale, une majorité qualifiée négative pourrait seule contraindre la Commission à revenir sur sa décision. Dans les négociations commerciales « classiques », la Commission compte en années, voir en décennies. Dans la guerre commerciale, les décisions se prennent en quelques semaines, au plus en quelques mois. Traditionnellement, les États-membres cherchent à encadrer la Commission. Dans le nouvel état du monde, cette dernière doit gagner en capacité de réaction autonome. Le règlement anti-coercition pourrait être amendée en ce sens.
Plus fondamentalement, l’UE n’est pas en mesure de s’affirmer dans la guerre économique. Elle est faible, lente et divisée. Il faut « se débrouiller » avec cela dans un premier temps. Elle peut réagir puisqu’elle s’est dotée d’instruments en ce sens. Elle vient de le faire en imposant des droits anti-dumping significatifs sur ses importations de produits sidérurgiques (50%), mais globalement, elle fait trop peu, trop tard. Alors que la riposte aux défis extérieurs appelle d’abord des réponses internes, un think tank bruxellois l’« European Policy Innovation Council » soulignait en septembre qu’un an après la publication du rapport Prodi qui demandait un réveil européen, seulement 11% de ses 383 recommandations avaient été mises en œuvre36. Il est certes possible d’exhorter à un changement décisif de l’intégration européenne, « s’unir ou périr » pour reprendre la formule du chapitre français du Mouvement européen. Mais il ne faut pas se bercer d’illusion : les peuples n’en veulent pas, les populistes qui exercent le pouvoir dans plusieurs États-membres ne l’accepteront pas et les égoïsmes nationaux bloqueront les compromis nécessaires.
Restent à promouvoir des avancées, à côté de l’UE, dans des initiatives entre partenaires volontaires notamment en matière de recherche, de politique industrielle, de décarbonation ou de protection des consommateurs. La Commission peut s’en accommoder, voire parfois accompagner37. Si elle s’y oppose, il conviendra d’engager le bras de fer avec elle.
Avec l’accord de Turnberry, l’UE a gagné du temps et en a payé le prix. Elle doit maintenant se préparer à la reprise des hostilités.