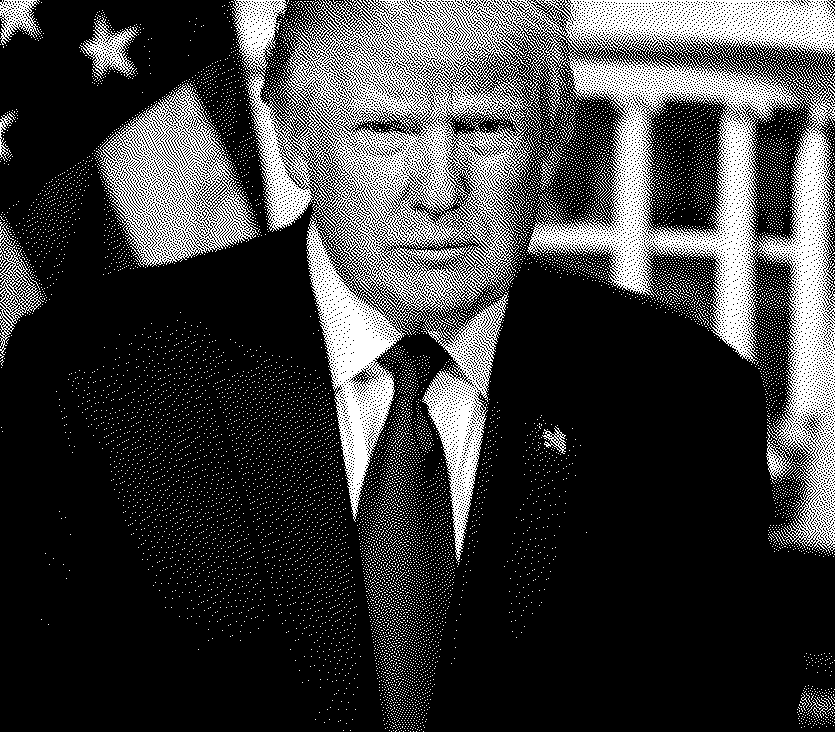À l’approche de l’investiture de Donald Trump, l’ambiance à Bruxelles et dans les capitales européennes va de la panique à la résignation, beaucoup espérant qu’un modus vivendi transactionnel puisse être trouvé. Mais des accords ad hoc ne répondront pas à la grande question qui plane dans l’air : que signifiera une nouvelle présidence Trump pour la coopération mondiale ? Quel espoir reste-t-il pour que des efforts collectifs permettent de sauvegarder les biens publics mondiaux tels que le climat et la santé publique, et de préserver la prospérité en maintenant l’interdépendance économique ?
L’élection de Trump est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui considèrent qu’il existe une responsabilité collective vis-à-vis des biens communs mondiaux et que l’interdépendance doit être gérée dans le cadre de règles claires, stables et cohérentes. Trump est un nationaliste pur et dur qui considère fondamentalement la gouvernance mondiale comme un obstacle à la primauté américaine. Plutôt que d’adhérer à des principes et à des règles, son approche est entièrement transactionnelle. Il a déjà menacé le Canada et le Mexique de relever les droits de douane s’ils n’empêchaient pas le fentanyl et les migrants d’entrer aux États-Unis. Il a également averti les neuf pays des BRICS que toute tentative de créer un rival du dollar ferait l’objet de représailles sévères et a dit à l’Europe qu’elle devrait acheter plus de pétrole et de gaz aux États-Unis sous peine d’être frappée par de nouveaux droits de douane. Ses dernières foucades autour de l’annexion du Groënland ou de l’absorption du Canada témoignent de ce que ce n’est pas la raison qui le guide.
Cependant, il y a de bonnes raisons de penser que Trump n’est pas une « aberration temporaire« , comme l’a dit le président américain Joe Biden en 2020, mais plutôt l’expression aberrante d’un changement fondamental dans l’attitude des États-Unis à l’égard du leadership mondial. Avec une Amérique fatiguée du rôle mondial qu’elle assumait de longue date, le monde est arrivé à la croisée des chemins. Rappelons l’analyse de l’historien économique Charles Kindleberger sur la Grande Dépression : la crise ne reflétait pas seulement la perte relative de pouvoir de la Grande-Bretagne, mais aussi le refus de l’Amérique d’assumer le rôle de leader mondial.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, cependant, les États-Unis ont pleinement assumé ce rôle, qui associe des privilèges exorbitants à des devoirs exorbitants. Les États-Unis profitent largement de la suprématie mondiale du dollar américain – qui leur procure, entre autres, des revenus de seigneuriage internationaux – tout en assumant la responsabilité de la stabilité monétaire et financière. Cela implique de fournir des liquidités en dollars aux banques centrales partenaires en période de tensions monétaires (comme en 2008-2010) et de maintenir ouvert le marché des biens américains lorsque la demande mondiale est faible.
Mais les États-Unis n’acceptent plus ce contrat implicite, et le monde d’aujourd’hui est trop fragmenté et divers pour qu’un seul pays puisse le dominer. Bien que l’Amérique reste la seule superpuissance financière (avec une capitalisation boursière de 60 Tr$, contre 10 Tr$ pour la Chine, et une fraction encore plus importante pour les segments de marché innovants), elle ne veut plus des obligations qui vont de pair avec le leadership. Le déclin démographique et économique de l’Europe l’a effectivement éliminée de la course. Quant à la Chine, elle est trop repliée sur elle-même pour devenir le prochain hégémon. Elle est peut-être la superpuissance manufacturière du monde (elle représente 35 % de la production mondiale), mais elle est loin de pouvoir assumer des responsabilités mondiales.
Heureusement, tous les problèmes ne requièrent pas le leadership d’un seul pays dominant. Au cours de la troisième décennie du XXIe siècle, le monde doit s’orienter vers de nouveaux arrangements pour lesquels les responsabilités mondiales sont plus largement réparties. Dans Les Nouvelles règles du jeu : Comment éviter le chaos planétaire, nous analysons les accords de gouvernance dans toute une série de domaines politiques – des biens communs mondiaux à l’interdépendance économique traditionnelle et ce que nous appelons les questions d' »intégration par delà les frontières ». Dans chaque cas, l’objectif est de sauver l’action collective dans un monde défini par la fragmentation et les préférences divergentes.
En ce qui concerne le climat, le bien commun mondial le plus emblématique, voire existentiel, il est probable que les États-Unis se retirent à nouveau de l’accord de Paris de 2015. Mais les États-Unis sont un acteur secondaire dans ce domaine, puisqu’ils ne représentent que 11 % des émissions mondiales, et de nombreux efforts de réduction des émissions au niveau des États américains se poursuivront. En outre, l’Union européenne et la Chine pourraient conjointement fournir le leadership nécessaire pour rallier les grandes économies émergentes, mobiliser le financement privé en faveur d’objectifs de neutralité climatique et galvaniser la société civile.
En ce qui concerne le commerce international, principal vecteur de l’interdépendance économique, les droits de douane de Trump pourraient être le dernier clou dans le cercueil du régime multilatéral fondé sur des règles. Il tentera de diviser les pays européens en différenciant les droits de douane pour punir ou faire chanter les gouvernements un par un. L’Europe peut néanmoins résister en maintenant un front uni (avec le Royaume-Uni). Cela lui permettrait de proposer à Trump un accord incluant des achats d’énergie et de défense, de prendre des mesures de rétorsion efficaces ou de former des coalitions avec des pays tiers (d’où l’importance du récent accord commercial de l’UE avec les pays du Mercosur en Amérique latine).
Quoi qu’il en soit, il est désormais clair que les règles commerciales multilatérales en vigueur sont trop exigeantes pour un monde fragmenté. L’UE devrait se concerter avec ses principaux partenaires pour distinguer les comportements réellement inacceptables de ceux qui sont simplement indésirables.
En ce qui concerne la finance mondiale, l’autre canal principal de l’interdépendance économique internationale, la tendance à la démondialisation a commencé il y a déjà un certain temps. Si les institutions au cœur du système (le Fonds monétaire international et la Banque mondiale) restent solides, M. Trump pourrait utiliser le droit de veto des États-Unis pour modifier leurs politiques sur toute une série de questions, notamment l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, qui ont représenté 44 % des prêts de la Banque mondiale l’année dernière.
Pour préserver le filet de sécurité financier international, l’Europe va devoir se concentrer sur les complémentarités entre les institutions régionales. Mais pour favoriser une coopération constructive, elle devra accepter que son rôle dans les principales organisations mondiales soit dilué pour tenir compte de la montée en puissance de la Chine, de l’Inde et de diverses puissances moyennes.
Au-delà de ces domaines politiques fondamentaux, il existe des questions d’intégration derrière la frontière telles que la concurrence, le système bancaire et la gouvernance fiscale, où l’acceptation généralisée de l’extraterritorialité et des réseaux informels peut produire des résultats souhaitables même en l’absence de règles strictes. Il semble peu probable que la coopération fiscale survive à une nouvelle administration Trump, du moins en ce qui concerne les multinationales ; mais certaines discussions et certains processus techniques pourraient encore se poursuivre sous le radar. Une approche incrémentale et granulaire pourrait être le meilleur moyen de préserver les progrès réalisés à ce jour.
Sur toutes ces questions et bien d’autres encore, les décideurs politiques devront s’adapter à un monde dans lequel aucune puissance n’est aux commandes. Cela suppose de définir, pour chaque domaine, les formes de gouvernance mondiale les mieux adaptées à un monde irréversiblement plus divers et plus fragmenté.