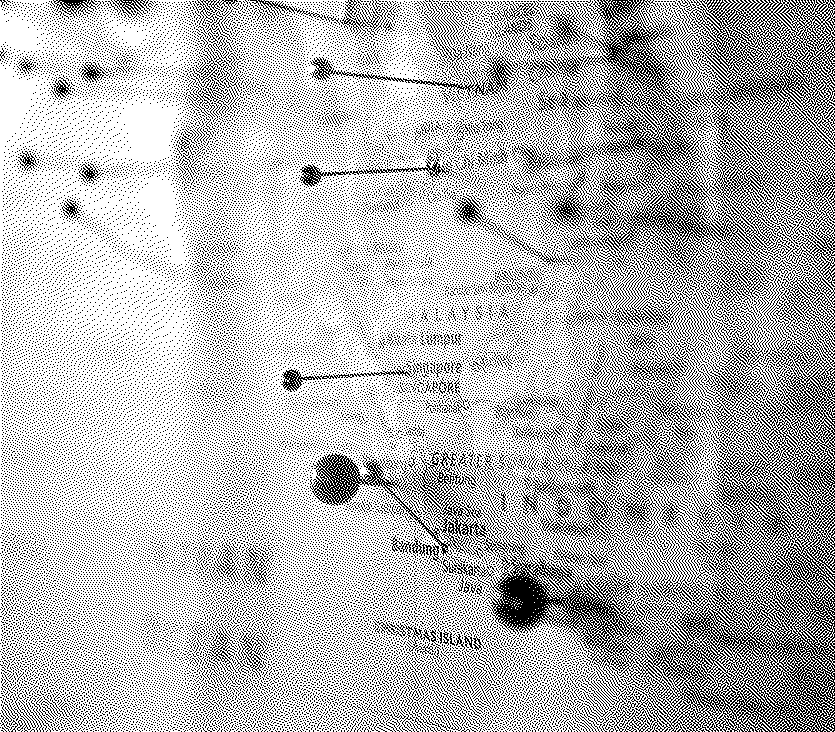Comment définiriez-vous le Sud global ? Cette notion vous semble-t-elle avoir une capacité descriptive intéressante ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : L’idée de global south a été entre autres mobilisée pour parler tous les pays qui ne se sont pas engagés, militairement ou diplomatiquement, dans le conflit en Ukraine. Ils ont eu une attitude similaire sur ce sujet. Cela peut rappeler le non-alignement décidé par 120 pays à la conférence de Bandung en 1955, mais il ne faut pas s’y tromper : le global south n’y correspond pas. D’abord parce que l’attitude du Sud global dans la guerre en Ukraine ne relève pas d’un choix concerté, et qu’il difficile de savoir quel pays inclure dans cet ensemble. Pour ne citer qu’un exemple : la Chine, qui était présente à Bandung, en fait-elle partie, ou est-elle une puissance polaire en compétition avec le Sud global ? Par ailleurs, il faut voir que le non-alignement n’est plus l’apanage des pays du Sud : Emmanuel Macron, reprenant le mot d’Hubert Védrine, s’est dit « ami et allié, mais pas aligné » avec les Etats-Unis lors de sa dernière visite en Chine (11 avril 2023).
En ce qui concerne la pertinence du concept, je ne suis pas tout à fait à l’aise avec, car il regroupe des pays extrêmement différents dans un vaste ensemble. C’est un pis-aller, certes préférable à d’autres oppositions caricaturales (« West and the Rest »). C’est un terme utilisé par la diplomatie indienne (plus que par la Russie ou la Chine). Le sud global est le dernier avatar de cette vieille habitude des civilisations de regrouper dans un vaste ensemble tout ce qui n’est pas soi. La Chine impériale l’avait fait en se plaçant seule sous le Ciel face aux barbares du reste du monde, l’islam avait aussi opposé monde de la foi et des incroyants, tout comme l’Occident avait posé une division entre l’Ouest et le reste pendant la guerre froide. Il est important de constater que les pays du Sud peuvent être très petits comme le Qatar, ou bien immenses comme le Pakistan, l’Indonésie, ou l’Inde. Ils peuvent être riches comme l’Arabie saoudite, ou très pauvres comme la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Certains jouent désormais un rôle majeur dans le système international, d’autres non : la Chine, pour autant que l’on décide de l’inclure dans cet ensemble, est le premier partenaire commercial de 130 pays dans le monde et s’engage dans la question de la dette plus que le FMI lui-même.
Ces pays très différents partagent-ils une manière de faire de la diplomatie, ou un certain point de vue sur les relations internationales ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Ces pays ont des attitudes similaires, mais non concertées. Elles peuvent être décrites comme pragmatiques. Certains parlent plutôt d’opportunisme, ce qui peut faire penser au mot du secrétaire d’Etat américain John Foster Dulles, qui était allé jusqu’à dire que la politique de non-alignement était « immorale ». Les pays du Sud global partagent en tout cas la conviction que, dans un système international fragmenté, il est normal que chacun pense d’abord à lui. Je ne pense pas qu’il faille voir là une attitude militante anti-occidentale, ou un désintérêt vis-à-vis de la guerre que subit l’Ukraine. Pour les pays du Sud global, domine simplement l’idée que leur intérêt particulier doit prévaloir. Pourquoi autant de pays ont-ils condamné l’annexion du Donbass par la Russie aux Nations Unies ? N’y voyez pas un succès de la diplomatie occidentale. C’est que chacun pense d’abord à soi. Beaucoup de pays du Sud ont des provinces menacées par les convoitises d’autres nations et souhaitaient éviter un précédent de conquête par la force et d’annexion d’un pays voisin. Au sein du global south, chaque pays se demande ce qu’implique pour lui l’annexion russe et tire des leçons de ce qu’il observe dans ce système international fragmenté.
On peut aussi prendre l’exemple du nucléaire : je m’interroge sur ce qu’il adviendra du traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) après la guerre. Beaucoup de pays – la Turquie ou l’Arabie saoudite notamment – pourraient se mettre à songer au nucléaire, pour se prémunir de toute invasion. Ils ont observé que les garanties de sécurité accordées à l’Ukraine – qui avait confié ses têtes nucléaires à la Russie en échange d’une compensation financière américaine – n’ont pas suffi. Enfin, les pays du Sud global me paraissent partager un sentiment, celui que l’Occident n’applique pas les mêmes règles partout et fait preuve d’une certaine hypocrisie. Depuis le début de la guerre, l’Occident a promis environ 100 milliards de dollars à l’Ukraine, ce qui est l’équivalent de l’aide au développement que tous les pays de l’OCDE offrent au reste du monde. Cela passe mal. Au cours d’une discussion sur la fragmentation du système international au Forum de Davos (2023), la ministre des Affaires étrangères sud-africaine avait par exemple quitté la salle en signe de protestation, considérant que la conversation tournait trop exclusivement autour de la guerre en Ukraine. Le sentiment que les Occidentaux s’occupent uniquement des conflits en Europe au détriment des autres guerres est largement partagé par les pays du Sud global.
La diplomatie indienne revendique un « multi-alignement », comment comprenez-vous cette notion ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : C’est la politique menée par le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar. Son idée est qu’il y a, pour tout pays, des questions sur lesquelles on peut trouver un terrain d’entente, bien qu’on ait des désaccords sur d’autres sujets. On peut par exemple s’accorder avec Lula sur l’environnement et la forêt amazonienne, tout en condamnant sa position sur l’Ukraine. Il est possible de s’entendre avec la Chine sur la régulation de l’intelligence artificielle, et de ne pas être d’accord avec ses agissements dans le détroit de Taïwan. C’est la question qui définit la position adoptée en relations internationales, on ne s’aligne plus sur l’idéologie ni le projet d’ensemble d’un pays. Vis-à-vis de l’Occident, l’Inde n’a pas le même positionnement selon la thématique. L’Inde est en étroite relation avec les pays occidentaux sur certains sujets : elle fait partie du QUAD (Dialogue quadrilatéral pour la sécurité), une opération régionale comprenant les Etats-Unis, le Japon et l’Australie en réaction à la puissance grandissante de la Chine. Cette coopération régionale a des conséquences importantes. En matière commerciale d’abord, puisqu’en 2022 le commerce indien avec l’Amérique a dépassé son commerce avec la Chine. Et aussi pour l’armement : ce rapprochement avec l’Occident a impliqué une baisse de l’achat des armes aux russes (il y a 10 ans, 75% des armes indiennes étaient achetées aux Russes, contre 55% aujourd’hui). Pour autant, l’Inde ne vote pas systématiquement avec les Occidentaux à l’ONU. L’Inde préserve ses accords commerciaux avec la Russie puisqu’elle est le principal acheteur de pétrole russe, et elle veille à ne pas entrer en conflit avec les Chinois, avec lesquels elle a déjà un différend territorial (Cachemire). La complexité des problématiques dans lesquelles une grande puissance comme l’Inde est engagée l’amène à avoir des positionnements qui sont déterminés par une thématique précise plus que par une orientation idéologique générale.
L’Arabie saoudite semble avoir une diplomatie similaire et garde plusieurs fers de feu. Elle est de plus en plus économiquement liée avec la Chine, elle a un partenariat stratégique avec la Russie sur l’OPEP+, mais son protecteur militaire en dernier ressort, ce sont les Etats-Unis. Ne prend-elle pas un risque pour sa sécurité en se rapprochant ainsi de pays qui ne sont pas sur la même ligne que les Etats-Unis ? Et, plus largement, quelle est la politique étrangère de l’Arabie saoudite vis-à-vis de l’Occident ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Pourquoi l’Arabie saoudite prend-elle de telles libertés ? Parce qu’elle sait que les Etats-Unis ne sont plus aussi investis dans sa protection qu’auparavant. Il faut se souvenir de ce qu’il s’est passé le 14 septembre 2019, quand deux installations pétrolières ont été ciblées par une attaque de drones suicide, à Abqaiq et à Khurais, dans l’est du pays. Les Américains n’ont pas eu une réaction apte à rassurer les Saoudiens. De fait, le pétrole saoudien ne compte plus tellement pour les Américains, qui sont eux-mêmes devenus des exportateurs de gaz et de pétrole. Les Saoudiens ont compris qu’ils sont beaucoup moins importants qu’auparavant et que les Etats-Unis ne les protégeront pas à tout prix. Autrement dit, la doctrine Carter de 1980, stipulant que toute tentative de gagner le contrôle de la région du golfe Persique impliquera des représailles des États-Unis, est morte. L’Arabie saoudite doit désormais surtout compter sur elle-même pour sa sécurité. Il n’est donc pas étonnant qu’elle se refuse à entrer dans une guerre froide avec la Russie ou la Chine. La Chine représente 85% de ses échanges commerciaux et est son principal client pétrolier. Elle s’est par ailleurs proposée d’aider l’Arabie saoudite à sortir du bourbier yéménite – rôle de médiateur que les Américains ne peuvent pas jouer puisqu’ils ne parlent pas aux Iraniens. En prenant en compte tous ces éléments, on comprend que les Saoudiens auraient eu tort de refuser le rapprochement avec la Chine.
En ce qui concerne la politique étrangère de l’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane y consacre peu de temps. Il communique surtout sur son projet intérieur d’ampleur qui, étrangement, n’intéresse personne en Occident. Il se déroule pourtant en Arabie saoudite l’un des processus les plus intéressants au Moyen-Orient aujourd’hui. Le prince héritier et Premier ministre depuis le 27 septembre 2022 combat le wahabisme, qui a fait beaucoup de dégâts dans le pays. L’intérêt qu’il porte à cette opération est fondamental et impacte ses relations extérieures. Une chose qui le gêne beaucoup est le manque d’intérêt qu’il trouve en Occident pour cette opération très risquée, autant d’un point de vue dynastique que politique. Les pays du Nord retiennent surtout qu’il a commandité l’assassinat du journaliste saoudien opposé à lui, Jamal Khashoggi. Mais ce qu’il fait a une portée très profonde dans le monde arabe. Depuis l’Asie centrale, jusqu’au Nigeria, le wahabisme a été l’incubateur de Daesh. Il est en train de le déconstruire et de mettre ses représentants les plus évidents en prison.
Prenez-vous au sérieux l’accord conclu par les Saoudiens et les Iraniens sous l’égide des Chinois : ne pêchent-ils pas par l’excès de confiance dans leur rôle, ils disaient avoir reconcilié le monde sunnite et chiite ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Je pense d’abord d’une façon générale qu’il ne faut pas exagérer la partition sunnite-chiite ; on tend à en faire la division centrale du monde musulman. Or l’Iran a énormément d’alliés sunnites et l’Arabie saoudite a quelques chiites de son côté. Le rôle de la Chine dans cette affaire est sérieux, il a eu des effets pratiques au Yémen et dans le rétablissement des relations diplomatiques. Cependant, le rôle chinois est moindre que Xi Jinping ne le prétend. Une bonne partie de cet accord avait déjà été négocié par les Omanais : il y avait eu un blocage sur deux points particuliers, et la Chine est entrée en fin de partie et a proposé de peser sur l’Iran pour que ces deux questions soient résolues. La Chine a donc joué un vrai rôle diplomatique, ce qui est assez nouveau.
Est-ce que ce que vous avez dit sur le Sud global – l’absence d’action concertée et la juxtaposition d’intérêts bien compris – n’est pas aussi devenu valable pour les Occidentaux ? Et quelles sont les conséquences pour les Nations unies : dans cette collision générale des nations, peut-on espérer refonder un multilatéralisme facteur de stabilité ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Mon sentiment est que ce qu’a dit Emmanuel Macron lors de son déplacement en Chine est partagé par beaucoup plus de gens qu’on ne le pense en Europe. Beaucoup ne veulent pas préserver la relation transatlantique au détriment d’autres partenaires. Les Européens n’ont pas été véritablement consultés dans l’établissement de cet artifice de guerre froide avec la Chine, et je pense que la réticence à s’inscrire dans cette opposition de plus en plus frontale entre Etats-Unis et Chine aura plutôt tendance à augmenter dans les mois qui viennent.
Le système onusien rencontre une crise importante. D’abord, sur le plan idéologique, les institutions de Bretton Woods et du Fonds monétaire international suscitent une grande hostilité. Cette institution a été le grand protecteur du capitalisme et a aidé les pays d’Europe de l’Est à faire leur transition vers un régime capitaliste ; mais il n’a pas véritablement joué son rôle dans les pays en voie de développement comme la Tunisie, l’Égypte ou le Liban. Ensuite, les institutions onusiennes paraissent avoir perdu en capacité d’action. La Banque mondiale a certes aidé des pays comme l’Inde à se développer, mais elle est aujourd’hui devenue un organe de réflexion plus que d’action. L’ONU elle-même cesse de jouer un rôle décisif en ce qui concerne les conflits majeurs. Ces dernières années, ce sont surtout les conflits africains qui ont été discutés au Conseil de sécurité. Sur ces sujets, le secrétaire général tend à se mettre en retrait et préconise que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Les conflits plus massifs, quant à eux, ne sont pas analysés par le Conseil, au motif qu’ils sont trop complexes (conflit israélo-palestinien) ou qu’ils concernent une grande puissance qui a le droit de veto. Dans la guerre en Ukraine, la capacité d’action de l’ONU a d’ailleurs été assez faible. Si elle a aidé à la mise en place (juillet 2022) d’un accord visant à permettre l’exportation des céréales ukrainiens et russes, c’est surtout la Turquie et l’UE qui ont assuré dans les faits la sécurisation des couloirs maritimes en mer noire.
Face à cette perte de puissance et de capacité d’action du Conseil de sécurité, que faut-il faire ? Soit on accepte sa dévaluation, soit on essaie de conserver son rôle avec des amendements. On a par exemple adopté une résolution (22 avril 2022) proposée par le Liechtenstein, obligeant un pays utilisant le droit de veto à justifier son choix devant l’Assemblée générale. C’est une avancée, mais qui ne suffit pas à rétablir le rôle de cette institution. C’est pourquoi l’ONU pourrait subir d’importants changements ces prochaines années. L’insistance d’un pays comme l’Inde à avoir un poste permanent au Conseil de sécurité va grandir. Étant courtisée par beaucoup de pays – l’Occident, la Chine, la Russie – l’Inde aura plus de poids pour y parvenir. Cette entrée pourrait amener l’ONU à considérer sérieusement la proposition de transformation du Conseil de sécurité, où le droit de veto est couplé au statut de membre permanent.
Dans les pays du Sud global, l’idée d’un déclin de la puissance américaine ces dernières années est-elle une idée commune ? Si oui, quelles en sont les conséquences ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Je crois que l’idée du déclin assez largement partagée. Les Etats-Unis ne sont plus dans une situation hégémonique. Ils conservent néanmoins de nombreux avantages. C’est un pays majeur en termes technologiques et financiers, ils totalisent 25% du PNB global et sont leader dans l’innovation et l’armement. Face au relatif déclin américain, les pays du Sud global adoptent deux types d’attitude. Certains pays pensent que ce déclin va pousser les Etats-Unis à leur accorder plus de garanties de sécurité – garanties qu’ils convoitent parfois depuis longtemps. Beaucoup de nations ne sont pas couvertes par l’article 5 de la Charte de l’Atlantique (stipulant que si un pays de l’OTAN subit une attaque armée, chaque membre de l’alliance considérera cet acte de violence comme une attaque contre l’ensemble des membres et prendra les dispositions nécessaires), mais la plupart souhaitent pouvoir en bénéficier. De même, certains dirigeants de pays arabes envient le genre de garanties dont bénéficie Israël. Les Etats-Unis ont toujours des accords de sécurité avec 88 pays, ils sont parfois marginaux – au Niger ils ont installé une base de drones – parfois massifs. Ces derniers mois, il y a eu une sorte d’émerveillement devant les milliards de dollars qui sont aujourd’hui accordés à l’armée ukrainienne. Chacun pense à lui, et constate que les Etats-Unis ont les moyens de fournir des munitions et des armes, même dans un temps réduit. Mais d’autres pays ne tirent pas les mêmes conséquences du déclin américain, et pensent que celui-ci doit au contraire les pousser à diversifier leurs relations, avec la Russie et la Chine notamment. De ce point de vue, ils sont hostiles à l’idée américaine d’une guerre froide avec la Chine. Celle-ci a germé pendant la dernière année du mandat de G.W. Bush, s’est développée avec Obama et est devenue une volonté claire avec Biden.
Le recul général de l’influence géopolitique des Occidentaux ne date-t-il pas de la sortie de la guerre froide ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Je pense que l’après-guerre-froide est une illusion, ou plutôt qu’il y a deux après-guerre froide à distinguer. La période de 1989 à 2007 constitue une première phase caractérisée par un optimiste et une démocratisation qui touche de nouveaux pays (plus de gens vivent dans un régime démocratique que dans un régime qui ne l’est pas), le commerce international marche très bien, avec des crises limitées. On assiste à une « mondialisation immobile » comme le dit Daniel Cohen, pour la distinguer des précédentes vagues de mondialisation : dans les années 1990-2000 les capitaux, les marchandises bougent mais pas les hommes. A partir de 2007, en revanche, s’ouvre une nouvelle période : la Freedom House constate qu’il y a une tendance à la régression démocratique dans beaucoup de pays. En effet, des coups d’Etat interviennent en Thaïlande, en Birmanie, en Afrique occidentale ; on observe en parallèle une dégénérescence de la démocratie turque, hongroise ou russe. On voit aussi que la mondialisation est moins prometteuse dans cette deuxième phase : les investissements directs étrangers ont diminué à partir de cette date, le commerce mondial a commencé à reculer, la capacité du capitalisme à éviter des crises a été ébranlée.
Il ne faut pas mélanger ces deux périodes d’après-guerre froide, très différentes en termes d’espérances et de promesses. La régression démocratique caractéristique de la seconde période rend très difficile la distinction entre pays démocratiques et pays non-démocratiques désormais. La Hongrie d’Orban peut-elle encore être considérée comme un Etat démocratique par exemple ? On parle de « démocratie illibérale » ou « autoritaire », comme s’il fallait maintenant adjoindre un adjectif à « démocratie » pour comprendre de quel type de régime on parle.
La volonté de Joe Biden de créer une « ligue des démocraties », récemment annoncée, ne pourra pas aller très loin. Adopter cette vision binaire et diviser, selon une vieille obsession américaine, le monde en deux parties est compliqué car la définition de la démocratie est devenue floue. Par ailleurs, cette proposition du président américain est non seulement anachronique, mais aussi périlleuse stratégiquement. Car elle risque d’éloigner de l’Occident des alliés qui ne sont pas démocratiques mais qui, dans le conflit ukrainien, pourraient être des appuis de taille.
La lutte contre le terrorisme donnait un objectif partagé au plan international. Est-ce encore le cas ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Depuis le 11 septembre, la lutte contre le terrorisme a été réussie sur le plan financier, mais c’est loin d’être un succès sur le terrain. Elle avait une contrepartie : la division des sociétés, entre celles qui soutenaient ou toléraient les mouvements terroristes (Daesh, Al Qaïda) et les autres qui étaient nos amis et participaient à la lutte anti-terroriste. Or les alliés des Occidentaux contre les terroristes étaient pour la plupart des kleptocrates, des gens qui pillaient leur pays, avec une immunité étatsunienne. Ils signaient des accords avec le Pentagone, sans vraiment y prêter attention, à la seule condition de pouvoir rester au pouvoir. Cela explique aussi les défaites de ces armées face aux terroristes. Elles sont extrêmement surprenantes au premier abord : comment Daesch a-t-il pu prendre Mossoul avec 800 personnes, face à 11 000 soldats irakiens formés par les Américains ? Si les terroristes l’ont emporté, c’est que les soldats irakiens ne voulaient pas mourir pour le compte d’une kleptocratie qui régnait à Bagdad. C’est aussi la raison pour laquelle les 360 000 soldats afghans ont perdu en 48h face à 44 000 talibans. Il y a dans la lutte contre le terrorisme un angle mort : nos alliés étaient des kleptocrates, coupés de la population qui n’avaient aucun contrôle sur les moyens militaires, et qui avaient pour seule qualité d’être anti-djihadiste.
Comment l’Europe est-elle perçue par le Sud global ? Est-elle vue principalement par rapport à sa gestion de la question migratoire ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : L’image de l’Europe est ce que les Européens en font, elle est parfois bonne, parfois moins, assez souvent incohérente. La question fondamentale que l’on se pose dans le Sud global est celle de savoir si l’Europe existe vraiment, ou s’il faut plutôt compter sur les pays individuellement. Autrement dit, est-ce qu’on doit prendre au sérieux Bruxelles, comme lieu où la décision est prise ? Les rivalités commerciales, et parfois les conflits, entre pays membres de l’Union européenne produisent beaucoup de confusion.
Quant à l’immigration, c’est un sujet qui va rester d’actualité. La pression subsaharienne en matière de migration va très sûrement s’aggraver et je ne vois pas, pour le moment, de réponse européenne. L’Europe a un problème d’image parce qu’elle a un problème de politique et non de marketing. Si on laisse les Italiens tout seuls sur la question migratoire, cela ne peut pas fonctionner. L’accord passé avec le président turc Erdogan, qui a fermé les portes de l’émigration contre 7 milliards d’euros, peut inspirer de nombreux autres pays. Pour le moment, le débat sur ces questions avance peu en France et en Europe, il est idéologique, trop fixé sur l’islam et pas assez sur la migration en tant que telle.
Le retour de la guerre de conquête sur le sol européen a pris les Occidentaux de court. Comment expliquer ce manque de préparation par rapport aux enjeux militaires ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Les Occidentaux ont en effet été surpris. Ils avaient réduit les effectifs de leur armée, se disant que le temps où l’on pouvait avoir besoin d’envoyer 500 000 hommes pour chasser Saddam Hussein du Koweït était révolu. Mais l’Ukraine a rappelé l’actualité des guerres de conquête et a démenti l’idée répandue dans le monde universitaire d’une fin des conflits territoriaux.Les peuples sont encore obsédés par leur terre promise, terre occupée ou à gagner. Les armées occidentales comptent moins d’hommes qu’auparavant. Côté britannique par exemple, l’armée, avec environ 80 000 hommes, est aujourd’hui plus petite qu’elle ne l’était du temps de Cromwell. Quant à l’armée allemande, elle est non seulement peu nombreuse mais aussi sous-équipée. Il n’y a pratiquement que les Etats-Unis qui ont fait le pari de garder une armée très nombreuse en termes d’hommes ; en France la question n’est pas encore tranchée. On a trop vite mis sous le tapis les guerres balkaniques comme des guerres qui ne sont pas véritablement européennes. Or elles l’étaient bel et bien, et l’Ukraine est la 2e guerre de ce type, sinon la 3e si on compte l’affaire géorgienne.
Certains pensent que l’Ukraine va gagner la guerre et que le déclin de la démocratie en Occident qui caractérise la seconde période (2007-2023) va s’inverser après la défaite russe, est-ce une perception trop optimiste ?
La Grande Conversation
Ghassan Salamé : Je ne connais pas exactement la situation militaire sur le terrain. Certains experts militaires disent que la contre-attaque ukrainienne peut seulement récupérer 2 à 3% des 18% du territoire occupé par la Russie. Mais je ne crois pas que la victoire de l’Ukraine changerait tout : le système international déjà fragmenté avant cette guerre l’est encore plus. Je doute qu’un nouveau système international puisse naître du Donbass.