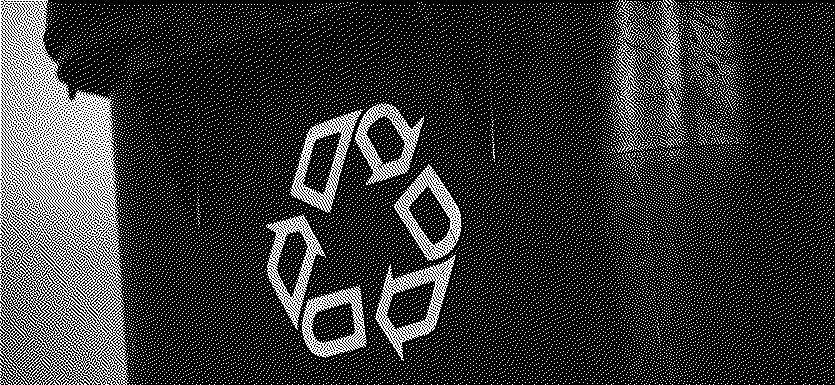Pierre Lévy, vous avez été ambassadeur à Moscou de 2020 à 2024, dans une période particulièrement difficile que vous résumez ainsi dans votre récit : « J’étais venu en Russie pour construire et dialoguer, je l’ai quittée dans la destruction et le mutisme ».
La Grande Conversation
Je pense que la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine est un conflit de très longue durée. En arrivant en poste en 2020, je savais que ma mission serait difficile mais je n’imaginais pas qu’elle serait aussi vertigineuse. Après mon arrivée le 15 janvier 2020, j’ai eu moins de deux mois de vie normale. Fin février, la Russie a fermé sa frontière terrestre avec la Chine, en raison du Covid. Ensuite, il y a eu la montée des tensions jusqu’à l’invasion de l’Ukraine, le 24 février 2022. Des développements importants sont survenus en 2020 : un nouveau premier ministre, Mikhaïl Michoustine, a été nommé ; une réforme constitutionnelle importante a eu lieu, permettant à Vladimir Poutine d’effectuer deux nouveaux mandats et rester théoriquement au pouvoir jusqu’en 2036.
Mon livre offre un triple cheminement. Un cheminement stratégique, politico-militaire, d’abord, dans un climat d’hostilité et de propagande croissante jusqu’aux opérations contre l’Ukraine. Un cheminement, ensuite, à travers l’action de l’ambassade, le « making of » de notre diplomatie, avec des moments intenses comme lorsque la Russie a expulsé une quarantaine de mes collaborateurs, en réponse à nos décisions d’expulser des Russes qui avaient, sous couverture diplomatique, des activités contraires à nos intérêts de sécurité. Un mouvement très large a concerné, en un peu plus d’un an, environ 680 personnels diplomatiques russes, déclarés persona non grata (PNG) par les pays occidentaux. Et, troisièmement, c’est un cheminement personnel car je me suis beaucoup investi dans ce poste, étant passionné par la Russie. C’était ma dernière affectation, dont je rêvais depuis longtemps, un choix logique compte tenu de mon expérience européenne et de mes affectations en Allemagne, en République tchèque et en Pologne, sans oublier une escapade à Singapour… Je suis parti avec des instructions correspondant à la volonté du président de la République de renouer le dialogue avec Moscou, avec ce qu’on appelait à l’époque « l’agenda de confiance et de sécurité ».
Le conflit actuel est un conflit gigogne, comme les poupées russes, les matriochkas qui s’emboitent les unes dans les autres. La plus petite poupée, c’est la lutte pour l’asservissement de l’Ukraine, la fin de sa souveraineté, la conquête territoriale et la fin du « junte » néo-nazie, pour reprendre l’expression russe, au pouvoir à Kyiv. La poupée intermédiaire, c’est la lutte contre les Etats-Unis, l’OTAN et l’Union européenne. La poupée enveloppante, la plus grande, c’est le combat pour un nouvel ordre international que les Russes qualifient de multipolaire ou polycentrique, selon l’expression utilisée par Vladimir Poutine lors de la conférence de Valdaï, le 2 octobre dernier… En clair, c’est le règne des sphères d’influence, un monde qui se partage entre les Etats-Unis qui dominent leur continent, la Russie qui domine l’Europe et la Chine l’Asie. Ce qui est en jeu dans ce conflit va bien au-delà de la conquête du Donbass, c’est véritablement un projet de transformation du monde avec l’objectif de le désoccidentaliser.
La crise est très profonde et vient de loin. J’y vois deux explications : une histoire mal digérée et un avenir refusé. L’histoire mal digérée, ce sont toutes les références historiques russes, en particulier de Vladimir Poutine, « historien en chef »[1]. Un salmigondis mêlant l’histoire impériale, le passé soviétique, la Deuxième guerre mondiale… qu’on peut lire dans son essai, publié en juillet 2021, sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens.
L’avenir refusé, c’est l’avenir de l’Ukraine et, même au-delà, celui du continent européen dans sa nouvelle configuration depuis l’éclatement du bloc de l’Est, la chute de l’Union soviétique, « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle » selon Poutine. Parmi les causes plus rapprochées, on se souvient de l’épisode de la non-signature de l’accord d’association de l’Ukraine avec l’Union européenne en novembre 2013, au sommet du partenariat oriental à Vilnius, après des pressions de Moscou. Ce qui a conduit à la mobilisation du Maïdan puis à l’annexion de la Crimée en 2014. Il y avait eu beaucoup de signes annonciateurs de l’action dans le Donbass, avec la Géorgie en 2008. Car on peut identifier un « pattern » d’agression russe : un substrat historique dont le pouvoir s’empare, puis une analyse du rapport de force qui conduit à penser que c’est le bon moment d’agir. En 2021, ces éléments sont alignés : Poutine a publié son essai révisionniste sur l’histoire ukrainienne, les Etats-Unis se sont piteusement retiré d’Afghanistan, Biden a lancé une « diplomatie de la démocratie » qui est un semi-échec, l’Union européenne apparaît divisée et affaiblie. Vladimir Poutine s’est dit que le moment était venu de régler la « question ukrainienne », une question qu’il rumine depuis très longtemps. La réforme constitutionnelle, avec la perspective d’être président jusqu’en 2036, l’a sans doute inspiré d’agir pour la postérité, d’inscrire son nom dans l’histoire comme le tsar Pierre 1er ou d’autres grandes figures historiques. L’effet Covid a peut-être joué aussi. On dit qu’il s’est beaucoup isolé et a pris conscience de la fragilité de sa vie, du temps qui passe.
Fin décembre 2021, la Russie a mis deux projets de traité sur la table, un avec l’OTAN et un avec les Etats-Unis pour régler les questions d’ordre de sécurité européen. Ces deux projets revenaient, de fait, à remettre en cause le grand élargissement de 1997-1998 et à faire revenir l’OTAN à ses frontières antérieures. On voit bien, aujourd’hui, que le propos russe va bien au-delà de la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. C’était bien évidemment des non-starters pour nous. Je pense que les Russes le savaient très bien. Nous avons néanmoins fait une réponse circonstanciée aux Russes et il y a eu une réunion du Conseil OTAN-Russie, le 12 janvier, qui était en quelque sorte la dernière sortie sur l’autoroute avant la guerre. Cette réunion a été très longue, assez dramatique. Nous sentions que les Russes n’avaient pas de marge de manœuvre. Mais la rencontre leur a permis de dire une fois de plus, comme ils le font de manière récurrente, que l’Occident n’a pas écouté la Russie, a repoussé d’un revers de la main toutes ses propositions. C’était une mise en scène, selon moi, pour justifier le passage à l’acte.
La guerre, comme d’ailleurs le Covid auparavant, donne une très bonne grille d’analyse du système de pouvoir russe. En particulier sa manière de gérer l’information : le système a une capacité d’étouffoir extraordinaire. Même un événement hors du commun comme l’attentat du Crocus City Hall disparaît des médias au bout d’une semaine parce que la presse est aux ordres. Même chose avec les morts mystérieuses de Prigojine ou de Navalny. Le pouvoir ne cherche même plus à donner des explications convaincantes au sujet de ces disparitions. Sa stratégie est de brouiller les pistes et de créer de la confusion.
Du fait de la guerre, le pays se transforme. Tout simplement parce qu’il a perdu, pour des générations, son premier partenaire économique, commercial et même culturel, l‘Europe. Il a effectué un pivot vers l’Est qui le change considérablement. Plus d’un million de personnes maintenant sont passées par le front. Que deviendront tous ces anciens combattants ? Quelle influence auront-ils sur le paysage politique et social post-guerre ? J’ai en tête l’exemple chez nous des anciens combattants de 14-18 et leur rôle dans l’entre-deux-guerres.
Que dire des perspectives ? Avec Donald Trump, elles sont instables et imprévisibles. Néanmoins, je donne quelques repères. Les Russes disent toujours que leurs objectifs concernant l’Ukraine restent « inchangés » avec les trois D : dénazification, dénucléarisation, démilitarisation. Plus concrètement, il y a trois strates pour Moscou : le cessez-le-feu, l’accord de paix et le règlement de ce que les Russes appellent dans leur langage codé les « causes profondes ». Pour eux, contrairement à l’approche ukrainienne soutenue par les Européens, le cessez- le-feu n’intervient qu’une fois qu’un accord de paix a été trouvé après des négociations pour lesquelles ils mettent des conditions extrêmement drastiques. Pour accepter un cessez-le-feu, il faut d’abord un retrait des troupes ukrainiennes des régions annexées par la Russie, la notification officielle que l’Ukraine renonce à adhérer à l’OTAN. Ils refusent en outre de discuter avec Zelenski, considéré comme illégitime. J’ajoute aussi qu’un cessez-le-feu suppose, pour eux, un moratoire sur les livraisons d’armes occidentales.
Ces négociations devraient déboucher sur des accords internationaux aboutissant à un statut démilitarisé, neutre, non aligné et non nucléaire de l’Ukraine ; la reconnaissance de ce qu’ils appellent « les nouvelles réalités territoriales », c’est-à-dire en fait la reconnaissance de l’annexion du Donbass et de la Crimée, ainsi que la levée de toutes les sanctions affectant la Russie. Vient en plus le règlement des causes profondes, ce qui renvoie en fait, aux deux traités déjà évoqués de décembre 2021, c’est-à-dire une discussion sur l’ordre de sécurité européen, pour revenir sur les élargissements de l’OTAN. On est donc très loin d’un début de dialogue crédible.
Sur le terrain, la guerre d’attrition se prolonge. Les Russes essaient de diviser le camp transatlantique en expliquant à Donald Trump que la guerre, – la guerre de Biden disent-ils pour ménager le président américain -, se prolonge par la faute des Européens. La guerre hybride menée contre l’Europe vise à affoler les opinions publiques et à peser dans les consultations électorales. Il faut garder en tête que même si la guerre s’arrête sur le terrain ukrainien, la confrontation avec « l’Occident collectif », elle, se poursuivra. Au-delà de l’affaire ukrainienne, il y a la volonté russe de revoir la gouvernance internationale et de se réinstaller à une place de premier rang dans le jeu de grandes puissances.
Pierre Lévy
Selon vous, le conflit est installé pour durer. Le pays est entièrement tourné vers l’effort de guerre, d’un point de vue économique, idéologique et institutionnel. Pourtant, l’effort de guerre est considérable en coût humain, en réputation internationale et pour l’économie… Comment la Russie peut-elle supporter cet effort ?
La Grande Conversation
D’abord, le thème de la Russie forteresse assiégée est très ancien dans le narratif russe. La référence à la volonté de l’Occident d’affaiblir ou de détruire l’Union soviétique et la Russie n’est pas présente seulement dans la propagande du régime, elle est présente aussi dans la population, comme j’ai pu le vérifier directement lors de certains de mes déplacements. Dans cette vision assez complotiste, le particularisme russe est supposé être intolérable pour les Occidentaux.
Ensuite, une fois que la guerre est déclenchée, il y a un effet drapeau, renforcé par une propagande effrénée qui martèle que l’OTAN a attaqué la Russie. Mais il y a aussi la peur, tout simplement. Vous ne pouvez pas manifester, il faut « parler dans la cuisine » comme on disait à l’époque soviétique. A travers les sondages de l’institut indépendant Levada, qui sont ce qu’on peut trouver de plus fiable en Russie, même si les résultats sont discutables, 69% des personnes interrogées considéraient, en octobre dernier, que le pays va dans la bonne direction. Selon moi, 15% de gens sont vraiment contre la guerre, à peu près la même proportion correspond à des pro-guerre ultranationalistes et le reste se tient à l’écart tout en restant légitimiste.
Poutine peut à tout moment arrêter la guerre en déclarant victoire, personne ne le contredira. De plus en plus de gens souhaitent des négociations et la fin de la guerre, toujours d’après les sondages, mais aux conditions de leur pays. Si cette part de l’opinion atteint une masse critique, le pouvoir devra en tenir compte. Mais, pour le moment, la société est mobilisée dans l’effort de guerre. C’est d’ailleurs aussi le cas de la diaspora russe. Il ne faut pas croire qu’elle est hostile à Poutine. Même des Russes qui ont voyagé, et vécu à l’étranger sont perméables à l’argument selon lequel l’Ukraine n’est pas un vrai pays, qu’il y a de la manipulation américaine derrière tout cela, j’en ai rencontré…
En outre, une partie de la population tire profit de la guerre. Comme les capitaux ne peuvent plus sortir de Russie, du fait des sanctions, beaucoup d’argent circule dans le pays. Pour les catégories les plus modestes, les primes d’engagement dans l’armée et de décès sont faramineuses. Des oligarques et hommes d’affaires peuvent racheter des actifs occidentaux à très bas prix. C’est ainsi que les choses tiennent.
Le système de pouvoir résiste aussi parce qu’il a une certaine souplesse, il n’est pas irrationnel, mais repose de manière clanique sur un système d’allégeance et de dépendance. Sauf trahison, comme dans le cas de Prigogine et quelques autres, où des accidents malheureux interviennent, les responsables qui déçoivent sont quand même ménagés. On ne les met pas dehors, ils sont recyclés dans le système. Medvedev par exemple, très critiqué pour avoir laissé passer, quand il était président, la résolution du conseil de sécurité des Nations unies sur la Libye ouvrant la voie à la chute de Khadafi, a été ensuite nommé Premier ministre puis vice-président du conseil de sécurité. De même, Choïgou, après avoir été remplacé au ministère de la Défense dont la corruption a été dénoncée, à juste titre, par Prigogine, a été nommé secrétaire du conseil de sécurité, avec des responsabilités importantes à la place de Patrouchev.
Enfin, d’un point de vue politique, on ne voit pas d’alternative. Le combat de Navalny contre la corruption était apprécié, son film sur le palais de Poutine a été visionné des millions de fois sur internet. Mais il n’apparaissait pas comme une alternative crédible au pouvoir. Le Kremlin est une boite noire, il est très difficile d’élaborer des scénarios. La formule qu’on pourrait imaginer, le moment venu, serait une alternative techno-nationaliste ou techno-patriote. C’est-à-dire des technocrates de la nouvelle génération – il y a beaucoup de compétences – qui pourraient sortir le pays de l’économie de guerre sans trop de dégâts. Toujours selon la méthode du recyclage, V. Poutine pourrait être nommé à un poste de président du Conseil d’État ou sur mesure, c’est la seule hypothèse à peu près réaliste, selon moi, très loin de la démocratie telle que nous la concevons.
En attendant, la grande majorité de la population s’en tient au contrat social implicite : on ne s’occupe pas de politique, on fait plus ou moins confiance aux autorités. Et on mène sa vie dans une Russie qui est plus stable que celle qu’on a connue après 1991.
Pierre Lévy
Mais on disait que, dans ce contrat implicite, la population russe était protégée de la guerre. Or, elle accepte quand même une guerre et une guerre qui se prolonge.
La Grande Conversation
Oui, la population accepte la guerre parce qu’on lui dit que la Russie est envahie et que c’est une guerre imposée par l’OTAN. Au matin du 24 février 2022, dans son discours diffusé à la télévision à 6 heures du matin, alors que les premiers chars russes pénètrent sur le territoire ukrainien, Poutine invoque l’article 51 de la charte des Nations Unies pour affirmer que la Russie est en état de légitime défense.
Pierre Lévy
Le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine devait être une simple promenade militaire et ça ne s’est pas tout à fait passé comme ça. Les forces russes ont été repoussées et le régime ukrainien ne s’est pas effondré. Comment cela a-t-il été perçu et géré par le pouvoir ?
La Grande Conversation
Une opacité complète entoure la conduite de la guerre. Les revers militaires ont été à peine évoqués, ou maquillés, et les media sont verrouillés. Aucune évaluation officielle des pertes militaires n’est diffusée. Sauf erreur de ma part, le seul chiffre officiel publié remonte à septembre 2022, mentionnant 5937 morts et, depuis, plus rien. Le terme de « guerre » lui-même n’est d’ailleurs pas utilisé, sous peine de sanction. L’explication officielle des difficultés est que l’armée russe n’a pas, face à elle, des Ukrainiens mais l’OTAN.
Paradoxalement, la seule vision un peu honnête de la guerre a été donnée par Prigogine. Au moment de sa rébellion, il a fait des déclarations pour dire que la guerre était mal gérée, que l’establishment militaire était corrompu, que les soldats n’étaient pas bien traités, qu’ils n’étaient pas équipés comme il le faudrait, que les blessés n’étaient pas bien soignés… Ce discours inquiétait beaucoup Poutine, qui a fait évoluer sa politique de communication. Il ne veut surtout pas lancer une deuxième vague de mobilisation qui serait politiquement désastreuse. Si bien que l’armée russe continue de grignoter du terrain sans parvenir actuellement à transformer ses succès tactiques locaux en percée stratégique.
Pierre Lévy
L’offensive idéologique contre l’« Occident collectif » s’accompagne d’un message sur le caractère euro-asiatique de la Russie. Plusieurs théoriciens défendent l’idée que la Russie présente une double identité, à la fois européenne et asiatique. Sont-ils écoutés au Kremlin ?
La Grande Conversation
Ce sont souvent des intellectuels très provocateurs, qui sont utiles au pouvoir parce qu’ils contribuent à brouiller les messages et à donner une image assez mystérieuse et inquiétante de la Russie. Mais, loin des essais de Karaganov ou Douguine, je n’ai jamais rencontré un Russe qui se revendique eurasiatique plutôt qu’européen. En outre, les autorités et les experts se distancient de leurs déclarations concernant la menace nucléaire. Mais ils font peur à l’Occident, ils sont utiles au pouvoir.
Pierre Lévy
Le 24 février 2022 représente aussi unbasculement sémantique chez Poutine qui parle tout d’un coup de « dénazification » de l’Ukraine, qui traite le gouvernement de Zelenski comme une bande de drogués, etc. Et, au-delà, il mobilise un registre quasi-biblique pour parler de l’Occident comme démoniaque, satanique… Comment analysez-vous ce basculement sémantique ?
La Grande Conversation
Effectivement, quand on vit à Moscou, on se demande si finalement la réalité n’est pas une option parmi d’autres. J’ai relevé au fil des années quelques traits caractéristiques de cette rhétorique. D’abord, le langage psychologisant. Avant le lancement de la guerre, quand notre ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s’inquiétait auprès des autorités russes d’un risque d’action militaire, on lui reprochait son « hystérie ». Il était, d’après le discours officiel, hors de question de faire la guerre, c’est l’Occident qui était complètement hystérique en imaginant que les Russes s’y préparaient.
Une autre caractéristique est la logique inversée. Quand je rencontrais des responsables du ministère russe des Affaires étrangères (MID), ceux-ci me reprochaient mon agressivité et mon refus du dialogue. Cette rhétorique connaît aussi une gradation. Ainsi Dmitri Peskov, le porte-parole du président Poutine, n’a pas la même tonalité que l’ancien président Dmitri Medvedev, toujours dans l’excès et l’outrance, ou la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zaharova, qui est souvent insultante, voire vulgaire.
Cette rhétorique présente également une grande capacité d’adaptation. Par exemple, le discours sur la dénazification ne parle pas beaucoup au « Sud global ». Le nazisme, pour beaucoup de ces pays du Sud, c’est une affaire européenne. C’est pourquoi, les Russes mettent désormais en avant la lutte contre le néo-colonialisme, par exemple en ciblant la France, notamment pendant les troubles en Outre-mer. Cela parle beaucoup plus aux pays du Sud global. L’expression de Serguei Lavrov a aussi évolué et il parle maintenant de la « majorité mondiale » pour souligner le recul de l’Occident.
Pierre Lévy
Vous avez évoqué le pivot vers l’Est de l’économie russe. De fait, en raison des sanctions européennes, la Russie est de plus en plus dépendante de la Chine. Comment cette situation de dépendance est-elle perçue, notamment par les nationalistes russes ?
La Grande Conversation
La question de l’emprise chinoise en Russie est bien antérieure à la guerre. Quand j’évoquais ce sujet en 2020 avec des officiels russes, je n’obtenais pas de réponse. Il y a effectivement une très profonde méfiance vis-à-vis de la Chine. En même temps qu’on vous dit que la Russie est naturellement tournée côté asiatique… La guerre a profondément accentué ce déséquilibre derrière « l’amitié sans limites » proclamée à Pékin lors de la visite de V. Poutine pour les jeux olympiques d’hiver en février 2022.
La méfiance est double parce que je pense que les Chinois se méfient du risque politique russe. Depuis 2022, la chute des investissements étrangers est considérable mais, pour autant, les Chinois ne se précipitent pas pour prendre la place laissée par exemple dans le secteur automobile par Renault ou Volkswagen. Pourquoi ? D’abord, parce que, pour les Chinois, il est plus facile d’exporter les voitures fabriquées en Chine que de les construire en Russie. Et puis, deuxièmement, parce que le pouvoir a engagé une politique protectionniste de russification de l’économie. Il ne veut pas que ses industries soient reprises par des Chinois. Le projet de grand gazoduc Force de Sibérie entre la Russie et la Chine n’avance pas parce que les relations sont maintenant assez déséquilibrées entre les deux parties. Les Chinois font attention à se diversifier aussi, pour éviter d’être trop dépendants de la Russie.
Pierre Lévy
Quelle est la position chinoise sur la fin du conflit ? Les Chinois ont-ils intérêt à voir la guerre se poursuivre ?
La Grande Conversation
En ce qui concerne la prolongation du conflit, son intérêt pour Pékin est de distraire l’attention de l’Occident et des États-Unis. La Chine n’est plus la première menace immédiate aux yeux de l’Occident. Deuxièmement, potentiellement, le conflit peut affaiblir à la fois l’Occident et la Russie. C’est un war lab, un laboratoire de la guerre, peut-être la bande annonce d’un conflit plus vaste en Asie. C’est pourquoi les Chinois suivent très attentivement ce qui se passe, la réaction occidentale. Je pense que l’unité européenne les a surpris, les livraisons d’armes aussi. C’est très intéressant à observer pour eux, afin d’en tirer des leçons.
Je relève pourtant une différence majeure entre la Russie et la Chine qui tient au degré d’intégration dans la globalisation. La Chine est très intégrée dans les chaines de valeur et d’approvisionnement, elle a de gros intérêts commerciaux sur les marchés américains et européens. Les Chinois ne veulent pas complètement renverser la table et développent une véritable stratégie d’entrisme dans les organisations internationales. Ils créent aussi en parallèle des organisations alternatives, comme la Route de la soie, une nouvelle banque de développement. Ce n’est pas le cas de la Russie, peu intégrée dans les chaines de valeur. La Russie devient autarcique, elle n’exporte que des matières premières. C’est un modèle économique déclinant avec d’importantes faiblesses structurelles. La Russie a beaucoup moins à perdre que la Chine à la remise en cause du système commercial international et de la globalisation.
Et puis, il y a bien évidemment toute la question nucléaire. Qui est importante, parce que pour les Chinois, c’est quand même aussi un épouvantail. Je ne suis pas sûr d’ailleurs qu’il n’y ait pas une grande méfiance, parce que le jeu russe à un certain moment consistait à recréer un duopole avec les Etats-Unis et à faire miroiter aux Américains des discussions sur le contrôle des armements et la stabilité stratégique qui pourraient inclure la Chine, ce qui correspond à la vision américaine qui souhaite contrôler l’émergence de la force nucléaire chinoise. Les Chinois n’ont pas apprécié les déclarations russes visant à agiter la menace nucléaire à propos de l’Ukraine.
Pierre Lévy
Dans la perspective de l’après-Poutine, aussi éloignée soit-elle, vous semble-t-il qu’il existe au sein des élites politiques russes une forte unité de vue sur ce que devrait être la sphère d’influence russe en Europe à long terme ?
La Grande Conversation
C’est très difficile à dire parce que, pour beaucoup de gens que j’ai rencontrés, des oligarques et des économistes, les références étaient avant tout européennes en termes de débouchés commerciaux, comme en termes de technologie. Même pour la culture et l’éducation, les références sont, pour eux, européennes et occidentales. Si certains membres de l’élite russe arrivent à tirer profit, comme je l’ai expliqué, de la situation de guerre, je pense que beaucoup regrettent, par réalisme, cette coupure profonde avec l’Europe, sans doute à l’échelle générationnelle. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs plusieurs passeports, dont un passeport européen, « comme assurance vie » m’a dit un jour l’un d’entre eux. Cela en dit long sur la Russie où des élites n’ont pas confiance dans l’avenir de leur pays.
Pierre Lévy