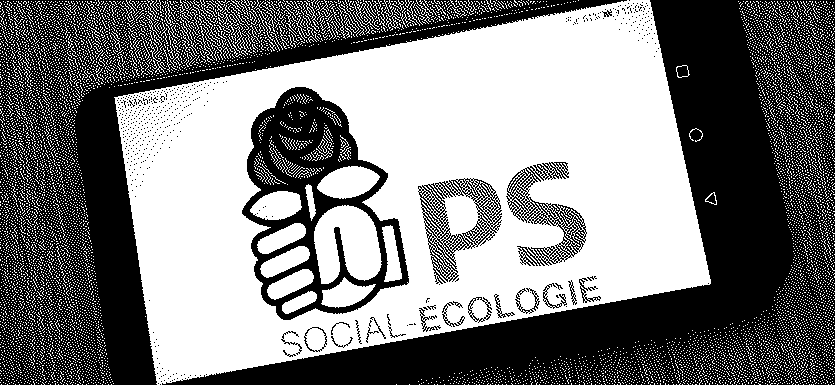Peut-on identifier un rapport spécifique de la France à la violence politique, voire une forme de culture de la violence politique, comme on l’entend parfois ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Je ne pense pas que nous ayons une telle culture de la violence politique en France. Avec ma collègue Isabelle Sommier, nous avons dirigé un livre sur la violence politique (Les violences politiques en France. De 1986 à nos jours, Presses de Sciences Po, 2021). Il s’appuie sur une importante base de données empiriques pour saisir la réalité du phénomène. Depuis 1986, on a comptabilisé en France 9200 faits de violences politiques. Plus de 4000 se sont produits en Corse, une violence qui est donc très localisée. Elle est par ailleurs très rarement létale : ce sont en grande majorité des obstructions, des dégradations, des destructions. Le peu de violences homicidaires que l’on dénombre (418 homicides répartis en « morts violentes » ou en « assassinats ») est surtout lié aux attentats islamistes : ils sont en effet responsables de 69% des violences politiques homicidaires1. Arrivent ensuite, mais bien plus loin, les idéologiques, surtout d’extrême droite (53 tués) et les séparatistes (90 tués). Nous avions donc conclu que, s’il y a un nombre assez important de violences politiques en France, celles-ci sont rarement d’un très haut niveau, contrairement à l’image que l’on peut s’en faire.
La France présente toutefois un certain nombre de spécificités, qui expliquent l’importance de la contestation politique dans notre pays. D’abord, nous avons un Etat historiquement centralisé, doté d’une bureaucratie administrative puissante, et peu ouvert sur la société civile – contrairement à nos voisins suisses, néerlandais, allemands ou même britanniques. Face à cette structure d’Etat fermée et rétive à la conciliation, il peut y avoir des rapports tendus : l’épisode que l’on vient de connaître avec la réforme des retraites en témoigne. On observe une sorte d’autisme d’Etat, lié à une fonction publique sûre d’elle-même et méfiante vis-à-vis des corps intermédiaires. Cela tient à la structure de l’Etat, mais aussi à la logique républicaine française, qui prescrit l’absence de corps intermédiaires entre l’Etat et le peuple. Ainsi les partis ont une place très faible : seulement un article y fait référence dans la Constitution de la Ve République, contre des dizaines dans la Constitution allemande ou espagnole par exemple. Ce fonctionnement de l’Etat paraît anachronique à l’heure où les citoyens demandent d’être davantage associés à la décision par des dispositifs participatifs. Pour le moment, ces mécanismes sont particulièrement limités chez nous : ils sont désormais assez fréquents au niveau local, mais ils ne sont pas vraiment décisifs dans l’élaboration des politiques publiques nationales.
Autre élément qui explique l’intensité de la contestation française : le faible rôle du Parlement par rapport à la puissance de l’exécutif. Bien souvent, il apparaît comme un instrument visant à faire passer les lois que le gouvernement a décidées. Troisième chose, la France est l’un des seuls pays où il existe une multitude de centrales syndicales2. La violence peut aussi s’expliquer par cette absence d’unité : lorsque l’Etat négocie avec l’un des syndicats, les autres sont tentés de développer un activisme plus fort pour se faire entendre.
Enfin, on trouve en France une forte production doctrinale d’extrême gauche, issue de la tradition blanquiste de « propagande par le fait », favorable à la conflictualité politique directe, que l’on retrouve peu dans des pays comme l’Angleterre, l’Allemagne ou les Etats-Unis. Par beaucoup d’aspects, elle théorise et légitime l’usage de la violence comme un mode de contestation du pouvoir légitime3.
En principe, les partis politiques permettent de métaboliser la colère de la rue pour lui donner forme politique par l’intermédiaire de la représentation. Y parviennent-ils encore aujourd’hui ? Et que penser de la stratégie d’un parti comme LFI qui, au contraire, prétend faire entrer la colère de la rue dans l’Assemblée ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Il me semble que les partis ne sont plus capables de métaboliser la colère populaire. Notamment parce qu’Emmanuel Macron a fait exploser le système des partis existants – avec la droite et la gauche traditionnelles – et même plus généralement l’institution partisane. C’est ce que souligne Michel Offerlé : on a affaire aujourd’hui à des partis mouvements (définis avant tout par un chef et Internet), comme En Marche ou la France insoumise. Or, à partir du moment où il n’y a plus de structures partisanes qui offrent un réceptacle et un horizon de transformation à la colère, ce sont les individus qui prennent les coups. C’est peut-être ce qui explique la montée des violences dirigées contre des individus, notamment les élus macronistes. Si les atteintes directes aux permanences politiques ou aux élus directement restent très minoritaires dans notre corpus (moins de 50 sur les 9200 faits de violences politiques dénombrés jusqu’en 2019), il semble néanmoins qu’elles aient augmenté ces quatre dernières années. Les intéressés sont souvent surpris par ces violences parce que ce ne sont pas des professionnels de la politique (rappelons que 75% des députés de LREM en 2017 sont des profanes) : ils ne s’imaginaient pas à quoi ils allaient être confrontés. La configuration particulière du parti aujourd’hui fait qu’on ne peut plus espérer qu’il absorbe la colère pour l’exprimer autrement. Pour ce qui est de LFI, il est vrai qu’ils mettent en place une stratégie de parti jamais vue au Parlement : on a affaire à un blocage collectif du débat, afin de refléter la colère de la rue. Les élus LFI, eux non plus, ne sont pas des professionnels de la politique. Ils suivent pour la plupart l’idéologie de Mélenchon, inspiré par Chantal Mouffe, selon laquelle la démocratie doit passer par le conflit amis/ennemis et par le refus de la démocratie libérale délibérative.
Pensez-vous qu’il peut y avoir un effet de socialisation sur les jeunes qui découvrent aujourd’hui les mouvements de manifestation et les violences qui peuvent les accompagner ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Je ne sais pas si ce sera le cas pour ce mouvement de lutte contre la réforme des retraites, mais il y a en effet une dimension de socialisation politique forte dans l’usage de la violence. Cette socialisation est souvent générationnelle : la violence politique est une affaire de jeunes, elle est rarement le fait des personnes plus âgées. Pourquoi ? Parce qu’elle suppose une forme de disponibilité biographique. Lorsqu’on a charge de famille et qu’on est pris dans les contraintes de la vie active, il va de soi que l’on n’a ni le temps ni forcément l’envie d’aller sur les barricades. Les jeunes partagent aussi un goût du risque, de l’adrénaline qui monte dans l’action de rue. La violence présente enfin une dimension affinitaire. Or la jeunesse est justement un moment de création de liens et de rencontres.
Comment s’organise une action collective ? A-t-on observé des changements importants en la matière ces dernières années ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Le mouvement des gilets jaunes a pris à défaut nombre de conceptions de la science politique et de la sociologie de la mobilisation. C’est un mouvement qui, étrangement, ne correspond pas du tout à ce que l’on nous a expliqué sur la manière dont se construit une action collective. Le paradigme dominant de l’action collective, selon Anthony Oberschall4, comporte deux éléments. Premièrement, les individus qui portent l’action collective doivent avoir des ressources à mobiliser, qu’elles soient symboliques, financières ou politiques (le lien avec les médias par exemple). Deuxièmement, il faut qu’il y ait une sorte de communauté préexistante : des individus complètement anomiques ne vont pas pouvoir monter une action collective. Les gilets jaunes ne s’inscrivent absolument pas dans ce paradigme. Ils n’avaient aucune ressource et étaient dans leur immense majorité des primo-manifestants, voire des primo-politiques – désengagés de la politique, abstentionnistes, peu syndiqués. Personne n’a vu venir ce mouvement, et encore moins son inscription dans la durée. Un élément qui explique qu’il ait duré – et qui, me semble-t-il, a été sous-estimé – c’est la dimension de plaisir dans l’action collective. Beaucoup d’études récentes ont montré que l’action politique, y compris radicale et violente, introduisait de la rupture dans le quotidien, ce qui induit un certain plaisir. Aller sur les ronds-points, cultiver la conversation politique, débattre, faire des rencontres a beaucoup plu aux manifestants, et parfois changé leur vie. Cela explique en partie pourquoi le mouvement a duré si longtemps : il devenait couteux de s’arrêter. Au fil de la mobilisation, on a en outre observé une socialisation politique par la violence et l’activisme radical. Des manifestants qui n’avaient jamais assisté à une charge de CRS ont appris des pratiques manifestantes au contact de l’ultragauche (black bloc notamment), voire de l’ultradroite. On a parlé des « ultra-jaunes » pour désigner ces manifestants qui ont suivi un véritable apprentissage de la contestation de rue violente.
Pour revenir au mouvement que nous venons de connaître avec la réforme des retraites, quel était le profil des manifestants violents qui s’y sont introduits ? Y a-t-il eu, comme avec les gilets jaunes, une forme de nouveauté dans cette action collective ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Le mouvement de lutte contre la réforme a vu se développer sur ses marges, me semble-t-il, quatre types de manifestants violents. Tout d’abord des manifestants traditionnels, syndiqués, qui se sont radicalisés après l’annonce du 49.3, qu’ils n’ont pas supportée. Deuxièmement, des militants presque insurrectionnels, professionnalisés, dont des anciens ultra-jaunes. Troisièmement, des très jeunes : beaucoup de lycéens sont entrés dans le conflit. Ils venaient par engagement ou pour le plaisir de l’agitation. Enfin, en dernier, les manifestants très échaudés par la répression policière. Ce problème devient structurel : il y a un vrai souci de maintien de l’ordre et d’adaptation de ce maintien de l’ordre. Des formes de répression ont été inadaptées. Une singularité qu’on a observée dans les manifestations violentes ces dernières semaines, c’est l’absence de casseurs prédateurs. C’était le cas dans toutes les manifestations violentes précédentes, où certains en profitaient pour casser des boutiques, prendre des chaussures de sport, etc. Il y n’y a eu que très peu de casse dans l’épisode que nous venons de connaître (hormis des banques) et quasiment pas de vol. C’est l’une des vraies différences avec le mouvement des gilets jaunes. Comment l’expliquer ? Sûrement par la présence des syndicats et des services d’ordre (en particulier celui de la CGT) dans les manifestations contre la réforme des retraites. Ils n’ont pas laissé faire les quelques casseurs avec une logique de prédation économique, car c’était dommageable pour l’image de la manifestation. Mais si elle a limité la casse, il est possible que la présence des services d’ordre des syndicats ait aggravé les faits de violences. Il existe en effet une espèce de concurrence pour le leadership de la contestation entre les groupes autonomes qui sont violemment anti-CGT et anti-CFDT. Voyant que les syndicats avaient une vraie légitimité dans la contestation, les autonomes ont essayé de se légitimer par la violence. La violence peut donc aussi s’expliquer par une logique concurrentielle interne. En 2021, il faut se souvenir que les autonomes avaient attaqué le service d’ordre de la CGT avec des dizaines de blessés.
Vous distinguez différentes logiques qui président à l’utilisation de la violence, quelles sont-elles ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Je développe quatre logiques : colérique, instrumentale, identitaire et émotionnelle. Tout d’abord, la violence vient souvent d’une colère, et il est difficile d’y échapper dans une communauté politique. La démocratie a été inventée pour transmuter cette violence de la rue en une colère du vote. C’est illustré par la lithographie de Daumier, avec cet ouvrier qui tient un bulletin de vote dans la main, et qui dit « voilà ma cartouche »5, ou les grands mots exaltés de Victor Hugo sur la fin de la violence qu’impliquerait le suffrage universel masculin, adopté en 1848. Ce point de vue peut paraître naïf chez Hugo ou Sand, mais il est aussi d’une très grande sincérité : c’est l’idée qu’une fois le vote institué, la violence n’est plus nécessaire. Second point, la logique instrumentale : la violence politique est parfois un moyen d’obtenir quelque chose. Par exemple, en Corse, la violence politique est une arme de marchandage avec l’Etat pour obtenir des exonérations fiscales pour les paysans, pour les agriculteurs de montagne, pour les hôteliers… On retrouve cela partout : Stefen Wilkinson et Christophe Jaffrelot ont montré qu’en Inde, la violence émeutière contre les musulmans suit très fidèlement les cycles électoraux. L’idée est de mettre en scène un affrontement fort entre les hindous et les musulmans pour pousser les électeurs hindous indécis à voter pour le parti nationaliste hindou (BJP). Autre exemple en Irlande du Nord avec le Sinn Fein : les émeutes ont pour objectif de faire fuir les protestants de certaines rues de Belfast et conserver ainsi certains quartiers catholiques très communautarisés (et inversement de la part des protestants). Car dans un quartier quasi exclusivement catholique ou loyaliste, le représentant communautaire a la certitude d’être réélu, il bénéficie une clientèle électorale fidèle. Troisièmement, la violence a un ressort identitaire. Elle sert à témoigner de l’identité de celui qui la pratique. C’est le cas de la violence d’Etat : la violence d’un corps de CRS, c’est la mise en scène dans l’espace public de la force de l’Etat. Dans un tout autre contexte, lorsque cette violence identitaire est extrême ou génocidaire, elle vise à dénier l’identité du groupe qui la subit. Enfin, il y a une dimension émotionnelle de la violence : on y trouve un plaisir. Cette dernière dimension est souvent négligée par les médias, qui ont tendance à seulement penser la violence comme une épreuve. Des études en cours sur les black blocs montrent que ceux-ci ne sont pas des individus marginaux mais souvent de jeunes adultes intégrés dans l’emploi, qui ont parfois des situations sociales stables, qui se livrent à la violence comme un défouloir et un amusement, pas toujours avec des perspectives politiques.
Avec les revendications écologiques, appuyées parfois sur une représentation apocalyptique du futur, ne peut-on pas basculer dans une nouvelle radicalité ? Certains manifestants ont le sentiment que la fin du monde est proche, et qu’au regard d’une telle échéance, tous les moyens sont bons pour sauver la planète…
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Avec Isabelle Sommier, nous avons inclus ce type d’action dans les violences sociétales (antitechnicistes, écologistes radicaux…). Nous les avons distinguées de quatre autres familles : les violences idéologiques (extrême-gauche et extrême-droite), séparatistes (Basques,Corses), religieuses (juifs du Betar ou de la LDJ, islamistes, catholicisme intégriste) et syndicales. Il faut bien voir que les violences sociétales sont à 90% des violences du XXIe siècle, elles commencent véritablement dans les années 2000. Pour l’instant, elles sont très minoritaires – environ 15% des violences que nous avons recensées – et modérées. Ce sont surtout des destructions et des dégradations, et non des attentats ou des violences létales. En revanche, ce que montre Isabelle Sommier dans un chapitre de l’ouvrage, c’est que le registre de justification des violences sociétales est particulièrement radical. Il existe une dimension eschatologique, également invoquée dans le cas des violences islamistes. Si c’est la fin du monde qui menace, alors les actions plus violentes deviennent justifiées. Une des grandes préoccupations des services de renseignement en ce moment est d’ailleurs l’action écologique violente. On craint une possible radicalisation de la jeunesse sur ces thématiques. Ce n’est pas encore le cas en France6, mais en Angleterre, aux Etats-Unis, ou en Australie, on a parfois affaire à des actes de nature terroriste (des bombes sont envoyées à des chercheurs ou à des laboratoires d’expérimentation animale, comme ce fut le cas avec l’action de Theodore Kaczynski, dit Unabomber aux Etats-Unis…).
Comment sort-on de la violence ? Faut-il attendre qu’elle se dissipe en quelque sorte d’elle-même, ou une initiative politique forte doit-elle intervenir ?
La Grande conversation
Xavier Crettiez : Olivier Filleule a montré dans Le Désengagement militant (2005) l’existence de cycles et de phénomènes de burn out militants qui font que la violence cesse d’elle-même à un certain moment. D’abord parce que l’engagement dans la violence est générationnel : on vieillit, on fonde une famille, et donc on finit par lâcher – à l’exception peut-être des islamistes dont l’ancrage familial fonctionne plutôt comme un encouragement à la radicalisation, plus que comme un frein. Par ailleurs, on cesse d’avoir recours à l’action violente parce qu’elle est épuisante, coûteuse à long terme pour celui qui la pratique. Lorsque la violence politique est d’intensité moyenne ou forte, et qu’elle implique l’état de clandestinité, il est difficile de tenir dans cette situation très longtemps. Commettre mais aussi voir de manière quasi permanente la violence et en subir la répression a un coût moral non-négligeable. Dans les années 1970, on a vu les organisations violentes en France (Action directe), en Italie (Brigades rouges) ou en Allemagne (RAF) s’épuiser progressivement pour ces deux raisons le plus souvent. De la même manière, les manifestants – qui ne font évidemment pas preuve du même degré de violence – finissent par se démobiliser. Le problème est que cet abandon par lassitude crée des frustrations et de la colère. La crise actuelle ouvre ainsi un boulevard à des formations d’extrême-droite comme le Rassemblement national. L’absence de sortie institutionnelle et d’une réconciliation opérée par l’Etat et le gouvernement laissera des traces.