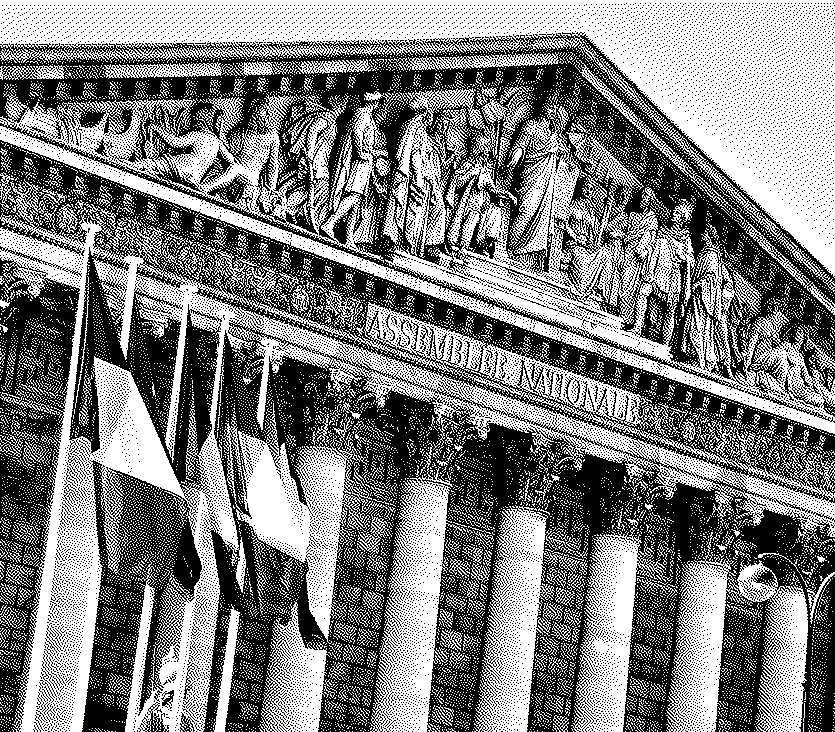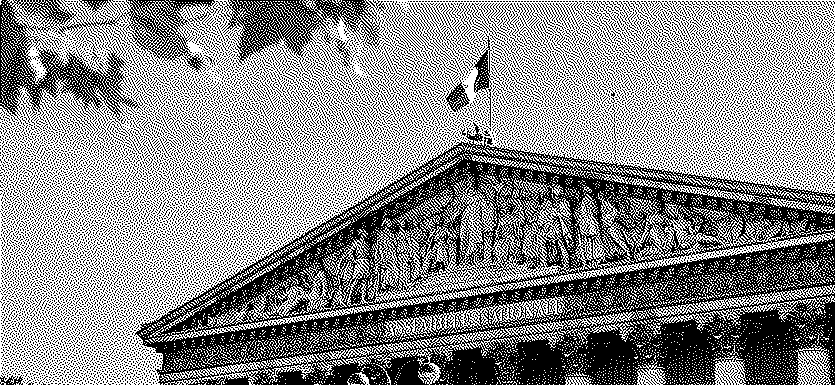La proposition d’adopter en France un mode de scrutin proportionnel compensatoire inspiré du modèle allemand vise à répondre à une double exigence démocratique : renforcer la représentativité du Parlement tout en assurant la stabilité du système politique. Loin d’être une valeur en soi, le mode de scrutin est un instrument : il doit être jugé à l’aune de sa capacité à traduire fidèlement la volonté des électeurs tout en permettant la constitution de majorités gouvernantes.
Le dispositif proposé repose sur le principe du double vote, tel qu’il existe en Allemagne depuis 1949, mais adapté aux spécificités françaises. Chaque électeur disposerait de deux bulletins : le premier pour élire un député dans sa circonscription au scrutin uninominal majoritaire à deux tours – soit sensiblement de la même façon qu’aujourd’hui –, le second pour exprimer un choix partisan à l’échelle nationale. Ce mécanisme présente un triple avantage. Il conserve tout d’abord un ancrage territorial fort, en maintenant le lien de proximité entre l’élu et ses électeurs, lien auquel la culture politique française est particulièrement attachée. Il permet ensuite de corriger les distorsions du scrutin majoritaire en assurant une représentation plus fidèle de la diversité des sensibilités politiques. Enfin, il libère l’électeur de la logique du « vote utile », en dissociant choix local et choix partisan.
Le principe de la proportionnelle compensatoire repose sur la coexistence de deux séries de sièges : une première, dite « majoritaire », attribuée dans le cadre de circonscriptions locales, et une seconde, dite « compensatoire », répartie de manière à rectifier les écarts issus du scrutin uninominal et à se rapprocher au mieux d’une représentation proportionnelle. Concrètement, si un parti a obtenu 20% des sièges au scrutin majoritaire de circonscription, mais 25% des voix au scrutin proportionnel, on lui alloue un surcroît de sièges de façon à ce qu’il dispose au final de 25% de l’ensemble des sièges. Ainsi si le parti X a fait 25% au scrutin proportionnel, il obtiendra bien 25% des 577 députés, soit 144 élus. Si le nombre de ses députés élus au scrutin majoritaire à deux tours est de 100, alors 44 députés seront pris sur la liste pour obtenir le nombre à atteindre.
L’intérêt de ce modèle tient à sa souplesse : il peut être modulé selon le type de scrutin majoritaire retenu (à un ou deux tours), selon le tour servant de base à la compensation, ou encore selon le niveau territorial choisi pour la répartition proportionnelle (national, régional, voire départemental). En théorie, près de 360 variantes sont possibles. L’enjeu est donc de calibrer un système mixte qui concilie l’ancrage local des élus et la représentation pluraliste des forces politiques, tout en préservant la stabilité institutionnelle.
1. Les systèmes de références
La réflexion sur l’introduction d’un scrutin proportionnel compensatoire en France ne peut être menée sans un retour sur les modèles qui l’inspirent. L’expérience allemande, forgée dans le contexte singulier de l’après-guerre et marquée par des évolutions jurisprudentielles et législatives successives, illustre la possibilité d’un équilibre entre représentation proportionnelle et ancrage territorial. Le modèle élaboré dans les années 1970 en France par Étienne Weill-Raynal, modèle déjà porté par Léon Blum, témoigne quant à lui de la vitalité des débats doctrinaux français autour de la conciliation entre logique majoritaire et logique proportionnelle. Ces deux références, bien que distinctes dans leur logique et leur faisabilité, permettent d’éclairer les atouts et les limites des solutions envisageables pour la France.
a. Le système mixte allemand : équilibre entre proportionnelle et ancrage local
Le système électoral adopté par la République fédérale d’Allemagne en 1949 ne résulte pas uniquement de la volonté des partis allemands. Il fut en réalité fortement influencé par les puissances alliées, et tout particulièrement par le Royaume-Uni, soucieux d’éviter les errements qu’avait connus la République de Weimar. Les Britanniques souhaitaient limiter la fragmentation du système partisan en réduisant le nombre de partis représentés, tout en préservant une tradition de représentation territoriale propre à leur culture politique. Ils expérimentèrent ainsi, dans leur zone d’occupation, un système mêlant scrutin uninominal et proportionnelle, dont la logique inspira largement la formule finalement retenue à l’échelle nationale en 1949.
Le système de 1949 reposait initialement sur une formule à un seul vote, combinant 60 % de députés élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans des circonscriptions, et 40 % de députés élus à la proportionnelle sur des listes régionales fermées. Pour accéder à la répartition proportionnelle, un parti devait soit remporter au moins un siège de circonscription, soit obtenir 5 % des suffrages exprimés dans un Land. En 1953, le système fut amendé pour introduire le « double vote » : un premier bulletin pour le candidat de circonscription (Erststimme), un second pour une liste de parti au niveau du Land (Zweitstimme). Dans le même temps, la part des sièges de liste fut portée à 50 %, et le seuil d’éligibilité fut nationalisé : un parti devait désormais atteindre 5 % des voix sur l’ensemble du territoire ou remporter un siège en circonscription. En 1956, cette exigence fut renforcée : un parti devait désormais obtenir soit 5 % des voix à l’échelle nationale, soit trois sièges de circonscription. Un électeur peut ainsi voter pour un candidat de circonscription appartenant à un parti, et pour la liste d’un autre parti. Cette dissociation est fréquente et correspond à des stratégies électorales de plus en plus rationalisées.
D’abord, les 299 mandats directs sont attribués au scrutin uninominal à un tour : le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription est élu. Ensuite, la répartition proportionnelle des sièges entre les partis est effectuée à l’échelle nationale en fonction du second vote (Zweitstimme), puis déclinée au niveau des Länder. Cette opération se fait selon la méthode de Sainte-Laguë/Schepers, en fonction du nombre de voix obtenues dans chaque Land. Enfin, du total de sièges proportionnels obtenu par un parti, on retranche le nombre de mandats directs qu’il a déjà remportés ; le solde est comblé par les candidats issus des listes régionales. Ce mécanisme, complété par l’ajustement des mandats surnuméraires et compensatoires, garantit le caractère globalement proportionnel du système.
Le système a toutefois suscité des déséquilibres croissants au fil du temps, notamment par la multiplication des sièges excédentaires. Lorsqu’un parti remporte plus de sièges dans les circonscriptions que ce que lui accorde la proportionnelle, ces sièges lui sont conservés, gonflant temporairement la taille du Bundestag. Si ces situations étaient rares avant 1990, leur fréquence et leur ampleur ont fortement augmenté, notamment en 2009 (24 sièges) ou en 2017 (46 sièges). Face aux critiques, le Tribunal constitutionnel déclara en 2012 ce mécanisme inconstitutionnel, car portant atteinte à l’égalité des suffrages. Une réforme introduite en 2013 limita ces sièges excédentaires et institua un système d’Ausgleichsmandate, attribué aux autres partis pour rétablir la proportionnalité. En 2021, 138 sièges supplémentaires furent ainsi créés (34 surplus, 104 compensatoires), portant la taille du Bundestag à 736 députés, loin des 598 sièges « normaux » fixés en 2002. En 2023, une nouvelle loi réduit ce nombre à 630.
Le système électoral mixte compensatoire allemand, bien que conçu pour assurer une représentation proportionnelle, génère parfois des résultats disproportionnés. Deux mécanismes en sont principalement responsables : la règle du seuil de 5 % et les sièges supplémentaires (surplus seats). Historiquement, les élections des années 1950 présentent de fortes distorsions entre voix et sièges, qui diminuent ensuite avant de réapparaître après la Réunification. L’élection de 2013 en est une illustration marquante : l’exclusion des libéraux du FDP, n’ayant pas atteint les 5 %, a permis à la CDU et au SPD de bénéficier d’une surreprésentation notable (respectivement +6,3 et +4,9 points). En moyenne, la CDU et le SPD obtiennent depuis 1949 des parts de sièges supérieures à leurs parts de voix (+2,1 et +1,8 point), au détriment des petits partis comme les Verts ou le FDP, parfois sous-représentés, voire exclus. Toutefois, malgré ces biais, le système allemand demeure globalement bien plus proportionnel que les systèmes majoritaires.
La règle du seuil induit une autre conséquence : les petits partis concentrent leurs efforts sur le scrutin de liste, où leurs chances sont plus grandes. Cela se traduit par une surreprésentation relative de ces partis dans les seconds votes, comparés aux premiers. Le phénomène de « vote stratégique » s’en trouve accentué : les électeurs peuvent être incités à donner leur Erststimme à un grand parti pour le candidat local, et leur Zweitstimme à un petit parti pour l’aider à franchir le seuil. Ce « ticket-splitting » est de plus en plus fréquent, passant de 6,4 % des électeurs en 1957 à 27,3 % en 2017. Ce phénomène est exploité stratégiquement par les partis eux-mêmes. Le FDP, par exemple, a historiquement appelé ses électeurs à voter pour leur partenaire de coalition en circonscription, afin de recevoir en retour les Zweitstimmen de leurs électeurs. Ce vote dit d’« assurance seuil » permettait de garantir leur maintien au Bundestag.
La question du statut des députés de circonscription (directement élus) et de liste (issus de la proportionnelle) fait aussi débat. Si le système accorde en apparence plus d’importance à l’Erststimme, en pratique, c’est la Zweitstimme qui détermine la composition du Bundestag. En cas de démission ou de décès, les remplacements, même pour des sièges de circonscription, se font par la liste. Cela affaiblit la logique de représentation locale et favorise une homogénéisation des rôles des députés. Toutefois, les études montrent que les partis tendent à traiter leurs élus de circonscription et de liste de manière identique. La double candidature est la norme : en 2009, 52 % des candidats — mais 89 % des élus — figuraient à la fois en circonscription et sur la liste. Cela permet à un candidat battu localement de siéger grâce à sa position sur la liste. Les petits partis présentent systématiquement des candidats mêmes dans des circonscriptions peu favorables, car cela donne de la visibilité à leur liste.
b. L’approche Weill-Raynal : la proportionnelle par repêchage
La méthode Weill-Raynal, conçue à partir d’une idée du socialiste autrichien Victor Adler et promue en France par le socialiste Ernest Bracke, fut défendue notamment par Léon Blum, qui la proposa sous forme de loi en 1926. Elle fut inscrite dans le programme de la SFIO jusqu’à la fin des années 1970 et fut de nouveau envisagée par François Mitterrand en 1993. Popularisée par le socialiste Étienne Weill-Raynal, elle constitue une forme de système électoral mixte visant à combiner représentation majoritaire et proportionnelle, tout en corrigeant certains biais propres à chacun de ces modes de scrutin.
L’originalité du dispositif tient à ce que les sièges de compensation ne sont pas attribués par le biais de listes de partis, mais en fonction des meilleurs résultats obtenus par les candidats battus. Ainsi, un parti qui, à l’échelle nationale, a droit à 120 sièges, mais n’en a obtenu que 70 au scrutin majoritaire se verra attribuer 50 sièges supplémentaires qui seront alloués aux candidats battus ayant réalisé les meilleurs scores, soit les « meilleurs perdants ». Ce mécanisme de « repêchage » peut aboutir à ce qu’une même circonscription soit représentée par plusieurs députés. La procédure de repêchage par score individuel affaiblit la maîtrise des partis sur la désignation des élus, ce qui peut être vertueux d’un point de vue démocratique, mais pose deux problèmes : d’une part, un parti peut se retrouver sans candidats à repêcher s’il ne se présente que dans un nombre limité de circonscriptions, et d’autre part, la représentation devient instable géographiquement (certaines circonscriptions comptent plusieurs députés). Ce déséquilibre territorial est accentué par la conjoncture politique : les départements sous-représentés peuvent varier d’une élection à l’autre, et les inégalités de représentation peuvent se concentrer dans certaines zones géographiques.
Comparativement au modèle allemand, la méthode Weill-Raynal se distingue donc par deux éléments :
- Le mode d’attribution des sièges proportionnels : en Allemagne, les sièges de liste sont attribués via des listes fermées déterminées par les partis. Avec Weill-Raynal, la répartition se fait en fonction des meilleurs perdants individuels.
- La stabilité structurelle : le système allemand compense les écarts entre proportionnelle et majoritaire par des « sièges de nivellement » (levelling seats), tout en maintenant un équilibre territorial. Dans le modèle Weill-Raynal, la multiplication de sièges et leur répartition aléatoire rendent l’architecture représentative bien plus instable.
Malgré son ambition de réconcilier logique majoritaire et proportionnelle, la méthode Weill-Raynal apparaît ainsi difficilement praticable dans sa version originelle. Les simulations menées dans les années 1970 et 1980 montrent que seule une variante plus proche du système allemand permettrait une application réaliste et opérationnelle, en assurant à la fois stabilité politique et équité dans la représentation1.
2. Vers un modèle français
Transposer en France un mode de scrutin proportionnel compensatoire implique de concilier l’héritage institutionnel de la Ve République avec les exigences de représentativité et de stabilité. Le système proposé, articulé autour du double vote, conserve un lien fort entre élus et territoires tout en garantissant une traduction plus fidèle des préférences partisanes. Mais cette transposition suppose des adaptations substantielles : redécoupage des circonscriptions, fixation d’un seuil électoral, réforme du financement public des partis et maintien des règles de parité. L’enjeu est de calibrer un dispositif qui ne se contente pas d’importer un modèle étranger mais qui réponde aux spécificités politiques, territoriales et constitutionnelles françaises.
a. Le mode de scrutin proposé
Dans le modèle proposé, l’Assemblée nationale serait composée de 577 députés, soit le nombre maximal prévu par la Constitution. Réduire ce chiffre aurait pour effet de fragiliser l’ancrage territorial, déjà affaibli par la fusion nécessaire des circonscriptions, et d’accroître les distorsions du scrutin majoritaire, plus difficiles à compenser. Une telle évolution poserait donc un risque sérieux de contrariété avec la Constitution. Par ailleurs, diminuer le nombre de députés sans réduire parallèlement celui des sénateurs déséquilibrerait le rapport entre les deux assemblées au sein du Congrès. Or, si l’on envisageait de réduire également le nombre de sénateurs, la question du redécoupage se poserait inévitablement. La loi organique deviendrait alors « relative au Sénat », conférant à celui-ci un droit de veto en vertu de l’article 46 de la Constitution.
Les modèles allemand et Weil Raynal (voir supra) suggèrent qu’une répartition de 60 % des sièges au scrutin majoritaire et de 40 % à la proportionnelle permet une compensation effective. Ce ratio pourrait être porté, comme en Allemagne, à 50 %-50 % afin de faciliter davantage la compensation. Un tel choix comporterait toutefois un risque constitutionnel : plus le nombre de circonscriptions est réduit, plus les déséquilibres démographiques entre elles augmentent. Le Conseil constitutionnel considère en effet que l’amplitude maximale d’une circonscription ne peut excéder les limites départementales. Jusqu’à présent, il ne sanctionne pas véritablement les divergences entre circonscriptions issues de départements différents. Ainsi, en métropole et dans le cadre du mode de scrutin actuel, un député de la 2e circonscription du Cantal représente environ 63 000 habitants, contre 167 000 dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique. La mise en place d’un mécanisme de compensation pourrait cependant conduire le Conseil à considérer que c’est avant tout dans le cadre du second vote que la volonté de l’électeur s’exprime de manière égale, au regard de la finalité proportionnelle du scrutin. Néanmoins, tout accroissement du différentiel démographique entre circonscriptions renforcerait mécaniquement le risque d’inconstitutionnalité.
Si l’on retient donc une répartition 60 %/40 %, la configuration serait la suivante :
- 347 sièges attribués dans des circonscriptions uninominales au scrutin majoritaire à deux tours. Ce mode de scrutin, familier des électeurs français et inscrit dans une tradition électorale bien ancrée, présente un avantage par rapport au modèle allemand (scrutin à un tour) : il génère de moindres « vagues électorales » et est donc plus aisément compensable. Une réforme pourrait cependant consister à supprimer le seuil de maintien permettant la tenue de triangulaires ou quadrangulaires : seuls les deux premiers candidats seraient alors qualifiés pour le second tour, ce qui simplifierait la mécanique du scrutin. La compensation proportionnelle viendrait atténuer l’impact négatif d’une telle réforme sur la représentativité. Cette solution pose toutefois une difficulté : le vote compensatoire devrait, logiquement, être exprimé dès le premier tour, puisque toutes les circonscriptions ne connaîtront pas de second tour. Cela risquerait d’accroître l’abstention au second tour et de renforcer les comportements de vote stratégique — dont l’effet resterait cependant limité.
Par ailleurs, comme en Allemagne, il serait opportun d’autoriser la double candidature (un même candidat pouvant figurer à la fois dans une circonscription et sur la liste proportionnelle). Mais en cas de double élection, il est impératif que le mandat acquis au scrutin majoritaire prime. À défaut, de nombreux élus issus des circonscriptions devraient démissionner, provoquant de nouvelles élections partielles. Ce scénario, déjà observé sous la IIIᵉ République lorsque la candidature multiple était permise, engendrerait mécaniquement une chambre moins proportionnelle et une forte instabilité politique. - 230 sièges attribués à la proportionnelle sur une base compensatoire via une liste nationale unique. Contrairement au modèle allemand, qui répartit les sièges compensatoires par Länder, une liste nationale apparaît plus adaptée au contexte français, en raison de l’extrême hétérogénéité démographique des régions. Si la compensation s’effectuait à l’échelle régionale, elle perdrait en efficacité : certaines régions compteraient plus de dix fois plus d’électeurs que d’autres (Île-de-France vs Corse ou Bourgogne–Franche-Comté), introduisant des distorsions majeures. Elle aboutirait aussi à ce que des formations soient représentées dans des territoires où elles n’ont aucun ancrage électoral puisque la répartition aurait pour objectif de rattraper le caractère national de la proportionnelle sur des listes qui seraient alors régionales. Si la compensation impliquait par exemple d’ajouter un député LFI ou Modem, ce dernier serait ainsi par exemple attribué arbitrairement à la Corse2. Éviter cela impliquerait de faire de la compensation sur la base des résultats régionaux ce qui aurait un effet très déformant dans les petites régions. Conjugué à la distorsion d’un scrutin mixte, une telle modalité rendrait au final le mode de scrutin à la fois très complexe et très peu proportionnel. Une circonscription nationale unique permettrait ainsi d’assurer une stricte égalité des électeurs et de garantir l’effectivité de la compensation. À défaut, des listes régionales pourraient être envisagées, mais dans un cadre très large, sur le modèle des circonscriptions européennes avant 2019, afin de rester compatibles avec l’objectif compensatoire. Dans ce cas, aucune exigence de domiciliation ne pourrait être imposée aux candidats, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdisant toute condition de résidence pour une élection nationale. Cette souplesse jurisprudentielle autoriserait en outre à réduire le nombre de sièges attribués au scrutin majoritaire dans les outre-mers, sans atteindre les mêmes seuils qu’en métropole, afin de garantir la spécificité de ces territoires.
Le seuil retenu pour l’attribution des sièges à la proportionnelle gagnerait à être fixé à 4 % des suffrages exprimés à l’échelle nationale. Ce seuil pourrait être retenu en s’appuyant sur les enseignements tirés de l’expérience allemande, mais aussi sur la pratique de plusieurs démocraties européennes — Suède, Autriche, Norvège — qui ont fait ce choix pour concilier pluralisme politique et efficacité parlementaire. Un seuil de 5 %, comme en Allemagne, s’est en effet révélé excessivement excluant : dans certains scrutins régionaux récents (élections en Sarre en 2022), plus de 25 % des voix exprimées ont été purement et simplement écartées de toute représentation parlementaire. Cette situation contribue à fragiliser la légitimité des institutions et à accentuer la défiance électorale. C’est précisément pour cette raison que le Tribunal constitutionnel fédéral allemand, dans une décision de 2023, a jugé ce seuil contraire à la Loi fondamentale pour les élections européennes, exigeant qu’il soit abaissé dans le cadre d’une prochaine réforme. Le choix d’un seuil à 4 % permet de conserver un filtre raisonnable contre une dispersion excessive tout en assurant que la grande majorité des voix exprimées soient représentées. Un seuil de 5 % pourrait toutefois être préféré pour répondre à celui des élections européennes.
Afin de ne pas pénaliser les partis disposant d’un fort ancrage territorial, mais d’une base nationale limitée, il est proposé de calquer la clause dérogatoire allemande : si un parti n’atteint pas le seuil de 4 % au niveau national, mais remporte au moins cinq sièges (trois en Allemagne avant la réforme de 2023, mais ce seuil nous semble pouvoir être relevé) au scrutin majoritaire, il serait alors pleinement intégré à la répartition proportionnelle. Cette disposition permet de prendre en compte la réalité du multipartisme local et d’éviter que des formations politiques significatives dans certaines zones — par exemple en outre-mer — soient exclues malgré une implantation électorale réelle. Elle vise également à renforcer le lien entre implantation territoriale et représentativité, en évitant que des partis purement protestataires ou non organisés sur le territoire bénéficient des seuls effets du scrutin proportionnel.
b. Les adaptations nécessaires du régime électoral
Le basculement vers ce mode de scrutin suppose un redécoupage en profondeur des circonscriptions législatives. En effet, passer de 577 à 347 circonscriptions implique une rationalisation du maillage territorial. Pour garantir l’impartialité du processus et éviter tout sentiment de manipulation partisane, le redécoupage pourrait être confié à une commission ad hoc composée de parlementaires de tous les groupes, de représentants du Conseil d’État et de personnalités qualifiées.
Le financement public des partis politiques gagnerait également à être repensé dans cette nouvelle configuration. Il serait attribué sur la base du nombre de voix obtenues lors du vote à la proportionnelle, c’est-à-dire à partir des bulletins de vote déposés pour les listes nationales. Ce choix garantit une évaluation plus fidèle du poids électoral des formations politiques et évite les effets de distorsion liés aux victoires individuelles en circonscription, souvent dues à des configurations locales spécifiques. Il permet aussi de renforcer la transparence et la responsabilité des partis, en les incitant à structurer une offre politique nationale cohérente. Pour autant, il ne peut sans doute s’envisager sans une réflexion plus large sur le mode de financement des partis et les conditions d’accès au financement public dont il conviendrait d’examiner si elles peuvent faire l’objet d’une réflexion conjointe dans le cadre d’une proposition de loi, en tenant compte des limites posées par l’article 40 de la Constitution.
Enfin, les règles actuelles de parité pourraient être maintenues. Pour les circonscriptions uninominales, les partis seraient tenus de respecter la parité globale dans l’attribution de leurs investitures, sous peine de pénalités financières, conformément à la législation actuelle. Pour la liste nationale, la règle de l’alternance stricte entre femmes et hommes s’appliquerait, comme c’est déjà le cas pour les élections européennes ou les conseils régionaux. Cela permettrait de garantir une représentation déjà plus équilibrée des femmes et des hommes dans l’Assemblée, quelle que soit la modalité d’élection. Une alternative peut exister, mais représente un risque d’inconstitutionnalité. Le dispositif garantit une parité de genre pour les élus d’un parti, en combinant ceux des circonscriptions et de la liste proportionnelle. On choisit les premiers hommes et femmes de la liste proportionnelle pour équilibrer le total des élus par genre. Par exemple, si 2 hommes et 5 femmes sont élus en circonscriptions et qu’il faut 20 élus à la proportionnelle, on sélectionne 11 hommes et 9 femmes pour obtenir 13 hommes et 14 femmes au total. Une liste en deux colonnes (hommes/femmes) simplifie le processus, et la première personne non élue d’un genre devient remplaçante.
La mise en place d’un scrutin proportionnel modifie en profondeur la dynamique démocratique et la manière dont les partis exercent le pouvoir en obligeant les formations politiques à passer des alliances post-électorales et en n’étant plus prisonnières des accords passés avant l’élection.
Elle tend d’abord à renforcer l’adhésion des citoyens aux institutions : les électeurs ont davantage le sentiment que leur voix compte, puisque les résultats obtenus se traduisent plus fidèlement en sièges. Cette perception se traduit par une plus grande satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie et par des élus perçus comme plus attentifs aux attentes de leurs électeurs. Elle favorise aussi une meilleure acceptation des politiques publiques, d’autant que celles-ci s’inscrivent souvent dans la durée. Les alternances sont moins brutales car les coalitions de gouvernement s’appuient sur des alliances larges et relativement stables ; les partis participant successivement à plusieurs gouvernements veillent à assurer la continuité des choix collectifs.
À l’inverse, le scrutin majoritaire peut produire des majorités massives reposant sur une base électorale réduite. En 2017, la majorité LREM-Modem a ainsi obtenu plus de 60 % des sièges de l’Assemblée nationale alors qu’elle n’avait rassemblé qu’à peine 19 % des électeurs inscrits au second tour. Le mécanisme repose largement sur des effets de démobilisation et de distorsion du rapport de force, permettant de gouverner avec l’appui effectif de moins de deux citoyens sur dix. Avec la proportionnelle, la formation d’une coalition suppose au contraire de convaincre une base électorale bien plus large. Les électeurs peuvent donc plus difficilement considérer que les politiques menées leur sont étrangères, ce qui favorise une relation plus stable et moins conflictuelle entre gouvernés et gouvernants.
Contrairement à une idée répandue en France, la proportionnelle ne réduit pas la liberté de choix de l’électeur. Les citoyens savent qu’aucun programme ne sera appliqué intégralement et qu’un compromis postélectoral est nécessaire, mais ils ne s’estiment pas pour autant floués. Les coalitions qui se succèdent sont souvent durables, ce qui stabilise les orientations programmatiques des partis et rend les clivages plus lisibles. Dans la phase de négociation, chaque parti doit rester fidèle aux priorités de son électorat sous peine d’être sanctionné lors du scrutin suivant. Cette responsabilisation contribue à la crédibilité des partis et renforce la confiance des électeurs dans le processus démocratique. Le scrutin majoritaire fonctionne différemment : il impose des alliances avant l’élection, ce qui rigidifie le jeu politique. Une fois élu dans le cadre d’un accord, un candidat dispose de peu de marge pour s’en détacher, sous peine de fragiliser sa légitimité. Et lorsque les alliances nouées en amont ne suffisent pas à dégager une majorité absolue, le système devient paradoxalement instable car il rend les compromis postélectoraux plus difficiles et plus coûteux politiquement. C’est exactement la situation que nous vivons et qui nous impose aujourd’hui de penser un nouveau mode de scrutin.
| Caractéristiques | Modèle allemand | Modèle Weill-Raynal | Modèle proposé |
| Mode de scrutin majoritaire | Uninominal à 1 tour (Erststimme) | Uninominal à 1 tour | Uninominal à 2 tours (347 sièges) |
| Part de proportionnelle | 50 % des sièges (listes régionales) | Environ 40 % des sièges | 40 % (230 sièges sur liste nationale) |
| Base de la compensation | Listes régionales (Zweitstimme) | Repêchage des « meilleurs perdants » | Liste nationale |
| Seuil électoral | 5 % national (naguère clause dérogatoire si 3 élus directs) | 5 % national | 4 % national (clause dérogatoire si 5 élus directs) |
| Gestion des excédents (overhang) | Naguère, sièges supplémentaires puis compensatoires (Ausgleichsmandate) | Non applicable (pas d’overhang prévu) | Non applicable (pas d’overhang prévu) |
| Rôle des partis | Forte maîtrise des partis via listes fermées | Moindre maîtrise des partis (repêchage individuel) | Maîtrise partielle (listes fermées, mais possibilité de se présenter juste au majoritaire) |
| Équilibre territorial | Partiel : déséquilibrée par petites listes régionales dans les petits Länder. | Faible : représentation faussée par repêchage dans certaines circonscriptions | Assez élevé : ancrage rééquilibré par liste nationale |