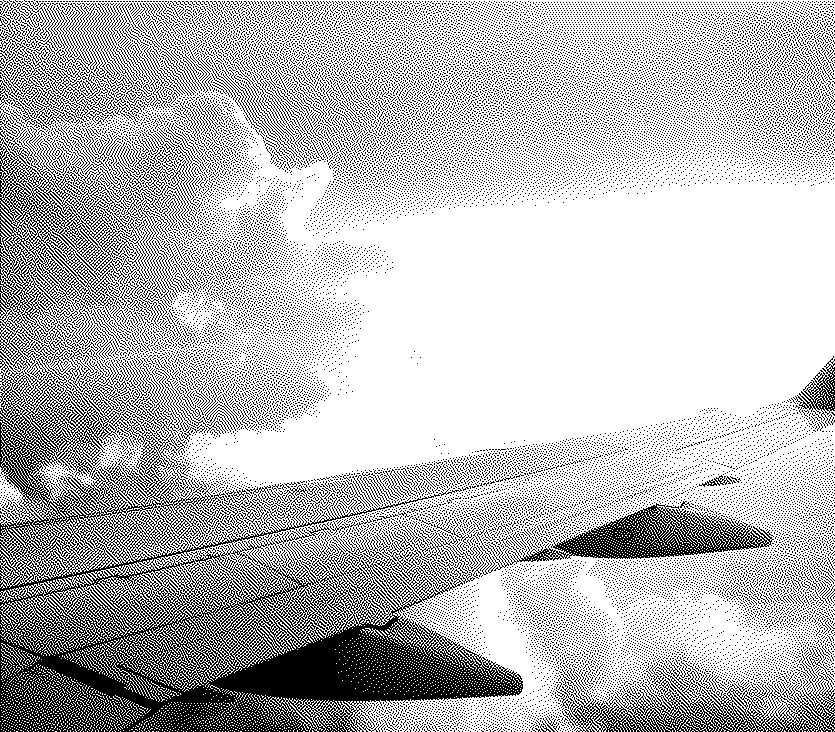« L’Afrique, Mère de l’Humanité. Lumière sur les cœurs qui battent. Douce pénombre sur le cercle resserré de nos vies. Tes enfants veulent partir, tes enfants veulent rentrer, tes enfants veulent rester. Se blottir en position fœtale dans ta silhouette en ailes et en racines. » Amzat Boukari Yabara1
Nous sommes en 2019. Je vis en France depuis deux ans et patauge au milieu d’une marre boueuse de déboires administratifs qui se soldera par une OQTF2. J’envisage donc sérieusement un retour au pays. Décision dont je fais part à une de mes grandes amies qui évidemment m’en dissuade. Elle est Béninoise et devait résider à l’époque en France depuis cinq ans déjà. Je dis « évidemment » à dessein parce que, dans nos cercles d’immigrés africains, il n’est pas concevable d’envisager ce retour au pays, surtout si peu de temps après avoir réussi, souvent au prix de nombreux sacrifices, à fouler le sol de la terre promise. Il faut se battre par tous les moyens pour faire annuler une telle décision de la préfecture. S’avouer vaincue en partant serait une grossière erreur.
Aux oreilles de mon amie, qui était à l’époque en poste au sein d’une importante rédaction installée à Paris après avoir décroché son diplôme de journaliste, l’idée du retour sonnait comme une absurdité. Je ne suis habituellement pas dotée d’une grande mémoire mais le souvenir de cet échange qui date à présent de presque six ans reste gravé dans mon esprit parce qu’à l’issue de cette entrevue, j’apprenais un nouveau mot : « épiphénomène ». Après avoir énuméré, dans le but de la convaincre, une liste de personnes ayant concrétisé le même projet que celui que je nourrissais, ma copine me rétorqua que le retour de ces gens que je prenais pour exemple était un épiphénomène. Il ne reflétait donc en rien la tendance majoritaire. Le retour (du moins à court terme) n’était tout simplement pas envisageable.
L’année dernière, en 2023, alors que je déjeunais avec un groupe d’amis chez cette même copine, elle nous annonça son retour imminent et définitif avec son amoureux au Bénin. Que s’est-il donc passé en l’espace de ces quelques années ?
Le sujet du retour en Afrique prend davantage d’ampleur depuis la crise du Covid et quand bien même la France aura échappé au soir du 7 juillet à un basculement historique vers un pouvoir d’extrême droite, le fil politique reste plus que jamais tendu entre les mains des différentes puissances politiques du pays et, de ce fait, fragile. Certains voient dans cet imbroglio politique un signe ultime : il est temps d’abandonner la France aux mains de celles et ceux qui s’érigent en puristes d’une francité, au mieux, révolue et, au pire, fantasmée. Car, si besoin était encore de le préciser, « le vote RN a des cibles. C’est un vote qui vise des gens, une catégorie précise de personnes rarement nommées en tant que telles, dont la désignation générique est : « l’immigration. » » comme le dit Léonora Miano3.
Aussi, contrairement aux convictions répandues chez les farouches partisans de la « repatriation » systématique, tous les immigrés ne viennent pas en France pour y rester. Bien souvent, la frange de cette immigration qui arrive avec la conscience des réalités politiques françaises et qui en a les moyens, dessine, avant même son arrivée, le plan du retour au pays. Dans ces cas-là, de manière générale, le projet se résume à ceci : « On vient chercher ce qui nous paraît utile (diplômes, expériences, opportunités professionnelles, papiers…) et on rentre ». Occasion de rappeler que 84% des flux migratoires ouest-africains s’effectuent à l’échelle régionale intra-africaine et que la migration sud-sud est sept fois plus importante que la migration de l’Afrique de l’Ouest vers le reste du monde4.
Les raisons qui motivent le retour de ceux que l’on nomme volontiers les « repats » en Afrique sont multiples. Le découragement, les obstacles administratifs, la désillusion, l’attractivité du retour, les opportunités, la volonté de participer au développement du pays d’origine… Et même si la décision n’est pas toujours directement liée au contexte politique, bien souvent, ce dernier sous-tend, en première ou dernière instance, la majorité des départs.
Toutefois, ce retour peut-il se décréter sur un coup de ras-le-bol ? Dans Immigration : le grand déni, François Héran rappelle : « Il ne suffit pas, en effet, d’aspirer à émigrer ; encore faut-il avoir les moyens de ses aspirations. »5 La véracité de cette affirmation est tout aussi valable pour le retour. Ne retourne pas au pays qui le veut mais qui le peut.
Le repoussoir du plafond de verre
Mon amie me confiera après l’annonce de son départ au Bénin que l’idée murissait en elle depuis trois ans déjà et que sa décision fut définitive au moment où elle comprit que ses opportunités professionnelles en France, dans son environnement de travail ou un autre, seraient limitées. En effet, il lui aurait été objectivement compliqué d’accéder en France au poste pour lequel elle fut débauchée par le gouvernement béninois. Elle me confia qu’une fois le tour d’horizon de sa profession effectué et la réalité du manque de représentativité à des positions hiérarchiques supérieure observée, la première graine de l’idée du retour fut plantée. A mesure que la perspective de son ascension professionnelle s’amenuisait, elle réalisait qu’elle ne réussirait à briser le plafond de verre qu’à la condition de créer un précédent. Le défi que cela représente pourrait être, pour les plus téméraires, perçu comme une opportunité de dépassement de soi. Mais la réalité est qu’il implique une charge mentale et psychologique conséquente, que la nouvelle génération d’immigrés n’a pas toujours envie d’assumer. « On (ne) dure pas dans (un) mauvais rêve » dit un célèbre adage ivoirien.
Le choix du retour devient parfois celui qui permet d’espérer une réelle ascension sociale, celle que l’on estime mériter du fait (entre autres) des diplômes obtenus. On s’oriente donc vers des pays où l’on est quasiment certain que le diplôme et les expériences cumulés à l’étranger seront à juste titre reconnus, sans être entachés d’un quelconque biais, lié à l’appartenance ethnique ou culturelle. Les diplômes étrangers jouissent dans nos pays (ceux d’Afrique subsaharienne, mais j’imagine, du Nord également) du sort réservé à tout ce qui porte le sceau de l’approbation occidentale. Ils pèsent plus lourds dans le regard des recruteurs, face aux diplômes locaux. Dans un micro-trottoir YouTube6, j’entendais encore récemment une Sénégalaise décrier le favoritisme de certaines entreprises lors du recrutement des salariés ayant des diplômes étrangers (c’est-à-dire occidentaux). Un état de fait qui génère d’ailleurs des complexes et de nombreuses frustrations au sein de la population diplômée locale en recherche d’emploi.
Au-delà du plafond de verre, bien d’autres raisons motivent ce projet. Il est d’ailleurs, à ce stade, utile de mentionner que le degré d’attractivité des pays est variable en fonction d’un faisceau épais de raisons qui peuvent être historiques, géopolitiques (démocratiques), socio-économiques ou culturelles. En Afrique de l’Ouest par exemple, il suffit de comparer le flux des retours en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal ou au Bénin, à celui des retours au Togo, au Burkina-Faso ou au Mali.
« Mes parents ont fait le trajet aller, je fais le choix du trajet retour »
71% de la diaspora africaine souhaite rentrer travailler en Afrique7. 42% des repats8 sont des hommes et 58%, des femmes. Une population qui compte 38% de cadres supérieurs et 32% d’entrepreneurs.9
Parmi les repats, il y a ceux qui sont nés en Afrique, les immigrés de première génération. Ceux-là qui en y retournant, ne font que rentrer chez eux. Et il y a ceux qui sont nés en France, de parents Africains, dont le départ en Afrique représente un retour « dans le bled de papa-maman ». Parfois, ce qui lie ces derniers au sol africain, ce sont des souvenirs tissés par bouts de vacances scolaires. Le retour n’est certes pas vécu de manière identique pour ces deux catégories, mais les raisons qui le motivent souvent se rejoignent.
L’envie de raviver la mémoire de racines qui, dans le sol français, peinent à s’épanouir. L’envie de se construire un avenir dans un espace où l’on considère que « tout reste à inventer ». L’envie existentielle de se sentir utile, en apportant son expérience et son expertise à des pays que l’on estime en manquer. L’envie aussi de prendre part au boom économique en cours dans ces pays, nouveaux eldorados entrepreneuriaux, nouvelles villes de réussites parfois fulgurantes, qui suscitent donc de nombreuses convoitises.
Dans un article traitant du sujet de la nouvelle génération d’émigrés et d’enfants de la diaspora qui souhaitent « échapper à l’individualisme occidental et créer des communautés dans leur pays d’origine », une productrice, Sally Ghaly, témoigne : « d’un point de vue créatif, commercial et culturel, il était tout à fait logique de s’installer ici. J’encourage vivement les personnes qui envisagent de quitter l’Europe et l’Amérique du Nord à s’installer ici ». Née et élevée au Canada, elle a vécu en Corée et en Allemagne avant de choisir de s’installer à Marrakech. Outre la production, elle a fondé une agence organisant des rencontres ou des séminaires pour des femmes créatives, qui met en lumière des artistes nord-africains. Des parcours similaires à celui de Sally sont de plus en plus racontés dans divers médias.
Effectuer en sens inverse le voyage qu’avaient fait les parents, en décidant au tout début ou en plein milieu d’une vie professionnelle (parfois florissante) de rentrer au pays, représente aussi parfois une rupture avec les précédentes générations. Ces derniers, pour la plupart, ne sautaient le pas qu’une fois l’heure de la retraite sonnée. L’image de l’Afrique, qui représentait auparavant pour une partie de la diaspora la terre des vieux jours, s’est donc désormais mutée en celle d’une terre de dynamisme, d’émulation et de vitalité.
En filigrane de la décision du retour, se dessine la plupart du temps, explicitement ou non, une motivation politique, résonnant avec l’héritage garveyen10 qui met au défi la diaspora africaine de « retourner chez soi, pour décider de ce que serait la maison des ancêtres : soit un royaume, soit la risée du monde. »11 Dans le choix de la destination du retour, cet aspect explique la vision souvent panafricaine qui s’exprime à travers la priorité donnée aux opportunités économiques sur l’attachement au pays d’origine. En d’autres termes, « retourner chez soi » veut dire retourner en Afrique, quel que soit le pays dans lequel on décide de s’établir.
Une fois la question de la nature des motivations élucidée, celle de la gestion du retour se pose. Comment passe-t-on du statut d’immigré à celui de repat ? Une fois de retour, comment s’adapte-t-on à cet environnement qui, faisant l’objet de mutations perpétuelles et importantes, a rarement le même visage que celui que l’on a autrefois connu ?
Vie de repat, vie d’équilibriste
Visualisez le passeport français, européen ou américain, selon le pays de résidence, comme étant un filet de sécurité, celui qui permet d’effectuer dans une quasi sérénité, le grand saut du retour au pays. Ceci est une vérité quasi indiscutable au sein de la communauté d’immigrés africains ; retourner ou rentrer au pays sans avoir été naturalisé est un faux pas à éviter. Sans avoir de chiffres officiels, si je me réfère aux mouvements en cours dans mon entourage proche, je peux affirmer que la majorité des retours au pays concerne des personnes ayant la nationalité française. Des exceptions existent, certes, mais la grande majorité s’inscrit dans ce schéma.
Pendant les échanges avec mon amie rentrée au Bénin, elle me confiait que la décision de son retour fut facilitée par l’obtention des papiers français. En effet, contrairement à nos passeports (le mien, en l’occurrence togolais), le passeport français est synonyme d’ouverture du champ des possibles, il amplifie les possibilités d’accès au monde. Évoluant dans un monde inégalitaire où tous les passeports ne se valent pas, mon amie me confiait combien la nationalité française l’a paradoxalement ouverte à des opportunités internationales, y compris dans son pays, le Bénin. Sans rappeler à nouveau combien les diplômes et expériences professionnelles à l’étranger (c-à-d occidentaux) pèsent lourd dans la balance des RH africains lors des recrutements. Pour espérer légitimement accéder à des opportunités au Royaume-Uni aux États-Unis au Canada ou au Bénin, le passeport occidental reste indéniablement un accélérateur. Sans compter le fait que la naturalisation accorde une meilleure fluidité de mouvement. Les porteurs de passeports occidentaux comprendront mieux que quiconque que l’on appréhende différemment le monde lorsque l’on sait pouvoir s’y mouvoir sans restriction. Je suis tentée d’affirmer que, pour certains, la raison qui motive l’émigration d’Afrique n’est pas nécessairement celui de s’établir indéfiniment en occident. C’est celui d’aller à la recherche des meilleures clés pour s’ouvrir les portes du monde.
Une fois les papiers obtenus, et le projet du retour concrétisé, démarre pour le repat un numéro d’équilibriste afin de réussir à tenir debout sur les deux jambes que sont finalement le pays de départ et celui de l’arrivée.
Un an avant mon départ pour la France, j’ai travaillé pour une marque togolaise de liqueur artisanale dérivée du vin de palme traditionnel. Le concept à l’époque novateur de la marque était de produire diverses variantes de cette liqueur, aromatisées aux fruits locaux. Avec son fondateur, un repat Serbo-Togolais, nous étions amenés à exposer ces produits sur divers marchés et foires, au gré desquels je me suis familiarisée avec un groupe d’entrepreneurs aux profils semblables à celui de mon ex-employeur. Ils étaient créateurs de marques de vêtements, designers de mode, pâtissiers ; des métiers qu’ils étaient revenus (de France pour certains, des États-Unis ou du Canada pour d’autres) exercer au Togo.
Bien qu’elles aient été créées au Togo, y tournent et y évoluent, ces entreprises portaient en elles l’empreinte de l’âme des pays où leurs fondateurs avaient vécu. Les cultures d’entreprise qui s’y pratiquent se démarquaient donc de celles des entreprises locales, preuve de l’hybridité liée à leur statut de repat. De la gestion des ressources humaines ou celle du salaire, jusqu’au respect scrupuleux des droits des salariés, mon expérience au sein de cet écosystème fut positive. Pourtant, un chef d’entreprise exhortait une foule de jeunes lors d’une master class dédiée au retour en Afrique. « Ne transportez pas l’Europe en Afrique ». Il prévenait le public contre un écueil dans lequel les repats tombaient souvent facilement : celui de calquer sur le continent les connaissances, habitudes, expériences acquises à l’extérieur de l’Afrique. Technique qui, pour certains, se solde par de la désillusion. En cause : le manque de connaissance du continent souvent, le manque d’humilité parfois et la déconnexion des réalités socio-culturelles et administratives africaines. Selma Derwish, personnage principale du film Un divan à Tunis12, fera les frais de ce décalage, en découvrant qu’il lui manquait une autorisation administrative de pratique, indispensable pour continuer d’exercer son métier, alors qu’elle commençait à peine à trouver ses marques dans la gestion du cabinet de psychanalyse ouvert dans la banlieue tunisienne où elle s’est installée après avoir exercé en France.
Le projet du retour implique une gymnastique complexe, il nécessite des aptitudes de maturité, de souplesse et de dextérité que les plus avertis s’attèlent à cultiver bien avant le départ. Certains réussissent tout de même à trouver leur équilibre en tirant le meilleur de la bi-culturalité qui résulte de fait de leur statut de repat.
Jusqu’ici, nous avons fait cas de ceux qui, ayant les moyens de sauter le pas, réalisaient tant bien que mal leur projet de retour. Cette catégorie n’est pourtant pas représentative de la totalité de la population immigrée.
Partir, une décision à la portée de tous ?
Qu’en est-il donc de ceux qui, pour une multitude de raisons, ne peuvent répondre à l’appel des racines et n’ont d’autres choix que de rester en terre d’accueil ?
Ceux dont les noms de famille ne garantissent pas un toit et un emploi confortables au pays ? Parce que, croyez-le ou non, il existe des pays où les recrutements se font au « militomètre »13 et non au talent.
Qu’en est-il de ceux dont les diplômes et expériences ne permettent pas d’espérer être classés en tête de liste lors des recrutements en Afrique ? Ceux-là à qui l’idée du retour n’effleurerait pas l’esprit parce qu’un retour reviendrait à trahir l’espoir de toute une famille ?
Ceux qui au fil des ans, des amitiés et des amours ont fait le choix, tout à fait légitime, d’établir leur vie ailleurs qu’en Afrique ?
Qu’en est-il des sans-papiers qui, du fait de leur statut administratif, ne peuvent bénéficier de cette même naturalisation, qui, nous l’aurons compris, demeure une condition du retour apaisé ? Quand bien même la reverse migration14 aura passé l’étape de l’épiphénomène, elle reste loin d’être une évidence pour l’entièreté de la diaspora africaine.
Enfin, au-delà des discours, des souhaits et motivations qui animent chacun, le projet du retour en Afrique ne peut se concrétiser dans le cadre d’un prêt à penser garni de prescriptions magiques.
La discussion avec mon amie rentrée au Bénin s’était achevée sur ces mots : « la décision du retour n’est pas une décision rationnelle parce que, si nous prenons les choses de manière objective, le contexte peut être rude. Cette décision vient forcément du cœur, c’est un appel. Il y aura toujours une raison de ne pas rentrer (le confort occidental auquel on s’habitue, entre autres). Il y aura aussi plein de raisons de rentrer. Il faut juste veiller à partir au bon moment. Ne pas partir trop tôt ni trop tard. Je suis de plus en plus persuadée que le retour est avant tout une décision personnelle, de cœur, d’âme, de ventre ».