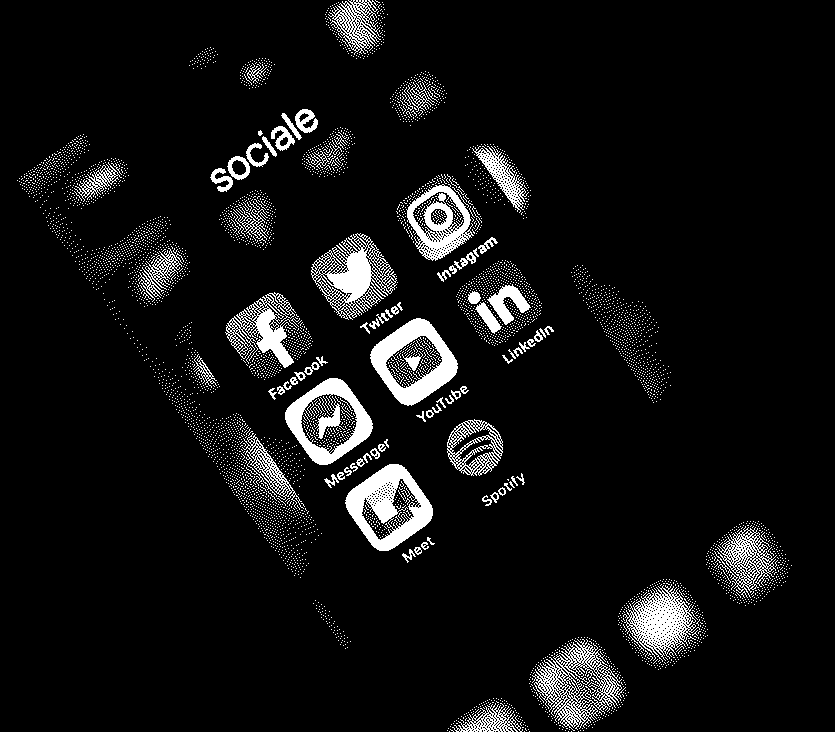L’illusion d’évidence
« Papa, comment on faisait pour aller sur internet avant l’invention des ordinateurs ? ». Cette innocente provocation, attribuée par un scientifique à sa fille, illustre en partie l’attitude générale de notre société face à des transformations médiatiques sans précédent. Bien au-delà même du technopouvoir annoncé par Foucault1, les technologies médiatiques numériques ont colonisé la totalité des activités humaines. Mais elles s’accompagnent surtout d’une illusion d’évidence qui décuple leurs effets. Elles sont tellement coextensives de nos existences qu’elles nous donnent l’impression d’avoir toujours été là. Leur adoption massive suffit à les « naturaliser », et nous pousse à les utiliser sans les questionner.
En réalité, la technologie numérique conditionne nos comportements médiatiques, par ses multiples affordances. Concept développé par le psychologue James Gibson2, les « affordances » désignent les schémas d’action, les cadrages des usages, contenus dans les objets, qui nous offrent ainsi des possibilités, mais qui « plient » nos usages et les déterminent. Le marteau nous sert, tout autant qu’il nous « plie » aux scénarios d’usage qu’il contient. Il en va de même pour les fonctionnalités des médias numériques, telles que les boutons d’action, zones cliquables, fonctionnalités sociales de notation, de partage, etc. Elles nous « permettent » (au sens anglo-saxon de enable), autant qu’elles nous contraignent et nous programment. C’est par ces affordances que nous sommes devenus, à notre insu, des « agents médiatiques »3. L’infrastructure technomédiatique a créé des salles de rédaction et de production en accès libre. Chacun d’entre nous peut s’y installer pour produire, éditorialiser, faire circuler et évaluer, grâce à une « technologie sociale », des contenus de toute nature (clashs politiques, bandes annonces, contenus d’influenceurs, vidéos d’utilisateurs…). Ce faisant, et à bas bruit, nous sommes les agents médiatiques dont dépend le fonctionnement et la création de valeur des plateformes numériques.
La sémiotique, discipline qui étudie les systèmes de signification, peut nous aider à mieux comprendre ce qui se joue dans nos existences médiatiques, notamment dans l’articulation entre la couche immatérielle du numérique qui « calcule » et les formes médiatiques perceptibles avec lesquelles nous interagissons. Voyons quel regard la sémiotique peut porter sur certaines de ces transformations en cours, et faire de nous pourquoi pas, plus que des utilisateurs, des sujets médiatiques conscients et éclairés.
De la métaphore spatiale à la transcendance du centre
Le monde digital est d’abord et souvent vu comme une technologie. Mais il est très important, on l’a vu, d’analyser la couche sémiotique et les dispositifs signifiants qu’il rend possible via les réseaux, les machines et les logiciels. En particulier, son histoire relève de procédés de figuration, singulièrement la spatialisation, qui sont déterminants.
L’Internet a d‘abord été un espace à conquérir. Longtemps a prévalu à son propos une métaphore spatiale, alors-même que le numérique est un dispositif qui génère une couche de sens immatérielle, à partir d‘infrastructures qui, elles, ne le sont pas. Le « surf » ou la « navigation », l’idée d’aller « sur » Internet faisait de nous des voyageurs certes virtuels mais invités à se déplacer dans l’espace des signes et des savoirs. Netscape Navigator, le logiciel de navigation des années 1990 avait pour emblème une barre de bateau puis l’horizon. Il s’agissait à la fois d’une utopie (celle d’un monde « ouvert », sans frontières) et d’une atopie car le numérique se désignait comme un espace mais sans lieu. Ce premier moment, autant dire la préhistoire, se prolonge aujourd’hui avec le Métavers qui fait resurgir l’hypothèse Second Life des années 2000. Pourtant, il semble bien que le monde digital se soit depuis orienté très différemment. Il est passé en 25 ans d’une spatialité à conquérir à une place, une centralité, faisant de chacun de nous non pas des aventuriers de la circonférence mais les occupants d’un point central occupé simultanément par tous. Le passage du « search » aux réseaux sociaux, l’avènement des supports mobiles, les algorithmes de personnalisation, la géolocalisation, tout nous confère une place centrale, au moins sur le plan imaginaire, celui que Lacan définit comme une image démultipliée de nous-mêmes qui nous identifie. Nos multiples profils, la diffraction de notre moi numérique, l’incroyable sophistication de l’affordance (façon dont un objet ou un outil génère son propre usage) des applications qu’on nous propose, nous place dans une position centrale de toute-puissance apparente où nous évaluons, choisissons, excluons, ordonnons les informations. Le digital contemporain nous permet d’occuper ce lieu panoptique foucaldien qui dispose le monde autour de nous. Le numérique se caractérise par la masse des données accessibles immédiatement, donc l’hyperchoix proposé que cela constitue, mais aussi par le sentiment conféré à chaque utilisateur d’en être le centre névralgique. L’ancienne définition4 de Dieu, un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, convient bien à ce nouvel imaginaire digital où tout concourt à mettre le sujet au milieu pour lui donner une impression de force. Prothèse du moi et dernier avatar de l’individualisation, ce renversement de la navigation à la centralité apparaît toutefois comme un marché de dupes. Si tous les utilisateurs occupent simultanément cette position centrale, c’est qu’elle est bien sûr largement factice, un effet « sujet » séduisant mais par lequel nous sommes instrumentalisés. Ce sont bien les algorithmes qui nous calculent sans cesse et qui tirent les ficelles, tels un Dieu caché, suscitant cette expérience ombilicale de centralité et d’ordonnancement du monde autour de soi pour mieux capter nos données, notre attention ou nos productions. Cette sorte d’hypercompétence dont le sujet digital est doté, se paie du prix de son objectivation par les algorithmes, cette intelligence du réseau qui fait de chaque nœud un centre pour celui qui l’occupe. L’addiction au smartphone, la défaite de l’interlocution au profit du clash, le repli identitaire, l’ensemble des maux que les réseaux sociaux semblent favoriser, proviennent en partie de ce renversement de l’espace réticulaire en autant de tours de guet occupées par le Moi digital.
L’évaluation
Voir, liker, partager, tweeter, noter, commenter… *toutes ces fonctionnalités qui régissent notre activité médiatique « sociale » nous ont fait entrer dans une société de l’évaluation. Constamment, et à tour de rôle, nous évaluons (un restaurant, un artiste, une marque, etc.), nous sommes évalués, et nous évaluons les évaluateurs5. Autant d’actes évaluatifs individuels qui s’agrègent dans un jugement collectif quantifié par l’algorithme, couche invisible de la substance numérique et de la « calculabilité » de notre activité sociale6. Cette généralisation des pratiques appréciatives dans le monde numérique, aujourd’hui totalement banalisée, assume une fonction capitale. Pour faire face à l’hyper proposition du numérique et aux microdécisions qu’il nous impose en permanence, nous sommes placés face à une double injonction : demander l’opinion des autres, et donner notre avis. Les formats d’évaluation qui parsèment nos parcours, répondent à cette double injonction et l’alimentent. Et la forme sémiotique donnée à ces affordances d’évaluation joue un rôle déterminant. Qu’il s’agisse de formes binaires comme le like et le dislike de Facebook, ou de formes scalaires comme les étoiles (Allociné, Amazon) ou les points (Trip Advisor), ils mettent en scène visuellement une micro-dramaturgie de la sanction, qui oriente l’utilisateur et l’incite à juger. Une sorte de syntaxe évaluative s’est installée comme une norme : elle combine le contenu médiatique avec des exposants quantifiés qui viennent moduler ce contenu par le jugement qu’ils expriment, ne serait-ce que par la sanction quantitative portée sur l’intérêt que ce contenu a suscité. On a là la base d’une grammaire sociale, qui s’est diffusée et « naturalisée » dans les usages. La quantification de cette grammaire sociale produit des effets de sens très puissants.
Ces exposants quantifiés rendent visibles un processus d’accumulation continu et ouvert. Ces valeurs numériques ne peuvent qu’augmenter, créant ce qu’on peut appeler un « effet d’enrôlement », c’est-à-dire une incitation à rejoindre l’orientation collective dominante. Il fait écho aux dynamiques sociales de la notation, qui montrent que plus il y a de contributeurs, plus la propension de participer à son tour est grande7. Ainsi, ces formats de quantification ne se bornent pas à être les simples marqueurs de nos jugements éphémères. En réalité, ils donnent une forme à l’opinion publique numérique et rendent visible sa dynamique. En outre, la généralisation de ces pratiques a fait naître une véritable économie de l’évaluation, puisqu’on accorde son attention d’abord aux évaluations sur un objet (bien, service, contenu artistique, etc.), avant l’objet lui-même. Le discours évaluatif devient une source de valeur, que l’on « consomme » comme un bien ou un service en soi, et qui constitue un opérateur central dans la gestion de la valeur économique, comme l’atteste l’industrie hôtelière et touristique.
Le tiers lecteur
Cette « technologie sociale » de l’évaluation a des implications sans précédent, non seulement du point de vue de l’histoire des médias, mais aussi du point de vue des pratiques de réception d’un texte ou d’un document. L’omniprésence de ces marques de jugement mises en scène fait apparaître un tiers lecteur à l’emprise grandissante. Que l’on consulte un blog, un contenu sur une plateforme, un média en ligne, les contenus auxquels on est exposé ont déjà été consultés, évalués et classés par ce tiers lecteur, c’est-à-dire par ce sujet collectif formalisé par l’algorithme. C’est donc le rapport entre un contenu quel qu’il soit et son lecteur qui se trouve modifié. Car la réception et la découverte d’un contenu (opinion, information, création, etc.) s’effectue désormais à travers le filtre des jugements de tiers qui nous ont précédé, et qui sont mis en signes. L’acte de lecture, autrefois fondé sur le colloque singulier, est reconfiguré par cette médiation du tiers lecteur qui oriente inévitablement la lecture en mettant en scène la « première » réception : « 83% sont d’accord avec cet article ». À l’inverse, l’absence de marques du tiers lecteur dans les formats natifs du média prévus à cet effet, constitue une forme de sanction négative en creux, qui oriente également la réception. Qui peut affirmer que l’absence de commentaires ou de marques d’adhésion (likes) à un post n’influence en rien son intention de lire ou son appréciation du contenu ?
Cette présence permanente de l’opinion publique numérique rend difficile et rare l’accès « pur » au contenu dès lors qu’il est médiatisé. Et voici que resurgit le paradoxe de la société de l’évaluation : l’injonction à se forger et à formuler un avis personnel sur tout, alors qu’on est d’abord et constamment confronté à l’avis d’autrui. Ces marques du tiers lecteur, insérées dans la substance même du média et dans sa forme, ont des conséquences qu’on peine encore à mesurer sur les processus cognitifs d’interprétation d’un contenu médiatisé. Comment anticiper aujourd’hui les effets de cette relation triangulaire notamment sur les jeunes enfants dans leur apprentissage de la lecture et de réception d’un texte ? L’acquisition de l’esprit critique doit désormais se construire à partir de la condition médiatique contemporaine : plus jamais seul.
La variation
Comme l’avait bien expliqué Lev Manovich dans son analyse désormais classique des nouveaux médias, il existe une relation de solidarité étroite entre la technologie numérique et les contenus culturels et idéologiques du média internet8. Autrement dit, ce qu’on appelle la culture numérique au sens large, est conditionnée par des déterminations techniques que l’on tend parfois à oublier, tant elles sont recouvertes par la couche des usages qui banalisent.
Une des caractéristiques d’internet consiste dans la possibilité, pour n’importe quel utilisateur, d’intervenir sur la matérialité technique d’un objet numérique (en insérant un fichier vidéo, du texte, de l’image), pour peu qu’il possède des connaissances de base. En vertu de ce que Manovich nomme le principe de modularité9, on peut modifier certaines parties variables d’un objet numérique sans changer l’objet dans son ensemble. Ce principe sous-tend nombre de nos usages numériques, et certaines formes communicationnelles massives, qui relèvent du régime de la variation. C’est ce qu’illustre le phénomène des séries de mèmes ou de défis (appelés challenges) sur les plateformes sociales. Un même se forme à partir d’une séquence initiale qui peut être une photo, une vidéo, un texte qui présente un potentiel de détournement et de parodie qui va lui confère une capacité de circulation et de reprise à grande échelle10. La séquence initiale va non seulement circuler, mais aussi subir des transformations produites par les internautes à partir de variantes individuelles, rendues possibles par le principe de modularité. En modifiant le texte, le mode de cadrage ou en insérant un élément visuel différent, les utilisateurs produisent une série de variations du même motif, qui constitue une « forme collective circulante ». On peut citer l’exemple fameux du clip de l’artiste américain Lil Nas, à l’origine d’une série de deux millions six cent mille variations sur TikTok11.
Ces formes communicationnelles fondées sur la variation viennent concurrencer le régime de la narration comme modèle dominant de la communication de masse. L’injonction à la narration s’est longtemps imposée comme la forme matricielle du récit collectif, qu’il soit politique, médiatique ou économique. La domination du story-telling dans un grand nombre de pratiques12 ainsi que la diffusion des fictions sérielles de masse lui ont donné une vigueur renouvelée. Le régime de la variation, propre à la culture numérique, offre une vision du sens attractive qui met en crise les modèles traditionnels narratifs : absence de progression dans le récit (mais plutôt un effet de piétinement), absence de finalité (on ne poursuit pas d’objectif), et une multitude de contributeurs formant un collectif spontané et éphémère, au lieu d’une source identifiée qui contrôle son récit. Mais plus largement, on retrouve aussi le principe de variabilité dans la version, comme modèle opératoire qui est au cœur de la culture numérique. La technologie informatique a « naturalisé » dans nos pratiques l’idée que tout objet développé à partir d’un processus numérique (un document, un concept produit, une œuvre musicale, etc.) est « versionnable », c’est-à-dire qu’il peut engendrer différentes versions en conservant la même structure d’ensemble, et ceci grâce à l’architexte13 qui permet de le générer, qui prend généralement la forme d’un outil logiciel. À ce titre, la « V12 » d’un document de travail est l’exact point de rencontre entre une technologie et une culture, associant ouverture collaborative et perfectivité.
La visualité médiatique
Comment voyons-nous les choses ? C’est la question qui est posée, au sens propre et figuré, par les transformations de notre écologie médiatique. Les plateformes et les pratiques qu’elles engendrent, sous la pression de l’économie de l’attention, modifient notre regard. Elles instaurent un nouveau régime de visualité médiatique, fondé sur une économie du visible et de la visibilité. Notre expérience médiatique quotidienne est dominée par le « flux visuel continu », qui produit plusieurs bouleversements. En consultant nos fils sociaux, nous sommes exposés à une succession de séquences médiatiques hétérogènes : vidéos d’utilisateurs, contenus sponsorisés, extraits de débat ou de séquence d’information produits par un média, etc. De plus, l’expérience d’un flux continu est renforcée par l’effacement des marques d’énonciation médiatique14, c’est-à-dire les codes et les marques formelles qui permettent à chacun de se repérer dans un média. Ces sont les types de rubriques, les formats et les codes éditoriaux qui établissent les distinctions entre les différentes parties d’un média ainsi que les transitions. Ces éléments formels, qui stabilisent notre consommation médiatique grâce à des repères, tendent à s’effacer dans ce flux hétérogène, laissant place à une sorte d’immédiation, au sens où le cadre du média semble disparaître ou se brouiller. En outre, l’effet de flux visuel est amplifié par la pratique de réception caractéristique de ce nouveau régime médiatique, appelée thumb scrolling (défilement par le pouce), et qui remplace le regard par le « visionnage ». On consacre en moyenne 3 à 7 secondes d’attention à chaque séquence qui défile15. Le flux visuel continu engendre ainsi une attention « flottante », proche de la fascination hypnotique qui tend à « désactiver » le contenu sémantique des séquences qui défilent. Cette attention flottante est en réalité un mécanisme qui se met en place pour résister à la surcharge cognitive de cette surexposition. Le regard interprétatif passe en mode veille et c’est la « vision perceptive » qui domine. Dans cette guerre de l’attention, chaque instance médiatique vise à obtenir une « suspension de l’inattention », pour interrompre le flux et transformer la vision flottante en attention interprétative.
A cela s’ajoute le rôle des marques évaluatives qui encadrent ces contenus, qui, par la sanction de leur valeur de visibilité sociale, les désignent comme « à voir, à regarder ». Dans ce régime médiatique, la quête permanente d’un capital de visibilité se fait au prix d’un remplacement du regard construit qui contemple, par un regard de captation, qui réagit aux sollicitations les plus « visibles ».
Le débat public et son évolution
L’utopie majeure qui va trouver ses limites dans le déploiement des réseaux sociaux est celle de l’espace public. Au départ, Internet a été porteur de la promesse d’une forme de renouvellement démocratique, en particulier à travers la réticularité. Chacun se voyait doté de moyens d’expression inouïs jusque-là. La parole n’était plus le privilège des seuls sachants, des institutions, des représentants. Elle avait vocation à être authentiquent partagée par tous, suscitant l’espoir d’une incarnation de ce « lieu vide »16 qu’est la démocratie comme discussion ouverte et permanente. Pourtant, c’est plutôt l’inverse qui s’est réalisé. La plateformisation du politique17 a favorisé les courants les plus conservateurs. La polémique a remplacé la discussion et dans ce nouveau régime d’expression, le débat, tel qu’il a été théorisé par Habermas n’est plus la norme. Pourquoi cette promesse d’horizontalité a-telle au moins en partie échoué ?
La première hypothèse et sans doute la plus forte et que ce débat universel a un arbitre qui n’est pas la Raison. Le réseau à ses raisons qu’elle ne connait pas. L’amplification et les métriques sociales des plateformes, la recherche maximale de circulation de l’information, la viralisation comme principe, l’économie de l’attention, incitent en effet à découper et à isoler les séquences d’un débat sur la base de sa dimension la plus polémique. N’en ressortent que des extraits hétérogènes réduisant ce débat a une pure forme agonistique, sans qu’il y ait de possibilité de l‘articuler et encore moins de le résoudre. L’accélération et la prolifération des échanges prennent largement le pas sur l’intelligence qu’ils devraient produire. La représentation était au cœur de la démocratie comme moyen de gérer le grand nombre. De fait, le débat était constitutivement représenté, dans les médias, dans le champ du savoir, dans les institutions (les parlements, les assemblés, les lieux du délibératif). Sur les réseaux sociaux, on a cru pouvoir s’abstraire de cette représentation au profit d’une horizontalité largement imaginaire. Là où un débat « représenté » est caractérisé par une unité de temps et de lieu et la possibilité pour chacun de s’exprimer, le débat réticulaire « réel » de tous avec tous et donc souvent de tous contre tous échappe à cette organisation principielle. Il gagne en intensité (polémique) et en étendue (viralité) mais il n’est pas ou très peu organisé mais au contraire sans cesse diffracté, sans véritable opérateur de synthèse. Ces transformations sont mises à profit et exploitées par les politiques et notamment, mais non exclusivement, les mouvements les plus conservateurs, qui y voient un outil et un reflet de leur quête identitaire, du procès fait à la représentation au profit de l’appartenance immédiate.
La seconde hypothèse est celle d’une forme d’illusion produite par la technologie, qui nous paraît au cœur du dispositif. On peut très grossièrement considérer l’émergence des réseaux sociaux comme le croisement des deux pierres angulaires de l’Internet originel : l’e-mail d’une part, renvoyant à la lettre, aux formes de la conversation privée, de l’échange, le Web de l’autre, proposant une publicisation massive et très peu médiée. C’est de cette hybridation que vont naitre les réseaux sociaux qui voudront au fond accomplir cette double promesse, une sorte d’immense conversation, brouillant le privé et le public et oubliant que la conversation, pour ordinaire qu’elle soit, obéit à des règles. Elle n’est possible qu’avec un nombre réduit d’interlocuteurs, elle suppose l’écoute réciproque, elle s’organise comme interaction. L’espace réticulaire, en singeant cette conversation ordinaire, médiée ou non, ne permet plus de construire cet accord minimal qui repose sur une forme de continuité, d’ouverture et d’égalité des places. Ces conditions a priori du débat, chères au néo-kantisme de l’espace public18, disparaissent dans la fragmentation et la circulation de l’opinion. Le Tweet et le Retweet par leur taille (qu’on compte en caractère en non plus en mots !) ne sont que le symptôme aigu de ce phénomène. L’empowerment individuel évoqué plus haut, i.e. la capacité à prendre la parole pour chacun, se renverse en un désordre collectif qui se donne comme un échange sans pouvoir en assurer les conditions d’effectivité. La rencontre entre la conversation et la communication de masse débouche sur l’émergence d’un modèle nouveau de communication hybride qui semble quelquefois ne procéder des deux que pour le pire : l’insulte de masse.
La situation actuelle est donc finalement bien éloignée de l’utopie de la conversation numérique globale positive qui primait au début d’Internet. Cette utopie s’inscrivait dans une chronologie qui faisait passer des conversations interpersonnelles symétriques aux mass media, dissymétriques, unidirectionnels et collectifs pour aboutir à une conversation numérique qui devait être à la fois centrale et bidirectionnelle. Mais ce modèle de conversation s’est effondré sous le poids de sa propre masse et de son impossible modération, la dimension paradigmatique (fragments, variation) l’emportant sur le syntagme (articulation, enchainement monologique ou dialogique, narration, conversation).
Vers une nouvelle médiologie hybride : industries médiatiques et industries médiatisantes
L’émergence des réseaux sociaux ne s’est pas faite sur le vide. Elle s’est greffée sur les médias classiques, dits de masse, descendants, unidirectionnels, en prétendant leur opposer un contrepoint plus horizontal et en les privant par ailleurs de leurs ressources par la captation d’une large partie du revenu publicitaire. La médiologie19 permet de distinguer les « couches » que constituent les différents de médias en notant d’ailleurs que cette évolution fonctionne par accumulation et non substitution. Yves Jeanneret, dans son livre Critique de la trivialité (trivium : carrefour de trois voies), distingue les « industries médiatiques », qui produisent des contenus, et les « industries médiatisantes »20 qui produisent des circulations, sans valeur ajoutée éditoriale, ce qui ne veut pas dire sans impact sur les contenus (cf. supra), uniquement en captant des données. Cette distinction est utile et opératoire.
Pourtant, il nous faut aujourd’hui considérer que le système médiatique constitue un tout, certes hybride, mais où les deux régimes, le médiatique et le médiatisant, ont fusionné. On notera par exemple que l’émergence du phénomène d’hybridation des médias est concomitante à une érosion de la confiance des Français dans ces mêmes médias. Économiquement, ce sont en effet les grands acteurs de l’économie des plateformes ou des réseaux qui se sont appropriés les médias classiques mais surtout l’hybridation est achevée au sens où les réseaux sociaux n’ont pas tué les médias classiques mais les ont largement subsumés. La presse, la radio ou la télévision se sont largement inscrits dans ce nouveau flux que constitue Internet. Leur stratégie ne peut en faire l’économie en termes de visibilité et de diffusion. La télévision par IP, la radio à podcaster ou la presse en ligne sont autant d’exemples qui montrent que l’Internet comme infrastructure est désormais déterminant. Finalement, il y a bien désormais un seul monde médiatique hybride au sein duquel médias médiatiques et médias médiatisants fusionnent et interagissent.
Mais au-delà, les médias « médiatiques » ne peuvent plus exister sans la caisse de résonnance des médias sociaux car c’est l’ensemble des publics qui sont devenus des agents médiatiques au sein de ce qu’on pourrait appeler une économie de la remédiation. De fait, il est possible de considérer les réseaux sociaux comme de vastes salles de rédaction dans lesquelles tous les utilisateurs auraient vocation à faire circuler les contenus, à les évaluer, à les commenter. Les fonctionnalités éditoriales des plateformes, et l’algorithme, permettent à chacun d’être un agent de “re-médiation” de séquences hétérogènes sur les fils sociaux.
Dans cette nouvelle grammaire digitale de l’identité (cf. supra), une métrique de la vanité21 détermine nos productions et nos reproductions, car chacun produit / reproduit en fonction de ce qui lui fait gagner du capital social et participe ainsi de cette économie de la remédiation. Ces deux régimes médiatiques sont entrés en résonnance depuis longtemps, s’influencent réciproquement et se contaminent22. Ainsi les contenus produits sur une chaîne hertzienne sont ensuite fragmentés et sélectionnés pour générer du passage sur les plateformes numériques. Et la notion même de public a donc muté, bien au-delà des logiques d’interprétation, jamais passives, qui lui sont propres. Ce public s’est déplacé des gradins du théâtre à l’orchestra digital qui fait de nous des membres du chœur voir des coryphées, amenés à faire écho ou à prendre la parole en s’avançant sur la scène médiatique23, même si ce pas en avant, on le sait, à un prix que nous payons à l’industrie médiatisante.
Conclusion
Ce panorama médiologique et sémiotique plus que technologique ou politique des réseaux sociaux est plutôt sombre. De fait, cette histoire récente se marque d’un certain nombre de désillusions et du deuil d’une révolution qui a bien eu lieu mais sans forcément produire les effets attendus. Il faut sans doute assumer ces transformations, comprendre leurs effets et proposer en regard des évolutions. Elles devraient autour de deux axes.
Un axe horizontal fondé sur la prise en compte de la notion d’agent médiatique, qui supposerait une éducation, une éthique, une hygiène nouvelle qui passerait par une formation des citoyens à ce nouveau régime médiatique généralisé, par la meilleure maîtrise et la compréhension des réseaux sociaux, des enjeux de circulation et d’éditorialisation, pour dépasser l’affordance par une véritable appropriation de l’outil. L’objectif pourrait être par exemple, grâce à la technologie, le paramétrage, la visualisation, que chacun puisse mieux se représenter la « géographie » d’une plateforme numérique ou d’un réseau social, en figurant mieux sa place au sein d’une territorialité commensurable car aujourd’hui chacun déambule assez largement dans un espace sans carte et sans boussole, en croyant sans cesse en occuper le centre. De fait, il reste un défi sur lequel conclure, celui de l’IA. Cette révolution qui elle aussi s’établit sur les fondations de l’Internet (la constitution d’une banque de données universelle) va-t-elle être aussi déceptive que la précédente en en renforçant les travers ou bien permettra-t-elle, comme opérateur de synthèse capable d’embrasser les méga-corpus, aux acteurs que nous sommes de véritablement se situer dans un espace digital et conversationnel non plus anomique mais enfin situé et circonscrit.
Un axe vertical du côté des institutions et de leurs normes régulatrices, qui devraient proposer une synthèse renouvelée de ces normes en prenant mieux en compte cette nouvelle hybridité et du côté des médias classiques qui ont vocation à domestiquer et à faire fonctionner leurs réseaux et leurs contenus dans une meilleure synthèse de l’horizontalité (la participation) et de la verticalité (la confiance), de l’accès et la médiation et du côté des plateformes elles-mêmes qui pourraient assumer davantage leur dimension de biens communs et leur responsabilité sociale.