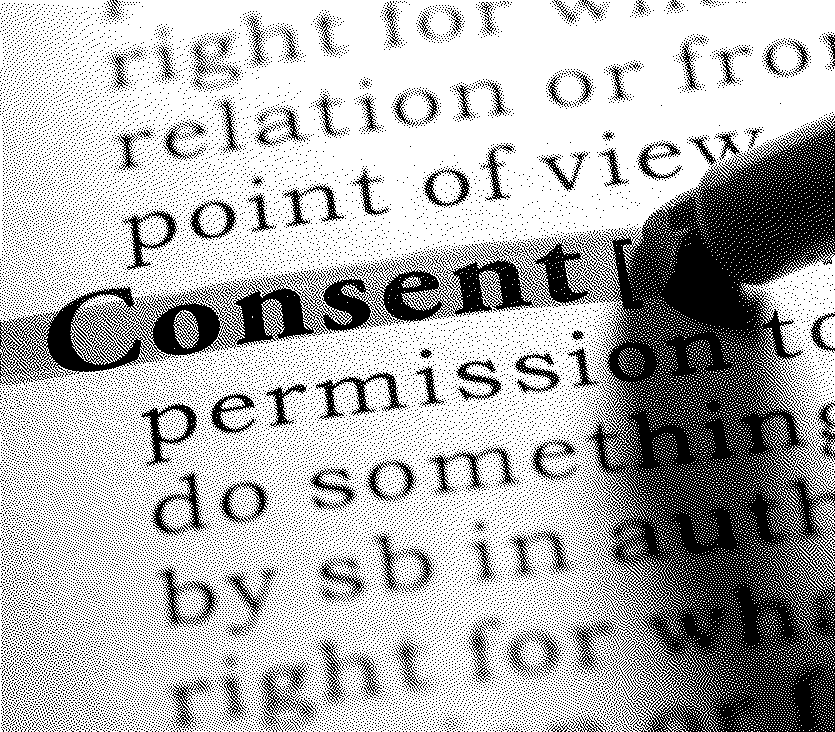Le 1er avril dernier, les députés ont adopté une proposition de loi portant sur une évolution de la définition pénale du viol. Ce texte, transpartisan et soutenu par le Gouvernement, propose d’y intégrer la notion de “consentement”, à l’instar de 12 autres pays européens dont l’Allemagne, l’Espagne ou la Suède et comme le prévoit la Convention d’Istanbul ratifiée par la France en 2014. Le texte, adopté à 161 voix pour et 56 contre propose de définir le viol comme “tout acte sexuel non consenti”, tout en précisant ce qu’est ou n’est pas le consentement : “Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.” Enfin, le texte ajoute « qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise », soit les quatre modalités déjà présentes dans le Code pénal. Alors que le texte sera prochainement discuté au Sénat, il continue de diviser, y compris au sein du camp progressiste : 9 députés socialistes ont voté contre, dénonçant à la fois “l’inutilité” d’un tel ajout, et pointant le risque que cette nouvelle disposition n’en vienne à complexifier la procédure pour les victimes, un argument également soulevé par des associations féministes.
Ce débat s’inscrit dans un contexte inédit de reconnaissance sociale des violences sexuelles. Il n’est donc pas surprenant que se pose alors la question de l’efficacité de leur traitement judiciaire. Celui-ci a de quoi être légitimement interrogé. En effet, il y a bientôt huit ans, le Mouvement #MeToo mettait déjà en évidence le décalage profond entre l’ampleur des violences sexuelles et le faible nombre de condamnations pour viol. Certes, ce constat peut, en partie, s’expliquer par la difficulté persistante des victimes à porter plainte – moins de 1% d’entre elles le font en France – du fait de la longue tradition de dénégation et de relativisation de ces violences, mais les chiffres continuent d’interroger : aujourd’hui encore, plus de 90% des plaintes pour viol en France sont classées sans suite.1 Plus récemment, le retentissement médiatique de l’affaire Pélicot a, de son côté, posé de manière crue et urgente, cette question du consentement. Enfin, la récente affaire dite de Bétharram a, quant à elle, remis en lumière la persistance des sévices sexuels au sein d’institutions catholiques, notamment sur des enfants – en particulier de jeunes garçons. Dans le sillage des travaux de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), présidée par Jean-Marc Sauvé, le cadre légal avait déjà évolué : la loi du 21 avril 2021 a instauré un âge de non-consentement sexuel, qualifiant automatiquement de viol toute relation entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du consentement.
Ce contexte global a contribué à faire évoluer la perception collective : les violences sexuelles ne sont plus uniquement perçues comme des affaires « de femmes » mais comme une question qui engage l’ensemble de la société. Dès lors, si jamais la mobilisation autour de ces violences — et de leur traitement judiciaire — n’avait occupé une place aussi centrale dans le débat public, une question demeure : cette réforme législative constituera-t-elle un véritable tournant pour les victimes, ou bien une mesure avant tout symbolique ?
Personne ne s’y trompe : cette révision, si elle a lieu, ne suffira pas, à elle seule, à transformer en profondeur le traitement judiciaire des violences sexuelles. Le décalage entre l’ampleur des violences et la faiblesse des condamnations s’enracine dans des causes multifactorielles : une tradition lourde de banalisation des violences sexuelles, des représentations sexistes encore profondément ancrées à tous les étages de notre société et, du même coup, un accueil défaillant des plaignant(e)s dans les commissariats, des biais persistants dans les enquêtes préliminaires et une formation insuffisante des magistrats. Ce constat n’invalide toutefois en rien l’intérêt d’une telle réforme.
A ce jour, notre Code Pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »2. Rien n’y est dit de façon explicite sur la présence ou l’absence de consentement. Si l’un ou plusiseurs de ces éléments ne sont pas démontrés, il ne peut y avoir, juridiquement, de viol, même si la personne plaignante n’a jamais consenti. Autrement dit, l’absence de consentement ne suffit pas, à elle seule, à qualifier un viol si aucun des quatre critères précités n’est démontré. Il s’agirait donc, dans cette nouvelle définition, de venir ajouter le critère de consentement, sans que celui-ci ne vienne se substituer aux quatre autres. En quoi la définition, en l’état, est-elle insuffisante, et que viendrait alors apporter l’ajout d’un critère de consentement ?
Pour la juriste Catherine le Magueresse3, si l’on s’en tient au texte, la définition actuellement en vigueur présente une faille centrale : en adoptant le point de vue de l’agresseur sans tenir compte de la subjectivité de la victime, elle part du principe d’un consentement par défaut. Concrètement, contrairement à d’autres infractions comme le vol (ou l’on ne présume jamais que la victime a bien voulu donner son bien), on présume, dans le viol, un consentement par défaut, jusqu’à preuve du contraire. La révision de la loi viendrait donc induire un changement de paradigme bien réel : le consentement ne va pas de soi, et l’absence de refus ne vaut pas accord.
Ce changement de perspective pourrait ainsi rééquilibrer la charge entre la victime et l’agresseur présumé. En effet, bien que la loi française reconnaisse, en théorie, qu’un viol peut être constitué par « surprise », donc sans violence ni contrainte, les pratiques judiciaires continuent souvent de s’appuyer sur des « signes » d’opposition : cris, résistance physique, dépôt de plainte immédiat. Ce n’est pas nécessairement anormal — si la preuve de résistance n’est pas exigée par la loi, elle reste, dans les faits, attendue ou du moins, valorisée. L’introduction du critère explicite de consentement dans la loi permettrait de déplacer la logique de preuve : il ne s’agirait plus seulement pour la victime de démontrer qu’elle a été contrainte ou forcée, mais aussi pour l’auteur présumé de justifier qu’il s’est assuré du consentement de l’autre. Du reste, cette révision de la définition permettrait d’accompagner (et d’entériner) des évolutions jurisprudentielles récentes : les représentations classiques du viol — et leur influence sur les décisions de justice — ont déjà commencé à évoluer. On commence progressivement à reconnaitre qu’une grande majorité des violences sexuelles ne sont pas commises par des inconnus dans l’espace public, mais bien au sein de sphères intimes, comme le rappelle le rapport parlementaire de Sophie Auconie et Marie-Pierre Rixain (2018) qui révélait que 91 % des auteurs de viols ou tentatives de viol sont des proches de la victime et celui de la MIPROF, (45 % des viols sont commis par un conjoint ou un ex-conjoint). Dans ce contexte, la jurisprudence a progressivement intégré les apports de la clinique du traumatisme : elle admet désormais que la sidération, l’emprise ou la paralysie – autant de réactions qui expliquent le silence, l’absence de résistance ou la soumission apparente – peuvent constituer des formes de contrainte ou de surprise. Comme le rappelle Irène Théry, cela a permis de qualifier de viol des actes imposés dans des contextes psychologiques de domination, qui seraient autrefois passés “sous les radars”4. En cela, l’ajout explicite du critère de consentement dans la loi viendrait renforcer et consolider ces évolutions jurisprudentielles. Il s’agirait de traduire, dans le texte même de la loi, une meilleure compréhension des réalités des violences sexuelles et des conséquences psycho traumatiques vécues par les victimes.
Or, c’est ce même argument qui conduit certains opposants à craindre une réforme essentiellement symbolique, une loi d’affichage sans portée réelle, au motif que le droit évoluant déjà dans ses pratiques, sous l’impulsion de la jurisprudence, l’ajout du critère de consentement serait avant tout redondant. Ce n’est toutefois pas la seule objection : ils redoutent également une insécurité au plan juridique : comment prouver une absence de consentement ? Les victimes présumées peuvent mentir, dit-on. Ces objections ne sont pas nouvelles mais elles méritent réponse. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le débat divise également les féministes. Certaines considèrent que la notion de consentement est un leurre, ou un faux allié juridique. C’était d’ailleurs l’un des arguments des députés socialistes ayant voté contre la réforme. C’est également la position de la juriste américaine Catharine Mackinnon, à l’origine de la définition du harcèlement sexuel dans la loi aux Etats-Unis. Dans un livre écrit en français sur la définition du viol5 – et adressé à un public français – elle explique que l’introduction du critère de consentement aurait pour effet de tourner l’investigation vers le comportement de la victime au lieu de se concentrer sur l’attitude de la personne mise en cause. Autrement dit, en insistant sur le consentement, on déplacerait encore le regard vers la victime : a-t-elle dit oui ? A-t-elle dit non ? Son comportement, ses hésitations, ses silences deviendraient alors le centre du procès, piégeant ainsi les plaignant(e)s. Cette approche donnerait du même coup une place dangereuse à la subjectivité des juges dont les décisions sont encore largement influencées par des stéréotypes de genre. Inspirée d’une grille de lecture fondée sur l’intersectionnalité, elle plaide pour une définition intégrant le critère d’inégalité et non de consentement. En effet, Catharine MacKinnon ne considère pas le viol comme un simple « manquement au consentement » mais comme un outil de domination inscrit dans un système social inégalitaire dans lequel des personnes en position dominante (le plus souvent, des hommes) imposent des relations sexuelles à des personnes plus vulnérables (d’autres hommes, des femmes, des enfants) parce qu’ils en ont le pouvoir. Cette conception soulève de grandes difficultés.
La justice, dans un Etat de droit, repose sur un principe fondamental : celui de l’égalité devant la loi. En ce sens, l’introduction d’une lecture juridique des rapports de domination sociale – aussi réels soient-ils – viendraient compromettre sa fonction d’universalité. Il ne s’agit pas ici de faire abstraction des inégalités sociales ni de nier la réalité vécues des victimes – ce qui reviendrait à entretenir un aveuglement complice – mais de rappeler le rôle de chacun : le législateur écrit le cadre, le juge l’interprète dans les cas concrets, et la jurisprudence en affine la portée. C’est à cette condition que le droit peut rester fidèle à ses principes, tout en demeurant ancré dans le réel.
Ensuite, sur le risque que cette réforme ne soit qu’une loi d’affichage, plusieurs arguments peuvent être opposés. D’abord, s’en remettre uniquement à la jurisprudence comme levier de protection des victimes est insuffisant : elle évolue lentement, de manière inégale, et dépend fortement des sensibilités des magistrats. Ensuite, comme le souligne Catherine Le Magueresse, le droit pénal ne sert pas uniquement à juger : il façonne aussi les normes sociales. Si personne n’imagine qu’un changement de loi transformera à lui seul le traitement judiciaire des affaires de viol, on ne peut pas sous-estimer le pouvoir structurant du droit. Le droit fixe un cap : il trace les lignes rouges de ce qui est acceptable ou non dans une société.
À une époque où seules 1 % des victimes portent plainte, et où la majorité des plaintes pour viol sont classées sans suite, inscrire clairement la notion de consentement enverrait un message fort : nul ne peut disposer du corps d’autrui sans son accord explicite. Il s’agirait d’un véritable changement de paradigme, après les combats menés par Gisèle Halimi au procès d’Aix-en-Provence (1978) et la reconnaissance du viol conjugal (1990 puis explicitement en 2006), qui a permis de rompre avec l’idée selon laquelle le mariage impliquerait un droit sexuel automatique. Ces avancées n’ont pas seulement modifié les textes : elles ont transformé le regard social.
Quant à la difficulté de prouver l’absence de consentement, l’argument ne tient pas. Cela n’est pas spécifique aux violences sexuelles. Il existe rarement de preuves absolues, pas plus pour un viol que pour un meurtre ou un vol. Les juges fondent leur conviction sur un faisceau d’indices, de témoignages, d’éléments contextuels. Il en ira de même pour le consentement. Enfin, quant au risque de “glissement vers une contractualisation des relations sexuelles” – ou autrement dit, celui d’une judiciarisation permanente de la sexualité – soulevé par l’ancien Ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti6 lors de son audition début 2024 par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale, on se contentera de rappeler que la relation sexuelle est un acte engageant, qui demande d’être attentif à l’autre et non de lui imposer ses propres projections. Ainsi, la réforme enverrait un signal clair : il n’est plus tolérable, dans notre société, de disposer du corps d’autrui sans son accord.
Mais aussi structurant que soit le pouvoir du droit, la portée réelle d’un changement de loi se fonde sur la capacité des institutions à évoluer pour en soutenir l’application réelle. Ainsi doit-elle s’accompagner d’un renforcement de la formation des professionnels de la justice et des forces de police aux violences sexuelles et à la notion de consentement, de moyens renforcés aux associations d’aide aux victimes, et d’une éducation au consentement dès le plus jeune âge. Le rapport “Prends ma plainte” du collectif Nous Toutes publié en 2021 rapporte sur 3496 témoignages (2019, 2020 et 2021) un taux massif de mauvaise prise en charge des plaintes déposées dans les commissariats français : plaintes refusées, faits banalisés, victimes dissuadées, moqueries, propos sexistes ou encore solidarité implicite avec les agresseurs. Cette tradition persistante de dénégation des violences faites aux femmes, dans laquelle il est encore courant que celles-ci soient rendues responsables de ce qu’elles ont subi (“Comment étiez-vous habillée ?”, “L’avez-vous provoqué ?”) pousse nombre d’entre elles à enfouir leur expérience dans le silence, au prix de lourdes conséquences psychologiques. Ces accueils défaillants affaiblissent non seulement la parole des victimes, mais introduisent aussi un biais dans le traitement judiciaire : si la plainte n’est pas prise au sérieux, l’enquête préliminaire sera lacunaire, et la transmission au parquet défaillante.
En conséquence, un changement de loi ne résoudra pas tout. Une réforme législative, aussi ambitieuse soit-elle, ne suffira pas si elle n’est pas accompagnée de moyens concrets. Sans investissements parallèles de la puissance publique dans la prévention des violences, l’accompagnement des victimes, le travail des forces de l’ordre et des magistrats, le changement restera largement symbolique. Il faut donc penser la justice dans toute sa complexité : la loi écrite, bien sûr, mais aussi la jurisprudence, les habitudes des tribunaux et les dynamiques sociales qui l’entourent. C’est à cette condition que le droit peut réellement protéger.