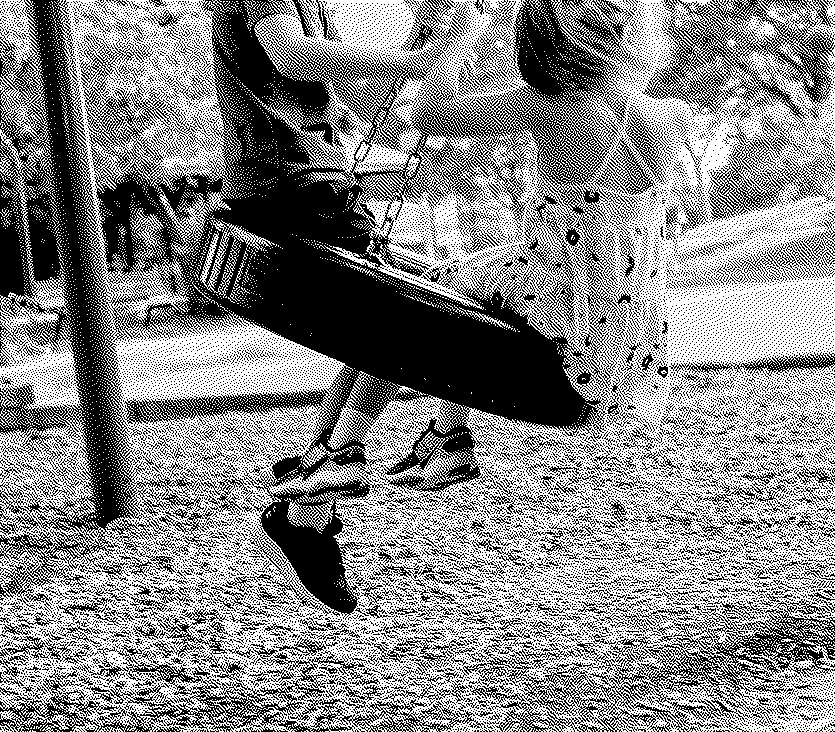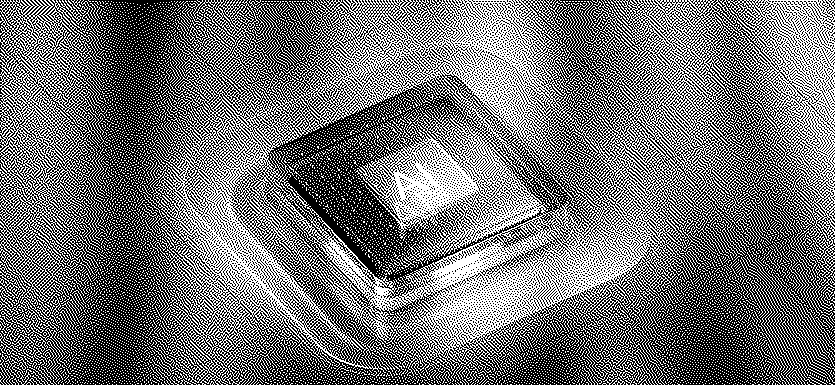Avant de connaître la fin qu’on lui sait, le budget du gouvernement Barnier s’était fait le réceptacle du mécontentement des députés qui, ayant adopté près de 200 amendements au projet de loi de finances, en avaient largement bouleversé l’équilibre financier initial. Parmi ceux-là figurait un amendement qui a divisé la commission des finances avant d’être finalement adopté à 50 voix pour et 46 contre. Déposé par les socialistes, l’amendement prévoyait la défiscalisation de la pension alimentaire pour le parent bénéficiaire alors que celle-ci était jusqu’alors considérée comme un revenu et, à ce titre, soumise à l’impôt sur le revenu.
Le gouvernement Barnier renversé, et le budget avec, l’amendement n’obtiendra finalement pas force de loi : il est absent du budget – désormais adopté – du gouvernement Bayrou.
Pour autant, la question de la charge fiscale des pensions alimentaires mérite d’être posée. Preuve de la prégnance du sujet : une proposition de loi avait déjà été adoptée à l’Assemblée lors de la précédente législature (en 2022) à l’initiative du MoDem. Elle est, depuis lors, au point mort au Sénat où elle n’a jamais été examinée.
Que faut-il en conclure ?
Le sujet du régime fiscal adapté au versement des pensions alimentaires est délicat et doublement idéologique. D’abord parce qu’il est question d’impôt sur un revenu et de (re)distributivité des finances publiques. Ensuite parce qu’il est question des relations femmes-hommes qui sont devenues un sujet de préoccupation majeur dans toutes les familles de sensibilité, bien que les réponses soient manifestement différentes d’un parti à l’autre.
Pour ces questions, seule une étude holistique intégrant un certain nombre de réalités sociales est de nature à proposer la réponse la plus juste possible. C’est dans cette perspective que le rapport de Kenza Tahri évoque les impensés concernant les reconfigurations familiales pour l’État providence. La fiscalisation des pensions alimentaires pour le parent-gardien constitue l’une de ces impasses.
Le versement des pensions alimentaires constitue une obligation légale qui a fait l’objet de réformes successives dans le sens d’une plus juste répartition des charges financières.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (CEEE), appelée couramment « pension alimentaire » est une obligation légale. Elle trouve son origine à l’article 203 du Code civil entré en vigueur en 1804, créant l’obligation alimentaire en ces termes : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Depuis lors, cette contribution emporte une obligation extra-maritale, ayant été étendue par la loi du 4 mars 2002, à tous les parents, quel que soit leur statut conjugal : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. […] ».
Que les parents soient mariés, pacsés, unis, séparés, divorcés ou jamais unis, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants demeure une obligation légale. Malgré un taux de non-versement de la pension alimentaire qui se stabilise à 25% quelques années après la rupture selon la DREES en 2021, le versement de la pension ne présenterait pas de « différence notable selon le type de séparation, divorce ou rupture de Pacs ». Dans sa note, K. Tahri relève toutefois l’influence (trop) importante qu’exercerait le statut conjugal (mariage ou PACS) sur le versement effectif de la pension alimentaire en cas de séparation ; le statut juridique conféré au mariage permettant un versement plus systématique de celle-ci.1 En effet, le versement d’une pension alimentaire n’a rien d’automatique ni, a fortiori, de systématique. Aussi, en cas de divorce ou de rupture de PACS, le montant et le versement de la pension alimentaire étaient souvent fixées par le juge aux affaires familiales après un accord préalable des parents (dans deux tiers des cas)2. Beaucoup de familles ne bénéficiaient pas de cette formalisation après séparation. Par ailleurs, les impayés de pension alimentaire sont plus fréquents lorsque les parents se séparent que lorsqu’ils divorcent.3
L’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) a répondu à une partie de ces biais. A sa création en 2017, l’ARIPA est pensée comme une solution d’intermédiation institutionnelle du versement des pensions alimentaires, notamment en raison des circonstances conflictuelles voire violentes lors de la séparation des parents. Le but est simple : premièrement, permettre une intermédiation financière (le parent débiteur verse le montant de la pension à l’ARIPA, laquelle verse ce même montant au parent-gardien) et ensuite, de lutter contre les impayés (l’ARIPA se substitue au parent débiteur en versant la pension au parent-gardien jusqu’au recouvrement de celle-ci). En 2021, l’ARIPA a ainsi permis le recouvrement de 157M€ d’impayés pour quelques 100 000 familles. De tels chiffres justifient bien la mise en place systématique de l’intermédiation financière dès 2022 et l’automatisation en 2023 des actions de recouvrement de l’ARIPA dès le premier mois de défaut. Ces progrès ont permis de limiter les défauts de paiement et le basculement de nombreuses familles dans la précarité en l’absence de versement des pensions.
La fragilité sociale et financière souvent associée à la situation de parent-gardien plaide pour une défiscalisation des pensions alimentaires.
En France, « l’accroissement du nombre de séparations conjugales » estimées à« environ 425 000 ruptures (divorces, ruptures de PACS ou d’unions libres) qui concernent 380 000 enfants mineurs », induit une hausse corrélative des pensions versées au titre de l’obligation légale susmentionnée.4 Les ressources des foyers avec enfants connaissent souvent un effet-ciseaux face aux coûts habituels ou nouveaux. En particulier, note la DREES5, « pour la moitié des mères qui ont la garde de leur enfant, le niveau de vie baisse d’au moins 20 % l’année de leur séparation.6 Pour les familles monoparentales qui en reçoivent, les pensions alimentaires représentent 18 % de leur revenu fiscal.7 Sans ce versement, la perte de niveau de vie serait plus importante d’au moins 6 points ».8 Pour les familles monoparentales, qui représentent 1 famille française sur 4, et particulièrement sujettes à la pauvreté (40% vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 50% du revenu médian en France, soit 1014€/mois), le revenu tiré du versement des pensions alimentaires est donc crucial chaque mois.
La pension alimentaire moyenne s’élève à 190€ par mois et par enfant. A titre de comparaison, la DREES (2015) estime le coût moyen mensuel d’un enfant de moins de 20 ans à environ 1 500 euros, en incluant à la fois les dépenses des ménages et celles des institutions publiques (éducation, santé, prestations sociales, subventions pour les structures d’accueil, aide sociale à l’enfance, etc.). Parmi ces 1 500 euros, les familles assument directement 37 % du coût, soit environ 555 euros par mois.9 Quoique les pensions alimentaires versées constituent une aide non-négligeable pour les gardiens, force est de constater leur insuffisance. Elles ne comprennent pas un certain nombre de frais annexes car contingents mais tout aussi essentiels à l’entretien de l’enfant (activités extrascolaires, frais d’ophtalmologie, dentaires, etc.). Il peut paraître discutable que soit considérée comme un revenu et fiscalisée une pension qui ne couvre pas à parts proportionnelles l’ensemble des frais engagés par le foyer pour l’enfant.
A l’inverse, en ce qui concerne le parent-débiteur, la rationalité économique invite à penser des modifications du cadre fiscal.
L’IGAS notait en 2021 que les 8,2 Mds€ de pensions alimentaires déclarées versées correspondent à une masse totale d’avantage fiscal de 1,8Mds€. Selon les estimations de la DGFIP, « en retranchant les recettes d’impôts liés à la taxation des pensions déclarées (0,3Mds€) […] la déductibilité fiscale des pensions engendre une perte théorique de recettes fiscales de 1,5Mds€ ».10 De surcroît, la contribution de chaque décile de revenu à cette perte interroge en termes d’équité sociale puisque les 10% de ménages les plus riches qui déclarent verser une pension contribuent à 48,2% de cette perte soit 863M€.
Aujourd’hui, la fiscalisation des pensions alimentaires est certes compensée par les politiques familiales mais elle induit des effets de seuil important.
Historiquement, les politiques familiales françaises ont pour finalité première de compenser les charges financières associées à la présence d’enfants au sein des ménages. Par conséquent, cet effort de compensation permet de soutenir la natalité mesurée en France par l’indice conjoncturel de fécondité (ICF). Le troisième grand résultat que les politiques familiales tentent d’atteindre est la réduction des inégalités et de la pauvreté des familles par le soutien des plus vulnérables d’entre elles. Dans cette perspective, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale structurellement élevée en France (43.5% du PIB en 2023), ne contribue pas directement à réduire les inégalités. L’Insee note ainsi que la réduction des inégalités provient avant tout (50%) des transferts en nature (santé, logement, éducation, etc.) qui sont financés par les prélèvements obligatoires et, dans une seconde et moindre part, par les transferts monétaires (23%) tandis que les prélèvements contribueraient au creusement des inégalités à hauteur de 5%.11
En prenant tout cela en compte, intégrer aux revenus imposables les pensions alimentaires n’est pas juste. Pour le parent-gardien, ces pensions agissent comme une « double-peine ». En « étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu »12, la fiscalisation des pensions alimentaires peut emporter des effets de bord délétères sur l’éligibilité ou le montant de certaines prestations sociales (mais beaucoup moins sur l’imposition du revenu dont les plus modestes ne s’acquittent pas). Ces « incohérences dans la prise en compte des pensions alimentaires par le système sociofiscal » selon le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA)13 sont parfois à l’origine de situations paradoxales où la pension perçue réduit le revenu disponible du parent-gardien.14
Même dans les cas où de tels effets ne sont pas à déplorer, l’écart de charges parentales dédiées à l’enfant persiste entre le parent-débiteur et le parent-gardien à la tête d’une famille monoparentale – et pour lesquelles l’amortissement des charges est le plus élevé.
Il faut se garder de croire que le complément apporté par les politiques familiales change radicalement la donne : le montant moyen de la pension alimentaire versée s’élève à 170€ par mois et par enfant et à 195,85€ augmenté de l’Allocation de Soutien Familial (ASF).15 Concernant cette dernière, il peut arriver que son versement soit même plus favorable que la perception d’une pension ; en revanche son versement est systématiquement interrompu en cas de remise en couple du parent-gardien. On considère, en effet, que le nouveau conjoint assure une solidarité intrafamiliale – y compris à destination d’enfants qui ne sont pas les siens – qui est pourtant loin d’être une évidence ni au plan théorique ni au plan sociologique !16
A l’évidence, les pensions alimentaires n’ont pas vocation à se substituer aux prestations sociales qui sont les armes mobilisées par l’État providence contre la précarité et les risques sociaux. Pour autant, les politiques familiales ne compensent qu’en partie l’effet de richesse négatif qui touche les familles monoparentales après la séparation du couple. Or, il se trouve que cette perte de revenu a une forte dimension de genre.
La fiscalisation des pensions alimentaires contribue à ce que les inégalités financières et de genre s’auto-entretiennent…
Jusqu’à présent, tous les arguments présentés en faveur de la défiscalisation des pensions alimentaires étaient complètement indépendants du genre du parent-gardien. Par eux-mêmes, ils suffisent à défendre le bien-fondé de l’idée. Néanmoins, on ne peut négliger la réalité sociale qui se cache derrière l’impersonnalité de la norme juridique. N’en déplaise à Laurent Saint-Martin, alors ministre chargé du Budget et des Comptes publics du gouvernement Barnier, qui s’exclamait en séance que « la pension n’est pas liée au sexe », dans les faits, elle l’est éminemment. Et ce sont le plus souvent les femmes qui en paient les frais (littéralement).
La séparation engendre un coût fortement contrasté selon le sexe du parent. Comme susmentionné, les femmes perdent au moins 20% de niveau de vie à moyen-terme tandis que le niveau de vie des hommes augmente de 3,5% en moyenne après la rupture bien que la hausse soit moindre que s’ils étaient restés en couple (+6,5%).17 Autrement dit, non seulement le niveau de vie des hommes ne souffre que d’un coût d’opportunité après la rupture (une hausse plus faible du niveau de vie mais une hausse tout de même) mais en plus il semblerait que la vie de couple avec une femme soit un facteur d’enrichissement pour les hommes. Et l’Insee de remarquer que « ces variations sont particulièrement sensibles à la part qu’apportait chaque conjoint dans les revenus du couple résultant en partie de la spécialisation entre travail domestique et travail professionnel rémunéré ».18 En d’autres termes, les femmes qui gagnent le moins et qui dédient le plus de temps hebdomadaire au travail domestique sont celles qui font face à la plus importante perte de niveau de vie à la séparation. Ces disparités se confirment avec l’arrivée des enfants bien qu’elles touchent différemment le père et la mère.19
Or, au coût économique de la rupture s’ajoute un certain nombre de réalités sociales persistantes et génératrices de risques auxquelles les femmes sont surexposées comparé aux hommes :
- Parmi les familles monoparentales, 82% sont composées de mères tandis que 18% sont constituées de pères résidant avec leurs enfants.
- En 2018, 22 % des enfants en famille monoparentale avec leur père sont pauvres, proportion proche de la moyenne des enfants, contre 45 % pour les enfants en famille monoparentale avec leur mère.
- A l’inverse, écrit l’INSEE, « les pères sont plus souvent propriétaires du logement : la moitié, contre un quart des enfants en famille monoparentale avec leur mère.
- Ils sont aussi nettement plus souvent en emploi (81 % contre 67 %, en 2020) et moins fréquemment au chômage (10 % contre 18 %) que les mères dans la même situation familiale.
- Quand ils sont en emploi, les pères de famille monoparentale sont aussi plus souvent cadres que les mères (18 % contre 10 %), avec un écart plus marqué que parmi les parents en couple (en famille « traditionnelle », 22 % des hommes en emploi sont cadres contre 16 % des femmes ; en famille recomposée, ces proportions sont respectivement de 14 % et 10 %) ».20
Ainsi, non seulement les considérations financières qui sous-tendent le régime fiscal des pensions sont intrinsèquement liées aux inégalités préexistantes entre hommes et femmes – notamment sur le marché du travail – mais encore, elles les renforcent. En France, les différences de genre dans la répartition de la charge financière liée à la parentalité restent donc très prégnantes. Au-delà des considérations financières, cruciales certes, c’est donc un modèle de parentalité inégalitaire que la défiscalisation des pensions doit contribuer à redéfinir.
… et ce sont bien les femmes qui en paient les frais.
A la fin du XIXe siècle, le président du tribunal correctionnel de Château-Thierry dans l’Aisne, Paul Magnaud, doit juger Louise Ménard, mère célibataire de 22 ans qui élève seule son fils de deux ans. La prévenue s’est rendue coupable du vol d’un pain dans une boulangerie pour nourrir l’enfant qui n’avait pas mangé depuis trente-six heures. Deux heures passent et le « bon » juge Magnaud (comme l’appelait Clemenceau) renvoie la prévenue sans dépens et met fin aux poursuites. Plaidant l’« état de nécessité » qu’il créé dans le droit français, Magnaud dénonce alors « une organisation sociale qui laisse à une fille-mère toute la charge de l’enfant qu’elle a conçu, alors que celui qui, sans aucun doute, le lui a fait concevoir, peut se dégager allègrement de toute responsabilité matérielle ».
Depuis, l’État-providence a été créé et les femmes, comme les hommes français, sont mieux protégés face aux risques sociaux et aux aléas de la vie en société. A ne pas en douter, les mentalités ont singulièrement évolué, preuve en est qu’on ne parle plus de « fille-mère » mais bien de « mère célibataire ». Aussi les défis d’hier en matière d’égalité hommes-femmes au sein des familles ne sont assurément pas ceux d’aujourd’hui. Néanmoins, certains subsistent et de nouveaux émergent de pair avec les restructurations des modèles familiaux traditionnels. C’est ce qui conduit K. Tahri à observer que ces « évolutions […] ouvrent des périodes de réorganisation en profondeur au plan personnel et familial : partage de l’autorité parentale et des tâches éducatives pouvant susciter des conflits entre les ex-conjoints, déménagement s’il y a lieu, réorganisation des emplois du temps pour concilier travail et parentalité, ajustement des budgets familiaux […] ». Et de regretter que « ces défis soient particulièrement marqués pour les femmes. Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que la possibilité de réinventer les liens conjugaux soit favorable à leur émancipation, les femmes se retrouvent, à l’issue d’une séparation, plus fréquemment exposées à diverses formes de vulnérabilité, entravant leur épanouissement personnel et professionnel ».
A cet égard, le régime fiscal de la pension alimentaire fait figure de vestige. Pour le parent-gardien qui la perçoit, la pension ne couvre pas à parts proportionnelles les frais engagés pour l’enfant contrairement aux dispositions du Code civil relatives au CEEE. Pire encore, la pension est considérée comme un revenu pour le parent qui la perçoit et « non pas comme une dépense pour l’enfant interne à chaque foyer comme au Canada » remarque l’IGAS.
Cette situation archaïque produit des effets délétères. Un effet financier d’abord puisqu’une pension intégrée dans la base imposable prive le parent-gardien du bénéfice de certaines prestations sociales ou renchérit la charge fiscale du foyer. Un effet moral ensuite, puisque ce régime socio-fiscal pose une question de principe très forte et contribue à répandre l’idée qu’il suffit de contribuer financièrement au bien-être d’un enfant afin de participer à son éducation et assurer un tant soit peu son rôle de parent. Et c’est peut-être sur ce dernier point que les progrès futurs les plus importants sont appelés à être faits.
Propositions
De la réforme de son régime fiscal à des ajustements paramétriques quant à son calcul, les pistes d’évolution de la CEEE sont multiples. Il appartient à la représentation nationale de choisir, parmi ces pistes, celles qui sont de nature à réduire le plus efficacement les inégalités susmentionnées avec le moins d’effets distorsifs sur la fiscalité des ménages, tout en emportant l’adhésion des Français.
Les mesures suivantes reprennent pour l’essentiel celles formulées par le rapport d’information du Sénat de 2024 « Familles monoparentales : pour un changement des représentations sociétales » (quatre premières) et la note de Kenza Thari pour Terra Nova (deux suivantes).
- Réviser les échelles d’équivalence de niveaux de vie afin de mieux appréhender le coût de l’enfant et le surcoût de la monoparentalité.
- Expérimenter, et assortir d’une évaluation chiffrée, le maintien provisoire du versement de l’allocation de soutien familial (ASF) en cas de remise en couple du parent gardien.
- Instaurer un abattement sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pris en compte dans les bases ressources des prestations familiales et des aides au logement, à hauteur de l’ASF.
- Réévaluer le barème de calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, afin de mieux tenir compte, de façon visible et plus équitable, des revenus des deux parents et des différentes dépenses relatives à l’enfant, comme prévu par la loi.
- Faciliter l’accès au système d’intermédiation pour les couples séparés avant 2022 en croisant les données fiscales avec celles des CAF pour activer automatiquement le service et lutter contre le non-recours
- Réviser le mode de calcul des pensions alimentaires : en s’inspirant de l’exemple québécois qui intègre un indicateur relatif au temps passé avec les enfants (plus rigoureusement intégré au calcul de la CEEE qu’en France).
Cette note, à son tour, suggère quelques propositions :
1. Renforcer l’information des parents et le consentement au versement de la CEEE.
En complément du simulateur de calcul de pension du ministère de la Justice, renforcer l’information par la rédaction d’un guide sur le modèle québécois expliquant, au regard du droit applicable, les fondements de la méthode de calcul de la CEEE21.
2. Tenir compte de l’évolution du coût de la vie au fil du temps.
Automatiser l’indexation des CEEE sur l’évolution du coût de la vie et intégrer au mandat de l’ARIPA son recouvrement, y compris en cas de défaut.
3. Lutter contre la sous-estimation du coût financier de l’enfant.
Afin que le montant de la CEEE ne soit pas sous-estimé dans le cadre d’un accord à l’amiable, celle-ci pourrait faire l’objet d’une validation par avis conforme, au regard des revenus déclarés et des coûts estimés par les parents, auprès du JAF ou de l’ARIPA.
4. Supprimer la charge fiscale qui pèse sur les parents-gardiens les plus modestes.
Exclure le bénéfice de la CEEE par tout parent-gardien du revenu imposable intégré au calcul des prestations sociales dans la limite d’un plafond afin que le versement d’une pension ne conduise pas au non-recours d’une prestation sociale et inversement.
En définitive, il convient de rappeler que si ces mesures sont à la fois porteuses de progrès, elles ne pourront pourtant pas, à elles seules, changer la donne. La charge extra-financière que représente l’éducation d’un enfant, la conciliation de la vie professionnelle et privée, et le respect général des devoirs inhérents à la parentalité sont autant de réflexions à mener, que ces propositions n’ont pas vocation à traiter directement.