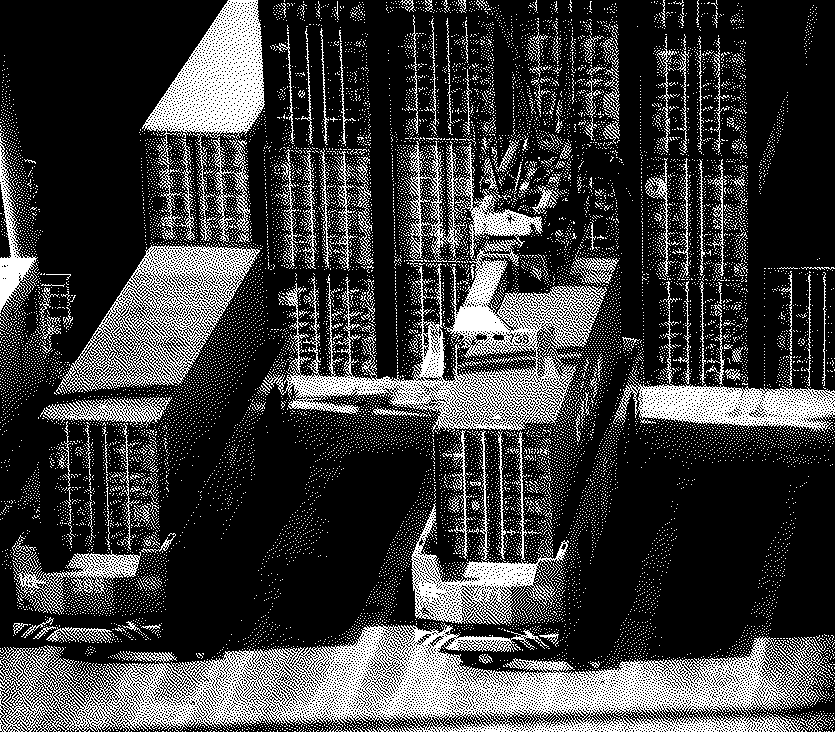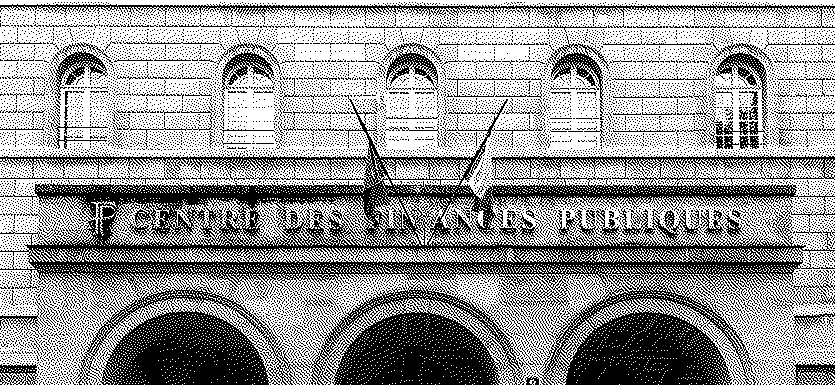Cet article a tout d’abord été publié en anglais sur le site International Politics and Society, IPS
Les Pays-Bas sont-ils devenus un narco-État ? Cette question occupe depuis un certain temps les esprits des hommes politiques, des experts et des citoyens néerlandais inquiets.
En janvier 2025 s’est ouvert le procès contre Inez Weski, avocate pénaliste à la retraite. Weski est soupçonnée d’avoir transmis des messages à Ridouan Taghi – condamné à la prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre en 2024 – alors qu’elle était son avocate et qu’il était détenu dans une prison de haute sécurité. La condamnation de Taghi s’inscrit dans le cadre du procès Marengo, l’une des plus grandes affaires de criminalité organisée liées au trafic de drogue aux Pays-Bas à ce jour.
Le procès de Marengo lui-même a pris une tournure violente. Le frère de Nabil B., témoin repenti1, a été assassiné quelques jours après la première séance, en mars 2018. Il en est de même pour son avocat, en septembre 2019. Puis, en juillet 2021, le célèbre journaliste d’investigation Peter R. De Vries, qui avait soutenu Nabil B. en tant que conseiller confidentiel, a également été assassiné. Ces événements ont conduit le magazine d’information allemand Der Spiegel à se demander si les Néerlandais n’étaient pas devenus une nation de « Gouda, crack et malfrats » (« Käse, Koks und Killer« ). Bien que Weski conteste avec véhémence toutes les accusations, son procès alimente l’impression qu’il y a quelque chose de pourri aux Pays-Bas.
Plus forts ensemble
Le nouveau gouvernement néerlandais s’est engagé à poursuivre la lutte contre l' »ondermijning ». Ce terme, qui se traduit approximativement par « crime de subversion », évoque le travail de sape par lequel le crime organisé affaiblit la société de l’intérieur. Par exemple, les trafiquants de cocaïne blanchissent leur argent en l’investissant légalement dans des entreprises ou en menaçant et en intimidant les citoyens et les entreprises pour qu’ils deviennent leurs complices. Ces activités favorisent un sentiment d’anarchie et d’insécurité dans toute la société, ce qui nuit à sa stabilité. Elles menacent également l’intégrité et la viabilité de l’économie légale car les entreprises financées par de l’argent illégal, par exemple, sont moins soumises aux forces du marché, ce qui leur permet de concurrencer leurs homologues et donc de fausser le marché.
En d’autres termes, pour lutter contre l’ondermijning, il faut renforcer la résilience de l’ensemble de la société. L’approche néerlandaise du trafic de drogue se distingue par sa manière d’encourager la coopération public-privé, qui a fait l’objet d’investissements importants depuis 2019. Cette démarche s’écarte des approches traditionnelles, dans lesquelles l’État est le seul à assurer la sécurité. Le port de Rotterdam est sans doute l’exemple le plus éclairant de cette approche. Mais quel est son degré de réussite ?
L’infrastructure logistique hautement automatisée du port de Rotterdam alimente l’économie européenne en marchandises provenant du monde entier. Mais c’est cette même infrastructure qui est utilisée par les réseaux criminels. L’image emblématique est celle de sachets de cocaïne introduits clandestinement en Europe et dissimulés dans des conteneurs de fruits exotiques. Des petites mains sont ensuite envoyées dans les ports pour récupérer ces paquets dans les conteneurs. Selon la dernière communication du ministère public, la plupart d’entre eux (42 %) ont entre 18 et 22 ans. En 2024, 226 d’entre euxont été arrêtés. Les employés des ports sont également visés. Les organisations criminelles les incitent ou les menacent pour les faire tomber dans le giron de la criminalité. Les groupes criminels organisés abusent ainsi à la fois des actifs du port et de son capital humain.
Dans la lutte contre ces crimes, la sécurité et les affaires sont liées.
Dans la lutte contre ces crimes, la sécurité et les affaires sont liées. Par exemple : en raison du niveau élevé d’automatisation du port, les personnes non autorisées présentes sur les infrastructures portuaires constituent un risque pour la santé et la sécurité. Par conséquent, leur détection implique l’arrêt du processus logistique. Ce qui très coûteux pour les entreprises portuaires. Renforcer la sécurité afin de décourager ou d’empêcher les personnes non autorisées de pénétrer dans les installations portuaires est donc logique, tant du point de vue de la sécurité que du point de vue commercial. Les entreprises se rendent également compte qu’une meilleure sécurité peut favoriser la compétitivité. Les employés et les clients sont plus difficiles à attirer et à conserver lorsque le port n’est pas considéré comme sûr. Les entreprises portuaires sont donc motivées pour faire de la sûreté une partie intégrante de leurs activités. Pour les autorités, les entreprises portuaires peuvent constituer une première ligne de défense et soutenir des budgets publics limités. De plus, la mise en commun des informations et des ressources est censée accroître l’efficacité de l’approche de l’ondermijning. Ces incitations ont conduit à une coopération remarquable dans le port de Rotterdam.
En 2014, le Centre de partage d’informations (ISC) pour la sûreté et la sécurité portuaires a été lancé. Toutes les six semaines, l’ISC réunit les agents de sûreté et de sécurité des terminaux à conteneurs, les spécialistes opérationnels de la police portuaire et l’autorité douanière de Rotterdam pour partager des informations sur la sécurité et les questions liées au trafic de drogue dans le port. Une étude de cas de réalisée en 2023 par l’ISC a conclu qu’il s’agissait d’un « exemple opérationnel unique de partenariat public-privé ». Depuis, d‘autres CSI ont été créés dans le port de Rotterdam et il est prévu d’appliquer le modèle dans d’autres ports néerlandais.
Ces CSI ont servi de plateformes pour lancer des projets de sécurité dans le port. La chaîne sécurisée en est un exemple. Ce projet implique des acteurs de la chaîne logistique aux côtés de la municipalité de Rotterdam, des douanes néerlandaises et de la police portuaire. La chaîne sécurisée permet aux participants d’échanger numériquement l’autorisation de libération et de collecte des conteneurs. Ce système remplace l’ancien système qui utilisait des codes pin pour le dédouanement. Or, les criminels ont montré qu’ils étaient capables d’acquérir ces codes pin, ce qui leur permettait d’infiltrer le port en utilisant des conteneurs utilisés comme des chevaux de Troie. La chaîne sécurisée élimine ce mode opératoire.
Maintenir le cap
Les mesures prises au fil des ans semblent avoir porté leurs fruits. Dans le port de Rotterdam, la quantité de cocaïne saisie en 2024 a été presque divisée par deux par rapport à 2023. Les chiffres pour le port d’Anvers sont encore plus spectaculaires : alors que 121,1 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2023, ce chiffre a chuté de près de deux tiers pour atteindre 44,3 tonnes en 2024. Dans le port de Rotterdam, le nombre de petites mains arrêtéesa également diminué, passant de 452 prises en 2023 à 266 en 2024. Les autorités anversoises en ont arrêté 127 en 2023 (dont 58 sont entrés par des conteneurs « chevaux de Troie ») et 111 en 2024 (dont 13 sont entrés par des conteneurs « chevaux de Troie »).
Un modèle pour le reste de l’Europe
Mais il reste encore de nombreuses questions à résoudre. L’instauration et le maintien de la confiance entre les partenaires publics et privés restent un défi. Une grande partie de la coopération a d’abord été menée sur une base informelle mais, à mesure que la coopération mûrit, le besoin de règles d’engagement claires augmente. Cela pose toutefois des questions difficiles en matière de responsabilité et de leadership. Parallèlement, les autorités mesurent encore souvent l’efficacité en termes de saisies et de condamnations, mais il n’est pas facile d’établir un lien direct entre la coopération et ces indicateurs clés de performance, même lorsque les participants ont clairement le sentiment que la coopération y contribue. Les différences culturelles entre les institutions et les entreprises, sans parler des différences transfrontalières, doivent également être gérées avec soin. Cela promet d’être un défi permanent pour la nouvelle Alliance portuaire européenne, récemment lancée par la Commission européenne avec la présidence belge du Conseil de l’UE. Cette alliance vise à rassembler toutes les parties prenantes concernées en Europe afin de renforcer la sécurité de ses ports.
Travailler ensemble est un travail difficile. Mais est-ce gratifiant ? Les statistiques énumérées ci-dessus semblent prometteuses. Mais sont-elles vraiment le signe que les efforts portent leurs fruits ? Ces questions n’ont pas encore trouvé de réponse. Il est clair que les techniques de trafic de cocaïne évoluent en même temps que les contre-mesures. La lutte contre l’ondermijning se poursuit. Il le faut, car les retombées de la violence et les effets sur l’économie légale associés au commerce de la cocaïne doivent être contenus. Un projet de recherche impliquant de nombreux acteurs cités dans cet article a été lancé en 2024 pour examiner si le port de Rotterdam « se concentre sur les bonnes choses ».
L’expérience de Rotterdam et les chiffres les plus récents incitent à un optimisme prudent. Des progrès sont possibles. Des solutions peuvent être élaborées. Rester innovant et adaptable est un impératif majeur. Et la résilience est un mot-clé, surtout dans un contexte international qui évolue si rapidement. L’union des forces publiques et privées peut se révéler un outil durable pour renforcer cette résilience. L’approche adoptée à Rotterdam pourrait ainsi servir de modèle au reste de l’Europe.