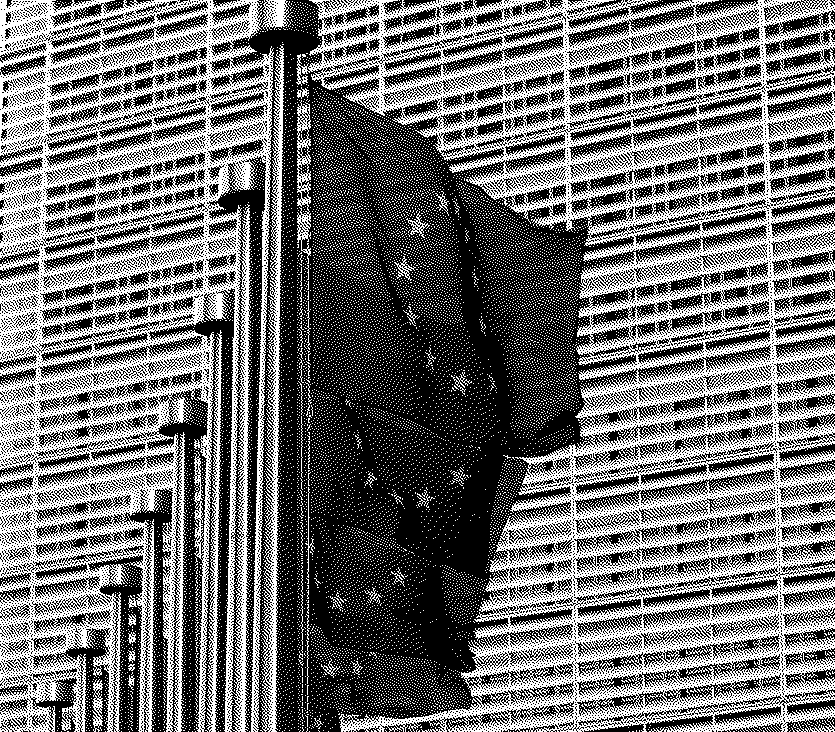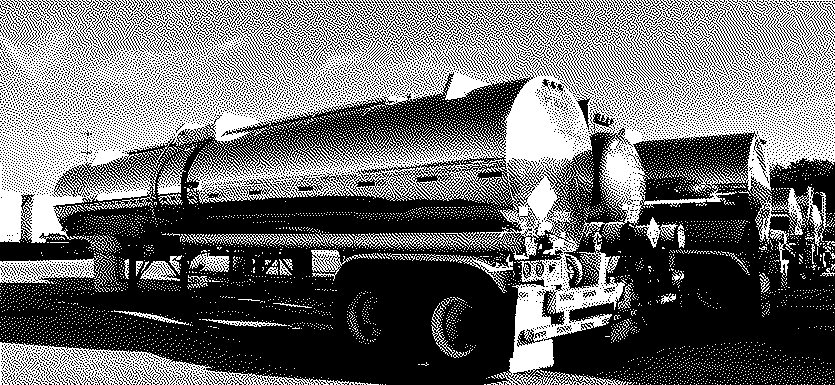1. Un mouvement de relocalisation de l’économie
Tout d’abord cette crise a amplement montré les fragilités associées à des chaînes d’approvisionnement très longues et fractionnées, misant en priorité sur des producteurs situés dans des zones lointaines sans liens politiques majeurs avec l’Union Européenne. Les tensions sur les masques, les respirateurs puis sur les semiconducteurs et d’autres composants ou matières premières, ont bien illustré cette fragilité depuis deux ans.
Cette prise de conscience devrait déboucher sur des politiques publiques plus actives de différents types dans de nombreux domaines : stocks de sécurité, capacités additionnelles de secours subventionnées… Cela devrait aussi conduire à un mouvement de « relocalisation » de la production plus près des marchés finaux et avec moins d’intermédiaires. Ce mouvement commençait d’ailleurs déjà à s’esquisser avant même la crise engendrée par le COVID-19 du fait de la hausse des coûts salariaux en Asie et de la montée des tensions entre la Chine et le monde occidental. La transition verte et la montée en puissance des énergies renouvelables relevait également de la même tendance pour une Europe qui détient très peu de réserves d’énergie fossile.
Il reste cependant indispensable que ce mouvement soit désormais plus activement accompagné et encouragé par les pouvoirs publics nationaux et européens. Cette relocalisation pourrait et devrait également devenir un élément important dans la relance de nos relations avec notre voisinage proche, et notamment l’autre rive de la Méditerranée.
Il ne faudrait pas cependant confondre deux notions qui sont souvent associées de manière abusive dans ce débat : « relocalisation » de la production, d’une part, et « démondialisation », d’autre part, c’est-à-dire une rupture des liens qui se sont tissés tout autour de la planète depuis un demi-siècle. S’il s’agissait réellement d’une « démondialisation », si on devait se remettre à ne concevoir et vendre des produits qu’à un marché régional ou national, ce serait en effet une évolution dommageable pour la qualité de vie et le pouvoir d’achat de la plupart d’entre nous. Nous perdrions en effet les avantages en termes d’ « économies d’échelles » associés au fait de pouvoir mobiliser des savoir-faire complexes et des investissement matériels et immatériels très lourds en s’adressant à un marché mondial composé de plusieurs milliards d’individus : le coût de la plupart des biens dont nous disposons actuellement en serait fortement augmenté.
Il n’est cependant pas obligatoire que « relocalisation » rime avec « démondialisation » : celle-ci peut en effet très bien être le fait en particulier de firmes mondialisées qui continuent de s’adresser à l’ensemble de la planète. Des firmes parmi les plus emblématiques de la mondialisation (pour le meilleur et pour le pire) comme McDonald’s, Danone ou Coca Cola sont en réalité déjà des firmes très locales en termes de production : Coca Cola embouteille toujours ses produits à proximité de ses marchés finaux et McDonald’s achète tous ses ingrédients sur place. Ce modèle classique dans les industries agroalimentaires peut en réalité se décliner à l’avenir dans beaucoup de domaines, notamment grâce aux technologies qui permettent la production de composants de façon moins centralisée. L’industrie automobile a déjà évolué en ce sens, en demandant souvent à ses sous-traitants d’installer des ateliers de production à proximité de ses usines d’assemblage pour limiter les stocks et les aléas. Les entreprises multinationales qui n’ont pas encore fait évoluer leur modèle économique vers une production et un approvisionnement plus localisés doivent y être incitées plus activement.
2. Le télétravail et ses implications
La seconde tendance lourde qu’a entraînée l’épidémie de COVID19, c’est bien entendu le développement du télétravail. Là non plus, il ne s’agit pas d’un phénomène que l’épidémie a créé mais d’une tendance préexistante qu’elle a accélérée. Les outils qui permettent de coopérer à distance, et notamment les outils de réunion de type Zoom, ont connu un véritable boom depuis deux ans et de nombreuses entreprises ont découvert avec surprise qu’elles pouvaient fonctionner quasiment intégralement en télétravail. Une fois l’épidémie terminée, beaucoup de salarié.e.s retourneront sans doute à leur bureau mais il existe de bonnes raisons de penser qu’on ne reviendra pas pour autant au statu quo ante.
Ce développement du télétravail va avoir de nombreuses conséquences. Cela pose tout d’abord question pour le fonctionnement futur des collectifs de travail. Chacun sait en effet que les relations formelles au sein d’une entreprise ne recouvrent qu’une partie de son fonctionnement réel et que beaucoup de questions importantes se règlent dans les couloirs, à la cantine ou devant la machine à café. Les gains de productivité réalisés grâce au télétravail en évitant les transports et la fatigue qu’ils entraînent et la réduction des émissions de gaz à effet de serre que cela a permis, ne vont-ils pas être compensés à terme par les effets négatifs de cette perte de dimension collective ? Et quid en particulier dans ce contexte du syndicalisme et de la représentation collective des salariés ?
Au-delà de ces aspects internes aux entreprises et aux organisations, le télétravail entraine aussi des conséquences considérables à l’extérieur de celles-ci. Cela pose en effet en particulier la question à termes de l’avenir des villes. Depuis trois siècles, on avait assisté partout dans le monde à un mouvement puissant et continu d’exode rural et de concentration de la population dans des villes.
Cela correspondait en particulier aux contraintes associées à une division du travail de plus en plus poussée : quand chacun ne produit plus qu’une petite partie d’un bien ou d’un service, il faut coordonner un nombre toujours plus grand d’acteurs, salariés et entreprises, pour être capable de produire les biens et les services dont la société a besoin. Cela correspondait également au besoin et à l’envie de chacun et chacune d’entre nous de pouvoir accroitre et diversifier ses interactions sociales, son accès à l’information et au savoir… Jusqu’ici, on ne parvenait à faire tout cela qu’en concentrant géographiquement les personnes dans les mêmes endroits : les villes. Cela n’allait cependant pas sans inconvénients majeurs en termes de pollutions, d’éloignement de la nature, d’embouteillages et de pertes de temps et d’énergie associés. Ainsi qu’en termes de santé publique et de risques liés à la propagation rapide des épidémies, comme le COVID-19 nous le rappelle encore.
Avec le développement des technologies de la communication, cette contrainte s’est cependant progressivement affaiblie. Et l’épidémie de COVID-19 a montré que, potentiellement, les inconvénients d’une urbanisation poussée pouvaient devenir supérieurs à ses avantages dans nos sociétés avancées où des moyens de communication à distance de plus en plus nombreux et efficaces sont disponibles. La pandémie a probablement bousculé durablement le marché de l’immobilier de bureau. La Commission européenne entend ainsi réduire de moitié la surface de ses bureaux à Bruxelles dans les dix ans et de nombreuses autres entreprises et organisations lui emboiteront probablement le pas. Il est trop tôt pour dire si cette tendance va se poursuivre et s’accentuer ou si au contraire on va progressivement revenir à la situation antérieure, mais il n’est pas impossible qu’on caractérise dans quelques décennies la pandémie de COVID-19 comme ayant marqué un tournant majeur dans l’histoire de nos civilisations.
Mais le développement du télétravail risque aussi d’accentuer une autre tendance qui était déjà à l’œuvre avant la pandémie de COVID-19 : la délocalisation des activités de service. Pendant longtemps, on a considéré en effet que les activités industrielles étaient aisément délocalisables mais pas les activités de services moins soumises à la concurrence internationale. Pour les raisons évoquées précédemment, il semble probable que le premier mouvement soit en train de s’inverser et qu’on assiste à une relocalisation progressive des activités physiques de production. Mais le développement du télétravail pourrait au contraire accélérer un mouvement inverse, déjà engagé, de délocalisation de nombreuses activités de service.
Si on peut en effet faire fonctionner de façon satisfaisante une activité en se trouvant à 10 kilomètres de ses bureaux, pourquoi ne le pourrait-on pas en étant situé à 1000 kilomètres ? Cela pose bien entendu de nombreuses difficultés supplémentaires en termes de langues, de culture, de décalage horaire… mais quand les écarts de coût du travail sont importants, le jeu peut en valoir la chandelle.
De nombreuses sociétés avaient déjà basé leurs centres d’appel au Maghreb ou des activités de « back office » en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud mais le développement du télétravail comme mode d’organisation « normal » devrait accentuer encore cette tendance à l’avenir.
3. Le retour de l’inflation
La pandémie, mais surtout la reprise économique qui a marqué 2021 se sont accompagnés d’un regain sensible d’inflation après une période pendant laquelle depuis la crise de 2008 celle-ci avait été proche de zéro malgré des politiques monétaires très expansives et des politiques budgétaires non restrictives. S’agit-il d’un phénomène transitoire ou, au contraire, assiste-t-on, là aussi, à tournant durable ? Il est une fois de plus encore trop tôt pour le dire.
La pandémie a désorganisé nombre de secteurs à commencer par l’agriculture et l’agro-alimentaire d’où une hausse des prix importante dans ce domaine. Elle a désorganisé aussi et continue de désorganiser de nombreuses chaînes d’approvisionnements dans de multiples secteurs ainsi que les chaînes logistiques, d’où des augmentations importantes des coûts de transports. Du fait de l’incertitude qu’elle a engendré, elle a enfin bloqué pendant deux ans, la plupart des investissements de capacité comme de renouvellement d’où des goulots d’étranglements au moment de la reprise comme on l’a constaté notamment sur les semi-conducteurs ou dans le domaine des énergies fossiles.
Beaucoup de ces phénomènes ne devraient être que transitoires et les tensions sur les prix devraient s’amoindrir au cours des prochains mois. Il existe cependant des raisons de considérer que la pandémie marque aussi un tournant plus durable sur le plan du régime de prix. Le mouvement de relocalisation évoqué précédemment, mené au nom des risques d’approvisionnement et de dépendance croissants, risque aussi d’avoir un impact structurel à la hausse sur les prix des produits manufacturés du fait d’un moindre recours aux pays à bas salaire. De même, le changement de régime de croissance de la Chine, désormais centré davantage sur la demande intérieure, limite la pression à la baisse exercée sur les prix mondiaux par les produits originaires de cette région du monde depuis au moins trois décennies alors qu’aucune autre n’est en mesure de prendre le relais de la Chine dans ce domaine du fait des problèmes de stabilité politique qui affectent beaucoup de pays du Sud.
Dans les pays développés, on était parvenu jusque là à continuer à faire croitre la population active malgré le ralentissement démographique et le vieillissement de la population avec l’entrée des femmes sur le marché du travail rémunéré et en repoussant l’âge de départ en retraite mais ces deux mouvements arrivent en bout de course et le chômage de masse recule, accroissant la pression sur les salaires.
La pandémie de COVID-19 a de plus spectaculairement accéléré le phénomène avec ce qu’on appelé aux Etats Unis « la grande démission », le fait que de nombreux salariés précaires et mal payés ont abandonné leurs postes au cours de la pandémie et refusent d’y revenir après. Il existe donc des raisons convergentes de considérer que les coûts salariaux devraient s’accroitre plus vite à l’avenir en Europe et dans les pays développés.
De plus, après plusieurs décennies pendant lesquelles les nouvelles découvertes et technologies, comme l’exploitation des sables bitumineux et des gaz et pétrole de schiste, avaient permis de compenser l’épuisement progressif des ressources fossiles classiques, on arrive là aussi à un moment où l’offre ne parvient plus à suivre la demande, bien que celle-ci soit limitée par la « transition verte ». Les prix des énergies fossiles et des autres matières premières non renouvelables sont sans doute structurellement orientés à la hausse. Tandis que les investissements nouveaux importants nécessités par la transition vertes vont nécessairement peser sur les prix de l’énergie dans un premier temps.
Enfin, le changement climatique risque de réduire durablement les rendements agricoles dans de nombreuses régions tandis que la « transition verte » va tendre à les diminuer également avec une agriculture moins intensive tout en exerçant une pression croissante en faveur d’un usage non alimentaire des surfaces agricoles pour servir de substituts aux ressources fossiles et fournir des fibres textiles, des matériaux de constructions, les matières premières de la « chimie verte »… Là aussi la pression à la hausse des prix des produits alimentaires semble bien avoir un caractère structurel au-delà des désordres conjoncturels engendrés par l’épidémie.
Bref, même si la hausse des prix se calme un peu au cours des prochains mois, il semble probable qu’on ne revienne pas à l’inflation quasi nulle qui a prévalu depuis la crise de 2008. Cela va naturellement poser des problèmes classiques, mais largement oubliés depuis trente ans, en matière de répartition : les groupes sociaux dotés d’un faible pouvoir de négociation risquent fort d’y perdre, à commencer notamment par des retraités de plus en plus nombreux dans nos pays. Cela devrait cependant aussi contribuer à dégonfler de manière relativement indolore les bulles d’endettement, notamment public et, parallèlement, celle des patrimoines qui s’est formée depuis la crise de 2008 et s’est beaucoup aggravée pendant la pandémie de COVID-19, creusant ainsi de façon importante les inégalités.
Pour y parvenir, il faut cependant réussir à maintenir des taux d’intérêts réels négatifs durablement. C’est-à-dire faire en sorte que la somme du taux d’inflation et du taux de croissance de l’économie soit durablement supérieure aux taux d’intérêts perçus sur les dettes contractées. Cela suppose que les banques centrales n’adoptent pas des politiques de taux trop agressives pour casser cette inflation comme elles l’avaient fait au tournant des années 1970. Ce sera, notamment en Europe, un des débats les plus déterminants des prochains mois et des prochaines années.
4. Un coup d’arrêt au rattrapage des pays du Sud
Si elle devait se confirmer dans la durée, une des suites les plus marquantes et les plus lourdes de conséquences de la pandémie de COVID-19 pourrait bien être l’inversion de la tendance au rattrapage des pays développés par les pays du Sud en termes de niveaux de vie. Même si la mondialisation a eu de nombreux effets néfastes, et notamment celui d’aggraver les inégalités au sein de nos sociétés, elle a malgré tout permis pendant plusieurs décennies que les écarts de revenus par habitant entre les pays développés et les pays du Sud se réduisent progressivement même s’ils restent encore très importants.
La pandémie a marqué un coup d’arrêt à cette tendance parce que, en dehors de la Chine, elle a touché beaucoup plus durement les pays émergents et en développement. L’Europe et les autres pays développés ont été en effet très sévèrement atteints par la pandémie de COVID-19 et sont très loin d’en être sortis. Mais nous disposons de systèmes sociaux puissants qui ont permis d’amortir le choc sur les revenus des ménages et les Etats ont eu les moyens de soutenir généreusement les entreprises. Ils ont pu en effet emprunter massivement à des taux d’intérêts quasiment nuls grâce aux politiques très expansives des banques centrales et cela sans entraîner de dévalorisation sensible de nos monnaies. Au bout du compte les dommages économiques et sociaux de la pandémie sont restés grâce à cela limités, beaucoup plus que durant la crise de 2008–2009 et ses suites.
Au Sud, en revanche, la situation est très différente. La plupart des personnes y sont employées dans le secteur informel et en cas de confinement elles sont privées de tout revenu. Les agricultures des pays du Sud, où on dispose de peu de possibilités de stockage et de conservation, ont été également profondément désorganisés par l’épidémie. Les Etats et les systèmes sociaux sont beaucoup plus faibles et bien incapables de s’endetter autant que ceux des pays développés. Et quand ils le font c’est à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que nous. D’ailleurs plusieurs d’entre eux se trouvent désormais dans une situation de surendettement préoccupante suite à la pandémie. Quant à leurs banques centrales, elles n’ont pas du tout les mêmes marges de manœuvre que la Fed ou la BCE pour mener des politiques monétaires expansionnistes sans que la valeur de leurs monnaies ne plonge. Résultat : hors Chine, les pays à bas revenus ou émergents ont été très loin de pouvoir amortir le choc autant que les pays développés.
Facteur aggravant, cette situation perdure parce que les pays développés ont largement monopolisé jusqu’ici les vaccins, et notamment les plus efficaces d’entre eux, les vaccins à mRNA. De plus, dans beaucoup de pays du Sud, la faiblesse des systèmes de santé a ralenti les déploiement de la vaccination même quand les vaccins étaient disponibles. Du coup les pays du Sud continuent également de subir plus durement que nous la poursuite de l’épidémie. Cet égoïsme vaccinal des pays développés est non seulement moralement peu défendable mais aussi en réalité contreproductif sur le plan sanitaire : tant que la planète entière n’est pas vaccinée, le virus continue de circuler et de muter pour revenir ensuite dans les pays développés sous des formes plus dangereuses.
Depuis deux ans, l’écart en termes de richesse entre les pays du Sud (hors Chine) et les pays du Nord s’accroit donc au lieu de se réduire. S’agit-il d’un phénomène transitoire ou d’une rupture de tendance majeure et durable ? On ne le sait pas encore. Mais même si elle ne devait pas se poursuivre, cette rupture laissera probablement des traces durables dont on a commencé à mesurer les effets à la COP26 à Glasgow : exaspérés par l’égoïsme et l’absence de solidarité des pays du Nord, les pays du Sud risquent de devenir des partenaires de plus en plus inconfortables dans tous les processus nécessairement planétaires, notamment pour pouvoir faire face à la crise écologique. Quant à l’Europe, son incapacité à aider significativement ses partenaires du Sud durant cette période a puissamment concouru à affaiblir davantage encore son « soft power » dans le monde alors qu’elle reste largement dépourvue d’outils de « hard power ».
5. Une Europe plus solidaire ?
Après une période initiale où la pandémie avait plutôt accentué les divisions au sein de l’Union, celle-ci s’est reprise et a engagé collectivement des mesures d’ampleur pour faire face à la crise. Contrairement à ce qui s’était produit durant la crise de 2008 et la crise de la zone euro qui avait suivi, la BCE a tout de suite accentué sa politique monétaire expansionniste et la Commission européenne a rapidement levé les règles budgétaires et assoupli celles qui concernent les aides d’Etat. C’est ce qui a permis de limiter efficacement les dégâts économiques et sociaux engendrés par la pandémie comme nous l’avons déjà mentionné.
Face à la pandémie, un pas a également franchi vers une politique de santé paneuropéenne avec la décision qui a été prise d’acheter en commun les vaccins contre le COVID-19. Après un démarrage un peu poussif, cette décision a permis une montée en puissance rapide et quasi généralisée de la vaccination dans l’Union en évitant les effets de la concurrence entre Etats qui auraient sinon été très probablement désastreux, notamment pour les Etats les plus petits et les plus pauvres. Même si, comme nous venons de le voir, cette solidarité vaccinale interne n’a pas permis à l’Union Européenne d’assumer ses responsabilités internationales dans ce domaine. Cela résulte notamment du fait que, si les achats de vaccins ont été mutualisés, ils sont néanmoins restés purement nationaux, l’Union n’en acquérant aucun directement. En matière de Sécurité civile et de solidarité dans ce domaine face aux pandémies, il reste encore des progrès à faire mais la pandémie a permis également d’avancer.
Enfin, last but not least, avec les 750 milliards d’euros du plan Next Generation Europe, cette crise a permis de briser deux tabous importants: pour la première fois l’Union a accepté de s’endetter en commun à des niveaux significatifs pour financer des transferts eux aussi significatifs vers les pays les plus touchés, même si 360 de ces 750 milliards ne sont au final distribués que sous forme de prêts. Il s’agit de financer les transitions numérique et écologique pour faciliter la sortie de la crise du COVID-19.
Cette innovation est importante et bienvenue, mais il faut raison garder. Tout d’abord les volumes sont en réalité limités : les 750 milliards d’euros ne représentent que 4,6 % du PIB de l’Union européenne, moins de 1 % du PIB par an sur la durée de l’opération. Et 2,4 % du PIB de l’Union si on ne s’intéresse qu’aux 390 milliards d’euros de dons. Par ailleurs, cet argent n’est pas réellement mobilisé pour produire en commun des biens publics à l’échelle européenne, il est attribué à chaque Etat pour financer des projets purement nationaux. Au contraire même, la naissance difficile de Next Generation EU n’a été possible qu’en contrepartie de tailles substantielles, notamment en matière de politique étrangère, dans le budget classique de l’Union. Autrement dit en diminuant encore la production de biens publics européens communs bien que celle-ci soit notoirement insuffisante. Enfin, l’Union a échoué jusqu’ici à mettre en place des ressources communes spécifiques pour rembourser cette dette et Next Generation Europe reste à ce stade une opération « one shot ». Des forces puissantes ne veulent pas entendre parler en effet de la réédition de ce genre de dépenses.
La pandémie de COVID-19 aura-t-elle au final renforcé l’Union Européenne ? Cela reste donc encore à voir. Son égoïsme vaccinal a plutôt sensiblement affaibli la position de l’Union dans le reste du monde. Quant à sa cohésion interne, cela va dépendre dans une large mesure de ce qui va être décidé dans les prochains mois sur plusieurs dossiers essentiels. Tout d’abord sur le plan de la politique monétaire : face à la remontée de l’inflation, la BCE va-t-elle se crisper et monter rapidement les taux d’intérêt au risque de casser l’activité économique ? Dans ce cas, le bénéfice tiré d’une réaction rapide et vigoureuse face à la pandémie de COVID-19 sur le plan économique et social pourrait être rapidement perdu et les tensions s’accroitre de nouveau au sein de l’Union. Par ailleurs, sur le plan budgétaire, la situation qui résulte de cette crise rend définitivement obsolètes les règles budgétaires prévues par le Pacte de stabilité, en particulier celles qui concernent le niveau d’endettement et son évolution. Pour l’instant, ces règles sont suspendues mais elles sont sensées être remises en vigueur en 2023. Le débat sur leur indispensable modification sera déterminant pour l’avenir de l’Union. Il s’agit en effet d’une chance historique d’en adopter de moins stupides que les précédentes pour reprendre les termes de Romano Prodi en 2002 lorsqu’il présidait la Commission Européenne.
Enfin, l’avenir de l’Union dépendra également dans une mesure significative du succès de la mise en œuvre de Next Generation EU et de la capacité à mettre en place de nouvelles ressources propres de l’Union pour rembourser cette dette. De ce succès dépendra sans doute la capacité politique à pérenniser ce genre d’outil tout en le faisant monter en puissance en termes de volume et en le réorientant vers la production de biens publics communs européens. Cela fait donc à ce stade encore beaucoup de « si » pour savoir si l’Union sortira renforcée de la crise du COVID-19.
Bref entre relocalisations, télétravail, retour de l’inflation, coup d’arrêt à la convergence mondiale et incertitudes sur l’avenir de l’Union Européenne, les raisons ne manquent pas de considérer que cette pandémie pourrait marquer un tournant majeur pour nos sociétés.