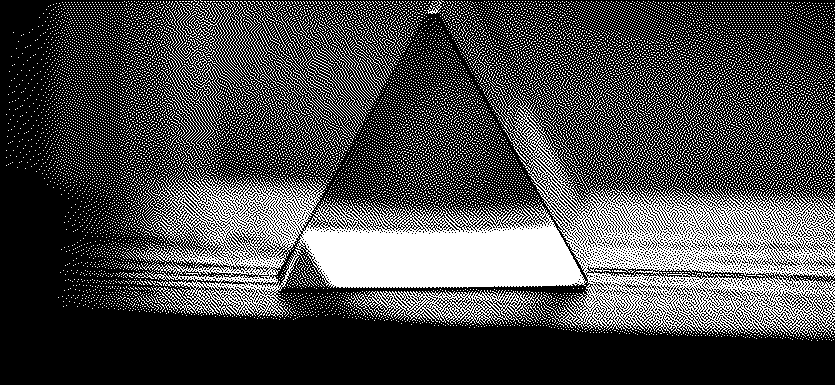Parmi les mesures phares du programme économique de l’ancienne ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’État, Valérie Pécresse, celle qui, jusqu’à une période récente, faisait l’objet de toutes les attentions était l’augmentation sur cinq ans de 10% hors inflation des salaires nets inférieurs à 2,2 SMIC dans le privé. Cette mesure concernait 12 millions d’actifs et devait être permise par la suppression des cotisations sociales salariales vieillesse (7,3% du salaire). Elle devait être financée pour les deux tiers à la charge de l’Etat et pour un tiers à la charge des entreprises.
Finalement, sous la pression conjuguée du Medef, semble-t-il, et à des arguments avancés par Bercy pour démontrer l’impossibilité d’une telle mesure, Valérie Pécresse a changé son fusil d’épaule le 26 janvier dernier. Elle maintient l’objectif théorique d’une hausse de 10% des salaires nets sur le prochain quinquennat, mais la méthode et le financement de son ambition n’ont plus rien à voir : si elle était élue, la candidate LR se contenterait en effet de baisser les cotisations sociales salariales vieillesse de 2,4 % dès l’été 2022 l’été pour l’ensemble des salariés et, pour le reste, de mettre la pression sur les entreprises pour qu’elles revalorisent les salaires de manière à atteindre la cible de 10% d’augmentation des salaires inférieurs à 2,2 Smic d’ici 2027.
1. Tout d’abord, cette mesure s’inscrit dans un schéma classique d’augmentation des dépenses publiques sans réflexion macro-économique globale
Première question : qui financera ? Si « rien [n’était] gravé dans le marbre » – heureusement compte tenu de ce revirement de dernière minute –, Valérie Pécresse proposait initialement de transférer deux tiers du coût de la mesure à l’État (environ 16 milliards d’euros selon de récentes estimations), donc de financer une fois de plus des prestations sociales par l’impôt, et le dernier tiers aux entreprises (soit environ 8 milliards d’euros), « au terme d’une négociation donnant-donnant sur l’organisation du temps de travail, l’assurance-chômage, les retraites et les différentes contributions des entreprises ». Elle précisait par ailleurs que la mesure se ferait à durée égale de travail. Comme on ignorait complètement ce qui allait être demandé aux entreprises en échange (« donnant-donnant »), cette mesure revenait en d’autres termes à faire intervenir l’État pour une augmentation du salaire net des salariés du secteur privé, que les entreprises ne financeraient que pour un tiers. Mais ce tiers restant représentait tout de même 80% des 10 milliards d’euros d’économies qui leur étaient par ailleurs promis via la baisse des impôts de production.
Les représentants du patronat ne semblent pas avoir apprécié. Passée la fièvre et les surenchères du congrès LR, la candidate s’est finalement assise sur ses premières convictions. Elle a décidé de se contenter d’une baisse de 2,4% des cotisations sociales salariales vieillesse entièrement prise en charge par l’Etat, ce qui devrait entraîner une hausse de 3% des salaires nets en-dessous de 2,2 Smic. Mais la mesure ne concernera pas seulement ces derniers : sans doute pour anticiper une censure du Conseil constitutionnel au titre de l’égalité devant les prélèvements obligatoires, elle sera étendue à l’ensemble des salariés pour la tranche de leur rémunération inférieure à 2,2 Smic. Ce qui était annoncé comme une mesure de soutien aux bas salaires se transforme donc en hausse général du pouvoir d’achat, y compris pour les salariés aisés, financée par le contribuable, ce qui revient pour beaucoup à donner d’une main pour reprendre de l’autre. Quant au reste du chemin à parcourir afin de parvenir à une augmentation de 10% des salaires nets jusqu’à 2,2 Smic sur le quinquennat, on s’en remettra à la négociation avec les entreprises, en espérant pouvoir faire levier d’autres dossiers (comme la libéralisation du temps de travail) dans le cadre d’une grande conférence sociale à venir. Et si les entreprises ne suivaient pas cette dynamique hors inflation ?
On peut déjà anticiper que ce financement par l’État représente, pour les entreprises, un effet d’aubaine dans les secteurs où les salaires auraient augmenté en sortie de crise, comme par exemple dans le secteur de l’hôtellerie, café, restauration (HCR) (signature le 17 janvier 2022 d’un accord salarial de branche actant une augmentation moyenne de l’ensemble de la grille salariale de 16,33 %), et, pour les salariés, un effet contre-productif dans les secteurs où l’augmentation des salaires net d’emplois peu qualifiés ne rendra pas l’accès à l’emploi plus facile.
En attendant, comme il est plus facile de s’endetter que de demander des comptes aux entreprises, une première hausse de 3% des salaires nets en 2022 sera financée par l’impôt, c’est-à-dire par les contribuables présents et futurs, à hauteur de 7 milliards d’euros, une somme qui n’a rien de négligeable et sur laquelle on aimerait avoir plus de détails car, bizarrement, l’estimation ne semble pas avoir évolué depuis que la mesure a été étendue à l’ensemble des salariés.
Deuxième question : quel effet pour quel coût ? Alors que les allègements de cotisations patronales ont vocation à renforcer la compétitivité et l’emploi, la baisse des cotisations salariales aurait un effet sur le pouvoir d’achat. Selon une hypothèse de l’équipe de campagne qui ne repose sur aucun modèle macro-économique chiffré1, le coût de cette mesure devrait s’autofinancer pour moitié par les effets de la mesure sur la consommation et les rentrées fiscales associées (TVA, impôt sur le revenu…). Le reste serait financé par des économies sur les dépenses, qu’on ne connaît pas encore, à l’exception de la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, dont on peut légitimement douter2, et bien sûr, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, comme si rien n’était fait en la matière.
Ainsi, la mesure économique phare de Valérie Pécresse sur le pouvoir d’achat consiste en une intervention de l’État sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire un transfert public, financé par le contribuable3. Le principal problème de cette mesure renvoie à deux limites bien identifiées :
- La difficulté d’augmenter d’autres impôts et les cotisations patronales qui ont des effets néfastes sur la compétitivité et l’emploi pour financer de nouvelles dépenses.
- L’incapacité des candidats aux échéances démocratiques à gager les augmentations de dépenses par des choix publics clairs, de dire clairement quelle politique publique, quel investissement, quel service, quelle prestation sociale baissera en contrepartie de l’augmentation des salaires nets. Les mesures paramétriques sont ainsi présentées sans s’insérer dans une réflexion globale sur nos choix de société (impôts et dépenses).
2. Ensuite, le levier de plus en plus utilisé des allégements de cotisations sociales pose la question de notre modèle de protection sociale
En effet, cette mesure vient compléter une dynamique de plus long terme d’allégement des cotisations patronales sur les bas salaires. Pour renforcer la compétitivité du coût du travail, la France a consenti depuis les années 1990 une série d’exonérations de cotisations patronales autour du SMIC. Cette politique s’est accélérée depuis 2019, avec les allégements instaurés en remplacement du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), en faveur de l’emploi et de la productivité. L’allègement de 2019 était de 10 points au niveau du SMIC, de 10 à 6 points entre le SMIC et 1,6 SMIC et de 6 points entre 1,6 et 2,5 SMIC. Le coût total de ces mesures, net du supplément d’impôt sur les sociétés, est d’environ 19 Md€ en régime permanent. Ces allègements ont eu pour effet de faire baisser le coût du travail pour les entreprises et non d’augmenter les salaires nets perçus par les salariés. Comme cette politique atteignait ses limites, avec des cotisations très faibles jusqu’à 1,6 SMIC, le gouvernement a également eu recours à une subvention des salaires les plus modérés avec la prime d’activité, très sensiblement augmentée en 2018.
Malgré les allègements de charge patronales, au 1er janvier 2021, la répartition des cotisations entre entreprises et salariés jusqu’à 2, 2 SMIC reste de l’ordre de trois quarts – un quart. Si la mesure de baisse de 2,4% des cotisations salariales retraite venait à être adoptée, cette répartition s’approcherait de 80% – 20% pour la part des salaires en-dessous de 2,2 SMIC. C’est notamment sur ce point que la France se distingue le plus de ses partenaires commerciaux en zone euro où la répartition est en moyenne plus équilibrée, de l’ordre de 56% – 44%.
Depuis l’ordonnance de 1945 portant organisation de la sécurité sociale, les cotisations sociales se distinguent des impôts par leur logique assurantielle, c’est-à-dire qu’elles ouvrent droit à des prestations et qu’elles financent ces prestations. Aujourd’hui, la distinction entre impôts et cotisations est devenue beaucoup moins claire avec l’affectation d’impôts au financement de la sécurité sociale pour des montants de plus en plus élevés, notamment du fait de la nécessaire compensation par les contribuables des baisses de ressources des organismes sociaux. Selon la Cour des comptes, depuis 1990, la part des cotisations sociales dans les recettes du régime général s’est réduite de 90% à 50%, transformation structurelle très profonde de la logique de financement qui pose la question de la place de l’assurance (les prestations sont liées au paiement de cotisations) et de la solidarité (les prestations sont indépendantes du paiement de cotisations) dans notre modèle de protection sociale.
Cette diminution de la part des cotisations dans le financement de la protection sociale va de pair avec le développement de prestations relevant d’une logique de solidarité. Cette orientation prise par la France correspond au passage d’un modèle assurantiel (« bismarckien » ou régime corporatiste), selon lequel les cotisations et les prestations sont censés s’équilibrer, à un modèle social-démocrate de type scandinave4 où le financement de la protection sociale est assuré en très grande partie par des impôts et non par des cotisations sociales. En définitive, le changement de modèle de la sécurité sociale française s’est déjà fait, à « bas bruits », et surtout sans réorganisation des règles de gouvernance et de gestion associées. Par voie de conséquence, la frontière entre le périmètre d’intervention de l’État et celui de la sécurité sociale a été progressivement brouillée. Au regard des premières esquisses de programmes des candidats, on peut pressentir que le choix collectif, politique et social, de modèle de protection sociale, ne fera pas l’objet d’un vrai débat, pourtant nécessaire au cours de la campagne électorale qui s’ouvre. En effet, la dynamique à l’œuvre emporte de nombreuses conséquences dont il conviendrait de débattre, entre autres la marginalisation accrue des partenaires sociaux dans la gestion de la protection sociale, une complexification croissante des relations financières entre la sécurité sociale et l’État et une baisse du consentement aux prélèvements obligatoires, car les cotisations sociales ne peuvent plus être considérées par les actifs qui les payent encore comme des salaires différés.
Ainsi, la mesure proposée pose plusieurs problèmes de fond, sans y répondre :
- La difficulté à proposer de nouvelles mesures de dépenses, non gagées par des choix clairs en termes de réduction du spectre des politiques publiques ou du niveau des prestations sociales ;
- La nécessité d’afficher le vrai impact des retraites sur nos déficits publics incluant les régimes des fonctionnaires et autres agents publics, de prioriser les mesures structurelles pour financer les retraites, compte tenu du déficit croissant de la branche vieillesse pour des raisons essentiellement démographiques ;
- La clarification du modèle social français, entre solidarité nationale et logique assurantielle ou au moins, une clarification des modes de financement des prestations sociales excessivement complexes et instables, pour les cinq branches de la protection sociale ;
- La mise en place d’une vision et d’une gouvernance unifiée des dépenses publiques françaises morcelées.
Voilà quelques pistes qui pourraient être envisagées pour vérifier que le programme de Valérie Pécresse passe lui-même la censure du « comité de la hache »5 qu’il propose d’instaurer. Après tout, peut-être que cette proposition n’est toujours pas gravée dans le marbre.