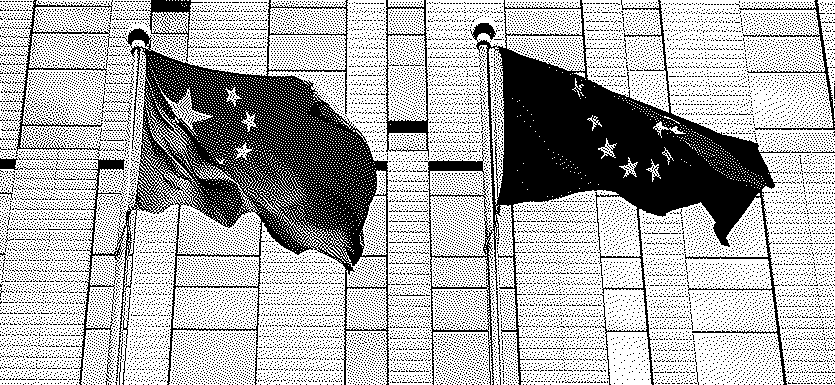Dans le casse-tête du débat sur le budget 2026, le dernier livre de Nicolas Dufourcq apporte un éclairage pertinent, celui de la dette sociale. Après avoir écrit en 2022 sur La Désindustrialisation de la France. 1995-2015, le Directeur général de la BPI (Banque Publique d’Investissement) poursuit la mise en perspective des défis auxquels le pays se confronte avec La Dette Sociale de la France. 1974-2024 (Odile Jacob, 2025). On peut rendre compte de ce dernier travail sous trois aspects : c’est un livre utile, un outil de lucidité ; il présente un historique éclairant et inspirant ; les voies d’action présentées comportent néanmoins certaines faiblesses mais il faut les voir positivement comme une incitation à aller plus loin et à penser une vraie politique de l’offre.
Un livre utile, un outil de lucidité
Parmi les mérites du livre, l’un d’eux, et pas le moindre, est la sincérité. Cela ne va pas de soi de voir un Inspecteur des Finances hyper-compétent, passé par le Cabinet d’un Ministre des Affaires Sociales (René Teulade) avant de contribuer à la direction de grandes entreprises (France Télécom, Cap Gemini) et de diriger la BPI, déclarer : « J’ai souhaité écrire une histoire de la dette, car je n’y voyais pas clair moi-même » (page 209). Ne sommes-nous pas nombreux à être dans le même cas ? Rares sont pourtant ceux qui l’avouent…
Il faut dire que les biais cognitifs sont nombreux. Il y a le biais générationnel car la dette sociale est un sujet relativement récent : lorsque la Sécurité Sociale a été créée au lendemain de la guerre, l’idée de solidarité active excluait la notion de dette. Les prestations de l’année étaient systématiquement couvertes par les contributions de l’exercice. « Au début des années 1970, les dépenses sociales pesaient d’un poids encore faible dans le budget de l’État » (page 24). Il y a ensuite le biais politique ou idéologique : face à une dette publique atteignant désormais 3346 milliards d’euros (114% du PIB) et à un déficit des comptes publics annuels égal à 5,4% du PIB en 2025, il y a ceux qui ne s’en remettent qu’à l’accroissement des recettes tandis que d’autres ne jurent que par la réduction des dépenses et le sabrage des coûts. Il y a enfin un mélange d’ignorance et de mauvaise foi, en faisant comme si les dépenses publiques étaient incompressibles, qu’elles correspondent aux indispensables fonctions régaliennes de l’État (Défense, Sécurité, Justice) ou au financement de nos précieux Services Publics (Éducation, Santé). Il n’est jamais question de ce troisième étage de dépenses publiques qui a pourtant formidablement gonflé : celui des prestations sociales et des transferts sociaux.
Bien sûr, le sujet est délicat mais il supposerait justement que l’on fasse preuve de transparence et de démocratie. Les comptes de l’État, des collectivités territoriales et des institutions spécialisées sont enchevêtrés comme si un Dieu malin voulait que la vérité échappe au commun des mortels. Depuis la révision constitutionnelle de 1996, une nouvelle catégorie de lois a été créée : la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS). Soumise au vote du Parlement, parallèlement au vote du budget de l’État, elle se veut une clarification et un progrès de transparence. Mais il n’existe pas de comptes consolidés ! Les écritures croisées, les transferts et les compensations se sont pourtant accumulés. Et, s’appuyant sur plusieurs rapports administratifs ou parlementaires, c’est cet indispensable effort de réconciliation comptable qu’engage le livre de Nicolas Dufourcq.
Les résultats sont impressionnants. Sur un montant de dépenses publiques supérieur à 1600 milliards d’euros (1695 prévus en 2025), le montant consolidé des prestations de protection sociale en représente plus de la moitié (888 milliards en 2023). Une annexe en présente les 6 grandes catégories : santé (324 milliards en 2023) ; vieillesse-survie-retraites (400 milliards) ; famille (64 milliards) ; emploi (50 milliards) ; logement (16 milliards) ; pauvreté-exclusion sociale (35 milliards). Chaque année, c’est donc la moitié des dépenses publiques qui vont aux prestations sociales et, comme les dépenses publiques représentent 57% du PIB, cela veut dire que ces transferts pèsent entre 25 et 30% du PIB. Quand on regarde le stock, pas le flux, on ne parle cependant plus du quart, du tiers ou de la moitié. Sur le stock total de dette de 3346 milliards, « 2000 milliards au minimum sont des prestations sociales versées depuis 40 ans à crédit » (page 13). 2000 sur 3346, environ les deux-tiers !
La masse de ces déficits donne le vertige. Surtout quand on voit que le vieillissement de la population va inexorablement accroître les dépenses de retraite et de santé, alors que le ralentissement continu de la croissance va limiter la progression des ressources pouvant les financer. Est-ce une raison de se précipiter, de vouloir aller vite et de n’écouter personne ? Le Directeur général de la BPI ne se sent pas autorisé à le dire. Mais, face au lamentable fiasco de la récente réforme des retraites, on peut constater que l’approche technocratique est la pire des méthodes. Nous l’avons écrit par ailleurs : il ne saurait y avoir de révolution de la France, sans les Français (cf. Philippe Lemoine, Une révolution sans les Français ?, l’Aube, 2018). La priorité c’est le débat, afin d’expliciter les besoins et les contraintes, éclairer les sujets de choix et de valeur, établir ensemble les priorités et les voies d’un équilibre. C’est ce à quoi le livre entend contribuer, en s’attachant à la question : comment en est-on arrivé là ?
Un historique éclairant et inspirant
Nicolas Dufourcq retrace 50 ans d’histoire : 1974-2024. En fait, il déborde ces cinquante années pour narrer la succession des décisions gouvernementales à travers onze petits chapitres commençant en 1969 et montrant comment la droite, la gauche, la cohabitation, le retour de la droite, le retour de la gauche et l’aventure du « et de gauche et de droite » ont gouverné selon des partitions variées mais avec, in fine, une même musique : celle d’une progression croissante de la dette sociale. En lisant les 200 pages de cet historique de plus de 50 ans et les presque 300 autres pages de témoignages recueillis auprès de 50 acteurs (50 témoins pour 50 années de dérive ?), on imagine que François Bayrou a dû se réjouir. Même s’il ne fait pas partie des 50 témoins élus, n’a-t-il pas publiquement mis l’accent sur la responsabilité de tous dans l’accumulation de notre endettement ?
Le livre de Dufourcq ne se borne cependant pas à camper une posture. L’historique est précis, échappe aux caricatures, fait la part des évènements qui surgissent et qui s’imposent (la crise de 2008, le Covid.). Il rend compte des ambigüités et des arabesques du pouvoir telles que les résume par exemple Michel Sapin lorsqu’il commente le « contraste systématique du PS entre sa posture d’opposition et le sérieux qui le guide dans l’exercice du gouvernement. C’est d’autant plus dommage, poursuit-il, que la droite, à l’inverse, fait du sérieux dans la gestion des finances publiques un totem quand elle est dans l’opposition, alors qu’elle est particulièrement laxiste quand elle est au pouvoir » (page 266).
Mais le livre ne serait pas aussi éclairant et inspirant s’il se bornait à cette chronique du jeu politique. Il choisit de faire débuter son récit en 1969 ou en 1974 car il pressent qu’une coupure bien plus profonde que celle des alternances politiques s’est produit à cette époque. Dufourcq cite ainsi les propos tenus en 1983 par Michel Foucault : « selon lui, jusque dans les années 1970, le système social était bâti pour apporter d’abord de la sécurité. Or il a été progressivement investi d’une nouvelle mission : donner de l’indépendance. Il est devenu le mécanisme qui rend possible une nouvelle étape de l’individualisme » (page 89). Nous ne sommes pas dans un traité de sociologie ou de philosophie politique. Peu importe que ces mots soient tout à fait ceux de Foucault ou qu’ils rendent parfaitement compte du basculement des logiques. Le mérite est d’élever le débat et de souligner que la finalité même des dépenses sociales change de nature entre ce qu’elles étaient à l’âge de la modernité classique et ce qu’elles deviennent dans une modernité avancée.
Lorsque la Sécurité Sociale naît, au lendemain de la guerre, on est en plein dans cette période de la modernité classique dont l’architecture reposait sur une articulation des différents registres : l’économique, le social, le culturel, le politique. Pour prendre le langage de Karl Polanyi dans La Grande Transformation (1944), l’espoir était alors de tourner la page des débordements, de remettre le fleuve dans son lit et de développer une économie « enchâssée » dans le social. Il fallait affirmer des valeurs de solidarité sous l’égide du paritarisme et avec un financement qui ne relève ni de l’État ni de la fiscalité. Le mot d’ordre était « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». La réalité de la Sécu de 1945 n’était certes pas celle d’une pure redistribution au sein de la population puisque, dès l’origine, une part importante des cotisations était supportée par les entreprises. Mais ce n’était pas incohérent dans une société où le travail constituait le pivot central de l’articulation entre l’économique et le social. La fatigue, l’usure, les accidents du travail fondent le besoin d’assurance-maladie ; l’exploitation du salariat impose la compensation des retraites ; l’insécurité et le chômage appellent un mécanisme d’assurance et de solidarité. Quant aux entreprises, elles n’étaient pas toutes sorties sans taches de la période de l’Occupation. Qui aurait osé, à l’époque, s’opposer à ce qu’elles soient mises à contribution ?
Vingt-cinq ans plus tard, le paysage est tout autre. La société a basculé dans un nouveau registre de modernité. Elle ne peut plus être représentée comme un poing fermé, capable de saisir l’économique et de l’enchâsser. L’heure est à la Grande Divergence entre les logiques du social et de l’économique. Sur le plan social, la dynamique est à l’extension des droits en raison de la fragmentation, de la diversification croissante des identités, de la formation de petites communautés, de la reconnaissance des minorités, voire d’un horizon de personnalisation. Dès la présidence de Giscard, il faut lancer des filets de sécurité dans de nombreuses directions si l’on veut s’adapter à cette société en doigts de gant. Relayée par Simone Veil et René Lenoir, l’action publique s’adresse aux « exclus », aux handicapés, au filles-mères, aux parents isolés. Après la crise de 1974, vont s’ajouter toutes les mesures du traitement social du chômage. Avec Mitterrand, la gauche au pouvoir et la cohabitation, l’éventail des prestations sociales va encore s’accroître. Jacques Chirac ayant été élu sur le thème de la fracture sociale, l’extension de la protection sociale ne fléchit pas vraiment. Tout au long de ces années, on verra naître successivement le RMI, le RSA, l’AAH (Allocation Adultes handicapés), l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), la CMU (Couverture Maladie Universelle)…
Tout cela a un coût, au moment même où l’économique part dans une tout autre direction. En 1970, Milton Friedman écrit dans le New York Times Magazine : « Il n’existe qu’une seule responsabilité sociale de l’entreprise : utiliser ses ressources et mener des activités destinées à accroître ses profits, tant qu’elle respecte les règles du jeu ». Il obtiendra le Nobel en 1976. Fin 1974, Arthur Laffer dessine sa célèbre courbe qui entend démontrer que « trop d’impôt tue l’impôt ». Cette vague libérale inspire les gouvernements anglo-saxons dès les années 1980 (Thatcher, Reagan) et les entreprises françaises commencent à redresser la tête et à affirmer que ce n’est pas à elles de payer la note. Au nom de la compétitivité, elles protestent contre le poids croissant des charges sociales. Dans un premier temps, les progressistes leur répondent que ces charges n’ont rien à voir avec l’impôt et qu’elles s’analysent en fait comme la conséquence du choix souverain qu’a fait la société française de salaires directs assez faibles, complétés par une rémunération indirecte, différée et mutualisée sous forme de protection sociale. Dans cette optique, on ne peut pas faire masse de l’impôt et des cotisations sociales ; la notion même de dépenses publiques cumulées est vide de sens. Cet argumentaire était loin d’être faux et nous l’avons entendu être brillamment soutenu, dans les années 1980, par Michel Rocard dans une conversation privée avec Ernest-Antoine Seillière. Mais le raisonnement ne valait que si les salaires directs restaient contenus et cela a cessé d’être vrai, assez vite. Poussés par la progression du SMIC qui avait remplacé le SMIG en 1970, les salaires directs français sont devenus comparables à ceux des autres grands pays européens et les cotisations se sont bien avérées être des charges additionnelles.
En novembre 1990, Michel Rocard décide de l’instauration de la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Il s’agit de taxer tous les revenus, plus seulement ceux du travail. Et de venir abonder avec le même instrument le budget de l’État et celui de la Sécurité Sociale. Les distinctions savantes entre cotisation et impôt, social et étatique sont désormais envolées… Était-ce suffisant ? Pas vraiment. En 1998, Ernest-Antoine Seillière prend la tête du Medef et il engage avec Denis Kessler le projet de « refondation sociale ». Il s’agit explicitement de revenir sur les compromis nés de la Libération et de la période de création de la Sécurité Sociale. Il faut remettre à plat la protection sociale et décharger les entreprises de tout ce qui ne relève pas directement d’elles. Ce projet inspirera Nicolas Sarkozy, lorsqu’il proposera l’institution d’une TVA sociale. Se présentant comme une mesure anti-délocalisation, la TVA est ainsi augmentée en janvier 2012 parallèlement à une baisse des cotisations patronales finançant la branche famille. Cette mesure est abolie par François Hollande dès son arrivée à l’Élysée mais, suite au rapport Gallois, il instaurera un pacte de responsabilité reprenant à son tour l’objectif d’allègement massif des cotisations sociales à la charge des entreprises. L’accélération de la désindustrialisation et la montée du chômage ont vaincu les dernières résistances. Les politiques peuvent continuer de faire du social si cela leur chante. Mais ce n’est définitivement plus aux entreprises de payer ! Délier les entreprises du champ des politiques sociales, est désormais le crédo dominant. L’économique et le social doivent être désimbriqués. À tort ou à raison, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui une politique de l’offre.
Une incitation à aller plus loin et à penser une vraie politique de l’offre
Le livre de Nicolas Dufourcq n’est pas un livre de doctrine. En conclusion, il croit « bon de retenir quelques-unes des leçons de ces quarante (?) années d’histoire », avec l’objectif de « trouver progressivement près de 180 milliards d’euros d’économies annuelles, soit 10% de nos dépenses » (page 211). Neuf pistes sont développées : réformer les retraites ; augmenter le temps de travail sur toute la vie ; augmenter le reste à charge en matière de santé ; lutter contre le chômage par le « trépied gagnant » que sont les allègements de charge, l’apprentissage et l’assouplissement du Code du travail ; arrêter la production de nouveaux droits sociaux ; stopper les baisses d’impôts, à l’exception des impôts de production ; changer l’imaginaire collectif, en sortant des politiques gradualistes et des chimères d’un retour de la croissance ; tenter d’obtenir une politique accommodante de la BCE pour compenser la rigueur budgétaire nationale ; écouter la « lassitude de la redistribution », en rééquilibrant les valeurs en faveur de la responsabilité et de l’autonomie, plutôt que de la réparation, de la consolation et de la compassion.
La philosophie n’est pas de mettre à bas l’État-providence français mais d’agir pour le préserver, en retrouvant « le courage de dire non à la demande sociale » (page 9). L’expression « politique de l’offre » est à peine utilisée mais l’esprit des mesures proposées y fait penser. Le programme d’action n’est d’ailleurs pas la partie la plus convaincante du livre. Trois paradoxes mériteraient d’être analysés si l’on voulait aller plus loin dans l’indispensable traitement de la dette sociale auquel nous invite l’auteur. Le premier, c’est que Nicolas Dufourcq s’exprime comme « patron de la Banque publique d’investissement » qu’il aime à présenter comme la maison des entrepreneurs. « Si nous étions une maison d’édition, écrit-il, ils seraient nos auteurs ». Le livre « leur est dédié » (page 17). Or, paradoxe, lorsqu’il interroge 50 acteurs pour éclairer cette histoire, il fait appel à 12 politiques, 4 économistes, 3 essayistes, 6 syndicalistes, 24 fonctionnaires et conseillers, 1 investisseur obligataire. Pas un seul entrepreneur ! Zéro ! Les entrepreneurs n’auraient-ils rien à dire sur cette protection sociale qu’ils ont contribué à gérer et qu’ils ont largement financée ? N’y a-t-il pas une grande diversité d’entreprises et une grande diversité de points de vue ? Cette impasse est peut-être intentionnelle. Mais, après avoir affirmé que « l’esprit d’entreprise est la solution », l’auteur se sent maître des « ordres de proportion » et assène : « le dynamisme des acteurs économiques ne parviendra pas, avant de nombreuses années, à changer les équilibres fondamentaux des masses gigantesques manipulées par la protection sociale » (page 215). Vraiment ? Combien de temps a-t-il fallu à l’Allemagne et au Japon pour se relever des ruines de la guerre ? Combien d’années ont été nécessaires à la Chine pour devenir la première puissance économique mondiale ? Combien de temps a mis la France pour passer de l’effondrement de 1870 à la « Belle Époque » où Paris était reconnu comme la capitale du monde ?
Le second paradoxe, c’est que la chronologie très détaillée présentée dans le livre ne met malheureusement pas le projecteur sur l’histoire de cet enjeu pourtant majeur qu’ont été les politiques d’allègement des charges sociales. L’auteur estime même qu’elles font partie du « trépied gagnant qu’il faut préserver » (page 213). Ayant été menées sans que soient explicitées les recettes qui viendraient les compenser, elles sont cependant – et de loin ! – le principal facteur qui a contribué au gonflement de la dette sociale. D’où cela vient-il ? Au départ, en 1993, l’idée portée par Martine Aubry était de lutter contre la montée du chômage, avec un allègement de charges sur les bas salaires du seul secteur non-marchand (associations, collectivités publiques, ESS…). Le patronat de l’époque (le CNPF) proteste en considérant que cela risque de fausser la concurrence. Son objectif est déjà celui de la « refondation sociale » et d’une redéfinition du financement de la protection sociale. Le MEDEF qui lui succède mènera le combat au nom de la compétitivité et de l’emploi. Il obtient ainsi de premières extensions des allègements de charge en contrepartie des 35 heures. La grande réforme qui abaisse les charges sociales pour tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC est toutefois celle des « allégements Fillon » en 2003. Elle fournira un cadre pour des ajustements de plus en plus coûteux, avec le CICE en 2013 (Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, jusqu’à 2,5 SMIC) et le Pacte de responsabilité qui s’y ajoute en 2015, avant que le système des allègements de charge soit rationalisé et pérennisé jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Voulues par les organisations d’employeurs et étendues par des gouvernements libéraux, ces mesures d’allègement sont emblématiques de ce qu’on appelle souvent une politique de l’offre. Outre leurs coûts faramineux, elles se traduisent par des effets pervers monumentaux dont une « smicardisation » croissante de la population active. L’incitation est en effet forte de maintenir les salaires à moins de 1,6 fois le SMIC, avec deux conséquences. La constitution d’un cercle vicieux d’abord où les inégalités salariales primaires s’accroissent fortement et où il faut un système de redistribution de plus en plus coûteux pour que l’on revienne à plus d’équité et à des écarts socialement acceptables. L’autre conséquence est que cette politique centrée sur les salaires proches du SMIC n’a pas été favorable aux industries exportatrices et que la « smicardisation » n’est pas la voie d’une économie à haute valeur ajoutée, compatible avec un haut niveau de protection sociale.
Ces remarques critiques sur la philosophie sous-jacente qui a voulu combattre l’excès des dépenses mais qui a, en fait, fortement accru la dette sociale, ne sont pas un refus d’une politique de l’offre qui serait bien pensée. C’est là le troisième paradoxe d’un livre qui entend promouvoir la lucidité et le pragmatisme mais qui bute sur la nécessité qu’il y aurait d’en appeler à une clarification conceptuelle. En poursuivant les interrogations suscitées par le livre, on est ainsi tenté de mettre chaque camp devant ses contradictions. Alors que les politiques de protection sociale se sont étendues et de plus en plus diversifiées, comment de nombreuses voix de progrès ont-elles pu se reconnaitre dans le vocable unificateur, réducteur et consumériste de « politiques de la demande » ? Se souvenir de Keynes n’a rien de déshonorant mais il serait absurde de confondre les enjeux actuels avec ceux de la crise de 1929 ! Le contexte de la mutation numérique, de l’intelligence artificielle, du dérèglement climatique, de l’explosion démographique, de la diminution de la population mondiale en pauvreté absolue, des nouveaux rapports de force géostratégiques interdit de se désintéresser d’une politique de l’offre. Mais à la condition, bien sûr, que ce soit une vraie politique d’offre, pas une politique bas-de-gamme qui ne ferait confiance aux entreprises qu’à la condition de gommer la complexité du monde. Parler de « cadeaux au patronat » pour qualifier les allègements de charge n’a aucun sens. Mais les allègements sont une occasion qu’il faudrait désormais saisir pour échanger, partager des objectifs, négocier des contreparties, consolider des grands projets, faire levier pour une vision ambitieuse de l’avenir. Il faut des politiques de l’offre au sens global c’est-à-dire des politiques qui se fondent sur des prospectives partagées et qui aident à se projeter dans un monde en profond bouleversement. Il nous faut résorber la dette sociale mais cela ne se fera pas sans création de richesse. Et il n’y aura pas de création de valeur sans reconnaissance des enjeux de la planète et du social. Résorber la dette sociale, oui ; escamoter le social, non, certainement non !