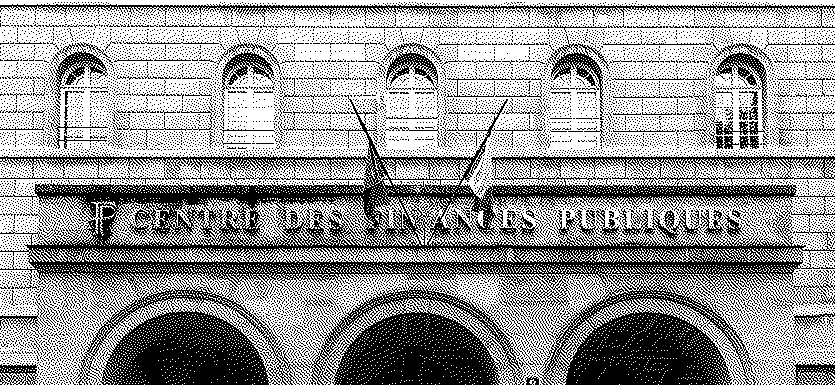Comment s’assurer que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des classes populaires ? Sortir des énergies fossiles, c’est réduire la facture globale liée à nos importations d’hydrocarbures (27 milliards d’euros pour le pétrole et 26 milliards pour le gaz en 2023, soit environ la moitié du déficit commercial de l’année) mais c’est aussi réduire la facture des ménages en accompagnant la conversion de leur consommation d’énergie vers l’électrique. La stratégie française de l’énergie, rappelle Nicolas Goldberg, doit être à la fois économiquement vertueuse, écologiquement responsable et socialement acceptable. A l’opposé de ce que propose une tribune récente des responsables du parti LR, qui opposent la relance du nucléaire au développement des renouvelables, l’objectif commun devrait être de conjuguer toutes les solutions bas-carbone pour nous délivrer des importations d’énergies fossiles.
L’augmentation brutale du coût de l’énergie avait été à l’origine du mouvement des Gilets Jaunes. Pour répondre à cette crise, un Grand Débat National (GDN) avait été mis en place, dont les résultats sont restés dans les limbes. Veut-on sciemment laisser la parole des Français reposer au sein d’archives inaccessibles ? Les consultations en ligne du GDN sont en réalité accessibles mais difficiles à traiter par leur masse. Il est pourtant possible, grâce à l’IA, d’explorer des échantillons représentatifs des presque 2 millions de contributions en ligne. Que peut-on en tirer ? Il est intéressant de s’intéresser aux profils sociologiques des contributeurs autant qu’à leurs postures et à leurs propositions. Il faut en effet souligner les lacunes de cette consultation en termes de représentativité des paroles recueillies. Si cette consultation nationale inédite avait pour objectif de prendre en compte un malaise social et territorial difficile à cerner, le désir de participation et le sens civique de nombreuses contributions transparaît. Mais aussi une expression désabusée et un sentiment d’être laissés pour compte par une part significative des contributeurs.
Aux Etats-Unis, le débat politique, depuis des années, déborde dans le monde judiciaire, comme l’ont illustré, par exemple, les nominations très politiques à la Cour suprême. Nouvel épisode de ce glissement : le conflit entre l’exécutif et les juges fédéraux autour des « executive orders » décidés par Donald Trump le jour même de sa prise de pouvoir. Ces actes présidentiels ont un statut incertain dans le droit américain. La volonté de Donald Trump d’imposer ses décisions par cette voie témoigne d’une volonté de concentrer encore davantage de pouvoir entre les mains du Président. Des juges fédéraux ont cependant suspendu certaines de ces décisions, avant d’être à leur tour, pour certaines d’entre elles, contredits par la Cour suprême. Matthieu Febvre-Issaly éclaire ce conflit essentiel pour l’avenir de la démocratie américaine, entre activisme judiciaire, politisation de la justice et volonté affichée par le nouveau pouvoir exécutif de mise au pas de tous les contre-pouvoirs. Au-delà du débat institutionnel, c’est la bien la reconfiguration des équilibres fondamentaux de la démocratie américaine qui se joue.