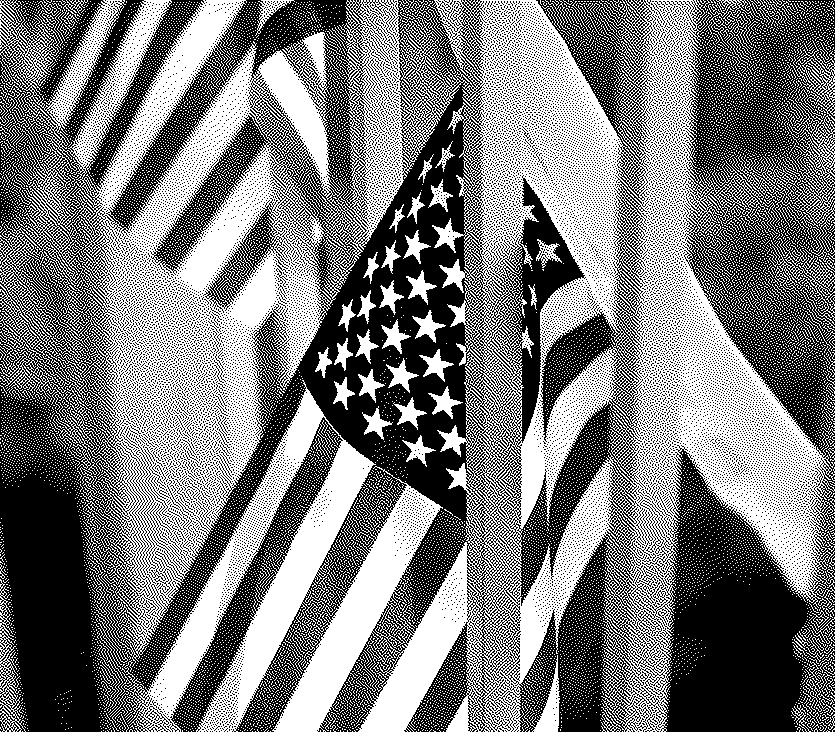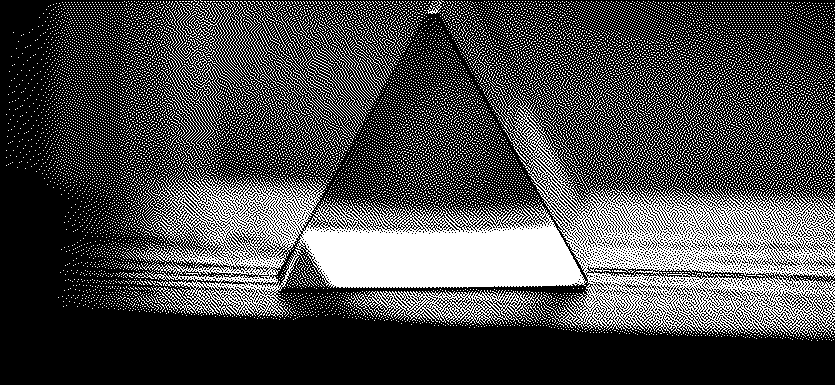Même si la marge qui sépare Kamala Harris de Donald Trump en suffrages à l’échelle nationale – moins de 1,6 % – est loin de constituer un raz-de-marée, pour les Démocrates le résultat des élections 2024 est globalement désastreux : ils ont perdu la présidence et le Sénat, sont restés une fois de plus minoritaires, de quelques sièges, à la Chambre des Représentants. Partout ou presque, même dans les Etats à forte majorité démocrate, le vote pour Kamala Harris est en retrait par rapport à celui de Joe Biden en 20201. Les sondages qui semblaient indiquer jusqu’à la dernière minute que l’élection était partout très serrée et partout jouable pour les Démocrates, étaient erronés comme ceux de 2016 qui garantissait à Hillary Clinton une victoire très facile en sous-estimant la poussée de Trump.
Cette défaite, dont les conséquences sont très graves pour les Etats-Unis et le monde, n’a pas manqué de bouleverser le parti et de susciter des diagnostics contradictoires accompagnés de leçons stratégiques qui font également polémique. Les médias ont tendance à présenter cette situation comme une simple querelle de factions qui se rejettent la responsabilité de la défaite (the « blame game ») mais il s’agit d’un débat stratégique essentiel et incontournable.
Dans un premier temps et en dépit de vrais désaccords politiques, un consensus a minima a émergé parmi les Démocrates pour reconnaître 1) que Kamala Harris a mené sa campagne dans des conditions difficiles puisqu’elle n’a disposé que de 100 jours entre le retrait de Joe Biden et la date de l’élection ; et 2) qu’un problème sérieux de communication a empêché Kamala Harris et le Parti démocrate en général de toucher un large public populaire. Le message de Kamala Harris n’a pas réussi à percer dans le monde des électeurs de Trump, où le bruit permanent, les outrances et la désinformation l’ont emporté faute de message suffisamment percutant venant du camp démocrate.
Pour certains commentateurs proches du terrain médiatique de la campagne, le problème de communication se résumait à une stratégie médiatique insuffisamment audacieuse : n’aurait-il pas fallu par exemple que Kamala Harris prenne plus de risques en se présentant dans des espaces médiatiques populaires tels que le podcast de Joe Rogan (entre 10 et 15 millions d’auditeurs) ? N’aurait-elle pas ainsi multiplié ses chances de rallier ou de récupérer beaucoup d’électeurs tentés par Trump mais indécis ?
En termes pratiques, on ne saurait se contenter cependant d’une critique qui se limite à la stratégie d’insertion dans les médias et les réseaux sociaux. C’est un sujet important bien sûr, mais les critiques qui vont plus loin et donnent de la consistance au débat politique auquel sera confronté le Parti démocrate dans les mois à venir, portent autant sur la substance de la campagne que sur sa forme et ses espaces de communication.
Le consensus a minima va jusqu’à reconnaître que l’offre politique des Démocrates a été rejetée par beaucoup d’électeurs. Mais, à partir de là, se dessinent deux perspectives critiques divergentes basées sur deux lectures opposées des événements. Quelque jours après le 5 novembre, un clivage se confirme déjà entre une critique dite « centriste », qu’on pourrait également appeler de droite, qui consiste à reprocher aux Démocrates de s’être aventurés trop loin « à gauche », c’est-à-dire en s’associant de trop près à des causes marginales qui détournent trop d’électeurs de leur camp et prêtent le flanc aux critiques évidemment outrancières de Trump ; et une critique de gauche consistant principalement à reprocher au parti d’avoir négligé les préoccupations des travailleurs, d’être resté trop dépendant par rapport aux gros donateurs et de s’être privé ainsi de la possibilité de proposer des mesures susceptibles de répondre à ces préoccupations, en laissant à Trump, et à l’oligarchie qu’il défend, le terrain du « populaire ».
La critique « centriste » des mouvements radicaux
L’une des versions les plus claires de la critique dite centriste a été formulée par Adam Jentleson, ancien chef de cabinet de deux sénateurs et commentateur politique. Jentleson reproche d’abord aux Démocrates de ne pas avoir eu une stratégie capable de viser et d’atteindre une « supermajorité » alors que Trump s’est donné les moyens d’une telle stratégie2. Trump a pu réaliser un réalignement électoral en « surperformant chez les électeurs noirs, hispaniques et de classe ouvrière ». Si les Démocrates n’ont pas pu avoir de telles ambitions, selon Jentleson, c’est parce qu’ils « restent handicapés par leur tendance à fétichiser la gestion des coalitions aux dépens d’une vraie recherche de pouvoir ». Autrement dit, ils sont contraints de « tenter de plaire à tous leurs groupes d’intérêt tout en étant désertés par des électeurs de toutes origines « à cause des prises de position que ces groupes imposent au parti ». Pour atteindre une « supermajorité » il faudrait que les Démocrates « déclarent leur indépendance par rapport aux groupes d’intérêt progressistes ». Ces groupes « imposent les mœurs rigides et le vocabulaire d’élites diplômées ».
De quels groupes d’intérêt s’agit-il ? Selon Jentleson, les groupes en question « ont tendance à être des organisations à but non lucratif qui se battent sur une seule question (single issue) ou des ensembles de questions qu’ils espèrent insérer dans l’agenda du parti ». Ces groupes, dit-il, peuvent être des partenaires constructifs des Démocrates mais dans certains cas ils sont devenus « trop grands » et ont « adopté des missions trop amples » qui ne tiennent pas compte selon lui des « réalités fondamentales de la politique américaine ».
Le premier exemple que Jentleson cite pour illustrer son propos est la cause des droits des personnes transgenre. Il reproche à l’American Civil Liberties Union (ACLU) d’avoir poussé Kamala Harris en 2019 à formuler une position sur le droit aux opérations chirurgicales des prisonniers transgenre, « en élevant en test de pureté une question obscure » d’ailleurs déjà résolue par la loi. La campagne Trump en a profité pour bombarder les téléspectateurs des matchs de football américain de spots de campagne incitant à la méfiance envers Kamala Harris et les Démocrates à cause de leurs « mauvaises priorités ». La position de la candidate a été naturellement caricaturée mais il suffisait de l’associer en quelques secondes avec une cause marginale et – pour les trumpistes en tout cas – suspecte.
De même, selon Jentleson, les Démocrates auraient trop cédé aux mouvements de défense des droits des immigrés et aux mouvements pour la réforme de la police, à cause de groupes tels que les Justice Democrats, le Sunrise Mouvement (écologiste) et le Working Families Party (groupement de New York qui appuie des mouvements sociaux urbains et des candidats progressistes, le plus souvent démocrates de gauche).
Pour Jentleson, il faudrait que les Démocrates refusent le soutien de ces groupes lorsque leurs positions s’exposent aux attaques républicaines et « provoquent des réactions négatives (backlash) au lieu de servir nos objectifs ». Il faudrait aussi que les groupes en question apprennent à respecter des limites en s’adaptant au système tel qu’il est, c’est-à-dire en reconnaissant que tout changement est progressif (incremental) et ne peut pas être le produit de campagnes « maximalistes ».
Les thèses de Jentleson constituent une version plus affinée de la critique centriste qui s’exprime aussi sous des formes plus sommaires, par exemple l’appel à la rupture avec le « woke » afin de ne pas choquer les électeurs (c’est l’avis de James Carville, célèbre consultant politique démocrate) et afin d’occuper résolument le centre politique, en reconnaissant, comme le dit un membre du Comité national du parti (DNC), « que le pays n’est pas progressiste, pas très à gauche ni très à droite mais au milieu »3.
La critique sociale : retrouver le soutien des travailleurs
La gauche n’a pas attendu la fin de la campagne électorale pour exprimer une critique très différente de celle de Jentleson. Le sénateur Bernie Sanders et d’autres élus, syndicalistes et militants ont participé activement à la campagne de Kamala Harris tout en affirmant que cette campagne ne se donnait pas les moyens de convaincre les travailleurs (the working class). Dès le lendemain de l’élection, Sanders a tweeté : « Nous ne devrions pas nous étonner que le Parti démocrate, qui a abandonné les travailleurs (working class people), découvre que les travailleurs l’ont abandonné. » Il a ajouté : « C’étaient d’abord des travailleurs blancs, maintenant des travailleurs latinos et noirs aussi ». La raison de cette saignée d’électeurs : « Alors que la direction démocrate défend le statu quo, le peuple américain est en colère et veut du changement et il a raison. »
Sanders, on le sait, fait partie du groupe des élus démocrates au Congrès tout en gardant son indépendance. Il n’a pas hésité, dans son message du lendemain de l’élection, à questionner la capacité des Démocrates à devenir un parti majoritaire :
Les intérêts du grand capital et les consultants bien rémunérés qui contrôlent le Parti démocrate apprendront-ils quelques vraies leçons de cette désastreuse campagne ? Comprendront-ils la douleur et l’aliénation politique qu’éprouvent des dizaines de millions d’Américains ? Savent-ils comment affronter l’oligarchie de plus en plus puissante ?
A ces questions il répond : « Il est probable que non » et conclut en invitant le public à « rester à l’écoute » puisque « des discussions politiques très sérieuses » vont avoir lieu. Nous savons déjà comment le courant de gauche qui s’inspire de Sanders entend orienter ces discussions. Dans la même interview, Sanders affirme que les travailleurs ont besoin d’une explication claire des raisons de leur souffrance et de leur aliénation. Un système politique qui permet à une oligarchie économique de devenir si puissante est la clé d’une explication concrète. Mais puisque les Démocrates n’ont pas su mettre en évidence cette explication en désignant et en dénonçant l’oligarchie, la voie était ouverte à Trump pour fournir sa propre explication : vous souffrez à cause des immigrés – explication délirante (« pretty crazy ») dit Sanders, mais efficace, faute d’une explication plus concrète accompagnée de luttes pour imposer, face à l’oligarchie, une autre politique plus égalitaire.
La direction en place contre la gauche
La déclaration de Sanders n’a pas manqué de susciter une vive réplique de la direction du Comité national démocrate (DNC). Son président actuel, qui arrive en fin de mandat, Jaime Harrison, a répondu avec ce tweet du 7 novembre :
C’est tout simplement du bullshit. Biden est le président plus pro-ouvrier de ma vie. Il a sauvé les pensions, a créé des millions d’emplois bien payés, a même marché avec un piquet de grève. Les plans de Madame la Vice-Présidente auraient fondamentalement transformé la qualité de la vie et aboli les inégalités raciales en matière de richesse pour les travailleurs de tout le pays. Les crédits d’impôts pour les enfants, l’apport de 25.000 dollars pour l’acquisition d’un premier logement, l’aide aux soins à domicile…
Nancy Pelosi, ancienne présidente et toujours membre de la Chambre, a répondu dans le même sens. Pour les dirigeants « centristes », le manque de soutien des Démocrates aux travailleurs n’est pas vraiment un problème.
Sanders reconnaît volontiers en Joe Biden un président qui a beaucoup accompli pour les travailleurs, mais cela ne change pas quelques faits têtus qu’il ne cesse de rappeler4 : la majorité des ménages n’a pas d’épargne et vit de salaire en salaire ; plus de 30 millions d’Américains n’ont pas toujours d’assurance médicale ; 25 % des personnes âgées vivent de moins de 15.000 dollars annuels ; le taux de pauvreté chez les enfants reste plus élevé que dans tous les autres pays développés ; la majorité des parents craignent que leurs enfants aient un niveau de vie plus bas que le leur. Et d’ajouter : les milliardaires restent libres d’acheter les élections. Si le Parti démocrate se libérait de la dépendance par rapport aux intérêts des grandes entreprises, il pourrait revendiquer et fournir la santé pour tous, l’éducation publique de qualité pour tous, l’expansion des retraites etc.
Les sondages de sortie des urnes indiquent clairement que de nombreux travailleurs ont fui les Démocrates. En 2024, Trump a capté les voix d’une courte majorité des personnes gagnant moins de $100.000 par an tandis que Kamala Harris, la Démocrate, a gagné, également de peu, l’électorat des personnes gagnant plus de $100.000 5.
Les Démocrates réticents ou hostiles à ce que propose Sanders essaient de cataloguer sa perspective comme exclusivement focalisée sur la redistribution des richesses, à l’exclusion de toutes les autres sortes d’enjeux qui ont pu ou pourraient mobiliser les électeurs démocrates. Sanders résiste à cette caractérisation. Lorsqu’une journaliste lui a demandé s’il est vrai que sa vision se limite à l’économie et néglige les questions dites « culturelles » qui peuvent préoccuper la classe ouvrière – autrement dit, s’il regrettait une dérive vers les identity politics,il a répondu ainsi :
Le Parti démocrate doit continuer à se dresser contre toutes les formes d’intolérance. Les Démocrates doivent être fiers de dire que nous avons mené la lutte pour les droits des femmes et la protection du droit à l’avortement. Nous avons mené les luttes pour les droits civiques, les droits des gays, nous devons en être fiers. Mais nous ne sommes pas obligés de choisir. On peut avancer dans deux directions à la fois : augmenter le salaire minimum, garantir la santé pour tous, mais aussi soutenir les droits des femmes à contrôler leur propre corps 6.
Mouvements sociaux et parti électoral selon Waleed Shahid
Waleed Shahid, stratège politique de gauche, ancien directeur de Justice Democrats, a accompagné plusieurs candidats au Congrès, dont les représentants au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez et Jamaal Bowman. Par le biais d’une réponse argumentée à Jentleson, il enrichit la critique de Sanders7. D’abord, affirme-t-il, les organisations à but non lucratif que Jentleson désigne comme des saboteurs électoraux des Démocrates, sont loin d’avoir toute la puissance que cet auteur leur attribue. Ce sont plutôt « les Démocrates liées aux grandes entreprises (corporate Democrats)… qui ont eu le plus d’influence sur la campagne de Harris », d’où une stratégie consistant à s’approcher de célébrités ultra-riches, du millardaire Mark Cuban, des Républicains Liz et Dick Cheney, et à « éviter toute rhétorique populiste susceptible d’aliéner le soutien des élites économiques qui dominent le parti. »
Shahid reconnaît que « certains jeunes militants de gauche pratiquent une politique puriste » mais il soutient que, dans les cas connus de prises de position démocrates excessivement polarisantes en situation de campagne sur des thèmes de société ou de sexualité ou de frontières etc., ce sont en général les candidats eux-mêmes qui en sont responsables, beaucoup plus que des organisations extérieures que Jentleson met en cause.
A ce propos, la réaction contre ce que la droite appelle le woke, exploitée par tout le mouvement MAGA (pro-Trump), repose souvent, soutient Shahid, sur des critiques vagues qui cachent mal des idées et des pratiques intolérantes. En prenant la contre-offensive, il ne revendique évidemment pas le « woke » tel que caricaturé par la droite, mais il plaide en faveur d’une prise en compte des enjeux concrets que cache et déforme la dénonciation rituelle du woke. L’antiwoke a certes pour fonction de détourner l’attention des politiques très antisociales (par ailleurs clairement annoncées), mais en poussant à l’intolérance voire à la haine (de l’immigré, du musulman, etc.) Un exemple-clé : l’immigration et la frontière. Shahid observe que, de 2017 à 2020, les Démocrates, dont Kamala Harris, avaient hâte de condamner les politiques cruelles et arbitraires de Trump. Depuis le début de la présidence de Biden, ils s’efforcent soit de fuir le sujet soit, pour les besoins de la campagne contre Trump, de s’adapter en girouette à l’opinion telle que mesurée dans les sondages et conditionnée par le bruit de fond de Trump en campagne, où chaque immigré passant par la frontière sud est un assassin ou un voleur en puissance. La course des Démocrates vers le centre, qui finit bien à droite à force de rechercher un compromis législatif avec MAGA, n’est pas ce que la question de l’immigration exige. Pour promouvoir une approche nécessairement complexe de l’immigration, les Démocrates auront besoin dans l’avenir de faire des efforts de « persuasion à longueur d’année » en fonction d’une politique d’immigration assumée, au lieu de rechercher un consensus opportuniste autour du tout-répressif.
Alors que Jentleson se méfie des organisations issues de mouvements sociaux qui seraient des foyers selon lui du « woke » et d’autres excès de militantisme, Shahid prône une collaboration fructueuse entre parti et mouvements. Les mouvements et les partis fonctionnent bien ensemble, écrit-il, lorsque « les mouvements font reculer les frontières du possible, créant ainsi l’espace politique pour redéfinir des questions telles que les droits des personnes transgenre ou l’immigration en termes majoritaires », tandis que « les politiques suivent lorsque le climat politique s’aligne avec leur intérêt propre. » Cette dynamique engendrera inévitablement des conflits mais « c’est dans la tension que réside le progrès ». Les Démocrates ne doivent pas avoir peur de ce processus. Au lieu de céder la maîtrise du récit à l’extrême droite – un récit « simple et chargé d’émotion » – il faut mener « des campagnes populistes qui n’ont pas peur de contrarier les « vilains » (villains) », c’est-à-dire les puissants intérêts qui vont résister au changement, de mettre en valeur l’humanité des communautés marginalisées, et démasquer pour mieux le combattre les tactiques de division Républicains pour mieux régner.
Le « populisme » dont se réclame Shahid doit être compris au sens nord-américain du terme, c’est-à-dire en référence à l’héritage du People’s Party de la fin du XIXe siècle. Aux Etats-Unis et à gauche, le terme populisme doit sa connotation positive à un mouvement réellement populaire, de petits et moyens agriculteurs et d’ouvriers, visant à imposer démocratiquement, contre les monopoles industriels et ferroviaires, un système économique plus égalitaire. Nous sommes loin du concept de populisme tel que défini par les politistes européens de nos jours, en référence presque exclusivement aux partis d’extrême droite ethnonationalistes8.
Le chemin que les Démocrates auraient à traverser pour devenir une force populiste au sens nord-américain du terme n’est pas tracé d’avance. Comme le note Shahid : « Le succès ne vient pas en rejetant la complexité d’une coalition diverse mais en apprenant à naviguer cette complexité ». Ce qui n’exclut pas du conflit, car il ajoute : « Si les forces du statu quo se mettent en travers de la voie du changement, il faut les déplacer. »
Du faux populisme trumpiste à la reconquête d’une majorité populaire selon Jonathan Smucker
Si Trump est un « populiste » au sens autoritaire et non démocratique du terme, il importe de comprendre comment fonctionne le « populaire » dans son discours et sa mise en scène. Jonathan Smucker, militant de gauche de la Pennsylvanie observe que « lorsque Trump porte des coups vers le bas (punches down) à des groupes vulnérables, il se présente en même temps comme portant des coups à ceux d’en haut (punching up), les élites culturelles condescendantes, fortement associées au Parti démocrate » 9. Il s’agit donc d’un « antiélitisme ambigu » ou un « faux populisme », qui « ne désigne pas le pouvoir économique comme responsable, mais les médias, l’université, Hollywood et, bien entendu, les élus démocrates. Si cela marche, c’est parce que le pouvoir économique est perçu comme abstrait, c’est-à-dire comme une force à laquelle on ne peut que se soumettre… tandis que l’élitisme social a un visage et provoque un ressentiment plus viscéral. »
Pour être en mesure de répondre efficacement à ce « faux populisme », il ne suffit pas, soutient Smucker, d’aligner les bonnes propositions de gouvernement. Il rappelle, comme le fait souvent Bernie Sanders, que « la plupart des Américains vivent de salaire en salaire et dans ce contexte la compétence de Trump consiste à faire écho au mécontentement populaire. » Son message pourrait se réduire à ceci : « Je vais détruire les élites qui ont dévasté notre pays. » Pour avoir une chance de gagner contre cette stratégie en retrouvant le soutien populaire, les Démocrates doivent se décider eux aussi des « nommer les coupables » : pas les jeunes transgenres dans des équipes de sport, pas les Haïtiens installés dans l’Ohio, mais plutôt Wall Street et les milliardaires rapaces qui maintiennent la majorité de la population dans l’insécurité économique.
Pour avoir une chance de succès, il faudrait également, souligne Smucker, que les Démocrates remettent en cause une stratégie électorale consistant à chercher leur marge de victoire dans les classes moyennes des banlieues pavillonnaires pour compenser une perte de soutien des couches populaires. Cette stratégie avait été rendue explicite par le Sénateur démocrate Charles Schumer de New York, actuel président du Sénat, qui déclaré explicitement en 2016, quelques semaines avant la défaite de Hillary Clinton, que « pour chaque ouvrier de col bleu qu’on perd dans l’ouest de la Pennsylvanie, nous récupérerons deux voix de Républicains modérés des banlieues (suburbs) de Philadelphie et vous pouvez répéter cela pour l’Ohio, l’Illinois et le Wisconsin ». (Notons que le terme suburb aux Etats-Unis suggère presque toujours des espaces résidentiels où habitent des diplômés et des professionnels.) Cette stratégie a effectivement aidé les Démocrates à récupérer du terrain lors des élections de mi-mandat en 2018, à reprendre la présidence en 2020 et à limiter les dégâts des élections de mi-mandat de 2022. Mais à long terme c’est une stratégie perdante pour une raison sociologique évidente : il y a plus de travailleurs que de résidents des suburbs.
A deux reprises, en 2016 et en 2020, l’establishment du Parti démocrate a déployé tous ses moyens pour empêcher Bernie Sanders de devenir le candidat à la présidence. Ils pensaient ainsi se rendre plus acceptable aux électeurs indécis, notamment des classes moyennes. Mais en étouffant l’esprit combatif et l’enthousiasme engendré par ces mouvements de réforme profonde, ils ont, à l’avis de Smucker, facilité deux mandats de Trump en attendant de savoir s’ils ont également facilité la consolidation d’un réalignement autoritaire de l’électorat à plus long terme.
A l’appui de sa thèse sur la nécessité d’un changement de stratégie, il cite une source inattendue : l’éditorialiste David Brooks de l’équipe du New York Times, qui se définit comme « modéré ». Sa rubrique du 13 novembre 2024, intitulé « Maybe Bernie Sanders Is Right » (Peut-être que Bernie Sanders a raison 10), il constate que les clivages de classe s’expriment aujourd’hui comme « un gouffre profond » entre les diplômés de l’université et ceux – beaucoup plus nombreux – qui ont seulement des études secondaires. Pour gagner ailleurs que dans les régions où abondent les diplômés, les Démocrates doivent « sortir de leurs bulles » et mieux comprendre comment pensent les électeurs travailleurs. Cela suppose, bien entendu, un changement de politique et pas seulement de message. Bien qu’il soit un « modéré » qui « n’aime pas les politiques proposées par Bernie Sanders », il reconnaît que Sanders a compris la nécessité de bouleverser (disrupt) le système pour capter l’attention des travailleurs. « Il serait peut-être temps, écrit-il, que ces deux versions du populisme s’affrontent ».
La guerre à Gaza a-t-elle pesé dans la défaite des Démocrates ?
Dans le débat dont nous rendons compte, les questions de politique étrangère sont très peu abordées parce qu’elles influent relativement peu sur les choix des électeurs, sauf exception. En 2024 la guerre à Gaza après le 7 octobre 2023 a fait partiellement exception. Elle a provoqué le décrochage et l’opposition ouverte de dizaines de milliers de jeunes électeurs qui auraient pu voter pour Kamala Harris. Des électeurs qui reconnaissaient dans beaucoup de cas que Trump n’avait pas plus à proposer aux Palestiniens que Biden, mais qui ne pouvaient pas cautionner la politique menée par l’administration Biden et ont préféré s’abstenir de voter pour Kamala Harris. Ce facteur a joué un rôle majeur dans le résultat de l’Etat-clé du Michigan, où résident, pour la plupart en banlieue de Detroit, plus de 200.00 électeurs arabes américain et/ou musulmans. Leur soutien massif à Joe Biden en 2020 s’est évaporé en 2024. Dans la primaire démocrate du 27 février 2024 plus de 101.623 électeurs (ou 13, 2 % ont voté « non engagé » (uncommitted) au lieu de désigner Joe Biden comme leur candidat préféré (contre 81,1 % pour Biden et 5,7 % pour deux candidats mineurs). Dans l’élection du 5 novembre, la candidate verte Jill Stein a recueilli 44.637 suffrages. La marge de la défaite de Kamala Harris dans le Michigan a été de 80.103 voix seulement.
Au Michigan ce facteur a donc été déterminant. Ailleurs, y compris dans quelques Etats-clé (Arizona, Géorgie, Pennsylvanie, Wisconsin), ce facteur compté, même s’il a été moins déterminant, puisque que beaucoup d’électeurs jeunes, de diverses origines, ont préféré ou s’abstenir ou investir leur énergie militante ailleurs que dans l’élection de la vice-présidente de Joe Biden.
Le Parti démocrate changera-t-il ?
L’élection de Trump, cette fois-ci avec une (courte) majorité au suffrage universel, signifie-t-elle que « le pays est passé à droite » ? L’Etat fédéral va certainement passer très à droite après janvier 2025, mais il est sans doute exagéré de dire que c’est le cas du « pays » dans son ensemble. La signification du vote Trump est différenciée : il y a un vote d’adhésion à tout un programme idéologique et un vote de détresse et de colère plus diffuses, souvent d’électeurs très peu informés sur les enjeux. Les campagnes de Bernie Sanders dans les élections primaires de 2016 et de 2020 (avant la pandémie) ont montré la capacité de la gauche à apporter des réponses aux électeurs en colère, puisque ce candidat a réussi à mobiliser, au-delà des électeurs démocrates habituels, beaucoup d’électeurs qui auraient pu être tentés d’emblée par Trump (et qui ont fini par l’être, une fois Sanders éliminé). En l’absence d’une option de gauche à l’élection présidentielle de 2024 comme à celles de 2016 et de 2020, c’est l’option Trump qui était la seule expression d’une volonté de rupture avec le système en place, même s’il était également le candidat pro-oligarchie.
Compte tenu du débat interne au Parti démocrate dont les termes commencent à se clarifier, que va-t-il se passer ? Il est évident qu’à partir de 2025 les Démocrates élus auront d’autres préoccupations que les prochaines élections en essayant de se défendre et de défendre leurs concitoyens contre une présidence qui s’annonce comme un changement de régime dans un sens autoritaire. Mais il y a aura des élections de mi-mandat fin 2026, et il n’est jamais trop tôt pour formuler et mettre en œuvre une stratégie gagnante. L’élection d’un nouveau président (chair) du Democratic National Committee (DNC, l’organe de direction des Démocrates) est prévue le 1er février 2025. Toutes les candidatures ne sont pas encore déclarées, mais un candidat probable, Ken Martin, l’actuel responsable (chair) du parti dans l’Etat de Minnesota est considéré comme un peu plus proche de la gauche que les autres, et parmi les mieux placés des candidats probables en tant qu’actuel président de l’association des responsables du parti des 50 Etats fédérés. Dans une interview avec le New York Times il a déclaré :
Une chose que je trouve profondément alarmante… c’est que pour la première fois… la majorité des Américains croient que les Parti républicain représente mieux les intérêts des travailleurs et des pauvres, et que le Parti démocrate représente les intérêts des riches et de l’élite. Cela suggère que nous avons un gros problème d’image de marque (branding) parce que notre parti, ce n’est pas ça ! Nous devons mieux faire pour que les gens – tous et d’où qu’ils viennent – sachent que nous nous battons pour eux, que nous sommes leur champion dans ce pays11.
Il n’est pas certain que la terminologie du marketing soit le plus pertinent pour son propos, mais en tout cas ce candidat a compris qu’il y a un problème de classe sociale et de statut, que les Démocrates se situent actuellement du mauvais côté du clivage, et qu’il convient de lutter efficacement contre un danger de réalignement de classe durable.
Comme le souligne Waleed Shahid, cité plus haut, le Parti démocrate à l’échelle nationale est une coalition diverse et donc complexe à « naviguer ». Il ne se transformera pas comme par magie en parti de gauche, « populiste » au sens positif où la gauche l’entend, mais en tout cas la défaite de 2024 provoque un débat stratégique approfondi qui n’a pas pu avoir lieu dans le feu des événements des trois dernières campagnes présidentielles.