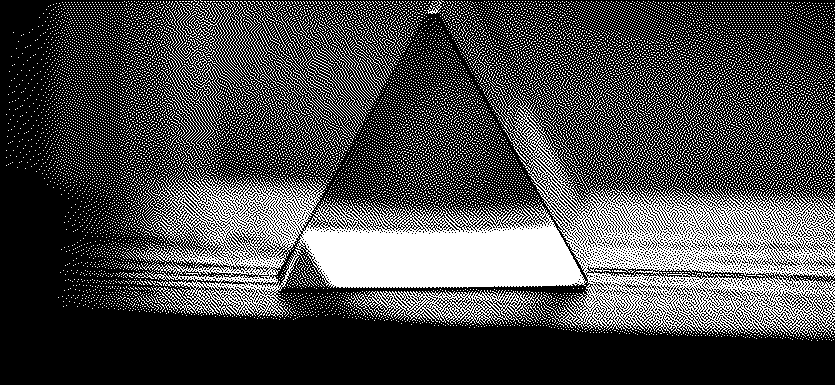Qui entend appréhender puis comprendre la guerre que mène le régime russe contre l’Ukraine doit d’abord considérer sa première manifestation, si l’on peut dire indépassable et inoubliable : le crime de masse. La guerre que mène la Russie en Ukraine est, de manière absolument exacte, une guerre d’extermination au même titre que celle d’Assad en Syrie et, pour prendre des exemples plus anciens, des Hutus contre les Tutsis et des Serbes de Bosnie contre la population bosniaque. La Russie de Poutine s’est rendue coupable en Ukraine de quatre catégories de crimes, tous parfaitement documentés : crimes de guerre, crimes contre l’humanité – caractère que revêtent les crimes de guerre dès lors qu’ils sont commis de manière systématique –, crimes de génocide – ce que sont, en droit, les déportations des enfants ukrainiens par la Russie, mais les autres crimes ont aussi une intention génocidaire, que révèlent les déclarations mêmes de Vladimir Poutine et de certains hiérarques du régime – et crime d’agression ou crime contre la paix, ce qui fut le facteur permissif de tous les autres.
Selon la formule consacrée, il existe des crimes qui ne se peuvent ni oublier ni pardonner. De fait, toute minimisation de ces crimes, toute tentative d’exclure Poutine et ses ministres du châtiment, toute prétention à « négocier » pour eux une forme d’immunité et d’empêcher la loi internationale de punir, et même toute irrésolution dans l’institution d’un tribunal spécial pour juger spécifiquement le crime d’agression, relèveraient de la trahison et du parjure. Mais le problème premier provient aussi du refus de recevoir des alertes précisément sur ces crimes, de ne pas avoir voulu percevoir la portée des crimes passés et, en fait, d’avoir déjà largement bafoué tant les exigences du droit international que nos impératifs de sécurité, sans même évoquer la simple décence.
La domination du crime et le silence des charniers
Les exactions à une échelle industrielle du régime de Poutine n’ont en effet pas commencé en Ukraine le 24 février 2022. Elles ont débuté en Tchétchénie, en particulier lors de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999-2000, dont l’origine a d’ailleurs été des attentats perpétrés par le FSB et imputés par le régime à des terroristes tchétchènes. Ils ont été également considérables – ils continuent d’ailleurs ce jour – en Syrie où les forces de Poutine, à elles seules, ont assassiné plus de civils syriens que même Daech. Quoique à une échelle moindre, de tels crimes ont été également commis en Géorgie comme l’a jugé, malgré certaines prudences dans la rédaction par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme en 2021. Bien sûr, ils ont déjà été le lot commun en Ukraine dès 2014, où des faits de torture et des disparitions forcées avaient déjà été documentés dans les zones occupées par la Russie, notamment en Crimée où les Tatars ont été persécutés en tant que tels.
Au-delà du fait même de l’absence de réponse à la politique d’agression du régime russe, c’est cet étrange silence des dirigeants occidentaux qui me paraît le plus éloquent. Ceux-ci ont fait comme s’ils voyaient en Poutine un dirigeant au pire mal commode et un peu brutal, mais non pas taillé dans le même bois que Pol Pot, Slobodan Milosevic, Amin Dada et Adolf Hitler. Ils ne voulaient pas voir que leur interlocuteur, voire « partenaire », était peu différent d’un Toto Riina, le chef mafieux le plus féroce de Sicile. Ils pouvaient lui serrer la main, lui donner l’accolade, le tutoyer et lui sourire ; ils ne l’auraient jamais fait avec Abou Bakr al-Baghdadi et Oussama ben Laden, alors que ses crimes sont considérablement plus nombreux que les leurs.
Je me souviens ainsi m’être retrouvé bien seul quand j’appelais à boycotter la coupe du monde de football de 2018 et il y eut globalement moins d’indignation que pour celle au Qatar – régime bien peu exemplaire certes, mais malgré tout nettement moins criminel. La campagne menée notamment par les activistes syriens et ukrainiens, à l’aide notamment des extraordinaires visuels réalisés par Andryi Yermolenko, a eu finalement bien peu d’impact. Je me rappellerai toujours certains dirigeants occidentaux et responsables des organisations internationales demander honteusement à Moscou de faire pression sur Damas pour qu’elle diminue ses crimes contre les civils syriens, alors même que la Russie en commettait quasiment autant. Rares ont été ceux qui ont nommé les crimes de guerre et contre l’humanité de Moscou à l’époque et demandé que Poutine soit jugé pour ses crimes. Notre ambassadeur de l’époque auprès de l’ONU, François Delattre, a été l’un des rares à comparer Alep à Guernica. Aujourd’hui encore, certains dirigeants occidentaux jouent aux vierges effarouchées lorsqu’on parle du « criminel Poutine » et qu’on évoque les crimes de génocide, puisque ce dernier implique, en principe, un devoir d’intervention.
Pour des raisons diplomatiques, certains dirigeants occidentaux ont continué à traiter Poutine comme un interlocuteur normal et même comme un « partenaire ». Ils ont feint de croire que le régime pourrait évoluer ; ils ont laissé le crime s’installer dans la banalité. Ils n’ont pas voulu comprendre que son régime était fondé sur le crime et que, pour ainsi dire, le crime était le message. Ils n’ont pas écouté les alertes précoces lancées, en Russie même, par Anna Politkovskaïa, Natalia Estemirova, Boris Nemtsov et tant d’autres, et en France même, dès le début des années 2000, notamment par André Glucksmann et Thérèse Delpech. Ils ont en quelque sorte non seulement bafoué les victimes et vite refermé leurs yeux sur les charniers, mais aussi, sur le plan stratégique, écarté tous ceux qui, avec insistance, voyaient la guerre venir. Comme l’écrivait Thérèse Delpech en 2005 dans L’ensauvagement : « La mémoire des crimes est une condition de la sécurité internationale. »
La politique occidentale vis-à-vis du régime russe : le passé et le passif
Comment définir le positionnement de la France et de plusieurs autres pays démocratiques vis-à-vis de cette crise et, plus généralement, vis-à-vis de la Russie ? Dans l’ensemble, avec une forme de continuité d’une présidence à l’autre, y compris avec l’alternance politique, une forme de déni a prévalu. Même François Hollande, pourtant le président le plus lucide sur la Russie de Poutine et qui a pris la judicieuse décision d’annuler le contrat des Mistral qui devaient être livrés à Moscou, n’a pas toujours donné suffisamment de la voix. L’attitude d’Emmanuel Macron, en particulier, même si elle a considérablement évolué depuis le 24 février 2022, laisse transparaître l’influence d’une série de conceptions erronées largement répandues chez les politiques et certains militaires et diplomates français. Prenons-en cinq.
Les tenants de la première conception prétendent que la Russie est un pays trop important pour qu’on prenne le risque de se fâcher avec elle. Ils la considèrent comme un interlocuteur nécessaire avec lequel il faudrait coopérer et commercer. Ils établissent ainsi – sans doute par un étonnant renvoi sur la manière dont ils perçoivent eux-mêmes la France – une hiérarchie implicite entre les Etats. Le P5 (appellation classique des cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies) fonctionne comme un miroir : il faut avoir du respect pour la Russie parce qu’on en demande pour soi-même. Il a longtemps fait figure de club où l’on lave son linge sale en famille. J’ai pu constater combien étaient rares, avant le 24 février 2022, les personnalités politiques, intellectuels et même spécialistes des questions internationales à s’être rendus en Ukraine comme si ce pays, grand comme la France, ne méritait pas qu’on s’y intéresse. Combien aussi n’ont guère de connaissance des Etats baltes ou des Balkans. Il n’est d’ailleurs pas certain que, malgré leurs éloges de la résistance du peuple ukrainien, ils ne continuent à considérer la Russie comme le seul pays qui compte vraiment. Cette conception trahit souvent une méconnaissance profonde de la réalité du régime au pouvoir à Moscou, ou plus précisément de l’État russe, qui est de plus en plus un Etat Potemkine où tout dysfonctionne, de l’école aux infrastructures, des hôpitaux – comme on l’a vu avec l’incapacité du système de soins de faire face à l’épidémie de la Covid-19 – à l’institution militaire – comme l’ont montré les défaillances criantes de l’armée russe. Sur ce dernier point, il serait d’ailleurs intéressant de comprendre comment des experts militaires occidentaux, par ailleurs sérieux, ont pu si facilement acheter les récits de la propagande russe sur la modernisation de l’armée. On pourrait bien sûr mentionner aussi la fuite massive des capitaux pendant les années Poutine et la fuite des cerveaux, celle-ci ayant privé la nation russe de toute innovation scientifique déterminante. S’ajoute à cette glorification de la Russie comme prétendue « grande puissance » une forme de romantisme un peu niais qui aime gloser, dans la version bistrot, sur une prétendue « âme russe » ou, de manière à peine plus sophistiquée, sur une culture russe certes souvent remarquable – quoique finalement relativement récente et courte en comparaison avec les cultures britannique, italienne, germanique, espagnole, française, etc. – alors que cette dernière ne dit rien sur le régime de Poutine lequel sait parfaitement l’utiliser comme une arme de propagande.
La seconde conception erronée consiste à ne pas comprendre les violations les plus monstrueuses des droits de l’homme non seulement dans leur gravité mais aussi dans leur signification ultime. On privilégie toujours la « stabilité », comme si les régimes autocratiques ne participaient pas d’une déstabilisation permanente de leurs voisins et des démocraties mêmes par le soutien de mouvements extrémistes et complotistes. Pendant vingt ans, certains ont ainsi entretenu le mythe de la Russie « partenaire de sécurité » et en ont même fait un supposé allié dans la lutte anti-terroriste ou même dans la lutte contre le changement climatique. Ils se sont bien sûr placés largement sous sa dépendance, en particulier dans le domaine des énergies fossiles.
Une troisième faute provient de ce que de nombreux dirigeants considèrent les Etats avant les régimes. Ils voient la permanence là où il y a rupture et la continuité là où il existe disruption. Ils tendent à faire des Etats des réalités intemporelles pour la même raison qu’ils essentialisent la culture et qu’ils naturalisent les peuples. Ce biais intellectuel n’est pas récent : c’est même une tendance ancienne que de concevoir les peuples comme déterminés par ce qui serait supposé rendre compte de leur être. Combien de fois n’a-t-on pas entendu proclamer que la Chine ne serait jamais mûre pour la démocratie en raison du confucianisme, les pays arabes et l’Iran en raison de l’Islam et la Russie en raison de sa « slavité », autrement dit sa propension à l’esclavage ? Ces vieilles représentations naturalistes et culturalistes ont la vie dure. Elles font évidemment bon marché, pour ne prendre que ces exemples, des Printemps arabes et des révoltes iraniennes, de la dissidence russe et des protestations en Chine en faveur de la liberté – sans même évoquer le fait qu’il existe bien une Chine démocratique : Taïwan. Sur le plan stratégique, ce biais qui invalide notre compréhension du réel avait été déjà pointé par Raymond Aron qui dénonçait la croyance en l’existence d’intérêts intangibles des Etats, alors que ceux-ci sont toujours construits politiquement et sont fondamentalement liés à un système de valeurs et non pas d’abord à un héritage historique ou à une situation géographique. Aron montrait aussi que la compréhension de la politique étrangère d’un pays passait par celle de l’idéologie caractéristique de son régime et non pas un recours à une improbable essence. Parlant ainsi de l’URSS, il disait que la Russie aurait eu d’évidence une autre politique étrangère si elle n’avait pas été communiste. On peut aujourd’hui dire de la même façon qu’elle est totalement dépendante de l’idéologie portée par Poutine, idéologie en fait de pure destruction. Beaucoup n’ont pas souhaité comprendre cette idéologie au motif qu’elle était plus « discrète » que celle du régime communiste. Or, ce n’est pas parce que Poutine n’a pas rédigé de Manifeste du Parti communiste, de Petit livre rouge (ou vert) ou l’équivalent d’un Mein Kampf que cette idéologie n’existe pas, comme l’a magistralement montré notamment Timothy Snyder dans The Road to Unfreedom1. Ils auraient pu ainsi mieux comprendre, pour ne prendre que cet exemple, que la rhétorique de l’humiliation est aussi fausse dans le cas du régime russe qu’elle l’était dans celui de l’Allemagne : dans l’un et l’autre cas, ce furent des chevilles rhétoriques utilisées par Poutine et Hitler. Ils auraient ainsi mieux compris que le projet de destruction de l’Ukraine était ancien chez Poutine et que, compte tenu de son idéologie, toute réconciliation avec ce régime tenait de l’illusion.
Une quatrième incompréhension de la nature du pouvoir russe réside dans une vision simplifiée et pour tout dire fausse de la diplomatie gaullienne ou de ce que certains ont cru pouvoir appeler, sans aucune considération pour la réalité historique, la doctrine gaullo-mitterrandienne. Ni le Général de Gaulle ni François Mitterrand ne considéraient qu’il fallait tenir à égale distance la France ou l’Europe et la Russie. La France, pour de Gaulle, était clairement dans le camp occidental et atlantiste : il l’avait spécifié dans son discours devant le Congrès américain en 1960, l’avait réitéré lors de la crise de Berlin de 1961 et lors de l’affaire des missiles de Cuba. Si la France sous de Gaulle est sortie du commandement intégré de l’OTAN en 1966, c’est essentiellement pour assurer l’indépendance de sa dissuasion nucléaire et la France est restée membre de l’Alliance. Lors de son voyage en URSS en 1966, il a clairement dit qu’il souhaitait que le peuple russe recouvre la liberté. Quant à Mitterrand, on sait qu’il avait soutenu le déploiement des Pershing américains en Allemagne lors de la crise des euromissiles. Il n’y a pas eu non-alignement français. La France a toujours su et dit qui étaient ses alliés et l’URSS n’en faisait pas partie. Ceci n’exclut pas des divergences avec Washington comme lors de la seconde guerre du Golfe ou sur les questions économiques et commerciales.
Enfin, toujours au mépris de la vérité historique, beaucoup ont fait droit à une vision peu informée de la réalité de la Russie qui a laissé le champ libre à l’idéologie, c’est-à-dire une réalité inversée. Ils ont ainsi parfois repris, consciemment ou non, le récit de propagande de Moscou, là aussi au mépris des crimes de grande ampleur commis par le régime russe, comme s’il pouvait y avoir une « explication » à ceux-ci – explication qui ressemble trop souvent à une justification. Plusieurs canaux d’influence contribuent à relayer la vision du Kremlin en France. On y trouve certes les admirateurs d’un régime fort à l’extrême droite et au sein d’une extrême gauche « campiste » (ceux qu’on appelle généralement en anglais les « tankies ») peu soucieuse des droits de l’homme et qui ne voient l’impérialisme que du côté de l’Occident. Ces deux tendances extrêmes sont taraudées par un mélange d’anti-américanisme de principe, de rejet de l’OTAN et de l’atlantisme, mais aussi de l’Union européenne, et finalement une révérence aux empires, doublées parfois de corruption personnelle. Il existe toutefois une autre tendance, à certains égards plus ravageuse car plus discrète, qui est également caractéristique de personnalités et d’analystes considérés comme plus modérés. Ce discours s’est un temps affaibli mais reprend depuis quelques mois avec l’installation de la guerre dans la durée. Il fait droit à une prétendue « humiliation » des Russes qui n’est rien d’autre que la fiction construite par Moscou. Il conviendrait dès lors de faire preuve de « compréhension ». On en retrouve certains dérivés dans les propos qui suggèrent que la France ne devrait pas être sur une position jugée atlantiste et que l’OTAN porterait une part de responsabilités – alors même que personne ne peut sérieusement acheter le discours du Kremlin selon lequel la guerre de Poutine contre l’Ukraine serait une réponse à une menace de l’Alliance atlantique. Dans le même esprit, d’autres et souvent les mêmes accréditent le récit russe d’une « menace » qui n’est d’ailleurs pas cru par leurs inventeurs et imaginent qu’il faudrait y répondre en donnant des « garanties de sécurité » à la Russie comme si Moscou pouvait être menacé par les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Ukraine, la Moldavie ou la Géorgie. D’autres encore ont souhaité, sous le prétexte fallacieux et, pour tout dire, assez répugnant, de « sauver des vies ukrainiennes » que les Alliés ne livrent pas d’armes à l’Ukraine. Enfin, d’autres demandent qu’on n’émette que des jugements « froids » et qu’on se garde – vieille attitude viriliste – de toute émotion devant les crimes commis par la Russie, comme si, au-delà même de tout jugement moral, ceux-ci n’avaient pas une portée à la fois annonciatrice, pour les crimes passés, de ce que le Kremlin s’apprêtait à faire et ne disaient rien sur son projet, et comme si, pour les crimes actuels, il fallait les extraire de l’analyse stratégique. Dans certains cas, assurément, la défense, explicite ou implicite, du Kremlin peut aussi s’expliquer par des compromissions.
Malgré des progrès, pourquoi sommes-nous encore loin d’être sérieux ?
Certes, depuis le début de la nouvelle guerre russe contre l’Ukraine – celle commencée le 24 février 2022, alors que la guerre a commencé en réalité en 2014 et que l’offensive massive de 2022 n’en est que la prolongation –, des inflexions ont eu lieu. Certains réflexes et comportements hérités de ces anciennes visions très ancrées ont été heureusement corrigés.
La première, fondamentale, réside dans le fait que les crimes de guerre, de mieux en mieux documentés, sont dénoncés par les dirigeants des démocraties. Après certaines hésitations, la plupart des pays ont donné leur accord de principe pour la mise en place d’un tribunal spécial pour juger les crimes d’agression, tels que définis à Nuremberg, qui permettrait d’atteindre directement Vladimir Poutine et les dirigeants russes. Certains rechignent toutefois à reprendre l’appellation de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide ou à caractère génocidaire – pour reprendre les attendus du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie qui avaient ainsi qualifiés ceux commis à Srebrenica. Mais cette conscience, trop tardive, a enfin vu le jour.
Ensuite, on n’entend plus guère le discours qui a prévalu trop longtemps selon lequel la Russie de Poutine serait une « partenaire ». Certes, même si elles pourraient être encore renforcées et connaître un rythme plus rapide dans leur exécution, les sanctions prises après le 24 février sont fortes et ont un impact réel. La Russie de Poutine cesse, peu à peu, d’être traitée comme un Etat « normal ». Certains dirigeants, y compris allemands, commencent à reconnaître publiquement la faute qu’ils ont commise en rendant les économies occidentales dépendantes de ce régime. L’immensité des crimes commis fait que, même dans le pire des scénarios, la relation avec Moscou ne pourra plus jamais revenir à l’état d’irresponsabilité d’avant.
La troisième inflexion réside dans le fait que les dirigeants occidentaux affirment tous que l’Ukraine doit gagner la guerre – même si cela peut signifier des choses différentes suivant le locuteur – et qu’ils soutiendront l’Ukraine jusqu’au bout. On est déjà loin de la situation qui prévalait dans les premiers jours, voire semaines, de cette nouvelle guerre où beaucoup, tout en condamnant l’agression russe, étaient dans une forme d’attentisme et, pour tout dire, de passivité. Si Poutine avait réussi son coup, après une période de purgatoire, il est à parier que beaucoup se seraient à nouveau précipités pour donner l’accolade au maître du Kremlin et lui accorder l’absolution. Ils n’auraient pas eu grand scrupule, malgré des protestations, à passer l’Ukraine par pertes et profits. C’est d’ailleurs la situation qui a largement prévalu entre 2014 et 2022 où, malgré des sanctions du reste bien limitées, les dirigeants occidentaux paraissaient surtout désireux de se débarrasser du « problème » ukrainien – sans voir que le seul vrai « problème » était russe.
Mais l’aggiornamento reste incomplet et devrait aller plus loin. C’est même le logiciel de notre action qui devrait être entièrement repensé au moins sur trois points. On ne saurait dire que les mécompréhensions qui ont caractérisé l’attitude des pays occidentaux envers la Russie aient complètement disparu : elles demeurent même souvent la grammaire intellectuelle qui structure l’appréhension de nombreux dirigeants occidentaux. L’engagement en termes de fourniture d’armes à l’Ukraine fut certes déterminant, mais il ne fut pas – il ne reste toujours pas – à la hauteur de ce que cette guerre exigerait. Nous restons encore à mi-chemin et ce que j’avais appelé les « lourds nuages de la paix », c’est-à-dire du compromis avec la Russie, continuent de charger le ciel de la guerre. Il faut donc essayer de comprendre les schémas intellectuels qui l’expliquent.
D’abord, l’attaque russe contre l’Ukraine a révélé notre impréparation conceptuelle en termes de doctrine d’intervention. Celle-ci est restée en quelque sorte le point aveugle de notre doctrine de dissuasion – je ne parle pas ici essentiellement de dissuasion nucléaire, qui n’est qu’une composante, la plus extrême, de la dissuasion plus globalement entendue. Plusieurs pays de l’Alliance, dont la France, et quelques autres sont intervenus dans le cadre d’opérations extérieures lorsque leur sécurité leur apparaissait menacée – première guerre du Golfe pour rétablir l’intégrité territoriale du Koweït, ex-Yougoslavie, Afghanistan, Sahel, Moyen-Orient dans le cadre de la coalition internationale contre Daech, etc. Mais dans le cas de la Géorgie en 2008, de la Syrie après les attaques chimiques dans la Ghouta en 2013 – François Hollande s’est alors retrouvé isolé alors qu’il avait justement perçu qu’une intervention était seule à même de sauver des centaines de milliers de vies –, en 2014 après l’annexion de la Crimée et l’invasion du Donbass par la Russie, et même en 2022, les Alliés ont immédiatement exclu une intervention militaire. Celle-ci aurait pourtant pu être fondée sur l’article 51 de la Charte des Nations unies (droit de légitime défense et d’appel de pays tiers à la protection d’un pays agressé) sans qu’il ait été nécessaire d’envoyer des troupes au sol et en limitant les frappes aux éléments militaires russes présents sur le sol ukrainien. Par la suite, certes, les Alliés ont fourni des armes décisives à l’Ukraine – quoique de manière trop tardive et encore insuffisante –, mais il est essentiel, pour l’avenir, de repenser à l’avance notre doctrine d’intervention dès lors qu’un pays serait attaqué.
Cette question d’une possible intervention et de la fourniture à l’Ukraine d’armes de nature à répliquer aux attaques de missiles tirées depuis le sol russe sur celui-ci ont suscité des débats délicats en Europe et outre-Atlantique principalement centrés autour de la notion de co-belligérance. Cette notion n’est pas précisément définie en droit hors du cas, devenu désuet, d’une déclaration de guerre et de frappes sur le territoire de l’agresseur par des Etats autres que l’État agressé. En réalité, l’appellation de co-belligérant est faite, en fonction de ses intentions et de ses intérêts, par un Etat qui se sentirait attaqué, sans d’ailleurs que cela ne préjuge en rien sa réponse. La vraie question, par définition incertaine, est celle de la réaction qu’aurait le régime russe si des Etats membres de l’OTAN intervenaient directement dans ce conflit en appui à l’Ukraine. Il en va de même pour la fourniture à Kyiv de missiles à plus longue portée – notamment les ATACMS américains dont beaucoup aux Etats-Unis réclament la livraison à l’Ukraine. Tout dépend à l’évidence de notre appréciation des risques. Certains pointent le danger d’une frappe nucléaire de la part de Moscou – ce dont il agite depuis des années le risque et ce que laisse ouverte la doctrine nucléaire russe actualisée par un oukaze présidentiel du 2 juin 2020, mais qui est aussi un récit destiné à nous dissuader de toute réplique – alors que d’autres, ce qui est mon cas, estiment que la Russie aurait cédé si une intervention, limitée au territoire ukrainien, avait été décidée dès le début de la guerre. Le débat reste ouvert, mais il pourrait à l’avenir concerner aussi d’autres cas, notamment dans l’hypothèse d’une attaque de Taïwan par Pékin. Récuser toute intervention signifierait qu’on laisse une puissance nucléaire commettre une agression en toute impunité. Pouvons-nous vivre avec cette perspective ?
Ensuite, la situation en Ukraine n’est comprise que de manière souvent isolée, indépendamment d’une stratégie globale à moyen et long terme envers la Russie qui n’est pour ainsi dire pas pensée. C’est ainsi que les Alliés affirment à raison leur soutien total à l’Ukraine, mais la plupart d’entre eux refusent encore de se fixer comme objectif, fût-ce de manière implicite, la défaite totale du régime russe. En somme, ils ne considèrent que l’Ukraine dans une perspective de court terme, certes aujourd’hui fondamentale et urgente, mais sans considérer les autres pays où la Russie commet des crimes monstrueux (Syrie, certains pays d’Afrique), ceux où elle soutient un régime criminel (Bélarus, Nicaragua, Venezuela, Cuba), ceux qu’elle a partiellement occupés (Géorgie, Moldavie) ou bien où elle exerce une influence délétère (Serbie, Hongrie), sans parler des interférences dans la vie politique des démocraties. La réalité est que le monde se porterait mieux si le régime russe était défait. Au lieu de cela, certains continuent d’évoquer à mi-mots un retour à la normale avec la Russie une fois la guerre terminée.
Là aussi, cette question de la défaite de la Russie a suscité des débats nombreux, par définition indécidables. D’un côté, cette défaite serait la seule garantie de sécurité apportée à l’espace européen et au-delà, en particulier en Syrie. D’un autre côté, nul ne peut prévoir comment la Russie évoluera dans les années, voire décennies, à venir. Ce que nous savons de science certaine est que la défaite de Poutine, qui devrait entraîner sa chute, est la condition nécessaire tant à la fin de la guerre qu’à un travail de conscience des citoyens russes sur les crimes commis. Ce n’en est assurément pas la condition suffisante. On peut parfaitement imaginer – certains disent que c’est même probable – qu’un dirigeant du même acabit lui succède. Celui-ci pourrait d’ailleurs, en donnant quelques signaux (libération des prisonniers politiques, retrait des troupes d’Ukraine, livraison à la justice de certains criminels) tenter d’amadouer les Occidentaux, quitte à reprendre une politique d’agression quelques années plus tard. Sans revenir ici sur les perspectives d’évolution de la société et de la conscience russes et le détail de ce que les nations démocratiques pourraient faire pour inciter la Russie à opérer des réformes – nul ne saurait en effet se désintéresser de son avenir –, on peut toutefois constater que, s’ils le veulent, les Occidentaux ne sont pas dénués de moyens de pression à condition de ne pas renouveler les erreurs qui sont suivi 1991, notamment ouverture et libéralisation incontrôlées de l’économie et absence de considération pour la souffrance sociale de la population russe. En somme, nous pouvons agir par un mélange de pression (maintien des sanctions sous conditions) et soutien à la transformation du pays.
Enfin, même si le sujet est parfois évoqué, il nous faut encore apprendre les leçons de ce conflit en termes de droit international et d’ajustement des organisations internationales. La question des droits fondamentaux a été ainsi progressivement occultée dans les relations internationales par les pays démocratiques qui n’ont pas vu que leur violation était l’annonce d’une agression de plus vaste ampleur dès lors que les Etats les bafouant étaient dotés d’une capacité d’intervention au-delà de leurs frontières. Parallèlement, la notion de responsabilité de protéger (R2P) a été, peu de temps après sa reconnaissance par les Nations unies, vidée de toute dimension pratique. Les dirigeants démocratiques n’ont pas voulu comprendre, d’abord en Syrie, que la possibilité pour un Etat de commettre des crimes contre l’humanité à une échelle massive comportait également une dimension idéologique et constituait une arme de cette nature à l’encontre des démocraties : rendre vraie sa prophétie autoréalisatrice sur la faiblesse de celles-ci et leur inconsistance en rendant ces proclamations risibles. Par ses 16 vetos sur la Syrie, notamment, suivis 9 fois par la République populaire de Chine, la Russie a détruit le fonctionnement normal du Conseil de sécurité des Nations unies et parfois entraîné certaines de ses agences dans une compromission avec le régime syrien (détournement de l’aide en particulier au profit de celui-ci). Parallèlement, toute réforme de cette organisation, notamment comme le propose depuis longtemps la France en rendant impossible un veto en cas de crimes massifs, se heurte précisément au veto de Moscou et de Pékin. Sans répondre ici à la question des modalités juridiques pour avancer, il est certain que ce travail de réforme est prioritaire.
Nous restons ici avec une question douloureuse qui ne cesse de nous hanter : aurions-nous pu éviter que plus d’une centaine de milliers de vies ukrainiennes – et avant syriennes – soient anéanties par la barbarie russe ? Aurions-pu faire plus pour les sauver ? L’avons-nous vraiment voulu ? Je ne crois pas que nous puissions nous affranchir de cette question de notre responsabilité – sans doute, en fait, de notre culpabilité.