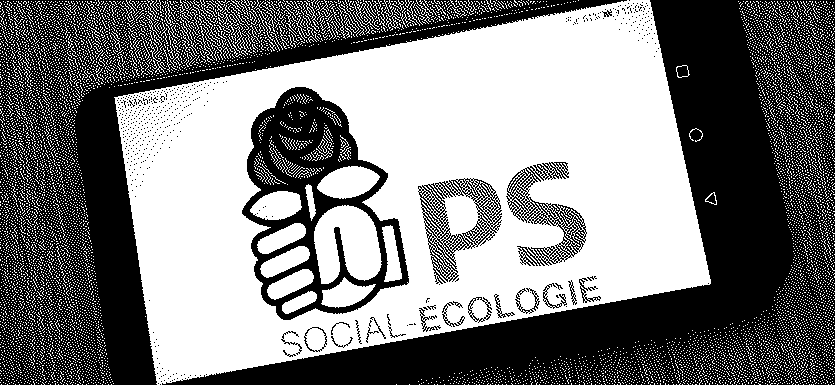Il ne suffit pas de déclarer sa fidélité au monde populaire pour dessiner une stratégie, encore moins une identité politique. Qui veut représenter les « classes populaires » aujourd’hui doit commencer par affronter la complexité de leur composition et des clivages qui les parcourent.
En complément et en discussion avec cette réflexion, deux contributions élargissent le regard vers les autres pays européens confrontés à des évolutions et des défis analogues. La première s’intitule « Classes populaires et partis de gauche : généalogie d’un désalignement » de Frédéric Sawicki, professeur de science politique à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS. La seconde « Le mythe du transfert des voix de gauche vers l’extrême droite » par Silja Häusermann, Professeur et chef du département de sciences politiques de l’université de Zurich (Suisse), Herbert Kitschelt, Professeur de Sciences politiques à Duke University, et Tarik Abou Chadi, Professeur adjoint au département de Sciences politiques de l’Université de Zurich (Suisse) initialement publiée par la Friedrich Ebert Stiftung, et par Agenda Publica.
Plus de dix ans après sa publication en 2011, le rapport de Terra Nova sur la stratégie électorale de la gauche est de nouveau sur le banc des accusés1. Arnaud Montebourg et Olivier Faure l’ont successivement brandi en contre-exemple de ce qu’il fallait faire pour renouer avec la victoire2. Ils rejoignent ainsi les griefs incessants de la presse conservatrice3 contre une supposée « stratégie d’abandon du peuple », reprenant elle-même un refrain ambiancé au début des années 2000 par le polémiste Eric Conan4.
Une vieille histoire, en somme, mais sur laquelle il est temps de revenir. Non pour défendre le rapport en question ou pour ajouter au concert de critiques qui l’ont visé, mais parce que cette discussion porte en réalité sur un sujet beaucoup plus important : la place et la représentation des classes populaires dans le discours politique. Domaine dans lequel les déclarations d’amour dispensent hélas souvent de réfléchir.
L’objet du délit
Commençons par quelques rappels au sujet de ce rapport que beaucoup ont oublié ou ne citent que par ouï-dire. Il partait d’un constat peu contestable : la coalition historique qui a porté la gauche depuis près d’un siècle est en déclin. Cette coalition reposait sur l’alliance des suffrages ouvriers avec ceux des employés et des petites classes moyennes.
Les causes de son déclin tenaient, selon les auteurs, non seulement au recul démographique des ouvriers et à l’affaiblissement de la dimension socioéconomique du choix électoral dans ce groupe, mais aussi à une divergence culturelle croissante : alors que la gauche avait épousé les valeurs du libéralisme culturel dans le sillage de Mai 68 et qu’elle cultivait la tolérance et l’ouverture à l’égard des immigrés, de l’homosexualité, de l’islam, etc., les ouvriers avaient fait dans leur majorité, disait-on, le chemin inverse, se rapprochant du même coup du Front national.
La conclusion « stratégique » qu’en tiraient les auteurs était la suivante : plutôt que de poursuivre indéfiniment un électorat ouvrier qui se dérobe, il valait mieux s’efforcer d’aller chercher celles et ceux qui sont davantage en phase avec les valeurs de la gauche progressiste, qui ne sont pas en situation de repli démographique et qui appellent cependant le soutien d’une forte politique d’émancipation. Parmi eux, les priorités désignées par le rapport étaient les jeunes, les femmes, les diplômés, les minorités et les quartiers populaires… Une France plus urbaine, plus diverse, plus jeune et moins catholique, telle était la cible stratégique du scénario « central » proposé par les auteurs.
On peut contester cette orientation avec laquelle j’ai moi-même pris mes distances5 – je dirai plus loin pourquoi – mais on ne peut pas lui faire dire ce qu’elle ne dit pas. Contrairement à ce que prétend aujourd’hui Arnaud Montebourg, cette note ne recommandait pas à la gauche « d’abandonner les classes moyennes et populaires » au profit d’une « bourgeoisie libérale et optimiste »6. Et contrairement à ce que prétend Olivier Faure, elle ne lui recommandait pas non plus de « s’appuyer exclusivement sur quelques minorités actives », les femmes, les jeunes ou les diplômés pouvant difficilement être décrits comme des « minorités actives ». Ce sont là des postures opportunistes et des reconstructions de convenance.
En réalité, les auteurs proposaient un redécoupage des groupes sociaux, notamment à l’intérieur de ce qu’il est convenu d’appeler les classes populaires, c’est-à-dire les CSP « ouvriers » et « employés ». En effet, renoncer à placer la CSP « ouvriers » au cœur de la stratégie électorale de la gauche au profit des jeunes, des femmes et des quartiers populaires, ce n’était pas se détourner de tous les ouvriers, car il n’aura échappé à personne qu’une partie non négligeable d’entre eux sont… des jeunes, des immigrés, des habitants des quartiers populaires et même, dans 20% des cas, des femmes. Et c’est encore plus vrai pour la CSP « employés », l’autre grande composante des classes populaires, dont plus des trois quarts sont justement… des femmes ! Bref, dans le mix sociologique du bloc majoritaire imaginé par les auteurs du rapport, les classes populaires demeuraient fortement présentes mais sous de nouveaux habits et de façon plus sélective, segmentées à partir d’autres critères que ceux définis par les CSP (c’est-à-dire, grosso modo, la position occupée dans le système de production).
Pourquoi ce redécoupage ? Parce qu’il permettait notamment d’isoler, dans chacune des deux grandes CSP, ceux que les auteurs appelaient les « outsiders » et auxquels ils souhaitaient que la gauche s’adresse en priorité. Chez les ouvriers, par exemple, ils souhaitaient qu’elle privilégie les jeunes qui sont aussi souvent d’origine immigrée, peu voire pas qualifiés et qui « galèrent » plus que les autres pour accéder marché du travail et à l’autonomie. Et chez les employés, ils souhaitaient qu’elle s’adresse en priorité aux femmes (plus des trois quarts de cette catégorie, comme on l’a dit) qui sont dans des emplois souvent précaires, mal rémunérés et à temps partiel ou se heurtent rapidement au « plafond de verre ».
En décentrant ainsi le regard, le rapport invitait à considérer plus attentivement des questions sociales qui n’étaient pas au cœur de la « condition ouvrière ». Je dis bien des questions sociales et non seulement sociétales comme on l’a dit ensuite avec un certain dédain : la condition des caissières de la grande distribution ou des femmes de ménage, aux emplois précaires, aux horaires atypiques et aux revenus très modestes, ne sont pas de simples « questions de société » et ne sont pas moins dignes de figurer au premier rang des préoccupations de la gauche que celle des ouvriers d’usine.
De fait, la proposition du rapport n’était pas que la gauche tourne le dos au monde populaire comme on le répète avec application depuis dix ans, mais qu’elle privilégie au sein même des classes populaires les publics les moins bien intégrés dans l’emploi, ceux qui, contrairement aux « insiders », ne sont protégés par aucun statut ni aucun patrimoine et qui, faute de capacités de mobilisation et de représentation, avaient souvent été négligés par les gouvernements successifs par le passé. Le pari des auteurs était par ailleurs que ces outsiders étaient plus susceptibles d’adhérer aux valeurs d’ouverture de la gauche et de s’attacher la solidarité des diplômés. Ainsi se dessinait à leurs yeux une synthèse idéologique et stratégique cohérente et « porteuse ».
Cette synthèse était d’ailleurs assortie de « stratégies complémentaires » parmi lesquelles était favorisée l’option « classes populaires » (cf. pp. 61–63). Les auteurs y suggéraient qu’à la stratégie centrale soit ajouté un effort particulier à destination des ouvriers et employés sur le terrain socioéconomique.
Si l’on s’entend sur le fait que la raison d’être des forces de gauche est de donner corps à la promesse d’égalité et pour cela d’œuvrer à l’amélioration du sort des plus faibles, des subalternes, de celles et ceux qui n’ont trouvé dans leur berceau ni capital économique ni capital social, alors les auteurs de la note souscrivaient à leur manière à cette promesse, mais en se débarrassant des cadres habituels de pensée du social et de leur inspiration marxiste. Le reste de l’œuvre de Terra Nova durant la campagne de 2011, alors portée par le travail infatigable d’Olivier Ferrand, ne laisse d’ailleurs aucune ambiguïté sur l’ancrage politique du think tank : en cette même année 2011, il soutenait, par exemple et pour mémoire, l’encadrement de la rémunération des hauts dirigeants d’entreprise et la retraite à 60 ans dans le cadre d’une réforme systémique du régime par répartition. On peut discuter de l’opportunité de ces propositions, mais plus difficilement de leur orientation idéologique.
Les limites du rapport
Cette méthode ne cachait pas ses sources d’inspiration : elle cherchait à importer une catégorisation à l’américaine des électeurs, là où, dans sa grande tradition jacobine, la politique française prétend s’adresser à des citoyens épris d’intérêt général. Terra Nova fut ainsi accusé de faire le lit d’une forme de clientélisme électoral. En réalité, les critiques jouaient sur un double registre au risque de s’égarer dans une contradiction inextricable : d’un côté, elles contestaient le principe même d’un ciblage stratégique, suggérant que la société serait une simple addition d’individus plus ou moins épars et qu’il faut « parler à tout le monde » ; de l’autre, elles dénonçaient ce ciblage stratégique en particulier, suggérant que la société est bel et bien structurée par des catégories distinctes voire opposées mais qu’il ne fallait pas privilégier celles-là.
Laissons de côté la fiction jacobine d’une totalité sociale indistincte : nous savons tous que la société est faite d’une pluralité de conditions et que tous les discours politiques rencontrent l’adhésion de certains groupes plutôt que d’autres. Toute compétition politique entre des candidats est en même temps une compétition plus ou moins explicite entre des groupes pour le leadership social, y compris en l’absence de stratégie claire et assumée.
La question est plutôt de savoir quelles sont les catégories pertinentes, c’est-à-dire celles qui permettent d’identifier des groupes suffisamment homogènes et cohérents et de mieux cerner les lignes de fracture du pays. Vaut-il mieux, de ce point de vue, regarder la société à partir de catégories socioprofessionnelles créées en 19537, ou bien à partir des variables d’âge (les jeunes), de genre (les femmes) ou de territoires (les quartiers populaires) comme le suggérait Terra Nova en 2011 ? Pour ma part, j’incline à penser qu’aucune de ces options n’est réellement satisfaisante.
D’un côté, on le verra plus loin pour le groupe des ouvriers, la position occupée dans le système productif ne suffit plus à identifier des groupes cohérents : les écarts de revenus, de statut d’emploi et de sécurité face à l’avenir entre un jeune chauffeur-livreur en CDD et un chaudronnier de 55 ans en CDI – tous deux ouvriers aux yeux des sondeurs – sont parfois plus grands qu’entre ce même chaudronnier et la moyenne des employés, voire une partie des professions intermédiaires en début de carrière. Mais, de l’autre, « les jeunes » ou « les femmes » recouvrent une diversité de situations plus grande encore : l’égalité d’âge ou de genre ne fait pas l’égalité de conditions ! Et encore moins l’égalité de valeurs : l’adhésion présumée des minorités aux valeurs culturelles de tolérance et d’ouverture, par exemple, était et est toujours loin d’être acquise. De même pour les jeunes qui adressent aujourd’hui encore une part significative de leurs suffrages au Rassemblement national. Par ailleurs, on est en droit de penser que les divergences culturelles relevées par le rapport – divergences qui sont loin d’être toutes nouvelles8 – ne devraient nullement décourager la gauche de parler aux ouvriers mais au contraire l’inciter à un effort d’explication.
En outre, ces stratégies de ciblage recourent à des instruments qui empêchent de tenir compte de la porosité entre les mondes ainsi définis et des circulations des individus d’un monde à l’autre. De même que l’on n’est pas jeune à vie, on peut passer d’insider à outsider à la faveur d’un événement (licenciement, fermeture d’établissement…), d’un accident ou d’un aléa de la vie (séparation, déménagement…) ; et l’on peut également faire le parcours inverse, ce qui explique par exemple que les habitants des quartiers populaires s’empressent de les quitter quand ils en ont l’opportunité, les privant ainsi un peu plus de chances de mixité sociale.
Dans l’expérience vécue, la sécurité économique et sociale se mesure aussi à l’aune de la composition des ménages : elle varie sensiblement selon que le conjoint est actif occupé, chômeur ou inactif, diplômé ou sans qualification, fonctionnaire d’Etat ou en CDD dans une TPE, etc. Et elle varie bien sûr également selon que l’on a ou non un conjoint, l’expérience de la monoparentalité – féminine dans l’immense majorité des cas – étant un facteur majeur de précarisation. Au regard de ces complexités, les classifications mobilisées par les auteurs du rapport de Terra Nova comme par leurs adversaires paraissent bien rustiques et même assez rudimentaires. Pis, elles empêchent peut-être de se concentrer sur l’essentiel : les risques (ou les chances) de mouvement à l’intérieur de la société, et la capacité plus ou moins grande de chacun d’assurer sa sécurité face à l’avenir.
Enfin, l’interprétation des données d’enquêtes mobilisées par les auteurs semblait tenir pour irréversibles l’éloignement du vote ouvrier à l’égard de la gauche de gouvernement et la domination de la dimension culturelle sur la dimension socioéconomique du choix électoral. Et ce, insistaient-ils, en France comme dans la plus grande partie du monde occidental. Elle validait en filigrane la théorie du transvasement du vote populaire de la gauche à l’extrême-droite. Or cette théorie mérite d’être discutée pour au moins deux raisons. La première est que les partis de droite ont toujours capté une part de l’électorat populaire et que les succès de l’extrême-droite dans ces catégories sociales tiennent aussi à la radicalisation des petites classes moyennes indépendantes et des membres des classes populaires qui votaient déjà à droite. La seconde est que l’érosion de l’assise électorale des partis de gauche dans les classes populaires s’est d’abord traduite à partir des années 1980 et 1990 par une augmentation de l’abstention et de la non-inscription, notamment de la part des jeunes qui étaient entrés sur le marché du travail à la fin des années 1970 et qui se sont souvent éloignés de la politique ou simplement émancipés des catégories droite-gauche9.
Au total, il était certainement inopportun et même franchement déplacé, à l’orée d’une campagne présidentielle, d’envoyer le signal que la gauche devait se détourner d’une partie de la société, et de qualifier la nouvelle coalition de « France de demain » en suggérant que ceux qui n’en étaient pas appartenaient de fait au passé et entreraient bientôt dans les livres d’histoire. Mais, au fond, la question fondamentale n’était pas de dénoncer des « clientèles » électorales : la gauche et la droite avaient les leurs de longue date. Le bon débat aurait été d’essayer de se mettre d’accord sur la façon de comprendre le social aujourd’hui.
Un secret de famille
On l’aura compris, ces critiques sont très différentes de celles qu’avancent depuis dix ans les adversaires de ce rapport, de droite comme de gauche. Selon eux, Terra Nova serait surtout coupable d’avoir coupé la gauche de son terrain authentique, au nom d’une synthèse idéologique improbable, détachée des réalités sociales et des attentes des Français. Il valait mieux, à leurs yeux, en rester à des recettes éprouvées : un discours généraliste attrape-tout, où la nostalgie d’un monde industriel idéalisé tenait lieu de fidélité aux sources authentiques du socialisme.
Ces critiques s’exonèrent à bon compte des réalités électorales et sociologiques sous-jacentes à cette discussion. Les réalités électorales d’abord. La note incriminée n’a pas déclenché un soudain désintérêt du monde ouvrier pour la gauche de gouvernement, pas plus que l’inverse. Celui-ci était malheureusement déjà bien installé, comme en témoigne la composition de l’électorat socialiste depuis les années 1990 et comme le rapport de 2011 le pointait en soulignant le déclin de la coalition traditionnelle de la gauche. A vrai dire, si la gauche n’avait pas capté les voix des classes moyennes et des cadres ces trois dernières décennies, elle serait tout simplement restée à l’écart du pouvoir pendant toute cette période. En réalité, elle a inventé sans le dire le moyen d’accéder aux responsabilités avec une faible part du vote ouvrier tout en entretenant une rhétorique populaire qui tournait de plus en plus à vide.
Si le rapport de Terra Nova a fait événement, c’est pour une toute autre raison. En pointant du doigt l’érosion de l’alliance qui avait fait la victoire de la gauche en 1981 et encore en 1988, elle commettait l’irréparable : elle trahissait un secret de famille. Comme on le sait, un secret de famille est le contraire d’un secret : quelque chose que tout le monde sait mais dont il est défendu de parler à table le dimanche. La défiance que suscite encore aujourd’hui la « stratégie Terra Nova » relève de ce point de vue d’un examen de conscience à la fois tardif, inassumé et inabouti. En dénonçant ce rapport pour mieux faire mine de rester fidèle aux classes populaires, la gauche se dispense en réalité d’un débat essentiel, non seulement sur sa stratégie électorale, mais sur son identité politique et sur sa fonction historique.
En outre, faire porter à la désaffection du vote ouvrier la responsabilité du déclin de l’offre social-démocrate comme on l’entend souvent aujourd’hui est très discutable. D’abord, la courbe n’est pas rectiligne : après avoir connu un plus bas en 2007 en réunissant 34% des électeurs ouvriers, le vote de gauche au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 – un an à peine après la publication du rapport de Terra Nova – remontait à 41%, soit une augmentation de 7 points et à peine 3 points de moins qu’en… 1969, deux ans avant le congrès d’Epinay. On était bien sûr très loin des points hauts de 1974 (64%), de 1981 (66%) ou encore de 1988 (63%), mais force est de constater que le vote ouvrier n’est pas une masse stable et captive : il connaît lui aussi d’importantes fluctuations dans le temps et il pourrait très bien en connaître de nouvelles dans les mois qui viennent.
Ensuite, on ne peut pas contester que la gauche a gagné en 1997 et en 2012 sans avoir recouvré le soutien d’une majorité d’ouvriers. De même, on ne peut pas contester qu’elle doit ses défaites de 2002, 2007 et 2017 autant au comportement électoral des autres CSP qu’à celui des ouvriers, et autant à la concurrence de la gauche radicale, des Verts et plus récemment des sociaux-libéraux de la République En Marche qu’au Front national (lequel ne recueillait en 2012 « que » 35% des suffrages ouvriers, c’est-à-dire 6 points de moins que la gauche).
Cette situation n’est d’ailleurs pas une particularité française : la Friedrich Ebert Stiftung a récemment publié une étude sur plusieurs pays européens qui montre que les partis sociaux-démocrates européens ont majoritairement perdu des voix au profit des Verts, des libéraux de gauche et de ceux de la droite de gouvernement10… Bref, le vote ouvrier a son importance mais, contrairement aux idées reçues, il ne détermine pas à lui seul les résultats de la gauche dans les confrontations électorales récentes, et les défaites qu’elle a pu connaître dans un passé récent ne sont pas non plus son fait exclusif.
Qui sont les ouvriers ?
Venons-en à présent aux réalités sociologiques. Qui sont les ouvriers ? Le mot convoque dans l’imaginaire de la gauche les puissantes représentations de la question sociale telle qu’elle s’est posée depuis la révolution industrielle et jusqu’aux Trente glorieuses. A cette époque, le monde ouvrier est conçu, à tort ou à raison, comme l’acteur majeur de l’histoire et le dépositaire principal de la promesse d’émancipation, et les grands ateliers de la société industrielle comme le lieu clé de la bataille. Que reste-t-il de tout cela non pas dans les spéculations des stratèges de campagne mais dans les faits ?
Première observation : le monde des ouvriers est aujourd’hui quantitativement déclinant comme le rappelait à juste titre le rapport de Terra Nova en 2011. 20% des actifs en emploi occupent aujourd’hui une profession d’ouvrier : c’est 3 points de moins qu’il y a dix ans, 10 de moins qu’en 1982 et 20 de moins qu’à la fin des années 1950. Dans le même temps, les cadres passaient de 8% à 19% : ils sont désormais presque aussi nombreux que les ouvriers et n’ont ni plus ni moins de droits que les autres à participer aux scrutins. Cette érosion continue des effectifs ouvriers est, après celle des paysans dans les décennies d’après-guerre, l’un des marqueurs les plus puissants de la transformation de notre modèle socio-productif.
Seconde observation : le profil des ouvriers a considérablement évolué. En 1982, les ouvriers non qualifiés de l’industrie étaient encore nettement dominants : ils représentaient près de 29% de l’effectif contre un peu plus de 16% aujourd’hui (soit moins de 4% de l’emploi total). Sur la même période, les ouvriers qualifiés de l’industrie (fraiseurs, chaudronniers, etc.) ont un peu mieux résisté. Mais dans le même temps, d’autres catégories ont connu une puissante progression : les chauffeurs sont passés de 7,5% à 12,5%, et les ouvriers qualifiés de l’artisanat (maçons, cuisiniers…) de 17,6% à 24,6%. Des faits largement documentés depuis plus de 20 ans par les travaux statistiques de l’Insee11 mais, semble-t-il, passés sous les radars des états-majors politiques : deux tiers des ouvriers d’aujourd’hui ne travaillent plus dans l’industrie.
Ces transformations sont bien sûr l’effet de la désindustrialisation, mais aussi d’une profonde mutation de l’emploi industriel, le tout sous les effets conjugués d’une nouvelle division internationale du travail et d’une profonde mutation de la demande domestique12. Ce n’est pas seulement que le secteur industriel a vu fondre le nombre de ses emplois directs, mais il n’emploie plus les mêmes profils. Pour faire image, on pourrait dire que le monde industriel d’aujourd’hui n’est plus celui de l’atelier mais celui des laboratoires et des robots ; plus celui de travailleurs majoritairement non qualifiés et mal rémunérés dont on exploitait une force de travail facilement substituable, mais celui de techniciens et d’ingénieurs diplômés et mieux rémunérés que la moyenne des salariés.
L’identification des ouvriers aux mondes de l’atelier et des usines d’antan relève de la persistance rétinienne d’une gauche nostalgique ou peu familière de l’expérience quotidienne de nos concitoyens – les thuriféraires de la « reconquête ouvrière » sont d’ailleurs en général les héritiers de partis qui n’ont jamais été de vrais partis de masse contrairement aux partis sociaux-démocrates allemand ou suédois, par exemple. Cette identification relève en outre d’une illusion rétrospective : même à la fin des années 1970, l’ensemble des ouvriers de type industriel ne représentaient qu’une petite moitié de l’effectif. Bref, comme l’écrivait naguère le sociologue Roger Cornu, « la classe ouvrière n’est plus ce qu’elle n’a jamais été » !
Si la gauche veut renouer avec les ouvriers d’aujourd’hui, elle doit certes parler au monde de l’usine, mais surtout se tourner vers les emplois moins visibles qui sont la réalité majoritaire du monde ouvrier actuel et d’une grande partie des classes populaires. Il ne lui suffira pas de faire des gammes sur la réindustrialisation du pays – projet essentiel, mais pour d’autres raisons. La condition du chauffeur qui travaille pour un sous-traitant d’Ikea, transporte les marchandises des classes moyennes en centre-ville, leur tend la facture et encaisse le règlement, ou encore celle du réparateur d’équipements ménagers en CDD au service d’un grand distributeur sont plus emblématiques des situations d’emploi dans lesquelles se trouvent de nombreux ouvriers d’aujourd’hui. Et elles diffèrent très sensiblement de celle du tourneur-fraiseur syndiqué des usines de Billancourt en 1960.
La majorité des ouvriers travaillent aujourd’hui dans des entreprises de plus petite taille où la socialisation des expériences de travail est moins aisée, les interactions avec les autres catégories sociales plus diversifiées et les syndicats souvent absents. Le sentiment d’appartenance au « monde ouvrier » s’est d’ailleurs, concomitamment, beaucoup affaibli : un quart seulement des ouvriers se considéraient encore comme appartenant à la « classe ouvrière » au début des années 2010, les autres s’identifiant spontanément pour l’essentiel aux « classes moyennes ». La « classe ouvrière » n’a donc pas seulement perdu en nombre et en cohérence : elle s’est aussi dépouillée d’une conscience d’elle-même et des grands récits qui lui donnaient forme politique et parfois aussi fierté.
Pendant ce temps, les emplois peu ou pas qualifiés se sont massivement déplacés vers les services aux personnes, le commerce, la restauration, l’hôtellerie, la fonction publique territoriale… Tandis que le monde ouvrier se contractait, celui des employés a en effet continué à croître (27% de l’emploi total en 2019 contre 25% en 1982). Là encore, la composition des situations à l’intérieur de cette grande CSP a changé : les employés administratifs d’entreprise ont reculé sous l’effet des révolution technologiques et cédé la place à de nouveaux profils. Ce monde désormais largement féminisé n’a pourtant guère attiré l’attention des états-majors de campagne, à gauche comme à droite : les vendeuses, femmes de ménages, hôtesses d’accueil, standardistes, aide-soignantes, assistantes maternelles… sont restées des fantômes du discours politique.
Il s’est pourtant joué dans ces emplois de services un retournement décisif. La qualité de la prestation y est en effet inséparable des qualités personnelles de celui ou de celle qui la produit, comme le notaient les économistes Dominique Goux et Eric Maurin à la fin des années 1990 : « les salariés valent de moins en moins pour ce qu’ils ont en commun avec les autres salariés, et de plus en plus pour ce qu’ils ont de singulier, de différent »13. Ce mouvement d’individualisation croissante des relations d’emploi qui installe une concurrence inédite « entre les travailleurs eux-mêmes en tant que parties des produits échangés »14, a peu à peu détruit le socle d’analyse des « rapports de production » qui fondait l’ancienne lecture du social.
La géographie n’explique pas tout
Il serait bien sûr inexact de laisser penser que la gauche a continué à réfléchir exclusivement dans les termes des rapports de production hérités de la société industrielle. Depuis dix ans, un autre paradigme s’est imposé dans les discours : celui des territoires. Opposant le monde des métropoles et la « France périphérique », les travaux de Christophe Guilluy15 ont joué ici un rôle majeur mais ils n’ont pas contribué à clarifier la question, au contraire.
Selon cette théorie, la distance des électeurs au cœur des métropoles éclairerait leurs choix : les publics métropolitains seraient dans une dynamique d’adhésion au « système », à la mondialisation et aux valeurs de la « société ouverte » ; ceux des périphéries, nouvelle terre d’élection des classes populaires, dans une dynamique de désaffiliation et de rejet se traduisant par une plus grande propension à épouser les offres de rupture.
Cette lecture s’appuie sur deux phénomènes incontestables. D’abord, la métropolisation : depuis vingt ans, les grandes aires urbaines ont concentré les trois quarts de la croissance française et la plus grande partie des créations nettes d’emplois dans le secteur marchand. La périurbanisation, ensuite. Résultat d’une offre urbanistique nouvelle, d’une demande pour la propriété du logement et d’une difficulté croissante à se loger dans les centres métropolitains pour les ménages modestes et moyens, le périurbain a vu sa population augmenter de 40 % dans les années 2000. Il accueille aujourd’hui un Français sur quatre. Ces forces centrifuges expliquent aussi la fin de la décroissance démographique du monde rural.
Concentration des emplois dans les cœurs d’agglomération et dispersion de la population dans le périurbain et les espaces ruraux expliquent l’allongement continu des distances domicile-travail, une dépendance accrue à la voiture et la multiplication rapide du nombre de personnes qui résident dans une commune et travaillent dans une autre (un peu plus de la moitié des actifs occupés étaient « navetteurs » en 1990 contre près des deux tiers au milieu des années 2010, soit environ 17 millions d’individus).
C’est sur ces bases que C. Guilluy a construit sa théorie. Mais il s’est aventuré, ce faisant, dans des interprétations hasardeuses et souvent erronées. Le cadastre sociopolitique français reposerait, selon lui, sur une tripartition du territoire. Du côté des métropoles, les populations les mieux dotées en capital économique et culturel et les opinions les plus disposées au multiculturalisme et à l’immigration. Du côté des deuxièmes couronnes et des espaces ruraux, les fameuses « périphéries », soit un vaste ensemble de populations parcourues d’un sentiment croissant de décrochage et de mépris où l’on retrouverait les trois quarts des classes populaires. Et, coincées entre les deux, les premières couronnes des centres dynamiques regroupant les quartiers d’immigration et les « cités » censées polariser la sollicitude de la nouvelle bourgeoisie urbaine.
Dans ce nouvel espace social, les classes populaires ne feraient plus qu’un avec les périphéries, au sens propre (les territoires où elles sont censées être le plus concentrées) comme au sens figuré (les territoires secondarisés par les états-majors politiques et la bourgeoisie diplômée de centre-ville).
Assez logiquement, C. Guilluy et ses partisans anticipaient en 2017, à la veille de la dernière élection présidentielle, un duel aux couleurs de cette confrontation territoriale. En réalité, la répartition géographique des suffrages au premier tour de cette élection dément plutôt cette théorie. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, soit le champion supposé de la bourgeoisie diplômée de centre-ville et la championne supposée des périphéries populaires, ont trouvé la plus grande partie de leurs voix dans le cœur des grandes aires urbaines. 21 % des voix captées par M. Le Pen au premier tour venaient des villes petites et moyennes et du monde rural, contre 46 % du cœur des grandes aires urbaines16. Inversement, l’électorat du candidat En Marche ! était loin d’être absent des « périphéries ».
Bien sûr, la proportion des votes en faveur de M. Le Pen croît à mesure que l’on s’éloigne des centres, et sa mise en valeur sur des cartes qui ne tiennent aucun compte de la densité de peuplement suggère que l’électorat frontiste se concentre dans les périphéries. Mais plus on s’éloigne des centres, moins il y a d’électeurs ! Non seulement la cartographie ne dit pas tout, mais elle cache l’essentiel, en l’occurrence des stocks de voix qui mordent très largement sur les cœurs d’agglomération.
Si cette lecture fonctionne mal, c’est aussi parce que les fractures économiques et sociales qu’elle est censée organiser dans l’espace traversent en réalité la plupart des territoires. La grande majorité des pauvres, immigrés ou non, vivent toujours dans les grandes villes. Les années 2010 ont vu les inégalités s’accroître en moyenne davantage à l’intérieur des grandes aires métropolitaines qu’entre ces dernières et le reste du territoire. Par ailleurs, les mondes peu denses ou les territoires de grandes périphéries sont beaucoup plus composites qu’on ne le pense : certains sont frappés par le déclin industriel et les effets dépressifs qu’il engendre mais la plupart des régions peu denses voient coexister des zones dynamiques et des zones déprimées. Certaines villes moyennes se portent bien (c’est même là que l’on serait le plus heureux en France, selon certaines enquêtes), tandis que d’autres illustrent une France des « volets clos » et des « rideaux tirés ».
Bref, la géographie ne peut rendre compte des comportements électoraux qu’à la condition d’être pondérée par d’autres facteurs, dont les dimensions socio-économiques qu’elles prétendaient supplanter, mais sans doute aussi des effets d’histoire politique locale. Autrement dit, cultiver ce géographisme politique comme le font aujourd’hui certains candidats dans l’espoir de capter l’attention des plus modestes est un pari qui risque de s’avérer, là encore, perdant17.
Le mouvement des Gilets jaunes qui a débuté en novembre 2018 a bien sûr réveillé cette lecture. Certains se sont empressés d’y voir cette révolte des périphéries qu’ils avaient vainement attendue un an plus tôt. Las, le diagnostic ne s’est pas révélé plus convaincant. La carte de la « France des ronds-points » occupés le 17 novembre 2018 et les week-ends suivants ne dit rien de précis sur les lieux de résidence des personnes mobilisées. Mieux, elle est en réalité parfois très proche de celle des grands centres urbains, comme l’a montré le géographe Sylvain Genevoix18. Un focus sur les points de blocage en Ile-de-France montre même que le mouvement est relativement absent des départements les plus populaires comme la Seine-Saint-Denis qui n’en compte aucun. Par ailleurs, les observations sociologiques de terrain inclinent plutôt à penser que la sociologie Gilets jaunes était assez diverse, puisant à la fois dans les classes populaires intégrées dans l’emploi et dans les petites classes moyennes.
La grande transformation des classes populaires
Si la gauche veut amorcer sa reconquête des classes populaires, elle doit donc commencer par cesser de les regarder avec les lunettes des catégories qui structuraient le monde d’hier et éviter les foyers déformants du cartographisme social. Un effort d’accommodation lui permettrait sans doute de les découvrir sous un jour nouveau – et de mieux situer leurs divisions. Et ce d’autant plus que le sentiment d’injustice qui traverse la société ne peut plus être rapporté uniquement à une condition d’emploi, à une position dans l’appareil productif ni même à une situation sur le territoire. Des épreuves liées aux parcours de vie dessinent aujourd’hui des expériences nouvelles des inégalités : discriminations, précarisation des existences… Les discours politiques doivent aussi prendre en compte cette colère que le simple mécanisme d’agrégation des intérêts de classe ne permet plus de capter.
Première observation : les classes populaires que la gauche prétend vouloir reconquérir sont largement sorties de « l’insularité collective »19 qui les avait longtemps caractérisées. Le monde populaire de la société industrielle était en effet pour une large part un monde fermé sur lui-même où l’on quittait rarement son quartier, où l’on cultivait l’entre-soi et où l’on regardait avec défiance celles et ceux qui éprouvaient le désir de s’élever au-dessus de leur condition d’origine. Depuis une cinquantaine d’années, les classes populaires ont au contraire été portées ou poussées à une ouverture croissante aux autres mondes sociaux, aux autres styles de vie et aux autres univers culturels.
Les bouleversements liés à cette ouverture sont insuffisamment rappelés et mesurés aujourd’hui. Alors que les classes populaires quittaient l’enseignement à 15 ou 16 ans dans les années 1950, leurs enfants ont accédé au lycée et leurs petits enfants pour une large partie au bac, voire à l’enseignement supérieur. La massification scolaire leur a ainsi permis de participer de façon croissante à la culture mainstream et a contribué à faire pénétrer l’enjeu scolaire dans les familles les plus modestes.
Alors qu’une partie d’entre elles dépendaient étroitement des revenus de leur mari, un grand nombre de femmes d’origine populaire sont simultanément entrées sur le marché du travail salarié et ont conquis leur autonomie matérielle. Alors que l’emploi industriel peu qualifié tenait les salariés du monde populaire dans des environnements sociaux homogènes et limités, le développement des emplois de services leur a ouvert des champs d’interactions beaucoup plus diversifiées. Alors qu’elles étaient longtemps restées en marge de la consommation de masse, les classes populaires ont assez largement adopté les normes et valeurs consuméristes des classes moyennes. Etc.
Troisième observation : ces bouleversements se sont accompagnés d’une nette augmentation des inégalités au sein des classes populaires elles-mêmes : inégalités d’exposition à la précarité et au sous-emploi (le fait d’être ou non qualifié dessine une frontière de condition souvent plus forte que les frontières de CSP) ; inégalités d’exposition au risque de pauvreté (du simple au double toujours selon le niveau de formation initiale) ; inégalités d’exposition aux pénibilités du travail (celles du chauffeur-livreur n’ont rien à voir avec celles de l’agent de service dans une école primaire) ; inégalités d’accès à la propriété immobilière ; etc.
Le monde des classes populaires continue bien sûr d’être identifié à la faiblesse du statut professionnel, des ressources économiques et du capital culturel, mais il est d’une hétérogénéité beaucoup plus grande qu’autrefois. Et sa diversité menace les catégories même à travers lesquelles on tente de le saisir, de le décrire et surtout de s’adresser à lui.
Les clivages qui organisent les rapports sociaux ont eux-mêmes bougé : le clivage binaire dominants/dominés ne suffit plus à rendre compte de la complexité du monde populaire, si tant est qu’il y ait jamais suffi. Comme l’a montré Olivier Schwartz, c’est un clivage sur plusieurs fronts qui tend désormais à s’imposer, opposant des milieux populaires relativement intégrés aux catégories dominantes d’un côté et, de l’autre, aux « plus bas qu’eux » (les pauvres, les « assistés », etc.). L’altérité sociale prend ainsi le visage traditionnel de la domination économique et culturelle, mais aussi celui de l’exclusion, de celles et ceux qui dépendent presque exclusivement des minima sociaux et dont on souhaite d’autant plus s’éloigner qu’on craint de devoir les rejoindre un jour à la faveur d’un accident de la vie. Les choix résidentiels autant que certains choix politiques expriment cette phobie de la promiscuité avec le bas de la distribution sociale. A la lumière de cette complexité, l’idée qu’il existerait quelque chose comme un « bloc populaire » opposé à un « bloc bourgeois », par exemple, est une simplification assez outrancière, qui ne peut conduire qu’à de nouveaux aveuglements20.
Conclusion
La conclusion provisoire de tout cela est que la nostalgie ne fait pas une politique. Il ne suffit de déclarer sa fidélité au monde populaire pour le rencontrer. Qui aspire à le représenter doit désormais commencer par affronter sa complexité et ses clivages. La vérité est que la plupart des forces politiques en présence y ont renoncé. Certains en noyant le poisson dans des proclamations aussi inoxydables que floues sur la République et l’égalité. D’autres, en particulier à droite, en segmentant les classes populaires pour y faire leur marché. C’est ce que fait Xavier Bertrand quand il oppose le monde rural et les zones peu denses aux grandes aires urbaines : il met de fait de côté les plus pauvres qui sont dans leur majorité regroupés dans les villes, et bien sûr les quartiers de la politique de la ville. C’est aussi ce que fait Marine Le Pen quand elle mène l’offensive sur les prix à la pompe : elle se tourne vers les classes populaires intégrées dans l’emploi qui doivent remplir le réservoir de leur voiture pour aller travailler. C’est encore ce que fait Eric Zemmour quand il appelle les électeurs sur le terrain de son roman culturel nationaliste et misogyne : il met délibérément de côté les immigrés et une grande partie de leurs enfants, ainsi qu’une bonne part des employées. Tous parlent du peuple la main sur le cœur, mais chacun choisit celui qui l’arrange.
Chacun cherche son peuple.