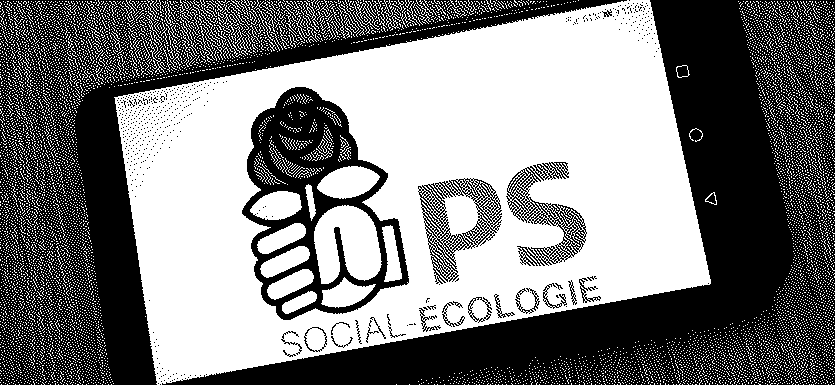La sortie des énergies fossiles est un impératif écologique. Avec la crise ukrainienne, elle s’impose désormais également comme un impératif géostratégique. Les énergies décarbonées et singulièrement les énergies renouvelables ont en effet une double vertu : 1) elles n’émettent pas de gaz à effet de serre et contribuent en cela à la lutte contre le réchauffement climatique ; 2) elles sont locales, créent des emplois et de la valeur sur le territoire et pour cette raison permettent de sortir de la dépendance aux importations d’hydrocarbures. Or ces importations viennent d’Etats dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont très étrangers aux valeurs qui nous animent. On pense naturellement à la Russie aujourd’hui, mais aussi à l’Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Pour le dire autrement, la décarbonation de notre mix énergétique augmentera notre autonomie ; symétriquement, elle affaiblira ces régimes et les poussera à sortir d’une économie de rente qui rime souvent avec corruption, autoritarisme et kleptocratie. Comme nous l’avions détaillé dans une note récente (Souveraineté alimentaire et transition écologique : un projet pour l’agriculture française | Terra Nova), la crise en Ukraine renforce cette nécessité de décarboner l’agriculture européenne et notre alimentation en valorisant notamment les solutions fondées sur l’agroécologie.
En effet, derrière la question énergétique se cache un autre sujet : celui de l’alimentation. Depuis le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine, nombreux ont été les commentateurs à souligner le risque d’une nouvelle crise alimentaire mondiale. Le conflit entre ces deux géants de la production et du commerce des céréales a déclenché un emballement des cours mondiaux et fait peser un risque sérieux sur les populations des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Est, en particulier. A l’horizon des mois qui viennent, des famines peuvent y être redoutées, ainsi que des « émeutes de la faim » comme ce fut le cas dans plusieurs pays du monde en 2008 suite à une brusque augmentation des prix de plusieurs denrées alimentaires. Face à ce risque, certains prônent le retour rapide en Europe et particulièrement en France à une agriculture plus productiviste afin de voler au secours des pays pauvres. Il faudrait en finir avec cette « lubie » du Pacte vert et ses déclinaisons que sont la stratégie « Biodiversité » et la stratégie « De la ferme à la table » et plutôt « libérer le potentiel de production ».
Les risques d’une nouvelle crise alimentaire mondiale sont-ils réels ? L’Europe et la France peuvent-elles réellement venir en aide aux pays menacés ? Et si oui, comment ? Faut-il voir une instrumentalisation de la crise ukrainienne derrière les appels à « produire plus » ?
Le raisonnement qui sous-tend la remise en cause de la transition écologique de l’agriculture est en réalité piégé. Car, à l’inverse de ce qui se passe pour la transition énergétique, les intérêts écologique, économique et géopolitique sont loin d’être alignés dans le domaine de la production agricole et de l’alimentation. A certains égards, ce calcul pourrait même se révéler contradictoire avec la transition énergétique et le souhait de renforcer la souveraineté alimentaire de l’Union européenne sans totalement répondre au besoin de solidarité à court terme.
Le conflit russo-ukrainien : une menace pour la sécurité alimentaire mondiale
Des impacts nombreux et variés
On l’a dit et répété ces derniers jours : l’Ukraine et la Russie sont devenues au cours des dernières années des acteurs majeurs des marchés des céréales. Dans ce secteur, leur contribution à la production mondiale est particulièrement importante pour l’orge, le blé et le maïs, principalement à destination de l’alimentation animale (pour mémoire l’alimentation animale représente environ 79 % de la consommation mondiale de protéines végétales, fourrages compris). Ensemble, les deux pays ont représenté, en moyenne et respectivement, 19, 14 et 4 % de la production mondiale de ces cultures entre 2016/17 et 20181. Ils jouent aussi un rôle particulièrement important pour l’huile de tournesol, avec un peu plus de la moitié de la production mondiale.
Au-delà de leur poids important dans la production mondiale, ils ont aussi un poids considérable en matière de commerce, avec des cultures très tournées vers l’exportation. Par exemple, dans le secteur du blé, la Russie est le premier exportateur mondial, avec 18% des expéditions mondiales. De son côté, l’Ukraine était le cinquième exportateur de blé en 2021, avec une part de marché mondiale de 10 %. La prééminence des deux pays sur la scène commerciale mondiale est également remarquable sur les marchés mondiaux du maïs, de l’orge et du colza, et plus encore dans le secteur de l’huile de tournesol.
Le conflit en cours pourrait ainsi entraîner des conséquences terribles pour de nombreux pays (voir ci-dessous) dans les douze à dix-huit prochains mois en raison de ses effets sur la production, le commerce et les prix.
Concernant la production de céréales, l’enjeu porte notamment sur la capacité de ces deux pays à réaliser les semis de printemps dans les prochaines semaines (maïs, tournesol, orge notamment) puis à l’automne pour les cultures d’hiver (blé et orge d’hiver) pour assurer la prochaine récolte (près de 90% du blé ukrainien de la récolte précédente a déjà été sortie du pays). Cette capacité dépendra de la disponibilité de la main d’œuvre – les agriculteurs ukrainiens viennent de disposer d’une dérogation à l’obligation de mobilisation –, du gazole (en Ukraine) et des semences (en Ukraine et en Russie, les importations étant quasiment impossibles du fait des sanctions). Ainsi, l’impact du conflit – qui a pour l’instant globalement épargné les zones rurales – sur la prochaine récolte est encore très incertain et dépendra des évolutions des prochaines semaines.
A très court terme, la guerre a surtout un impact sur le commerce et les prix. L’enjeu est de réussir à faire sortir les grains d’Ukraine et de Russie. Aujourd’hui, les ports ukrainiens et russes en mer Noire et en mer d’Azov sont devenus totalement inopérants (occupés, bloqués ou plus desservis en raison des sanctions). Il existe encore un passage par la Roumanie voisine pour les volumes restant en Ukraine mais le débit est plus compliqué. L’effet du conflit sur les prix des céréales a été immédiat et pourrait durer. Sur un marché où la demande est relativement inélastique – les hommes et les animaux doivent bien continuer à manger – un petit impact sur l’offre – réel ou anticipé – aura un effet plus que proportionnel sur les prix. Le conflit a d’ores et déjà provoqué un choc majeur pour les matières premières alimentaires. Depuis le début de l’année, le prix du blé a augmenté de 44 % sur le marché à terme de Chicago et de 33 % sur le marché parisien, référence en Europe. Ceux du soja et du maïs ont aussi grimpé de près de 30 %.
Le fantôme des émeutes de la faim de 2007 : Vers une nouvelle crise alimentaire mondiale ?
Si le pire n’est jamais certain, il est aujourd’hui très difficile de prévoir avec précision l’ampleur des différents impacts. En cas de prolongation du conflit, des risques de pénurie physique ne peuvent être écartés dans certains pays. Il faut également distinguer selon les céréales et leur utilisation – alimentation humaine ou animale – et les zones géographiques.
En Europe, les risques pour la sécurité alimentaire des populations sont relativement limités. D’une part, l’Europe importe relativement peu de céréales destinées à l’alimentation humaine d’Ukraine et de Russie et les pays européens disposent des moyens financiers nécessaires pour faire face à une hausse des cours. Les catégories sociales les plus défavorisées pourraient en revanche souffrir de l’inflation à venir sur les biens alimentaires, nécessitant une réponse ciblée des gouvernements à l’image de ce qui est fait aujourd’hui sur l’énergie et l’essence.
La dépendance de l’Europe aux céréales russes et ukrainiennes concerne surtout l’alimentation animale pour le maïs et les tourteaux de tournesol importés à plus de 50 % d’Ukraine. Les conséquences de la hausse des cours dans ces domaines pourraient être lourdes pour une industrie de la viande déjà en crise et où l’alimentation des bêtes représente le principal coût de production.
La véritable dépendance de l’Europe réside cependant dans les importations d’engrais russes, à hauteur de 25% de ses besoins. Pour mémoire, en 2021, la Russie était le premier exportateur mondial d’engrais azotés (dérivé à près de 80% du gaz, lui aussi russe à hauteur de 40%) et le deuxième fournisseur d’engrais potassiques et de phosphates ; autant de produits essentiels au développement des cultures dans des systèmes agricoles très spécialisés. C’est une véritable faiblesse du système agricole européen.
Le risque de crise alimentaire concerne surtout les pays pauvres et le continent africain. Si, à très court terme, les stocks devraient permettre de trouver des substituts aux livraisons bloquées dans les ports de la mer Noire, se pose toutefois la question de la capacité des pays dépendant des exportations russes et ukrainiennes à supporter les prix actuels. En fonction de la durée du conflit, la FAO prévoit une inflation des prix alimentaires de 8 % à 20 %. Le conflit ukrainien vient aggraver une situation déjà difficile puisque ces derniers avaient déjà augmenté de 30 % fin 2021 par rapport 2020, en raison de la hausse des prix de l’énergie et des conséquences de la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui, les prix des principales céréales destinées à l’alimentation humaine (blé, maïs) ont déjà dépassé les prix atteints lors des dernières émeutes de la faim en 2007 et 2008. Les pays principalement concernés par cette hausse des prix et une possible future pénurie physique si le conflit devait s’enliser sont notamment l’Erythrée, la Somalie, l’Egypte, la Turquie, le Liban, la Lybie, etc. Tous importent entre 50% et 100% de leurs besoins en blé de Russie ou d’Ukraine. L’inflation du prix des céréales et le risque de pénurie physique constituent une menace existentielle pour les populations de ces pays où les ménages consacrent déjà près de 50% de leur revenu à l’alimentation. Au-delà du coût humain de nouvelles émeutes de la faim, cette situation représente un véritable risque de déstabilisation des régimes en place dans le voisinage méridional de l’Europe et une nouvelle crise migratoire.
Dans ce contexte, faut-il, comme certains le demandent, suspendre les normes environnementales et « libérer le potentiel productif » de l’agriculture en Europe ? En augmentant les rendements, ils pensent pouvoir maximiser la production et ainsi venir en aide aux pays du sud de la Méditerranée. Ce calcul joint l’intérêt économique et l’impératif humanitaire : cette aide pourrait en effet non seulement porter secours à des populations en détresse, mais aussi se traduire par de confortables recettes commerciales supplémentaires et, par la même occasion, contrer l’influence russe dans certains de ces pays. Ce calcul présuppose cependant, de la part des systèmes agricoles européens, une capacité de réaction qui n’a rien d’évident. Augmenter des rendements qui sont déjà parmi les plus importants au monde est loin d’être acquis.
Que peut l’agriculture européenne ? La solidarité plutôt que le commerce
La réponse à la crise alimentaire potentielle n’est pas la même selon les temporalités envisagées. Cette guerre ukrainienne appelle des mesures rapides, de court terme sur les douze à dix-huit prochains mois, et des mesures plus structurelles de long terme pour renforcer la souveraineté alimentaire européenne et mondiale.
Favoriser la transparence des marchés et la solidarité vers les pays les plus en risque
A court terme, les capacités d’augmenter fortement la production européenne ou mondiale sont assez limitées. Les surfaces disponibles sont en effet relativement peu nombreuses pour permettre de semer plus. Les principaux syndicats agricoles européens demandent ainsi de pouvoir déroger à la règle de la politique agricole commune qui leur impose de réserver 4% des terres agricoles à des « surfaces non productives », afin de semer davantage. Il faut rappeler qu’en réalité les terres disponibles pour produire plus sont bien inférieures à ces 4% et représentent au final une « goutte d’eau » par rapport aux surfaces russo-ukrainiennes qui pourraient venir à manquer. En effet, sont comptabilisés dans ces 4% tous les éléments des paysages comme les murs de pierre, les roches naturelles, les haies et bosquets, les arbres non-agricoles, les zones humides ou les terrasses. Par ailleurs, une grande partie des exploitations européennes (celles qui font moins de 15 hectares ou qui ont majoritairement des prairies dans de nombreux pays) échappe d’ores et déjà à cette obligation. Sauf à détruire le peu de haies restantes et à retourner les prairies, le réservoir de terre est en réalité assez limité. En Allemagne, par exemple, les terres en jachère représentaient en 2021 moins de 1% de la surface agricole utile. En ajoutant les cultures dérobées – une plante cultivée entre deux cultures principales annuelles successives – souvent fixatrices d’azote (ce qui permet de limiter l’utilisation d’engrais importés), on arrive à 1,2Mha. En France, cela représente 0,35 Mha. Ces chiffres sont à rapporter aux 32,5 Mha ukrainiens et aux 123Mha russes. Les ordres de grandeurs ne sont donc pas du tout les mêmes. La mobilisation de ces surfaces en Europe serait surtout nécessaire pour apporter un complément d’appoint à l’alimentation des animaux européens plutôt qu’à fournir une solution à la situation des pays de notre voisinage.
A court terme, les pays développés, dont la France, peuvent toutefois apporter un soutien très concret à l’Ukraine et aux pays africains pour éviter le scénario du pire. Ce soutien doit d’abord s’attaquer à la question de l’approvisionnement et du prix des céréales sur les marchés mondiaux à travers :
- Un soutien financier aux pays les plus pauvres pour financer l’achat de denrées alimentaire et éviter que la facture alimentaire ne déstabilise leur balance des paiements ;
- Un soutien technique et logistique à l’Ukraine pour préparer la prochaine campagne de production ;
- Une surveillance accrue du fonctionnement des marchés mondiaux et une amélioration de la transparence sur les stocks. Ce dernier point repose notamment sur une communication claire pour maintenir les flux commerciaux et limiter les politiques pro-cycliques comme les restrictions à l’export. La mobilisation du système AMIS2 et la communication des pays du G7 va dans le bon sens mais l’Union européenne pourrait avoir une approche davantage coordonnée en interrogeant les mesures prises en Hongrie ou en Bulgarie3.
Par ailleurs, à court terme, si l’objectif est bien de prévenir une éventuelle crise alimentaire dans les pays du voisinage de l’Union européenne, une action coordonnée des Etats membres, sous l’impulsion de la France qui occupe aujourd’hui la Présidence du Conseil, pourrait venir réaffirmer la priorité absolue à l’alimentation humaine (par rapport à l’alimentation animale ou à la production de bioénergie). Rappelons que les premiers consommateurs de céréales en France sont… les animaux d’élevage, singulièrement les porcs et les volailles. Autrement dit, les terres consacrées à des productions destinées à l’alimentation animale pourraient être en partie allouées à l’alimentation humaine.
Si l’on comprend la nécessité, surtout en période de campagne électorale, de soutenir la trésorerie des exploitations d’élevage en finançant l’achat de céréales à hauteur de 400 M€, ces politiques de soutien, surtout si elles se généralisent en Europe, pourraient venir entretenir la dynamique inflationniste des marchés et engendrer une compétition déloyale avec les pays pauvres incapables de suivre les moyens financiers déployés en Europe, les privant ainsi de volumes de céréales qui auraient aussi pu servir à l’alimentation humaine.
Cette priorité absolue à l’alimentation humaine pourrait se traduire par une série de mesures visant à accroitre les stocks disponibles et à prioriser ces derniers de manière claire vers les pays en difficulté à travers un accroissement de l’aide alimentaire d’urgence (l’Ukraine fournissait 30% des réserves du programme alimentaire mondial) financé par les pays développés et particulièrement l’Union européenne.
Le premier moyen serait de sortir les céréales russes des mesures de sanction à l’image du refus de l’Union européenne d’appliquer un embargo sur le gaz et le pétrole qu’elle importe. Au regard de l’enjeu humanitaire, il pourrait être envisagé de permettre à la Russie de préparer la prochaine récolte en facilitant l’approvisionnement en semence puis d’organiser l’achat des céréales russes aujourd’hui très compliqué du fait des sanctions bancaires. Rien ne garantit que Vladimir Poutine accepte et renonce à sa menace de déstabilisation des pays voisins de l’UE. De plus, cela revient, comme pour le pétrole et le gaz, à financer le régime russe et sa guerre.
Si l’Union européenne veut rester fidèle à ses principes et faire preuve de solidarité, d’autres leviers pourraient être aussi explorés et débattus à très court terme :
- Réorienter une partie de nos productions : alors que les semis de printemps pour la betterave sucrière (1,7 Mha) et la pomme de terre d’industrie – deux productions qui contribuent relativement peu à la sécurité alimentaire – sont en cours, on pourrait imaginer qu’une partie des parcelles soient plutôt semées en soja, autres légumineuses et céréales de printemps adaptées au climat. Si le conflit venait à s’enliser, la question pourrait aussi se poser concernant l’assolement à l’automne : nos agriculteurs pourraient semer un peu moins de colza (5MHa) et un peu plus de céréales. Les pouvoirs publics prendraient à leur charge le rachat des semences nécessaires. Une telle modification des assolements à court terme présente aussi des inconvénients pour l’appareil industriel en aval (les raffineries et sucreries) et l’alimentation animale mais qui sont relativement gérables par les pouvoirs publics à travers les mesures de crise (chômage partiel, prêt garanti, etc.) ;
- Réduire (temporairement) une partie du cheptel porcin et aviaire : sur des céréales comme le maïs et le tournesol, il y a une compétition nette entre alimentation humaine et animale. Plutôt que soutenir les trésoreries pour acheter de l’alimentation animale, il pourrait être envisagé de réduire la demande globale de céréale en réduisant le cheptel et d’accompagner la restructuration de certaines filières déjà en surproduction comme la filière porcine. Des mesures de marché tel que des programmes de réduction volontaire de la production et des programmes de stockage privé de la viande qui sont prévus par la réglementation européenne et déjà mobilisés dans des crises récentes permettraient de gérer cette décroissance Ce serait l’occasion d’engager également une réflexion politique à moyen et long terme sur l’élevage et une transition négociée de ce secteur.
Ces deux leviers peuvent être mobilisés, à court terme, de manière complémentaire et surtout de manière coordonnée au niveau européen pour éviter tout phénomène de « passager clandestin ». Ils enverraient également un signal contra-cyclique clair aux marchés à la fois sur l’augmentation de l’offre européenne et la baisse de la demande qui pourrait faire redescendre les prix spot et futurs. Ils représentent un coût pour les pouvoirs publics – comme les mesures des différents plans de résilience – mais s’inscrivent dans une démarche claire de solidarité avec nos voisins au-delà de la préservation de nos intérêts économiques biens compris.
Au-delà de cette urgence de court-terme, la guerre ukrainienne souligne aussi la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire européenne à moyen et long terme.
L’illusion du « produire plus »
Face à cette crise, les voix sont nombreuses pour réclamer de « libérer le potentiel productif » ou pour réaffirmer la « fonction nourricière » de l’agriculture qui seraient mis à mal par le Pacte vert européen et ses déclinaisons, s’appuyant sur des analyses dont les biais méthodologiques ont déjà été largement soulignés et les résultats débattus4. Personne ne conteste la fonction nourricière de notre agriculture, c’est en effet sa raison première. Il faut toutefois rappeler qu’aujourd’hui l’Europe et la France sont en réalité des importateurs nets de calories. Aujourd’hui, malgré toutes nos exportations, c’est le reste du monde qui contribue à nous nourrir plutôt que l’inverse5.
Par ailleurs, l’agriculture française est dépendante comme les autres secteurs de l’économie, directement et indirectement, des énergies fossiles que nous importons sous forme de gazole pour le machinisme, d’engrais, de pesticides ou de matières riches en protéine comme le soja, destinées à l’alimentation animale. Directement (4,5 à 5 Mtep/an, soit près de 3% de la consommation finale nationale) du fait de ses consommations de fioul et de gaz pour faire fonctionner ses tracteurs et autres engins, pour chauffer ses serres ou pour alimenter ses bâtiments d’élevage, ses laiteries, etc. Et indirectement (5 Mtep/an) principalement du fait de son intensité en engrais azotés dont le prix a été multiplié par trois en un an du fait de l’augmentation du prix du gaz. Le tout sans compter les consommations d’énergie des transformateurs et de l’ensemble de la filière alimentaire.
Cette dépendance directe ou indirecte aux énergies fossiles est un facteur de fragilisation de nombreuses filières agricoles en période de hausse des prix du pétrole et du gaz : le coût de l’énergie représente en effet selon les systèmes de production en moyenne de 10 à 20% des charges des exploitations, et parfois plus de 30% dans certaines productions sous serre. Les productions agricoles les plus consommatrices d’énergie (en tep/kg produit) sont la viande, le poisson, les oeufs et les légumes sous serre chauffée.
Pour le dire vite, l’intensification des systèmes de production agricole et la surconsommation de protéines animales augmente la dépendance aux énergies fossiles et aux engrais azotées, et donc la sensibilité au prix de l’énergie. La recherche à court terme d’un choc de production par l’augmentation des rendements en France risque donc de se heurter à la hausse du prix des intrants et de générer des externalités négatives en matière environnementale (émission de gaz à effet de serre, épuisement des sols…). Le tout sans générer des gains véritablement significatifs sur les rendements qui sont déjà très élevés : l’agriculture française fait déjà partie des plus intensives (la France est l’un des plus gros consommateur de pesticides) et la perte de richesse des sols explique déjà en partie que les rendements aient cessé de croître au rythme que l’on a pu connaître dans le passé. De même, relocaliser massivement la production d’engrais en Europe ne changera que marginalement la situation car nous serons toujours dépendants des ressources fossiles nécessaires à leur production. Au final, l’intensification de la production pourrait transférer la dépendance aux grains ukrainiens à une dépendance encore plus marquée au gaz et au pétrole.
L’enjeu à moyen et long terme reste donc bien de décarboner massivement notre agriculture par le progrès technique, d’investir et de dérisquer le passage à des modes de production qui ne requièrent pas ou très peu d’intrants de synthèse et surtout par une évolution de nos modes de consommation – moins carnés et moins transformés – et de production. Il ne s’agit pas de produire moins mais de produire différemment – en valorisant davantage les systèmes agroécologiques fondés sur la nature et la relocalisation territoriale de certaines productions. Cette transition, outre ses bénéfices pour notre nutrition et la nature, réduira amplement la dépendance de notre système alimentaire à des intrants soit dont nous ne sommes pas producteurs (et qui nous rendent donc vulnérables à des chocs exogènes d’approvisionnement), soit qui pèsent particulièrement sur les marges des agriculteurs. En l’état actuel, et la guerre ukrainienne le démontre par l’exemple, l’agriculture européenne doit se renforcer autour des notions de réduction des dépendances, de renforcement de sa résilience et de valorisation d’une production de qualité. Dans un scénario qui concilie transition écologique et renforcement de la souveraineté alimentaire, la contribution de l’Europe à la sécurité alimentaire mondiale pourrait même devenir positive sans forcément à abandoner les ambitions de la stratégie « de la fourche à la table ».