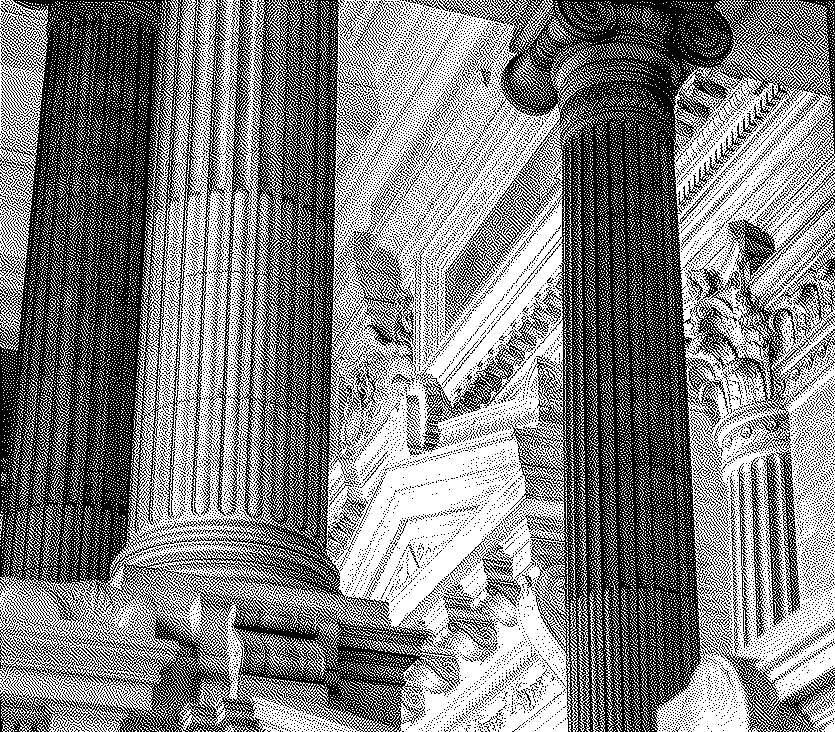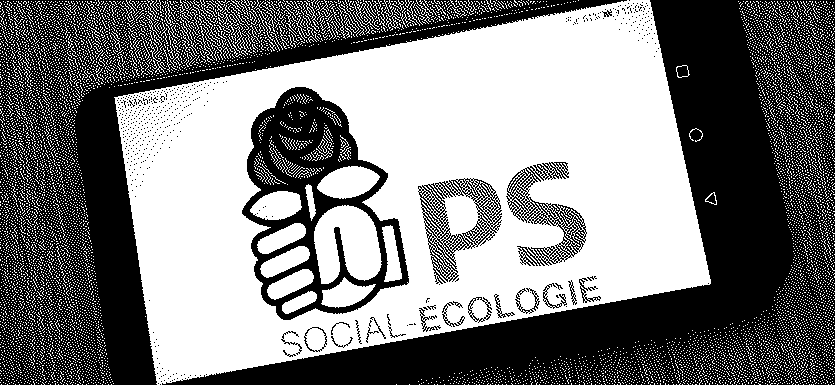Dans quel contexte la Cour de justice de la République a-t-elle été créée, et avec quelles finalités ?
Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est mentionnée aux articles 68-1 et 68-2 dans le titre X de la Constitution (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement). A sa création, sous l’impulsion de François Mitterrand, l’idée est de rapprocher en matière pénale le statut des membres du gouvernement du droit commun.
Il faut souligner qu’il s’agit bien de matière pénale, et non de responsabilité politique. La responsabilité politique est couverte par les articles 49 et 50 de la Constitution ; elle a un seul effet, à travers la motion de censure, qui est la perte du pouvoir pour l’ensemble du gouvernement, et non pour un seul de ses membres. En France, il n’y a pas dans la constitution de responsabilité politique individuelle des ministres. L’institution de la CJR en 1993 vise à réorganiser quelque chose de différent : la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Il ne s’agit pas seulement de perdre le pouvoir ou de s’y maintenir. Il s’agit d’organiser la sanction pénale.
Le point constitutif de la création de la CJR, c’est la volonté de rapprocher du droit commun le statut pénal des ministres en exercice. Le rapprochement avec le droit commun est fait sur la question des infractions. Ce que permet la CJR, c’est de réprimer des crimes et délits de droit commun commis dans l’exercice de leurs fonctions par des membres du gouvernement.
La Cour peut être saisie par toute personne qui s’estime lésée par un crime ou un délit imputé à un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. La procédure de saisine comprend trois étapes :
- La commission des requêtes, composée de sept magistrats issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, décide de l’engagement des poursuites. Ce filtre est mis en place afin que le nouveau droit offert aux particuliers ne devienne pas une arme politique contre l’action gouvernementale. La commission des requêtes décide de la transmission de la plainte au procureur général près la Cour de cassation afin de saisir la Cour de justice de la République. Elle peut, à l’inverse, prononcer le classement de la procédure.
- Si la plainte est déclarée recevable, la commission d’instruction, composée de trois magistrats de la Cour de cassation, procède aux auditions des personnes se déclarant victimes et des personnes incriminées. Elle décide ou non du renvoi de ces dernières devant la CJR.
- La formation de jugement, composée de trois magistrats et de douze parlementaires, se prononce à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu puis, en cas de culpabilité, sur l’application de la peine infligée.
Quelles leçons peut-on tirer de la procédure diligentée contre Eric Dupont-Moretti et de sa conclusion ?
C’est une première dans l’histoire de la cinquième République, qu’un Garde des Sceaux fasse l’objet d’un recours devant la Cour de justice de la République. Pour la première fois, le ministre de la fonction judiciaire dans le pays, garant du respect des lois et de la Constitution, Garde des Sceaux, se trouve attrait devant une juridiction pénale. C’est une première, pas très heureuse, et c’est indiscutablement très frappant.
S’il est positif que l’Etat de droit permette de conduire une action en justice contre chacun, fût-il ministre, il reste qu’il n’y a pas lieu de se réjouir aujourd’hui de ce qui apparaît bel et bien comme une ténébreuse affaire dans l’histoire de la République. Une affaire d’une grande complexité, dont on ne peut certes pas séparer la personnalité propre d’un ministre au verbe plein d’arêtes vives, largement contesté dès sa nomination, engagé dans un conflit de longue date avec la magistrature contre laquelle il a porté, notamment dans ses livres, des accusations d’une extrême gravité. D’autres gardes des sceaux ont été avocats avant lui, mais la nomination nécessairement conflictuelle d’un avocat aussi marqué, tout au long de sa carrière, par la critique des magistrats, fait figure de péché originel dans cette affaire.
Au-delà, c’est une affaire qui interroge surtout toute la machinerie de la chancellerie, du Conseil supérieur de la magistrature et de l’ensemble du fonctionnement judiciaire en France. Dans le cas présent, Eric Dupont-Moretti n’a pas pioché dans la caisse, il a été mêlé à un dispositif administratif de contrôle de l’action des magistrats : les (désormais) fameuses « enquêtes administratives » qui peuvent conduire à des procédures disciplinaires devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Cette affaire pose des questions qui, en un sens, le dépassent. L’enquête qu’on lui reproche d’avoir déclenché l’avait en fait été par son prédécesseur, Mme Belloubet.
Nul ne sort grandi de cette affaire, qui signale des problèmes structurels dans le fonctionnement de la justice. Il faut en particulier prêter attention à l’enquête administrative visant le parquet national financier. L’une des questions posées est la pertinence d’avoir déclenché une enquête administrative : cette décision posait nécessairement un enjeu de conflits d’intérêts pour M.Dupont-Moretti, ce qu’a d’ailleurs aussitôt souligné le Syndicat de la magistrature. L’audience a révélé le rôle qu’a joué le procureur François Mollins dans ce déclenchement, en conseillant la directrice de cabinet Véronique Malbec ; s’il a pu dire à l’audience qu’il n’avait fait que rappeler le droit, il reste que, comme l’a montré Cécile Guérin-Bargues, certains lui en ont voulu d’avoir ainsi ouvert la voie à une procédure qui ne pouvait que faire tomber son instigateur sous la qualification de prise illégale d’intérêts.
Mais au vu des conclusions de l’Inspection générale de la justice, c’est plutôt l’absence d’enquête qui aurait été inquiétante. Olivier Beaud a souligné qu’à la lecture du rapport de l’enquête administrative sur le parquet national financier, un citoyen ne pouvait pas ne pas s’émouvoir : comment dès lors demander à Eric Dupond-Moretti de la débrancher ? D’autant qu’il a par ailleurs agi pour se déporter. Le rapport pointait des difficultés sérieuses, des comportements pour le moins étonnants voire embarrassants. Comme l’a souligné Olivier Beaud, les avocats, en particulier, étaient fondés, en lisant ce rapport, à contester l’utilisation des « fadettes » d’avocats qui y étaient révélée dans le cadre de l’affaire « Bismuth », et à défendre leurs libertés fondamentales d’avocats. La légalité de la procédure sera ensuite reconnue, les fadettes ne bénéficiant pas du même régime protecteur que les écoutes téléphoniques. Unique pénaliste ainsi « espionné », Éric Dupond-Moretti est aussi le seul avocat à porter plainte contre X pour « violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances », tenant sur les magistrats en général des propos peu amènes. Nommé ministre un mois plus tard, il avait aussitôt retiré sa plainte, ce qui cependant n’éteignait pas l’action publique. Même en gardant à l’esprit, toujours, que la lourdeur de tout dossier pénal interdise par principe quelque jugement extérieur que ce soit, faute de pouvoir en maîtriser l’infinie complexité, il faut bien considérer malgré tout que la magistrature ne pouvait pas être exempte ici d’un regard sur ses pratiques.
Dans cette affaire, la qualification retenue présente-t-elle des spécificités ?
Éric Dupond-Moretti était poursuivi pour prise illégale d’intérêts, pour avoir, en tant que dépositaire de l’autorité publique « sciemment pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération quelconque sur laquelle il exerçait un contrôle au moment des actes posés, en particulier sur la discipline des magistrats ». La prise illégale d’intérêts est peut-être l’une des infractions les plus compliquées du code pénal. La seule lecture des lignes de l’article 432-12 signale la complexité technique de cette infraction, ce qui donne forcément une certaine marge discrétionnaire aux juridictions qui doivent l’interpréter.
Ce qui est extrêmement étonnant dans la décision de la Cour de justice de la République, c’est d’avoir distingué un élément matériel et un élément intentionnel, surtout de la façon dont elle l’a fait. La CJR a en effet considéré que le garde des sceaux ayant pris les décisions d’ouverture d’une enquête administrative, tout en étant placé – du fait des critiques qu’il avait pu préalablement émettre – dans une situation de conflit d’intérêts, l’élément matériel de l’infraction était constitué, ce qui permet de justifier la saisine de la Cour. Toutefois, à défaut d’élément intentionnel, faute « d’une conscience suffisante qu’il pouvait avoir de s’exposer à la commission d’une prise illégale d’intérêts en ordonnant les enquêtes administratives litigieuses », le Garde des sceaux est relaxé.
En droit, il y a des infractions qu’on appelle objectives, ou quasi-objectives, parce qu’elles ne comportent pas d’élément intentionnel, ou que l’élément intentionnel est aisé à démontrer ou quasiment objectif par lui-même. C’est a priori le cas en matière de prise illégale d’intérêts : l’intention est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment les faits reprochés. La simple conscience des intérêts suffit à caractériser ce que l’on peut appeler une situation de conflit d’intérêts. En ce sens, cette infraction est presque un modèle d’infraction objective ou quasi objective. C’est pourquoi le texte de la CJR suscite l’étonnement. La rédaction même du texte est surprenante : on a le sentiment que tout converge dans le raisonnement pour motiver une condamnation, mais le paragraphe s’achève sur la conclusion inverse.
Cette décision pourrait-elle valoir précédent dans le jugement d’autres affaires de prise illégale d’intérêts qui n’auraient rien à voir avec des personnes occupant des fonctions gouvernementales ? On peut penser que les 36.000 maires de France seraient fort contents, s’ils étaient poursuivis comme ils y sont souvent exposés sur ce motif avec de fortes chances d’être condamnés, d’être soumis à l’interprétation dont a bénéficié Eric Dupond-Moretti. Les avocats de maires, de présidents d’associations ou d’élus qui seront mis en accusation sous ce chef plaideront sans doute demain l’absence d’intentionnalité devant les juridictions pénales ; je serais assez étonné – en sachant qu’en la matière la jurisprudence de la Cour de cassation est très abondante, compliquée mais relativement précise – que ce qui a été retenu par la CJR leur bénéficie demain. Ce qui naturellement alimentera l’idée que l’on n’est pas jugé de la même façon selon que l’on est ministre ou non.
Il faut bien retenir que la Cour de justice n’a pas choisi la stratégie de se soumettre à la jurisprudence de droit commun. Elle n’a pas décidé, sur fond d’un certain doute face à cette infraction compliquée, de se plier à ce que font les autres juges. Elle a choisi la direction inverse. C’est pour cela qu’un pourvoi en cassation contre cette décision de relaxe aurait eu des chances de succès et que le procureur général Rémy Heitz a déclaré n’y renoncer que dans un souci « d’apaisement »…
Quels sont les termes du débat récurrent sur l’éventuelle suppression de la Cour de justice de la République ?
Il y a aujourd’hui une quasi-unanimité pour la suppression de la CJR, suppression portée d’ailleurs à deux reprises, sous l’égide d’Emmanuel Macron, dans les projets de loi constitutionnelle de 2018 et 2019. Il faut noter que Julien Bayou, qui participait à la formation de jugement dans l’affaire Dupont-Moretti, en est sorti en affirmant que, quoi que l’on pense de cette affaire, la conclusion à en tirer, c’était qu’il fallait supprimer la CJR, que les citoyens ne « pouvaient pas comprendre » que « des politiques jugent des politiques ».
De fait, il est difficile de trouver du positif dans le bilan de la CJR. Rien, dans l’historique des décisions rendues, ne semble aller dans le bon sens. Prenons par exemple l’affaire Pasqua : en 2010, Charles Pasqua fait l’objet de mises en accusation dans l’affaire du casino d’Annemasse. Il est jugé devant la Cour de justice de la République, mais ses complices ne peuvent pas y être attraits : ils sont déférés devant les juridictions ordinaires. Eux seront condamnés, mais Charles Pasqua sort blanchi sur les mêmes faits. Une issue qui, naturellement, suscite l’étonnement. Autre exemple avec Christine Lagarde. Jugée par la Cour de justice de la République, elle est reconnue coupable en décembre 2016 de « négligence », mais dispensée de peine du fait, est-il argué, de ses responsabilités importantes au moment du jugement. Une condamnation sans peine et pour un tel motif, là encore, cela suscite l’étonnement. Le sentiment que l’on en retire, c’est celui d’une atténuation de fait de la responsabilité. Pour ne pas parler d’une forme d’impunité dans certains cas…
En 1993, au moment de la création de cette juridiction, les mentalités étaient différentes, c’était un peu la fin d’une époque aussi. La tendance générale qui accompagne cette histoire, c’est l’idée qu’un Etat moderne doit tendre à ce que tous soient soumis au droit commun, ministre ou non. Cette idée, bien que partagée, a cependant, pour l’instant, échoué à conduire à la suppression de la Cour de justice de la République. Elle a pourtant l’effet de suggérer une forme de corporatisme entre pairs qui pose problème : non seulement parce que c’est injuste, mais aussi parce que cela ne peut qu’alimenter une lecture populiste vilipendant ce que certains seront tentés d’appelés une « caste ».
Ce qui interroge dans la CJR, c’est au fond ce que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) appelle la question de l’impartialité objective, c’est-à-dire la question de savoir comment est construit le dispositif de justice. Il y a une notion fondamentale d’apparence d’impartialité qu’explique la CEDH : « [Cette démarche] conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées » (CEDH, 6 juin 2000, Morel c. France).Dans certains arrêts, la Cour se fonde d’ailleurs explicitement sur le célèbre aphorisme de Lord Hewart C.J. : « It is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ». A la lumière du bilan de la CJR, on peut considérer que les conditions d’une impartialité objective de la CJR ne sont pas réunies. Comme le disait Michel Audiard, « la justice, c’est comme la sainte vierge : il faut qu’elle se manifeste de temps en temps, sinon le doute s’installe… » Avec la CJR, il est tout simplement devenu impossible que le doute ne s’installe pas.
Quel dispositif pourrait alors la remplacer ?
La présence d’une majorité de politiques dans la formation de jugement d’une juridiction pénale, cela pose quand même de sérieuses questions. Il faut donc revenir au droit commun.
Mais pour revenir au droit commun, ilest très probablement nécessaire, et ce point me paraît consensuel, qu’il y ait une commission des requêtes pour préserver les ministres d’accusations répétitives et/ou indues. Cet organe qui opère un filtrage est un gage de sérieux des recours. C’est la position que défend la grande spécialiste de la question, ma collègue Cécile Guérin-Bargues. Cette commission d’examen des requêtes serait le dernier vestige de singularité statutaire d’un membre du gouvernement, par opposition à un citoyen ordinaire. Il serait légitime qu’elle se substitue au parquet dans le cas précis des ministres de gouvernement : les exigences de la continuité de l’État, les nécessités de l’action gouvernementale, justifient qu’il y ait une particularité pour filtrer les accusations portées contre des ministres. En regard du parquet, qui pourrait a priori assurer lui-même ce filtrage, il me semble cependant que la composition de la commission des requêtes, incluant, outre des magistrats du judiciaire, des membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes qui sont aguerris au fonctionnement de l’action publique, présente un intérêt réel. Le procureur général près la Cour de cassation et la commission d’instruction pourraient ensuite, comme aujourd’hui, conserver leur place dans la procédure. Ce dispositif et les organes qui le composent n’ont pas démérité, si je puis m’exprimer ainsi, au contraire de l’organe de jugement qu’est la CJR. C’est aussi un gage de neutralité, dans un contexte malheureux de fortes tensions entre les magistrats et le politique.
Par ailleurs, avancer sur la responsabilité pénale des ministres n’empêche pas de continuer à s’interroger sur leur responsabilité politique. Une affaire a marqué les esprits sur ce sujet : l’affaire Benalla. En réponse à l’émoi causé dans l’opinion, lorsque le président de la République propose qu’on « vienne le chercher » lui, que veut-il dire au juste ? Il sait fort bien qu’il n’est pas politiquement responsable et qu’il nous propose donc là une impasse : on ne peut tout simplement pas « venir le chercher », justement. On ne peut pas rester dans un système politique où le président mais aussi les ministres pris individuellement sont irresponsables politiquement en droit et où le gouvernement est, de fait, protégé contre la plupart des manifestations de défiance du Parlement. On l’a vu avec la motion de rejet du 11 décembre dernier. Revenons à l’affaire qui nous occupe. Même sans condamnation devant la CJR, n’est-il pas possible de réfléchir aujourd’hui à la responsabilité politique d’Eric Dupont-Moretti ? Est-il légitime que sa démission n’ait été envisagée qu’en cas de condamnation ? Cette affaire pose en définitive la question de la responsabilité politique des ministres devant le Parlement.
Pourquoi les projets de suppression n’ont-ils pas abouti ?
Pourquoi ne supprime-t-on pas une institution que pratiquement plus personne de raisonnable ne défend et sur laquelle il n’y a finalement même plus de véritable controverse ? Peut-être faudra-t-il un énième scandale, plus énorme encore que les autres, pour parvenir à cette issue.
Ceci interroge les conditions de réussite d’une révision constitutionnelle. C’est une vaste question. En 2008, sous le mandat Sarkozy, la méthode choisie avait fonctionné : réunir une commission chargée de poser un diagnostic large et déterminer sur cette base une série de révisions souhaitables, avec un certain consensus, cela confère à la révision une certaine légitimité. Les dernières tentatives de révisions constitutionnelles ont, elles, plutôt choisi la méthode du « cherry-picking » et progressivement, à chaque fois, l’agenda de révision est passé au second plan. L’inscription du droit à l’IVG dans la constitution s’annonce complexe, même si elle me semble hautement souhaitable. Le risque politique du référendum étant probablement trop grand, une révision exige une légitimité politique solide devant le Congrès, quel que soit le sujet.
Le corporatisme politique peut-il être mis en miroir d’un certain corporatisme judiciaire ?
Les audiences ont jeté une lumière crue sur les pratiques pas toujours très reluisantes, pour ne pas parler de « coups bas », au niveau le plus élevé de notre appareil judiciaire. Le tableau ainsi dressé n’est flatteur pour aucun des protagonistes. Mais la conflictualité frontale qui existe entre magistrats et politiques est une réalité qu’il faut regarder en face. Et il ne faut pas se priver de dire que ce n’est pas une bonne chose pour notre pays.
Les conditions de travail extrêmement dégradées des magistrats en sont la toile de fond : sur ce point, le rapport de Jean-Marc Sauvé issu des Etats généraux de la justice en octobre 2022 a posé un diagnostic précis. On compte aujourd’hui en France environ 11 juges des ordres administratif et judiciaire pour 100 000 habitants, alors que la médiane des membres du Conseil de l’Europe est de 17,6. En parallèle, le ratio magistrats/avocats est passé de 2,8 en 1986 à 8 aujourd’hui, et il est possible de penser que ceci pousse à une hausse du contentieux. De fait, le contentieux a explosé et les effectifs de la magistrature n’ont clairement pas suivi. Quelle réponse peut-on apporter à cette paupérisation, source de réelles souffrances pour les magistrats autant que pour les justiciables ? Les efforts budgétaires pour le service public de la Justice, qu’Eric Dupont-Moretti se targue d’avoir réussi à imposer, sont bien sûr une réponse indispensable.
Au-delà, il faut bien faire l’hypothèse que la classe politique se mobilise peu, depuis plusieurs décennies, pour la Justice. Il ne lui est pas reconnu, dans l’action publique, l’importance que lui confère de fait la société en lui soumettant une masse de contentieux toujours plus importante. Le grand mérite du débat présidé par Jean-Marc Sauvé en 2022 a été de montrer la discordance entre le nouveau rôle conféré par la société à la justice, et le relatif désintérêt dans lequel elle est cependant maintenue, peut-être sous l’effet de la crainte, par les responsables politiques.