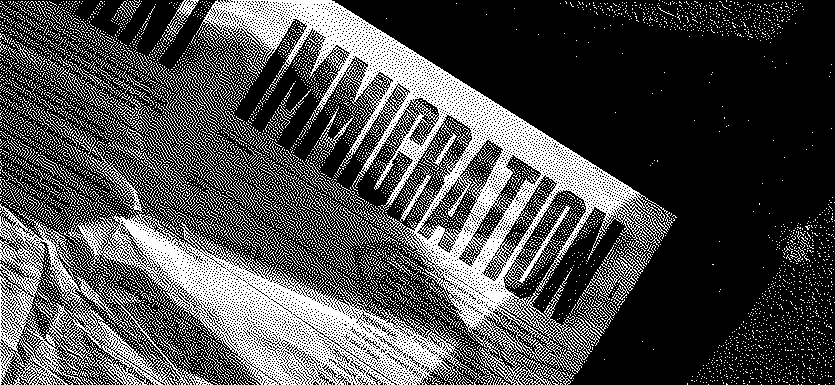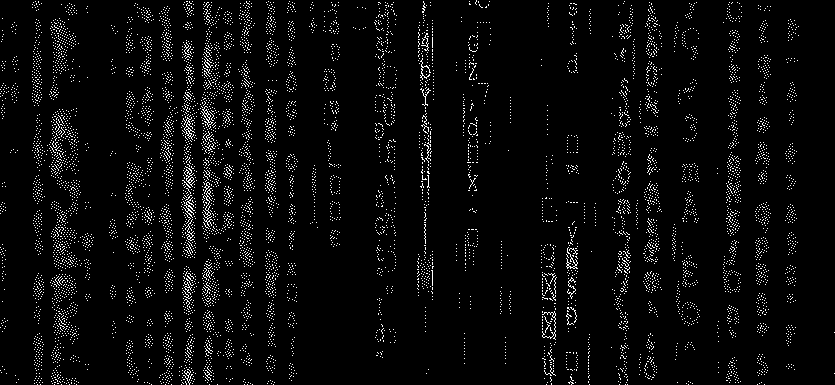Le premier facteur de la crise en cours réside dans la disparition du fait majoritaire. Pour la première fois depuis 60 ans, en 2022 et de façon plus évidente encore en 2024, les élections législatives n’ont pas permis d’installer une large majorité à l’Assemblée nationale. Cette disparition rend impossible un gouvernement issu du camp présidentiel mais également une cohabitation classique faute de majorité alternative. Toutes les offres de gouvernement en circulation sont, pour cette même raison, des offres minoritaires qui ne peuvent prospérer que par la grâce d’accords de non censure souvent tacites, à tout moment réversibles et donc très fragiles.
A cette crise politique s’ajoute une crise budgétaire. L’équation serait à l’évidence moins difficile à résoudre si nous étions en excédent ! La France s’endette aujourd’hui à des taux supérieurs à ceux de l’Espagne, de la Grèce ou du Portugal et équivalents à ceux de l’Italie. Le service de la dette est le deuxième poste budgétaire derrière l’Éducation nationale et pourrait rapidement devenir le premier. Il faut donc amorcer une consolidation budgétaire pour faire en sorte, a minima, que la dette n’augmente pas plus vite que la richesse, ce qui implique un effort de 100 à 120 milliards d’euros sur plusieurs années (3, 5 voire 7 ans, à discuter avec nos partenaires européens), soit environ 4 000 euros par foyer. Cette consolidation est d’une envergure inédite depuis au moins un demi-siècle. Pour cela, des décisions difficiles vont devoir être prises et elles excèderont nécessairement les propositions phares de la gauche (taxe Zucman…) et de la droite (gel des prestations sociales, suppression des postes de fonctionnaires…), lesquelles, même dans leurs versions maximalistes, ne sont pas à la mesure de l’effort à fournir. En somme, si le bouclage d’un projet de budget pour 2026 est si difficile, ce n’est pas simplement parce qu’il dessine traditionnellement le clivage entre une majorité (aujourd’hui introuvable) et une opposition (aujourd’hui plurielle), mais parce que rien de ce qui doit être fait n’est populaire.
Ces deux crises (politique et budgétaire) s’entretiennent mutuellement. La crise politique inquiète les marchés, crée des coûts additionnels et sème la défiance (l’OFCE a chiffré le coût de l’incertitude créée par la crise politique depuis juin 2024 à 0,5 point de croissance à la fin 2025 soit 15 milliards d’euros). La crise budgétaire et les choix qu’elle implique n’encouragent pas les acteurs à prendre des risques pour gouverner (le PS, pour ne citer que lui, pose des lignes rouges tellement nombreuses et tellement rouges qu’elles autorisent à douter de sa réelle volonté de gouverner). Enfin, la résolution de la crise budgétaire appelle un capital et une légitimité politiques dont tous les partis sont précisément privés. C’est de ce piège qu’il faudrait sortir rapidement.
A ces dimensions s’ajoute le jeu des acteurs eux-mêmes. Le Président de la République, pour commencer, concentre sur lui une pluie de critiques. Certaines sont de commodité, mais d’autres parfaitement légitimes. Dans cette catégorie, l’idée qu’il ne veut rien entendre, qu’il s’obstine à nommer des proches et à reconduire une politique rejetée par les Français. La difficulté est qu’au soir des dernières élections législatives, il aurait dû instantanément se transformer en roi des Belges : cesser de défendre sa politique (retraites, politique de l’offre, fiscalité des hauts patrimoines, etc.) et appeler au gouvernement une force ou un bouquet de forces alternatives. Cela aurait marché ou pas. De nouvelles options auraient été explorées en cas d’échec… Bref, le fonctionnement ordinaire des régimes parlementaires. Ce n’est pas du tout ce qu’il a fait, considérant sans doute qu’à la différence d’un Président dans un régime parlementaire classique, l’élection au suffrage universel lui confère une force particulière et l’autorise à s’immiscer continuellement dans les affaires du gouvernement, au risque de tout bloquer.
Les forces politiques présentes au Parlement, par ailleurs, ont pour l’essentiel refusé de transiger et de négocier. On a beaucoup parlé de l’absence d’une culture du compromis. Cette explication est très courte. L’idée de culture tend à naturaliser une difficulté qui n’a rien à voir avec une quelconque identité nationale. La France de la IIIe République faisait des compromis quand l’Allemagne des années 1933-1945 n’en faisait aucun. Il n’y a pas de prédisposition génétique au compromis. Celui-ci aurait pourtant dû s’imposer au moins parce qu’une part significative des députés ont été élus, en raison du barrage républicain, avec des voix venues du camp opposé. Les électrices et les électeurs qui ont voté par défaut, en dépit de leurs préférences politiques, pour un candidat opposé aux extrêmes pouvaient légitimement attendre que les élus fassent preuve, à leur suite, du même esprit de responsabilité en sortant des postures partisanes habituelles.
Plusieurs facteurs expliquent cependant que les forces politiques soient aussi réticentes à emprunter la voie du compromis :
- elles font des anticipations sur les prochaines échéances électorales locales et nationales (très, trop proches…) au regard desquelles le compromis d’aujourd’hui risque de se payer d’une défaite demain ;
- toujours du point de vue de ces anticipations, beaucoup d’entre elles se racontent – parfois sans trop y croire – une histoire dans laquelle le système va retomber sur ses pieds au prochain cycle électoral, qu’une nouvelle majorité forte et stable sortira toute armée des urnes dans le sillage d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente ;
- contrairement à ce qui se passe au Bundestag, par exemple, elles sont faibles et très divisées (le premier groupe, le RN, a moins de 21% des sièges et pour le moment personne ne souhaite construire une majorité de gouvernement avec lui), raison pour laquelle il ne s’agit pas de mettre d’accord 2 ou 3 groupes, mais au moins 5. Le problème de la situation parlementaire actuelle est qu’elle combine la polarisation et la fragmentation ;
- enfin, le personnel politique à l’œuvre au sein de ces forces se distingue, il faut bien le dire, par sa médiocrité, son manque d’imagination et parfois aussi de courage.
Un cinquième facteur joue également : le centre (Renaissance, Modem, Horizons) qui constitue aujourd’hui la force pivot autour de laquelle s’organisent nécessairement les solutions, est lui-même de plus en plus faible et divisé. Le macronisme ne s’est jamais donné un corps de doctrine stable mais, à l’épreuve d’une crise politique inédite, les désaccords sont de plus en plus perceptibles (écologie, immigration, sécurité, retraites, etc.). Ce socle est de plus en plus menacé d’effondrement. Il faut rappeler ici a) qu’il a perdu sa majorité absolue en 2022, b) qu’il a descendu plusieurs marches supplémentaires en 2024 alors même que le jeu du front républicain lui a beaucoup profité, c) que les sondages récents prédisent son explosion en cas de nouvelle dissolution. On peut imaginer dans cette hypothèse qu’une centaine de sièges seraient alors à redistribuer entre la gauche et la droite (« républicaine » ou nationale, la frontière étant elle-même de moins en moins claire). Ce scénario invaliderait l’idée d’un vaste espace central survivant au macronisme (thèse des proches de Gabriel Attal, notamment) et validerait le retour progressif du clivage gauche-droite. Un clivage familier, cependant transformé par la “fusion des droites” en cours, c’est-à-dire la perspective d’une disparition historique de la droite gaulliste et républicaine.
La crise a également été nourrie par l’un des effets pervers de notre Constitution et la multitude d’instruments qu’elle met à la disposition de l’exécutif pour « rationaliser le parlementarisme », le 49-3 étant le plus célèbre mais pas le plus contestable. Beaucoup de ces instruments avaient finalement peu servi pendant 60 ans, le fait majoritaire s’étant imposé comme la « surprise du chef » (Nicolas Rousselier). A partir de 2022, ils ont permis de gouverner au mépris de la légitimité du Parlement (vote bloqué, réforme des retraites traité comme un PLFSS pour pouvoir passer au 49-3, etc.). Tout cela a permis de réaliser les conditions d’une gouvernabilité artificielle qui a laissé de nombreuses « blessures démocratiques » pour parler comme la CFDT. Au bout du compte, ces trois dernières années auront continuellement nourri le sentiment qu’on s’arrangeait avec le verdict des urnes pour poursuivre dans la même direction en utilisant tous les artifices juridiques à la disposition de l’exécutif. La démocratie a désormais besoin de respirer et d’imposer le respect de ses résultats.
Faut-il retourner aux urnes et, pour cela, dissoudre ? La situation internationale commande la plus grande prudence. La Russie a ramené la guerre en Europe et allume chaque semaine de nouveaux feux. Imaginer les conséquences d’une majorité RN de ce point de vue glace le sang. Si nos partenaires ne l’ont pas encore fait, ils seraient bien inspirés de prier le Président de la République de chercher à tout prix une autre solution. Ce qu’il a fait ces derniers jours. La question est de savoir à quel prix (budgétaire) est -on prêt à payer le retour à la stabilité.
Il faudra donc faire respirer la démocratie autrement. D’abord, en donnant aux Français de toutes obédiences des raisons de penser que le chef de l’État est enfin sorti de sa surdité et qu’il est prêt à se faire un peu oublier. Pour cela, il doit accepter de reconnaître qu’il n’a plus les cartes en main, ce qui implique d’accepter des pertes sur son bilan politique.
Ensuite, le Parlement devrait pouvoir mener son travail de délibération démocratique sans être bridé par l’arsenal toxique du “parlementarisme rationalisé”. Il devrait en outre se rendre compte qu’il conserve la faculté de modifier le mode de scrutin législatif, ce qui modifierait les anticipations des acteurs, donnerait un sens à un retour aux urnes et permettrait aux électeurs de voter selon leur sensibilité et non plus en fonction de calculs stratégiques les contraignant au choix du “moindre mal” qui ne fait qu’amplifier leur sentiment de frustration démocratique.
A plus long terme, devraient être explorées différentes pistes de participation démocratique permettant de donner la voix aux citoyens entre les échéances électorales (droit de pétition, RIP, etc.). Et pourquoi pas le référendum.