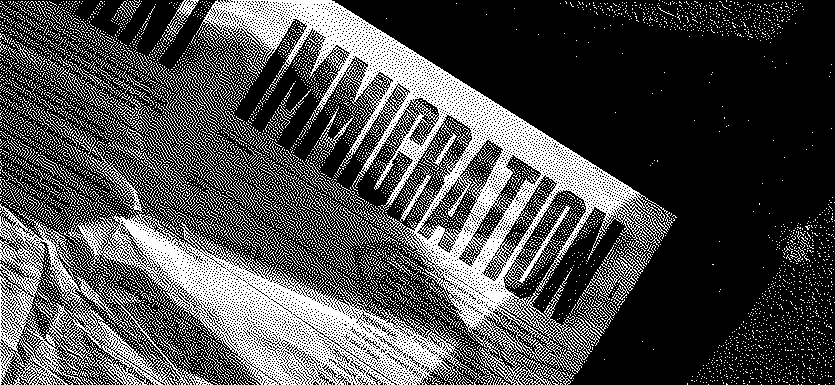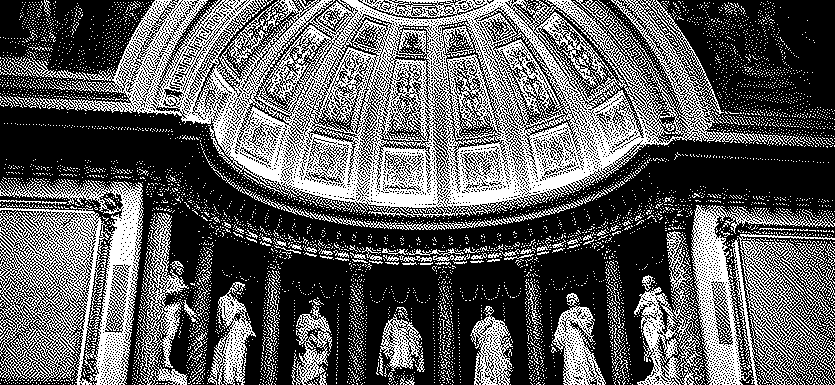En mai 2025, la parution du rapport intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France »1 avait fait grand bruit. Commandé en 2024 par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, le texte pointait du doigt le risque que cette mouvance ne gagne du terrain, notamment grâce à une implantation municipale renforcée. Alors que les responsables politiques y allaient chacun de leur commentaire2, Renaissance, par la voix de son secrétaire général Gabriel Attal, s’était aussi emparé du dossier en déclarant sa volonté d’élaborer une « deuxième loi séparatisme »3. Une loi visant, notamment, à interdire le port du voile pour les mineures de moins de 15 ans et à créer un nouveau « délit de communautarisme », censé compléter le délit de séparatisme. Début juillet, Emmanuel Macron confirmait, sans revenir sur les mesures exactes, l’intention du bloc central de faire voter un nouveau texte, qu’il appelait de ses vœux d’ici « la fin de l’année »4.
Ce projet – pour le moment resté lettre morte depuis l’actualité budgétaire – n’arrive pas en terrain vierge. Quatre ans plus tôt, en 2021, la France s’était déjà dotée d’une loi pour lutter contre le séparatisme : la loi « confortant le respect des principes de la République »5. Un texte qui a opéré un basculement. Il a en effet placé sous contrôle juridique des comportements et pratiques (associatives, professionnelles, scolaires) jusque-là considérées comme relevant de la liberté individuelle. Sur quel fondement ce texte s’est-il appuyé ? Notamment sur la notion d’« exigences minimales de la vie en société », mobilisée dans les débats, dans l’exposé des motifs et dans le texte de loi par le législateur6. Cette notion est loin d’être anodine : floue et évolutive, elle permet de proscrire certains comportements au motif qu’ils seraient dommageables aux fondements de la vie en société.
La perspective d’une nouvelle loi venant compléter celle de 2021 invite à s’interroger. Faut-il voter un texte supplémentaire, alors même que l’arsenal existant est déjà l’un des plus contraignant que la République ait connus en matière de régulation des comportements ? La loi de 2021 a mobilisé un outil juridique particulièrement puissant, voire contestable, qu’on peut s’inquiéter de voir réactivé ou étendu. D’où la nécessité de revenir sur le texte de 2021, en analysant en détail le sens de ces « exigences minimales de vie en société », tout comme les risques dont elles sont porteuses.
Le périmètre inédit de l’interdiction
La loi de 2021 marque une inflexion notable. C’est du moins ce que révèlent plusieurs de ses dispositions. D’abord, elle impose aux associations de signer une charte de laïcité pour pouvoir être agréées – une exigence qui ne figure pas dans la loi de 1901, qui laissait aux associations une totale autonomie dans leur fonctionnement. Ensuite, elle fait de l’instruction d’un enfant en famille une mesure dérogatoire soumise à une autorisation renouvelée chaque année, alors qu’il appartenait auparavant aux familles d’en décider librement, comme le disposait la loi du 28 mars 1882. Enfin, elle étend l’exigence de neutralité aux salariés du secteur participant à une mission de service public ou agissant dans le cadre d’un contrat de marché public7. Cela surprend, car cette obligation ne s’appliquait jusque-là qu’aux agents du service public. Avec ce texte, l’État encadre donc un large éventail de pratiques sociales et professionnelles.
Le pourquoi de ces limitations de liberté interroge. A quelle nécessité répond cette régulation des conduites introduite par la loi ? L’exposé des motifs du texte parle de lui-même : la loi vient répondre à une inquiétude croissante des pouvoirs publics face à ce qu’ils qualifient d’« entrisme communautariste », lequel gangrènerait « lentement les fondements de notre société ». Ce phénomène, essentiellement attribué à l’islamisme, est présenté comme un projet politico-religieux structuré, visant à faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune. La République veut donc se doter de nouveaux outils juridiques pour lutter contre ce qu’elle perçoit comme des « enclaves » communautaires potentiellement séparatistes. Ces dernières menaceraient l’unité nationale en inversant la hiérarchie des normes au profit de valeurs religieuses. La loi cible en particulier les discours fréristes, accusés de promouvoir une « identité musulmane » surplombant l’appartenance républicaine, notamment à travers des structures comme le Collectif contre l’islamophobie en France.
Il importe aussi de souligner que le climat d’inquiétude face aux manifestations de « l’entrisme » a été renforcé en 2021 par des éléments de contexte, comme l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, les tensions politico-religieuses entre la France et la Turquie8, et une période de pré-campagne électorale durant laquelle Emmanuel Macron a souhaité s’adresser à l’électorat de droite9.
Ces éléments permettent de mieux comprendre pourquoi la majorité a souhaité faire adopter une nouvelle loi, mais ils sont loin d’avoir fait l’unanimité au Parlement. C’est seulement après sept mois d’allers retours entre le Palais Bourbon et le Sénat que le texte a fini par être adopté, en dépit des réticences de l’ensemble des partis de gauche (PS, LFI, PCF) de droite (LR) et d’extrême droite (RN)10. A noter que les restrictions que la loi apporte à plusieurs libertés et droits fondamentaux ont conduit les parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel en vue d’un examen préventif – signe du caractère controversé du texte.
Mais au-delà des parlementaires et de la classe politique, ce sont aussi les intellectuels qui se sont emparés de la loi de 2021 pour en débattre. Certains, à l’instar de Stéphanie Hennette-Vauchez, Jean-Fabien Spitz11 ou Philippe Portier, se sont montrés particulièrement critiques. Pour eux, les « exigences minimales de la vie en société », au fondement de la loi, élargissent de manière particulièrement extensive le champ de la contrainte.
Une loi d’ordre public ?
Si cette notion d’exigences minimales de vie en société suscite des inquiétudes chez certains intellectuels, c’est parce qu’elle réactive et accrédite l’idée d’un « l’ordre public immatériel ». L’expression, qui peut paraître paradoxale, sinon oxymorique, suggère qu’il est possible d’édicter des interdictions d’ordre public, non pas en raison d’atteintes matérielles, mais au nom de valeurs fondamentales de la société. Parfois perçu comme désuet, cet ordre public immatériel retrouve aujourd’hui toute son actualité à travers la notion d’« exigences minimales de vie en société ».
L’ordre public immatériel, on l’avait surtout rencontré au XIXᵉ siècle sous la forme des « bonnes mœurs », qui servirent notamment à condamner Baudelaire et Flaubert en 1857, ou encore à borner la liberté de la presse en 188112. Plus récemment, il s’était exprimé à travers la notion de « moralité publique », en 1959, pour interdire le film Le feu dans la peau jugé trop licencieux13. Il était enfin apparu sous les atours de la « dignité », mobilisée par le Conseil d’État pour interdire le lancer de nain dans l’arrêt célèbre14 de la commune de Morsang-sur-Orge datant de 1995.
Les exigences minimales de vie en société, qui font leur première apparition en 2010 avec la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public15, s’inscrivent dans cette filiation de concepts conférant à l’ordre public un caractère immatériel. Mais elles ne se contentent pas d’enrichir ce corpus : elles en renforcent la portée. Car elles s’avèrent bien plus puissantes que les notions de bonnes mœurs ou de dignité qui les ont précédées. Elles se singularisent, notamment, parce qu’elles protègent un large ensemble de valeurs. Ce n’était pas le cas de la dignité, qui se cantonnait à prémunir l’individu des atteintes à sa personne ou des bonnes mœurs et de la moralité publique, dont l’objectif était surtout de soustraire la société aux images ou d’idéologies qui seraient venues lui porter préjudice. Les exigences minimales de vie en société, elles, vont plus loin : elles postulent que le fait d’être citoyen implique l’adhésion à un certain nombre de valeurs.
Cela pose problème, dans la mesure où le corpus de valeurs en question n’est pas défini et s’avère de facto variable selon les lois. En 2010, pour interdire le voile intégral, les exigences minimales de vie en société semblaient, en creux, être pensées comme ce qui protège l’interrelation et l’ouverture à l’échange entre les individus16. En 2021, c’est plutôt l’adhésion au « projet républicain » qui apparaît comme une exigence minimale de vie en société. La notion outrepasse ainsi le champ des valeurs constitutionnalisées pour sanctuariser ce qu’une majorité parlementaire déclare, selon les lois, comme faisant partie des fondements de la sociabilité et du vivre ensemble.
M.-O. Peyroux-Sissoko17, cherchant à définir ces fameuses exigences dans un ouvrage de référence sur l’ordre public immatériel, affirmait qu’elles constituaient la condition de possibilité des droits et des libertés individuelles au sein de la société. Mais cette tentative de définition théorique n’épuise pas le problème : de quelles valeurs précises parle-t-on précisément et à qui appartient-il de les définir ? Ces questions étant laissées sans réponses, le législateur a entre ses mains un outil aussi utile que dangereux. Si bien que le professeur de droit Denys de Béchillon, inquiet de cette plasticité, dénonçait déjà en 2010 « un couteau suisse d’une polyvalence infinie, capable de donner légitimité à n’importe quelle prétention politique à la direction juridique des conduites »18.
Conclusion : quelle vision de la République ?
En 2021, ces critiques de fond étaient connues des parlementaires, qui avaient longuement débattu de la notion dans leurs débats à l’Assemblée nationale et au Sénat en 2010. Pourquoi ont-ils choisi de réactiver une notion qui fait courir des risques en matière de restriction des libertés ? Valentin Gazagne-Jammes avance une explication intéressante19 : selon lui, la majorité a voulu mettre en place un « républicanisme militant » avec sa loi de 2021. Ce concept, forgé en référence aux travaux du politiste allemand Karl Loewenstein, repose sur l’idée qu’une République peut, lorsque ses principes sont menacés par des groupes dissidents, imposer activement ses valeurs, quitte à restreindre le pluralisme.
Une telle conception peut sembler salutaire : elle permet à la République de se défendre par le droit face à des forces qui cherchent à saper ses fondements. Cependant, elle n’est pas sans danger. Elle disqualifie, au profit de solutions coercitives, les espaces de discussion et de médiation qui sont pourtant essentiels à la vie démocratique. Il n’est pas certain que le jeu en ait valu la chandelle dans le cas précis de la loi confortant le respect des principes de la République. La situation n’était pas hors de contrôle et, par ailleurs, il n’est pas dit que la réponse juridique ait été vraiment efficace pour susciter l’adhésion aux « exigences minimales de vie en société ». Leur imposition d’en haut pouvant en effet être perçue comme une forme d’humiliation.
Il apparaît donc nécessaire, dans l’hypothèse d’un nouveau texte visant à lutter contre le séparatisme fin 2025 ou début 2026, que le gouvernement réfléchisse aux moyens de susciter l’adhésion à un projet de société commun sans recourir nécessairement à la notion d’exigences minimales de vie en société. Cet outil juridique a un coût – le plein pluralisme – et il n’est pas souhaitable à cet égard qu’il se banalise.
La prudence est donc de mise, et d’ailleurs les principales instances garantes de l’État de droit se montrent elles-mêmes réservées à l’égard des exigences minimales de vie en société. Le Conseil constitutionnel, s’il n’a certes censuré aucune des deux lois qui s’en réclament, s’est toujours gardé de préciser le contenu de la notion, signe d’une certaine distance critique vis-à-vis de l’idée d’un ordre public fondé sur des valeurs20. Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, elle a bien validé la loi de 2010 introduisant pour la première fois les exigences minimales de vie en société, mais en se retranchant derrière la marge d’appréciation laissée au législateur français – manière implicite de ne pas se saisir directement de cette notion21. La balle est donc dans le camp du législateur, auquel il appartient de rester prudent et de rechercher d’autres voies pour renforcer l’adhésion à un projet de société commun.