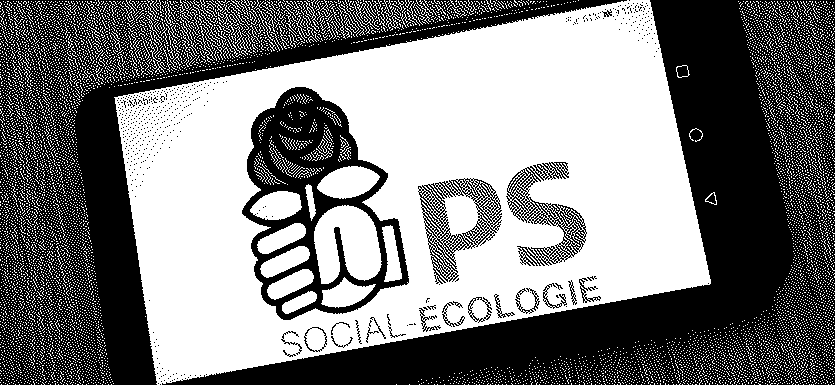Certains discours politiques ont pour vocation de détruire le sens des mots. L’emploi du mot « démocratie
» par Marine Le Pen est révélateur. Elle s’en gargarise1 en promouvant son projet de referendum destiné à ériger discrimination et xénophobie en principes constitutionnels pour la France, dans un projet largement reconnu comme un « coup d’État institutionnel
»2. Le sens d’un mot rabâché s’use en bouche. Lors de sa conférence de presse sur les institutions, le 12 avril 2022, elle a répété près de vingt fois les mots « démocratie, démocratique
». Elle a même sur-articulé celui-ci lors de sa dernière occurrence, en invitant les journalistes à lui poser des questions sur toutes « ces annonces dé-mo-cra-tiques !
». En un discours, la candidate a vidé le mot « démocratie » de son contenu et de son sens.
Vulnérabilité du sens
Provoquée par l’invasion de l’Ukraine que V. Poutine a brusquement déclenchée le 24 février 2022, la crise internationale actuelle est généralisée, balayant simultanément tous les domaines – militaire, politique, économique, social… – et entraînant, par sa soudaineté même, la prise de conscience de changements structurels inévitables et irréversibles. Or, cette crise est aussi une crise du langage et du sens. Un connaisseur russe commentait ainsi plaisamment l’évolution définitionnelle du mot « Russie » en disant qu’il a signifié successivement « un pays avec un peuple
», puis « un territoire avec une population
», et qu’il se définira bientôt comme « une étendue de terre avec une biomasse
». Il y a de l’érosion sémantique comme il y a de l’érosion géologique.
Que la langue et ses significations soient ébranlées en contexte de guerre, le phénomène n’est pas nouveau : « Les balles allemandes ne tuent pas
» pouvait-on lire dans la presse parisienne au début de la première guerre mondiale, elles « ne sont pas dangereuses : elles traversent les chairs de nos pious-pious de part en part sans faire aucune déchirure
», écrivait à sa Une L’Intransigeant le 17 août 1914, sous le titre « Camelote allemande. Balles et blessures inoffensives ».
Le même phénomène se produit aujourd’hui en Russie et en Ukraine, avec la propagande inhérente à toute communication de guerre, chaque jour apportant son lot de fake. Pourtant les dévoiements du sens prennent, au cours de la période actuelle, une dimension nouvelle. D’abord parce qu’ils semblent avoir débordé les frontières de l’événement lui-même. Il était surprenant par exemple d’entendre Bruno Le Maire définir le code Swift comme « l’arme nucléaire financière
» (25 février 2022) dans le cadre des sanctions économiques contre la Russie, quand on sait ce que signifie la menace, bien réelle, de l’arme du même nom brandie par le dictateur russe pour terrifier les peuples et paralyser les États potentiellement hostiles.
Parmi les mots à la dérive – du moins chez lui –, il y a « guerre », dont il a interdit l’emploi sous peine de quinze ans de prison et qu’il a remplacé par « opération militaire spéciale ». Les formes narratives qui découlent de ces deux termes ne sont bien entendu pas du même ordre : une guerre, ça se gagne ou ça se perd, alors qu’une opération militaire, ça se prolonge ou ça s’interrompt, a fortiori si elle est « spéciale
», c’est-à-dire n’entrant pas dans la classe ordinaire des « opérations militaires
». Ainsi les mots fonctionnent comme des protections symboliques. Croit-on. Car si l’usage, grand maître de l’évolution sémantique des langues, venait à s’emparer de « opération-militaire-spéciale
», alors ce syntagme désormais figé pourrait bien, selon les faits qu’il sera amené à recouvrir, aller jusqu’à signifier « guerre d’extermination
» et, dès lors, se perdre plus que se gagner, projetant en tout cas sur son initiateur une marque d’infamie historique. Et peut-être même le qualificatif « spécial » à lui seul fera frémir.
Autre exemple : l’emploi ou non du mot « président » pour qualifier le statut professionnel de Vladimir Poutine. Là se dessine une ligne de partage entre ceux qui envisagent la situation comme négociable et ceux qui la considèrent comme irrémédiablement conflictuelle. Le président français, de même que la plupart des politiques et des journalistes, continuent de nommer « président
» Vladimir Poutine, alors qu’« autocrate
» ou « dictateur
» serait référentiellement plus juste. Les personnes sensibles à la langue éprouvent une légère douleur sémantique chaque fois qu’ils lisent ou entendent « le Président Poutine
». Elles perçoivent comme une salissure sur le mot « président » qui présuppose démocratie et élection, ressentent une sorte de lâcheté munichoise devant le mot juste. Il suffit de tester « Le président Hitler
» (« *Le président Adolf Hitler s’est plaint de manquements à la loyauté
», « *Le président Adolf Hitler a inauguré hier le camp de travail d’Auschwitz-Birkenau en présence de nombreuses personnalités
»). Le président Macron ne souhaite pas, s’opposant en cela au président Biden, froisser le « criminel de guerre » parce qu’il veut sans doute maintenir les conditions minimales d’un éventuel dialogue de sortie de crise. Mais il ne faudrait pas attendre que le mot français « président » en vienne à signifier, par glissement progressif de l’usage, « dictateur », laissant alors s’éroder son sens ancien, démocratique, avec ce qu’il implique d’acceptation de la différence d’opinion, de discussion, d’élection et de reconnaissance instituée de l’élu pour la durée contractuelle d’un mandat.
Robert Badinter, qui s’y connaît, ne prononce à aucun moment l’expression « président Poutine
». Au contraire, interrogé sur les justifications que le potentat revendique, il s’exclame : « Jamais à court de mensonges, les dictateurs !
»3. Et Bruno Tertrais va plus loin encore, lorsqu’il n’hésite pas à nommer, dans l’ordinaire d’une phrase, le « syndicat mafieux qui gouverne la Russie aujourd’hui »4.
Beaucoup d’autres exemples pourraient être retenus afin de mettre en évidence cette fragilité inhérente du sens, ou plutôt son extraordinaire élasticité, sa capacité à se mouler, à se mouvoir, à s’ajuster ou à se désajuster en fonction de ce qui arrive et que les mots ont pour charge de nommer, de manière si variable selon les discours qui prennent en charge ces faits.
La vérité est bien entendu la grande malmenée dans cette affaire, avec son souci de faire coïncider ce qui paraît et ce qui est : un nom et une chose par exemple. Elle perd en tout cas son statut privilégié, statut qu’on voulait croire encore souverain, parce que désormais elle cohabite si étroitement avec le mensonge qui fait paraître ce qui n’est pas, avec le secret qui ne fait pas paraître ce qui est, et même avec la fausseté qui, elle, ne fait pas paraître ce qui n’est pas, que la vérité, elle, se noie dans toute cette relativité. La fausseté, ce sont les fameux « faits alternatifs » de D. Trump, lorsque le fait est là, sous les yeux, contredisant l’affirmation qui le nie, et que pourtant il suffit de « croire » que ce n’est pas le cas pour que la fausseté, entretenue, nourrie, gavée par les réseaux sociaux s’impose envers et contre tout. On se souvient du fait marquant de l’esplanade de Washington lors de l’investiture de Donald Trump : sa porte-parole, proclamant qu’elle est bien plus remplie que lors de celle de Barack Obama, est confrontée au split-screen qui lui met sous les yeux son imposture, et elle s’en débarrasse au nom du « fait alternatif ». Trouvaille du siècle.
La « véridiction » est le nom qu’on donne à cette fièvre de discours où s’entrechoquent fausseté, secret, mensonge et vérité, sans que cette dernière puisse jouir d’un quelconque privilège. Le « faire paraître vrai » est un jeu de langage, et les faits alternatifs s’étayent et s’organisent, devenant plus largement une « réalité alternative ». C’est ce que construit la matriochka narrative de V. Poutine : l’emboîtement de ses récits gigognes.
Les poupées gigognes du récit poutinien
Car, au-delà des mots, ce sont ces justifications discursives de V. Poutine qui importent. Elles dessinent un véritable édifice idéologique dont l’objectif a été de donner une assise de logique et de raison à l’invasion russe de l’Ukraine. « Invasion » et non « guerre », ni même « conflit », car ce dernier terme suppose, si on s’en tient à sa définition, une répartition égale entre les deux parties des raisons et de l’intention de lutter. Pourquoi donc cette invasion ? Il s’agit ici de battre en brèche l’idée reçue selon laquelle V. Poutine serait mu par un seul ressort passionnel, voire pathologique et plus précisément paranoïaque – sans pour autant que cette dimension soit totalement absente. L’invasion s’inscrit dans un récit collectif qui combine l’histoire, le mythe et la foi.
Ce récit est donc d’une grande profondeur historique, idéologique et politique. Quand il l’énonce, le lieutenant-colonel du KGB se fait essayiste, à la fois historien et philosophe. De nombreux spécialistes – politistes, slavisants, soviétologues – en ont étudié la grande complexité. Mais on peut aussi, plus modestement et à l’appui de leurs analyses, repérer les manipulations du sens dont fait l’objet cette grande narration pour en mesurer les enjeux véridictoires.
Pour cela nous avons examiné trois textes qui, dans la trame qu’ils forment ensemble, dessinent un véritable organisme idéologique du discours supposé fonder en raison la guerre prédatrice en cours : un essai de V. Poutine, intitulé « Sur l’unité historique des Russes et des ukrainiens » publié en juillet 2021, le discours de déclaration de guerre du même Poutine la nuit du 24 février 2022, l’homélie de Kirill, Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, prononcée le 6 mars 2022, dimanche de la Saint-Jean. On pourrait ajouter, en contre-point, l’adresse au peuple russe de Volodymyr Zelensky, le 23 février 2022, où le président ukrainien conteste pied à pied les allégations du dictateur russe.
Cette trame à trois étages emboîtés forme un modèle qu’on peut comparer à une poupée russe : une matriochka narrative.
Poupée 1 : le récit polémique de la mobilisation immédiate
Au sein du discours de déclaration de l’opération-militaire-spéciale, ce récit présente une structure polémique élémentaire : d’un côté les bons, de l’autre les méchants. La lisibilité narrative est immédiate puisqu’elle repose sur un schéma qui est celui du conte populaire : le héros, le traitre et ses victimes.
«
(V. Poutine, 24 février 2022)L’objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis huit ans. A cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux contre les personnes du Donbass y compris des citoyens de la Fédération de Russie.»
Les deux mots-clefs, porteurs de la charge mobilisatrice, à la fois historique, idéologique et morale, sont bien entendu dénazifier et génocide.
On connaît la thèse dite du « point Godwin » dans la théorie conversationnelle : elle indique que toute conversation conflictuelle tend inéluctablement à un point de tension où l’un des interlocuteurs, renonçant à l’argumentation, va qualifier son adversaire de « nazi !
», « SS
! », « génocidaire !
» Ce jugement constituera le point ultime de l’échange : rien ne pourra plus être dit après. Le dialogue s’interrompt, il ne se poursuivra que par l’exercice de la force brute. Or, ce moment terminatif qui suppose une controverse préalable est ici renversé. Le discours poutinien profère bien le jugement définitif comme une évidence en dehors de tout argument. Il emploie bien les mots qui fâchent. Mais il le fait dès le commencement, et non pas au terme d’un échange qui, de toute façon, n’a pas eu lieu. Il commence par le point Godwin, interdisant dès lors tout dialogue ultérieur.
Cela signifie qu’il y a là une vérité incontestable, adossée à la glorieuse victoire contre Hitler, telle qu’elle ne saurait accueillir la moindre discussion. La suite du discours poutinien le confirme, sur le mode de la menace. Tout comme Barbe Bleue annonce à sa femme la célèbre punition qui fait trembler les enfants s’il lui vient l’idée d’ouvrir le cabinet interdit : « Il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère !
», Poutine lance un avertissement à ceux qui soutiendraient ses « nazis » d’aujourd’hui : « Quiconque tentera d’interférer (…) doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous (je souligne) conduira à des conséquences telles que vous n’en avez jamais connues dans votre histoire.
»
Cette simplicité narrative, archaïque, ouvre la possibilité du récitatif. L’énoncé peut être repris ad libitum par tous les agents de la communication, depuis les éminences comme Sergeï Lavrov jusqu’aux plus modestes bureaucrates, des universitaires soumis au régime aux prolétaires anonymes, de manière quasi incantatoire, sans que jamais le moindre ajout narratif ou argumentatif vienne préciser, affiner ou illustrer l’anathème. La nouveauté du phénomène est là : la banalisation du point Godwin invite à en reproduire le schéma de manière mécanique, sans dramatisation subjective, sur un ton neutre, comme une évidence d’emblée et depuis toujours partagée au sein de la tradition populaire.
Poupée 2. Le récit mythique d’une Unité historique
Mais à cette strate narrative une autre s’ajoute, plus élaborée et plus savante. Nous ne sommes plus dans le récit de l’action immédiate, mais dans celui de la grande Histoire. L’article-essai de V. Poutine, « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens » en est le texte de référence.
Les spécialistes ont amplement montré qu’il s’agissait là d’une réécriture du récit historique visant à faire reconnaître l’unité présupposée d’une mosaïque de peuples dont les conflits au fil des siècles et les dominations alternées sont particulièrement complexes. Car il s’agit pour le narrateur Poutine de fonder l’acteur collectif russe sur le mode du « totus », c’est-à-dire de le concevoir comme un bloc, de l’imposer comme une totalité insécable du sein de laquelle ne saurait se dégager aucune identité particulière. La ville de Kiev en a été le foyer originel, la ville de Moscou en est le lieu tutélaire ; rien ne peut couper le fil continu, immuable et permanent qui les lie. « J’ai dit que les Russes et les Ukrainiens constituaient un seul peuple.
»
À cela s’oppose l’affirmation de l’identité distincte et séparée des Ukrainiens, elle aussi justifiée par l’Histoire. Mais ce qui est frappant à ce sujet et qui s’oppose à la stabilité essentielle et définitive revendiquée par Poutine, c’est le caractère de recréation et de refondation permanente de cette identité collective, en fonction des événements eux-mêmes : sa longue et tumultueuse histoire bien sûr depuis la fondation de Kiev, mais aussi, parmi d’autres circonstances qui fabriquent du ciment identitaire, sa reconnaissance par Lénine dans l’Union soviétique au XXe siècle que Poutine dénonce, puis la grande famine génocidaire de 1931–33 due à Staline, le « Holodomor », avec ses 4 à 7 millions de morts ukrainiennes selon les estimations, le don de la Crimée à l’Ukraine par Khrouchtchev en 1954, l’« autocéphalie » accordée au patriarche orthodoxe de Kiev (2019) par le patriarche de Constantinople, et même cette guerre actuelle soudant, dans et par une résistance héroïque, un sujet collectif qui, aux yeux de Poutine, n’a pas lieu d’être.
C’est sur cette affirmation de non-existence, ou de non-droit à l’existence – qui rappelle celle des SS dans L’espèce humaine de Rober Antelme – que le président ukrainien Zelinsky se fonde pour parler de génocide à propos de la guerre que Poutine mène aujourd’hui contre son peuple.
Car cette identité distincte ne serait aux yeux de ce dernier que le produit d’une opération de plus grande envergure, mise au cœur du récit dans le discours du 24 février. L’ennemi véritable n’est pas le nazi de la première poupée, mais la puissance manipulatrice qui se profile derrière, celle des Etats-Unis d’Amérique, celle de son bras armé l’OTAN, et celle de ses nombreux satellites – les pays européens – qui tournoient en menaçant le ciel russe.
Le motif n’est pas nouveau, la plainte est récurrente : la Russie est un colosse assailli à ses anxieuses frontières. Mais ce motif s’inscrit cette fois, au prix d’une réécriture de l’Histoire, dans la deuxième poupée de l’édifice narratif dont la première abritait la comptine lancinante qu’on a vue et qu’on dirait presque enfantine si elle n’était pas aussi cruelle. Déjà, par son ancrage dans l’Histoire, ce nouveau récit offre une perspective, une profondeur et une cohérence à l’imaginaire soucieux de saisir les raisons de cette colère et de cette violence soudaine. La guerre a sa justification identitaire.
Poupée 3. Le récit mystique du Salut
Mais une troisième poupée narrative vient envelopper les deux précédentes, et offrir au public destinataire un nouvel horizon, plus profond encore : une justification mystique. Le 6 mars 2022, dimanche de la Saint-Jean, journée du Pardon, le patriarche de l’église orthodoxe russe, Kyrill, prononce une homélie qui fera date, dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Elle fait date car, dans les semaines qui ont suivi, plusieurs évêques orthodoxes russes l’ont prolongée et « ont pris la parole pour approuver l’offensive militaire en Ukraine ordonnée par le président russe » (Le Monde, 18 avril 2022).
Car l’homélie de Kyrill raconte une histoire bien différente : non pas un conte populaire à la Barbe Bleue, ni une fresque historique avec Cosaques Zaporogues et Catherine la Grande, mais le récit métaphysique d’une lutte spirituelle livrée contre les « forces du mal ». Comment identifier celles-ci ? Par le « test de loyauté » dit Kyrill. Ce test permet de dessiner la frontière entre les pays vertueux et les pays décadents, selon qu’on y organise ou non une « parade de la Gay Pride ». Le figure de l’anti-sujet a donc changé de nature : ce n’est plus le nazi, ce n’est plus l’insupportable prétendant à l’identité, c’est l’homosexuel. Celui qui viole la loi de l’amour divin. Et qui donne à notre lutte, précise-t-il, une « signification métaphysique ». A l’épreuve de véridiction qu’exprime le test de loyauté fait suite l’épreuve de la sanction, celle de la théorie du Pardon, le pardon des décadents par les vertueux : « Qu’est-ce que le Pardon ? demande Kyrill. Celui qui vous fait du mal, vous cessez de le haïr, il cesse d’être votre ennemi
». Mais la sanction n’est alors que différée, car « par votre pardon, vous le livrez au Jugement de Dieu.
» Et le patriarche implore : « Que le juste Jugement de Dieu s’accomplisse sur tous.
» En empruntant par exemple la voie d’une opération militaire spéciale.
On comprend que Kyrill considère que « ce qui se passe actuellement n’est pas un conflit entre l’Ukraine et la Russie
» mais une « grande apostasie », celle des peuples « qui se détournent de Dieu ». Autant de bonnes raisons pour « soutenir [notre] président et son action ».
Outre la finesse de son décor, ce qui fascine dans la matriochka russe, c’est l’ajustement des poupées les unes dans les autres. Il en est de même dans la matriochka narrative de Poutine. Les connecteurs qui mettent bord à bord les éléments des trois récits assurent la cohésion de l’ensemble (une analyse détaillée pourrait les mettre en évidence). Poutine réalise, d’une certaine manière, le rêve de Flaubert qui déclarait vouloir « écrire un livre sur rien, (…) qui se tiendrait de lui-même, par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l’air
»5. De fait, ces trois récits se tiennent ainsi l’un par l’autre, indépendamment de toute attache extérieure. Une logique autarcique en ressort, indifférente à sa communication vers l’extérieur et à sa réception, générant de toute pièce une « réalité alternative ». Nous sommes face à un discours non réfutable, une sorte d’énorme « bulle de filtre » à laquelle participent et adhèrent tous ceux qui l’espèrent, s’y attendent et s’y retrouvent. Du point de vue véridictoire dont nous parlions plus haut, on se trouve au beau milieu de cette réalité alternative, qui ne réclame aucune vérification, rien que de l’adhésion. En Russie, dit Marie Mendras, « on vit dans une bulle de mensonge
», « un mensonge colossal
» (France Inter, 20 avril 2022). Il s’agit plus que d’un mensonge, car le peuple russe n’a pas la possibilité d’apercevoir le monde réel derrière la paroi de la bulle. Dans cette bulle, le mensonge se dissout, et la nouvelle réalité, même fictive, se cristallise.
Le contre-point argumentatif de cet édifice est le discours de Volodymyr Zelensky diffusé le 23 février 2022, la veille du feu destructeur. Tout y est différent : le regard, le visage, la posture, le langage. La rationalité surtout diffère : elle est fondée sur la réfutation des accusations (nazisme, génocide), sollicitant aussi bien la logique de l’argument que les faits qui l’illustrent et dans lesquels il se concrétise, prenant à témoin l’auditoire, exposant des prémisses pour conduire à des conclusions, bref se soumettant au principe scientifique de la réfutabilité (Popper) et au principe dialogique de la coopération (Grice).
« Que ça te plaise ou non, ma belle, il va falloir t’y résoudre »
Le théoricien du langage et historien russe de la littérature Mikhaïl Mikhaïlovitch Bakhtine (1895–1975) a apporté à la critique le beau concept de « polyphonie ». Il montrait par exemple qu’une des propriétés de l’écriture romanesque de Dostoïevski était de doter chacun de ses personnages d’une manière de parler qui lui était propre, irréductible à celle des autres personnages, et a fortiori à celle du narrateur. D’où l’effet de foisonnement polyphonique du langage dans le dialogisme, culminant dans les « scènes conclave » qui marquent chacun de ses romans.
La célèbre « scène conclave » à laquelle s’est livré Poutine, la veille de l’attaque, avec ses plus proches ministres et collaborateurs pour les mouiller dans la responsabilité de la guerre imminente n’avait rien de polyphonique. Une redoutable monophonie au contraire, imposée avec violence comme en témoignent les regards effarés des participants, mais « scène conclave » tout de même. Et on peut dire cependant que, d’une autre manière, l’édifice rhétorique poutinien, de par son usage de langue, porte aussi l’héritage de cette polyphonie définie par Bakhtine. Sur un ton monocorde et, semble-t-il, un peu dépressif, il multiplie les registres : le registre bureaucratique du fonctionnaire terne, typique du roman russe, mais aussi le registre lyrique de la Russie éternelle, ou encore le registre pathétique un peu plaintif du mal-aimé, ou le registre tragique de la mort trop familière. Mais par-dessus tout, il y a le parler mafieux bien connu, et son registre de malotru : la fameuse grossièreté du « On ira les buter jusqu’au fond des chiottes
» visant les résistants tchétchènes, l’assimilation de « la racaille et du traitre
» à un « moucheron qui a accidentellement atterri dans la bouche
» et qu’on recrache avec dégoût, et enfin la sirupeuse menace de baise et de mort à l’Ukraine : « Que ça te plaise ou non ma belle, il va falloir t’y résoudre
».
Cette composition polyphonique parle-t-elle à l’âme russe ? En tout cas, ses formes d’énonciation entrecroisées semblent participer à la construction de l’assemblage narratif composite qu’on vient de chercher à décrire, entre dénazification, relents panslavistes et test de loyauté, formant un ensemble invraisemblable pour un esprit cartésien. Ensemble narratif qui est néanmoins au service d’une stratégie de pouvoir bien réelle.
Marine Le Pen, comme Vladimir Poutine
Avec les traits propres à sa culture nationaliste locale, c’est dans le même espace débarrassé de toute relation à la vérité et au contradictoire que Marine Le Pen invite les Français à se placer, celui d’une réalité alternative : un pays purifié de ses étrangers, une Europe spontanément à sa botte, une nation transformée en famille, une alliance avec le dictateur russe considérée comme naturelle. Le secret, la fourberie, le mensonge, sont embarrassées par la vérité, c’est leur souci, la vérité les hante. Alors que, indifférente à la réalité référentielle qui fonde le « vrai », la réalité alternative – quand ce qu’on dit n’est pas et ne paraît pas, mais est néanmoins assumé et cru : la « fausseté » – n’a pas ce problème avec la vérité, elle construit un monde parallèle. Comme Vladimir Poutine, Marine Le Pen propose un discours politique centré sur cette réalité alternative, indifférente à la vérité et au dialogue.