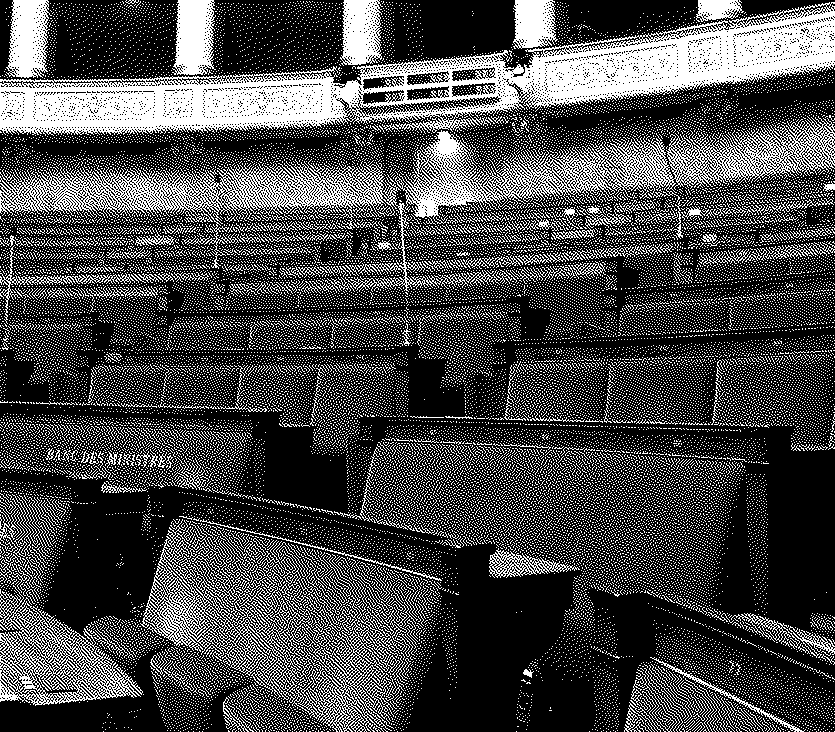Le scrutin majoritaire à deux tours pour élire nos députés distingue la France parmi les démocraties occidentales1. La logique selon laquelle « au premier tour on choisit, au second tour on élimine », affectant depuis 1958 (à l’exception de 1986) les scrutins législatifs français, se trouve maximisée dans une situation où une bonne partie de l’électorat veut éviter l’élection d’un député RN ou rejeter tel ou tel parti de gauche. Cet effet, ainsi que l’abstention ou le choix du vote blanc ou nul, alliés à des variations territoriales, crée une situation d’impossible majorité pour les trois forces se partageant le paysage politique, entrainant un blocage institutionnel qui s’installe depuis les deux dernières consultations.
En l’état de la carte électorale issue du redécoupage de 2010, et sans changement de mode de scrutin, chacun des trois blocs apparaît confronté à une difficile progression, de cent sièges pour la gauche, même unie, cent-quarante à l’extrême-droite et autant au « bloc central », pour aboutir au nombre décisif 289, minimum à réunir pour s’assurer d’une majorité dans une Assemblée Nationale à 577 sièges. Un retour sur les résultats de 2024 montre l’importance des écarts à combler pour chacune des forces politiques aspirant à conquérir une majorité au Parlement. Toutes les campagnes ne se ressemblent pas mais l’histoire et la géographie électorales rappellent quelques lignes de force qui rendent aujourd’hui improbable un raz-de-marée pour quiconque.
1) Une extrême-droite qui plafonne dans beaucoup de territoires
Malgré les annonces alarmistes et les sondages de juin 2024 présidant une majorité absolue possible pour le RN et ses alliés ciottistes, ce camp n’emporta au final aucun siège sur 18 à Paris, aucun siège sur 13 dans les Hauts-de-Seine, zéro député sur les 13 de Seine-Saint-Denis, zéro sur les 11 du Val-de-Marne. Malgré sa conquête d’un siège à la Réunion et d’un à Mayotte, vingt-cinq représentants des Outre-Mer sur vingt-sept lui échappèrent, les positions ambigües de Marine Le Pen sur la Nouvelle-Calédonie empêchant tout succès sur ce territoire et la bonne implantation des députés de gauche guadeloupéens interdisant à ce parti de reproduire son très bon score des européennes. De même, l’impréparation de ce parti en Polynésie Française limita son score à de très bas niveaux (4,6 % et 6,3%). En ajoutant les onze députés des Français de l’Étranger, ce total de 2 députés sur un sous-ensemble de 93 montre toute la distance qui sépare le RN d’une majorité à l’Assemblée.
Après tout, malgré son très bon score au premier tour, le RN se retrouva éliminé de 131 circonscriptions, ce qui le contraignait à remporter les deux tiers de ses seconds tours pour espérer 290 députés ou plus. L’hypothèse tenait du grand optimisme et ne se réalisa pas tant grâce aux bons reports de voix macronistes vers la gauche, et inversement, ou du fait de quelques défaites de députés sortants (dans la circonscription du Médoc en Gironde ou de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne notamment).
En sortant de la petite couronne et des deux groupes de députés à la sociologie électorale particulière de l’Outre-mer et de l’étranger déjà cités, comment l’extrême-droite contrôlerait-elle l’Assemblée Nationale si elle se trouve incapable de gagner aucun des six sièges des Pyrénées-Atlantiques, aucun des trois des Landes, aucun des deux du Gers, aucun des quatre des deux départements corses, aucun des huit du Finistère ou des dix de la Haute-Garonne ? Croire les compenser en remportant, avec ses alliés, des grands chelems comme dans l’Yonne (3/3) ou la Haute-Saône (2/2) néglige ce constat : le RN est fort dans des territoires faibles démographiquement et ne remporte pas de députés dans plusieurs régions plus importantes électoralement : aucun en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, seulement quatre en Île-de-France. Sa non-représentation dans les grandes villes reproduit en calque inversé les faiblesses de la gauche dans de nombreux départements ruraux, entraînant un équilibre des forces électorales renvoyant la lutte pour une majorité législative dans quelques circonscriptions décisives.
Fort dans des départements en stagnation ou déclin démographiques (Haute-Marne, Aube, Yonne…), le RN ne parvient pas à obtenir des élus dans les plus dynamiques économiquement, importants en poids électoral (Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique). Il n’incarne pas encore une respectabilité pouvant attirer, hormis dans quelques exceptions (une partie de la Gironde et du Lot-et-Garonne), la nouvelle France des notables ou le vote agricole (lequel se tourne encore assez vers la droite LR, comme en Haute-Loire ou dans le Cantal) et ne plaira jamais aux électeurs de gauche détenant pourtant dans leurs bulletins un bon tiers des sièges à l’Assemblée.
En calquant des sondages nationaux sur les 577 sièges de l’Assemblée Nationale, les enquêtes d’opinion négligent l’ancrage local de certains élus qui peuvent faire voter pour eux même des électeurs de gauche (tel Charles de Courson dans la Marne) ou de droite (comme Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle). Le RN n’a pas réussi en 2024 à s’imposer face aux régionalistes en Corse (qui perdirent cependant un siège, en Corse-du-Sud, face à LR).
De même, si personne n’imagine les circonscriptions de Chatou, Versailles ou Cabourg passer à gauche, ces safe seats macronistes ne risquent pas non plus, a priori, de basculer dans l’escarcelle de l’extrême-droite, compliquant, avec les quatre sièges savoyards (où pas un candidat RN n’a dépassé les 42% au second tour en 2024) et les six de Haute-Savoie partagés entre Renaissance, Horizons et LR la quête d’une majorité absolue RN. En somme, les territoires électoraux les plus riches en France n’ont pas encore choisi d’abandonner le centre-droit ou de donner leur confiance à des candidats promettant de porter Jordan Bardella à Matignon.
2) Une gauche aux forces insuffisamment réparties sur le territoire et dont la composante insoumise gêne les ambitions gouvernementales
Cette faiblesse du RN ne doit pour autant pas consoler le camp macroniste ni la gauche, dont les perspectives ne sont pas moins incertaines. Si cette dernière pouvait se féliciter d’avoir, dans le Nouveau Front Populaire, remporté tous les députés de Seine-Saint-Denis, son effacement complet de l’Aisne (où la majorité présidentielle gagna quatre sièges en 2012), des Pyrénées-Orientales (quatre députés RN contre trois pour les soutiens de François Hollande en 2012) ou de l’Oise (pas un seul député de gauche contre un PS et un communiste en 2012) l’empêche elle aussi d’obtenir une majorité absolue ou de s’en approcher. Elle ne s’approchera pas de 289 tant que le RN et ses alliés contrôleront dix des douze députés du Pas-de-Calais (leur seul département à plus de dix députés) et sept des vingt-et-un du Nord.
Les alliances défensives que constituèrent la NUPES puis le NFP, sous leurs présentations triomphales et leurs résultats honorables, négligent que les majorités absolues de gauche étaient auparavant obtenues, en 1981, 1997 et 2012, par un seul parti, le PS, ses alliés ne lui servant que d’appoints (ou de partenaires de coalition pour la Gauche Plurielle et les écologistes en 2012 dans le cadre d’un accord d’investitures). Aujourd’hui, les quatre partis de gauche doivent se répartir les circonscriptions depuis Paris pour espérer atteindre une majorité relative. Plus encore, le premier groupe parmi eux reste LFI qui ne veut pas gouverner en l’absence d’un Président insoumis. La dispersion des voix de gauche en cas de non-renouvellement des candidats uniques et de partage des voix entre insoumis et socialistes empêcherait clairement une victoire, même partielle, à l’échelle nationale. Mais cette dépendance à l’électorat insoumis et la mainmise de ce mouvement politique sur nombre de sièges sûrs, en particulier à Paris et en petite couronne, restent difficiles à remettre en cause chez les trois alliés de circonstance. Pas plus que n’est inventé un programme ou une voie politiques afin de gagner, comme entre 1973 et 2012, avec un parti social-démocrate clairement plus fort que son allié sur sa gauche, comme le PS avec le PCF puis Les Verts. Sur ce point, la force inexploitée des socialistes au Sénat, dans les grandes villes (en attendant les prochaines municipales) et à la tête de plusieurs Régions, jamais mise dans la balance dans la NUPES et le NFP, reste un lourd impensé, bien que les scrutins ne se répètent pas et que conserver des régions comme le Centre-Val-de-Loire ou la Bourgogne-Franche-Comté, très travaillées par le vote RN, constituera un défi en 2028.
Plus encore, penser les territoires ruraux perdus pour la gauche, à l’image des insoumis préférant mobiliser l’électorat jeune et les abstentionnistes des banlieues, ignore plusieurs succès de ce camp : ainsi Boris Vallaud représente-t-il la Chalosse et le sud-est des Landes, Sophie Pantel a-t-elle remporté pour les socialistes le siège de la Lozère dans une triangulaire en 2024, ou Marie Pochon, pour les écologistes, est-elle députée de la circonscription de Crest et Saou dans la Drôme. De même, au sein du groupe LIOT, David Habib (3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Orthez et Sallies-de-Béarn) ou David Taupiac (2e du Gers, Condom et Vic-Fezensac) ont-ils empêché deux victoires du RN aux dernières législatives. Des progrès sont toutefois indispensables, à gauche, pour compléter ses succès dans les grandes métropoles ou les Outre-Mer.
La majorité absolue du PS en 2012 s’était aussi construite grâce à des victoires dans la deuxième circonscription de l’Yonne (Avallon et Tonnerre), la quatrième circonscription des Vosges (Charmes et Mirecourt) et les trois circonscriptions de l’Aude, cinq sièges aujourd’hui occupés par l’extrême-droite. Elle avait aussi bénéficié des deux députés des Alpes-de-Haute-Provence, territoire aujourd’hui disputé entre le RN et les représentants du NFP, lequel a perdu de peu en 2024 la deuxième circonscription (Barcelonnette et Manosque). Elle comptait aussi deux députés vendéens, département où le NFP n’a atteint le second tour que dans une circonscription (la 4e) en 2024.
Les trois dernières majorités absolues franches (UMP en 2007, PS et alliés en 2012, En Marche et MODEM en 2017) reposaient sur la capacité à gagner des députés dans presque tous les départements, à ne négliger aucun territoire. Dès 2022, la perte de douze députés à Paris et en petite couronne par le camp macroniste signait un retour de la gauche dans des sièges qui lui semblaient naturellement acquis en 2017 et provoquait, en même temps qu’une forte abstention et un mauvais report de voix au deuxième tour, la perte de sa majorité absolue. La réussite du NFP en 2024 pour obtenir son bon score tint en ses victoires au-delà des villes « gagnées d’avance » (Lille, Montreuil, Montpellier) par l’investiture d’élus ancrés localement : ainsi de Christophe Proença, maire et conseiller départemental socialiste qui l’emporta dans la deuxième circonscription du Lot (Figeac et Gramat) ou Marie-José Allemand victorieuse dans la première des Hautes-Alpes (Gap et Serres). Deux exemples où le PS avait pu récupérer l’investiture contrôlée par LFI dans la NUPES en 2022. Cette même exigence de candidats plus modérés bénéficia au PS dans la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle (Nancy et Malzéville) où sa candidate l’emporta là où une LFI avait perdu en 2022 face à une députée macroniste sortante ; ou dans la cinquième circonscription de Gironde, où Pascale Got, déjà élue en 2022, remporta ce siège face à un RN contre qui une insoumise avait perdu deux ans auparavant ; ou dans la deuxième des Hautes-Pyrénées (Lourdes et Tarbes) où un PS défit un RN alors qu’un insoumis n’avait pas réussi en 2022 à y battre un macroniste.
La NUPES puis le NFP ont permis à ses quatre composantes de maximiser leurs élus par rapport à l’hypothèse de candidatures dispersées, mais ont rendu peu visible l’objectif d’une majorité de gauche à l’Assemblée. En effet, nonobstant la volonté des électeurs de gauche de voter LFI ou PCF ou PS ou Les Écologistes non selon leur préférence mais en fonction des investitures décidées à Paris, cette procédure conduisit à n’octroyer aux écologistes et aux communistes que des circonscriptions difficiles ou « ingagnables ».
3) Un bloc central doublement menacé sur sa gauche et sur sa droite
La majorité absolue obtenue par les marconistes en 2017 reposa sur une passivité et une ouverture. Passivité d’une grande partie de l’électorat entraînant un taux d’abstention jusqu’alors inédit pour des législatives et permettant à l’électorat macroniste d’importants succès dès lors qu’il se mobilisait, y compris dans des circonscriptions parisiennes, landaises ou nordistes jusqu’alors acquises à la gauche. Ouverture des électeurs choisissant, comme en 2007 et en 2012, d’accorder à un nouveau Président une majorité adéquate. Cette logique ne se reproduisit pas en 2022, pour la première fois depuis 1988. Aujourd’hui, les députés des trois composantes du bloc central (Renaissance, MODEM et Horizons) se trouvent confrontés à la disparition complète de la curiosité que suscitait Emmanuel Macron en 2017. Compliquant déjà leur réélection en 2022, son impopularité en a contraint certains, en 2024, à l’effacer de leurs affiches et à ne faire campagne sur leur bilan personnel, comme Sacha Houlié (récent transfuge du macronisme vers Place Publique). Le risque assumé par de nombreux électeurs de gauche, surtout insoumis, de ne pas choisir un candidat de centre-droit au second tour en cas de duel face au RN en votant blanc ou nul, contribue à limiter les perspectives de ce camp aux législatives.
Devoir disputer les sièges des villes et départements les plus riches de France, cependant que la gauche trustera ceux des villes universitaires, de Marseille (en compétition avec le RN) et de Paris démontre l’impossibilité, a priori, pour le centre-droit de retrouver 289 députés ou plus. L’hypothèse prévalant chez LR que les électeurs macronistes reviendraient tôt ou tard vers l’ancien parti dominant à droite ne tient pas, puisque les électeurs des départements où le RN est fort choisissent des députés de ce parti et que ses anciens électeurs de Versailles, Rambouillet ou Saint-Jean-de-Luz préfèrent profondément une droite modérée, au destin gouvernemental plutôt que d’éternelle opposition. Même en cas de candidature unique comme dans la coalition Ensemble en 2022 et 2024 (afin de préserver les trois partis composant le macronisme), un bloc central avec le destin électoral et la représentation de l’ancienne UDF – laquelle ne fit jamais mieux, à l’Assemblée, que 215 sièges en 1993 – n’atteindra jamais la majorité absolue.
Semblablement, la trajectoire de LR depuis les législatives de 2012 dessine son lent effacement électoral, en particulier en région parisienne ou en Nouvelle-Aquitaine (où les macronistes ou le MODEM récupérèrent leurs bastions basques et girondins dès 2017), reléguant leurs députés vers des circonscriptions plus vastes géographiquement qu’importantes démographiquement. Le parti représente ainsi Morteau ou Saint-Claude, mais plus aucune ville de 100 000 habitants depuis le départ d’Éric Ciotti (hormis Boulogne-Billancourt depuis une partielle en février 2025). Même ses derniers fiefs municipaux, en péril dans quelques mois, ne se reproduisent pas aux législatives : ainsi les deux députés de Saint-Étienne sont-ils issus du NFP et les deux de Nîmes du RN. Ce parti n’a fait que perdre des députés depuis sa fondation en tant qu’UMP et ses électeurs peuvent légitimement se demander l’utilité de le choisir dans un contexte où le RN a déjà conquis ses fiefs électoraux (aux côtés de ses alliés ciottistes, six députés sur neuf dans les Alpes-Maritimes, sept sur huit dans le Var, quatre sur cinq dans le Vaucluse, par exemple).
Conclusion : l’élection présidentielle conditionne-t-elle encore les législatives ?
C’est ici la dernière variable d’une quête de majorité pour les prochaines législatives : à quoi doit-elle servir et où se situera le scrutin par rapport à la présidentielle ? Si le ou la locataire de l’Élysée en 2027 choisit, comme semble l’indiquer l’état et la dispersion des forces actuelles au Palais Bourbon, de dissoudre après son élection, le scrutin reproduira le contexte connu en 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022 : des électeurs devant répondre implicitement au besoin d’une Assemblée en accord avec l’orientation politique de l’exécutif. Si un candidat issu du camp macroniste l’emporte, le défi de faire élire 290 ou 300 députés sera majeur. Dans le même temps, les électeurs de gauche ayant constaté après juillet 2024 qu’une majorité relative ne servait à rien seront d’autant plus motivés à en conquérir une. Mais comment surmonter les faiblesses électorales identifiées plus haut ? Enfin, le plafond de verre mis en évidence dans plusieurs territoires, notamment franciliens, pour le RN sera très difficile à dépasser tant que ce parti restera un repoussoir pour une frange plus éduquée et plus aisée de l’électorat ; et les votes de protestation en Outre-Mer aux présidentielles ou européennes ne se convertiront pas en sièges à l’Assemblée tant que ce parti n’y implantera pas mieux ses candidats ou se contentera d’en parachuter.