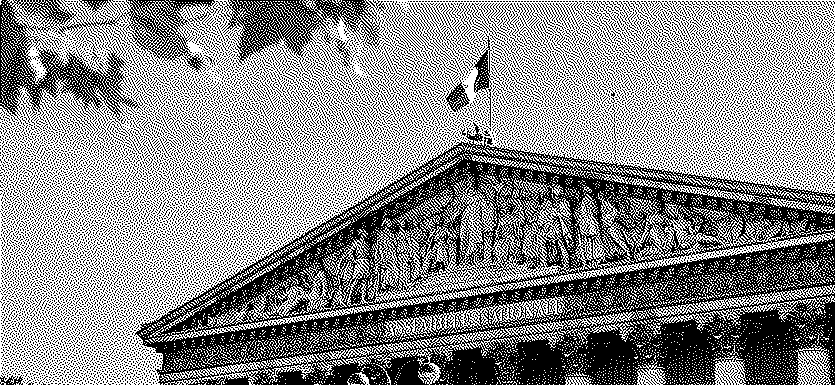Introduction
« La seule chose que je veux pour Paris, c’est qu’un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu’ailleurs. (…) Une réforme en profondeur de la loi “Paris-Lyon-Marseille” pour revenir au droit commun », affirmait le président de la République Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse, le 16 janvier 2024.
La réforme du scrutin appliqué à Paris, Lyon et Marseille (dit “PLM”), promulguée le 11 août 2025, met fin à quarante ans d’un système électoral dérogatoire du droit commun. En rétablissant une élection municipale plus directe, elle est la promesse d’un souffle démocratique nouveau et, à terme, d’un meilleur renouvellement des élus locaux parisiens, lyonnais et marseillais. Mais cette avancée s’accompagne de fortes incertitudes, dont un risque de fragmentation politique et d’une gouvernance municipale fragilisée…
I. Le système PLM avant réforme : une exception démocratique
1. Un mode de scrutin en dehors du droit commun
Le régime électoral appliqué depuis 1982 dans les trois plus grandes villes françaises reposait sur une élection indirecte des conseils municipaux par arrondissements ou secteurs. Destiné à répondre à la complexité et à la taille de ces métropoles, ce système a engendré une forme de verrouillage démocratique, une lisibilité pour les citoyens moins évidente et des distorsions de représentation politique.
Dans les trois villes régies par la loi PLM, ce système ultra-sectorisé a pu créer des déséquilibres, voire certaines dérives : à Paris, les électeurs votaient pour des listes comprenant des candidats au Conseil de Paris et aux conseils d’arrondissements ; à Lyon, le découpage électoral pouvait renforcer le poids de certains arrondissements dans l’élection du Maire ; à Marseille, quelques secteurs « poids lourds » concentraient une influence déterminante sur l’élection municipale, poussant les candidats et élus à des comportements clientélistes.
2. Effets pervers sur la représentation politique
Cette sectorisation avait tendance à produire des majorités municipales qui ne reflètent pas toujours la volonté globale des électeurs et peut entraîner l’élection d’un Maire… minoritaire en voix : cela fut le cas par exemple pour Gaston Defferre – d’ailleurs auteur de la loi PLM – à Marseille en 1983 ou encore Gérard Collomb à Lyon en 2001.
Le découpage en arrondissements ou secteurs amplifie les bastions historiques, marginalisant ainsi les forces émergentes ou dissidentes sur la scène municipale. Ce système a ainsi favorisé l’émergence de figures locales, comme Jean-Claude Gaudin à Marseille, Gérard Collomb à Lyon, ou Jean Tiberi à Paris. À Marseille, Jean-Claude Gaudin a consolidé son pouvoir pendant 25 ans grâce à des secteurs acquis à sa majorité, tels que les 6e-8e arrondissements. À Lyon, Gérard Collomb a bâti son ascension sur la maîtrise de quelques arrondissements clés, avant d’étendre son influence à la Métropole. Dans la capitale, Jean Tiberi – Maire du 5e arrondissement pendant un quart de siècle – illustre également cette personnalisation du pouvoir fondée sur une implantation locale durable. Cette mécanique électorale a eu tendance à freiner le renouvellement et l’ouverture à de nouveaux profils politiques, notamment les jeunes et les femmes.
Reste à savoir si la fin de ce mode de scrutin favorisera un réel renouveau dans les profils des élus concernés.
II. La réforme électorale : fin d’un verrou démocratique, incitation au renouvellement politique ?
La réforme récente constitue un tournant, en redonnant à l’élection municipale son rôle central et, potentiellement, en poussant au renouvellement des élus locaux, sans toutefois clore le chantier démocratique.
1. La lisibilité retrouvée ?
En centrant l’élection sur le conseil municipal global, la réforme supprime le filtre des arrondissements. Dès 2026, deux scrutins seront organisés concomitamment, avec deux urnes distinctes : une élection à l’échelle municipale dans les trois villes, ainsi que des élections dans chaque arrondissement ou secteur. À Lyon, s’ajoutera également un troisième scrutin pour les élections métropolitaines, faisant d’ores et déjà l’objet d’un vote distinct.
Autre point important et non des moindres : la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête sera réduite de 50 à 25 %, encourageant le pluralisme de la représentation. Concrètement, la liste arrivée en tête disposera désormais d’un avantage moins écrasant, ce qui laisse plus de place aux autres listes, encourageant la négociation et la formation de coalitions pour gouverner. L’objectif serait de limiter la domination d’une seule force politique sur les oppositions, avec une représentation municipale diversifiée.
Il s’agit d’un premier pas vers une élection municipale plus proportionnelle, dans les trois plus grandes villes, alors que cette prime majoritaire reste pour l’heure inchangée dans les autres communes françaises de plus de 1 000 habitants. Cela étant, il est curieux de constater l’introduction de cette règle nouvelle faisant figure d’exception, dans une réforme initialement dédiée à faire revenir Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun électoral.
2. Vers un renouveau politique ?
Dans les trois villes, les électeurs gagnent en clarté : un seul bulletin pour toute la ville permet une réelle élection municipale globale, mais devrait réduire l’influence de chaque Maire d’arrondissement sur le résultat final, notamment à Paris. À Lyon, la réforme pourrait resserrer les liens entre la ville et la Métropole, en alignant plus efficacement scrutins municipal et métropolitain. À Marseille, la chute du pouvoir des secteurs historiquement dominants permettrait de rompre les anciennes logiques clientélistes et ainsi d’ouvrir la porte à des recompositions politiques.
III. Limites et angles morts d’une réforme imparfaite
1. Des maires d’arrondissement désormais impuissants ?
Bien que désormais élus dans un cadre clarifié, leurs compétences restent floues et restreintes. Cette ambiguïté institutionnelle peut générer frustration et tensions, entre Maires centraux et arrondissements. Même si le nouveau régime instaure dans la loi un mécanisme de coordination politique – la “conférence des Maires” – la gouvernance des trois villes risque d’en ressortir fragmentée, avec un pouvoir plus important des Maires centraux vis-à-vis de Maires d’arrondissements dépourvus de véritables prérogatives.
2. La persistance d’inégalités territoriales
Les quartiers périphériques ou économiquement défavorisés, moins visibles médiatiquement et moins dotés en ressources politiques, risquent de continuer à être sous-représentés avec ce nouveau schéma électoral. Avec une compétition électorale municipale, le renouvellement pourrait se limiter aux seules élites locales disponibles, plutôt issues des arrondissements centraux.
3. Des coalitions rendues nécessaires par le risque de fragmentation politique
Surtout, la réduction de la prime majoritaire pourrait grandement complexifier la formation de majorités claires. La culture de coalition – encore peu développée en France, y compris à l’échelle locale – devrait logiquement se trouver renforcée. Sans cela, la capacité des trois plus grandes villes à être gouvernées de manière stable pourrait pâtir de cette ouverture, notamment dans un paysage municipal morcelé et des contextes électoraux multi-listes fragmentés.
IV. Pour aller plus loin : approfondir le virage démocratique et lancer la réforme métropolitaine
1. Renforcer la démocratie infra-urbaine
Il pourrait être judicieux d’attribuer des compétences propres aux mairies d’arrondissement/secteur, pour éviter leur effacement du paysage institutionnel local : animation locale, démocratie participative, culture, petite voirie… Peut-être cela sera-t-il l’un des thèmes des campagnes municipales dans les trois villes.
2. Lancer une grande réforme métropolitaine
À Paris comme à Marseille, la gouvernance métropolitaine reste un angle mort démocratique. Les présidents de la Métropole du Grand Paris (MGP) et de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) exercent des compétences structurantes, sans véritablement disposer de la légitimité directe du suffrage universel. À l’inverse, Lyon fait figure d’exception avec l’élection directe de ses conseillers métropolitains depuis 2020, offrant une meilleure visibilité/lisibilité et une responsabilité politique clairement établie. Étendre ce modèle à Paris et Marseille permettrait de rapprocher la décision des citoyens, de clarifier l’articulation entre ville-centre et métropole, et de renforcer la cohérence des politiques publiques à l’échelle des grands bassins de vie.
3. Instaurer une clause de revoyure
Une évaluation systématique devrait être réalisée après les municipales de 2026, fondée sur des indicateurs permettant d’appréhender le renouvellement des élus locaux parisiens, lyonnais et marseillais, tels que l’âge médian des élus, la diversité sociale ou le nombre de mandats préalablement effectués. Cela permettrait de réajuster la réforme en fonction des résultats concrets, et de relancer une nouvelle phase si nécessaire.
Conclusion
La réforme PLM pourrait marquer un tournant : elle rétablit une élection municipale directe, réduit le verrouillage politique et pourrait favoriser l’émergence de nouveaux profils dans les trois plus grandes villes de France. Ces avancées restent toutefois partielles.
Tout l’enjeu sera désormais d’encourager le renforcement de la démocratie locale, dans un sens plus décentralisé, plus pluraliste, avec une gouvernance infra-urbaine légitime. Il conviendra d’assurer que la réforme devienne véritablement transformatrice, sans fragiliser la gouvernance des trois municipalités qui, de fait, sera poussée vers des logiques de coalitions.
Les élections municipales de 2026 constitueront un premier test grandeur nature : seront-elles l’occasion d’une recomposition politique dans les arrondissements et secteurs, avec l’émergence de listes citoyennes de proximité ou de candidatures dissidentes ? Les partis politiques sauront-ils s’acculturer aux dynamiques de coalitions ? (bien que cela soit souhaitable, rien n’est moins sûr…). Les habitants percevront-ils une amélioration concrète de la représentation politique, ou bien les failles de gouvernance et le manque de moyens des mairies d’arrondissement nourriront-ils au contraire de nouvelles frustrations ?
Enfin, l’absence de réforme métropolitaine reste un angle mort majeur. Or, dans les trois villes concernées, les compétences structurantes – comme l’urbanisme, les mobilités, l’environnement ou le logement – relèvent en partie, sinon largement, de l’échelon métropolitain. Le risque est donc de créer une démocratie locale plus vivante, mais déconnectée de la réalité de la dévolution des pouvoirs locaux.
En ce sens, la réforme PLM ouvre un cycle démocratique inachevé et soulève, à court terme, davantage de questions que de clarifications. Les élections municipales de mars 2026 permettront d’en mesurer les avancées et les limites. Leurs résultats devraient nourrir, dès le lendemain du scrutin, un débat bien plus large sur la gouvernance des grandes métropoles françaises et la décentralisation des pouvoirs en France.