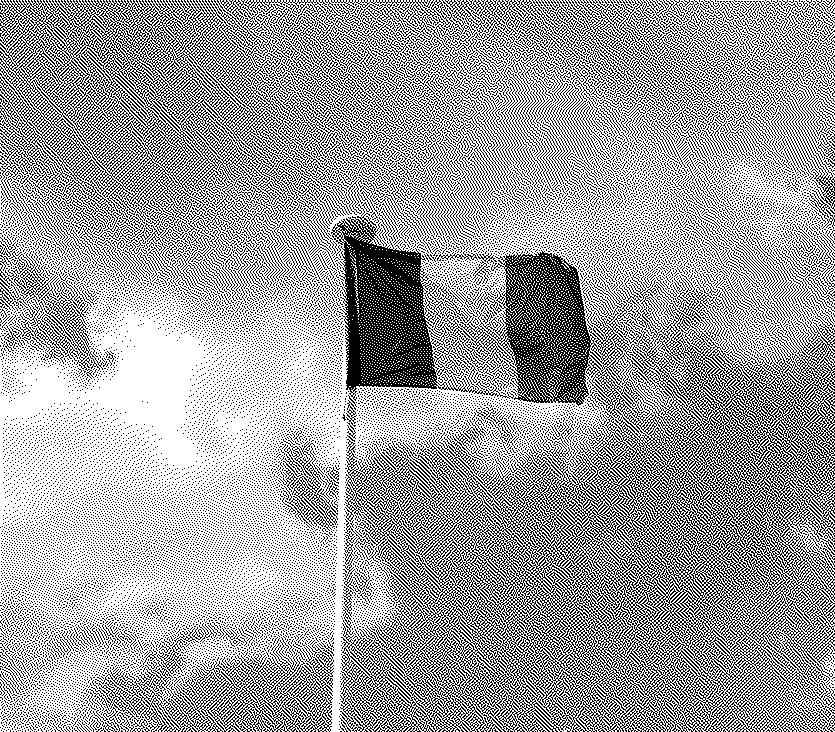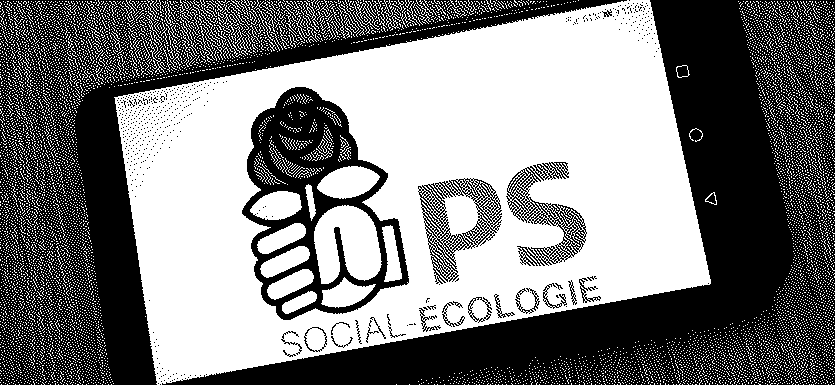Commençons par rappeler une évidence : contrairement à la réputation qu’elle s’est faite et en dépit de ses singularités, la Ve République reste un régime parlementaire. Cela signifie très simplement que le pouvoir gouvernant trouve son assise et sa légitimité au Parlement.
Quand la majorité parlementaire est de la même orientation politique que le Président de la République, ce dernier a tout loisir de déterminer la politique de la nation et se confond avec le gouvernement ; c’est la situation qui a prévalu pendant près de 60 ans entre 1962 et 2022 et nous nous sommes habitués à la considérer comme la norme.
Quand la majorité parlementaire est d’une orientation contraire à celle du Président de la République, alors il cohabite : le gouvernement est conduit par le chef de la nouvelle majorité parlementaire et peut, quoi que rien ne l’y oblige dans la constitution, concéder au Président de la République la gestion d’un « domaine réservé » ; c’est la situation que nous avons connue dans les années 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002.
Depuis 2022, toutefois, est apparu un phénomène que nous n’avions encore jamais connu ces soixante dernières années : la disparition pure et simple du « fait majoritaire ». Ce n’est pas que le pouvoir n’est plus au Parlement mais aucune majorité forte ne s’en dégage.
Pour nous inouïe, cette situation est toutefois l’ordinaire des démocraties parlementaires européennes qui ont toutes adopté un scrutin de type proportionnel aux élections législatives, ce qui n’aboutit que très rarement à donner le pouvoir à une seule famille politique. Résultat, les forces politiques arrivées en tête doivent négocier pour former une coalition fondée sur des compromis programmatiques et un partage des différentes fonctions gouvernementales.
Au lendemain des dernières élections législatives, que se serait-il donc passé si nous avions été dans l’une de ces démocraties européennes ?
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, le Président de la République aurait certainement appelé à Matignon le ou la leader de la première force politique pour lui demander de former un gouvernement capable de rencontrer une majorité à la chambre. Et si cette personne avait échoué, si son gouvernement avait été censuré, alors il aurait appelé une autre personnalité pour tenter un autre scénario. Ou, pour éviter d’en passer par une censure au Parlement comme test de la viabilité d’un possible gouvernement, il aurait nommé une personnalité chargée de préfigurer les équilibres d’une majorité stable et de mener les négociations sans être elle-même candidate au poste de Premier ministre.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, le Président de la République aurait respecté non seulement la lettre mais l’esprit de la constitution : il n’aurait probablement pas suspendu pendant un mois la vie politique, laissant à un gouvernement démissionnaire le soin de gérer des affaires courantes pas toujours si courantes. Il n’aurait sans doute pas permis non plus que des ministres démissionnaires siègent au Parlement pour y faire réélire sa Présidente sortante. Il aurait au contraire rapidement désigné la personne en charge de la construction d’une nouvelle majorité pour lui laisser ensuite le temps de négocier avec ses partenaires.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, le Président de la République n’aurait pas été le chef de la majorité sortante, responsable, représentant et défenseur de la politique conduite depuis près de sept ans. Il aurait pu ainsi prétendre au rôle qui lui revient en pareilles circonstances : celui d’arbitre, fort d’une certaine distance aux appareils partisans.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, un groupe politique fort de 47 députés n’aurait pas proposé un « pacte législatif » mort-né excluant toute « coalition gouvernementale » sans susciter l’incompréhension.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, la force politique arrivée en tête n’aurait sans doute pas expliqué à qui voulait l’entendre qu’elle appliquerait « son programme, tout son programme, rien que son programme », sachant pertinemment qu’une telle perspective aurait rapidement ligué contre elle tous les autres groupes parlementaires. Elle n’aurait pas pu expliquer très longtemps que ses 193 députés pèsent plus que les 384 autres, et qu’elle avait le monopole de l’interprétation du vote de « front républicain » auquel les électeurs se sont pliés.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, la force politique arrivée en tête n’aurait sans doute pas expliqué que son gouvernement serait exclusivement composé de personnalités issues de ses propres rangs. Elle aurait au contraire cherché à répartir les postes ministériels en fonction des équilibres de la coalition recherchée avec ses partenaires.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, la force politique arrivée en tête n’aurait sans doute pas assumé vouloir abroger une réforme par voie réglementaire afin de court-circuiter les divisions du Parlement, c’est-à-dire le Parlement lui-même, siège de sa légitimité.
Dans une démocratie parlementaire, disons, normale, la force politique arrivée en tête n’aurait sans doute pas consacré toute son énergie, pendant plus de trois semaines, à chercher le nom de sa candidate au poste de Première ministre. Elle aurait au contraire consacré cette énergie à identifier les voies et moyens d’un accord majoritaire avec d’autres forces.
Enfin, dans une démocratie parlementaire, disons, normale, l’une des composantes de l’alliance arrivée en tête n’aurait sans doute pas menacé d’engager une procédure en destitution contre l’arbitre de la partie, c’est-à-dire le Président de la République.
Chacun l’aura bien compris : nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire normale. Au fond, alors même que presque tous les acteurs du jeu jurent la main sur le cœur que, désormais, tout se joue au Palais Bourbon, bien peu le respectent suffisamment pour lui laisser réellement la main. Le Président de la République préempte les solutions qu’il juge préférables, les appareils partisans se grisent de récits alternatifs dans lesquels un gouvernement ultra-minoritaire pourrait ne pas encourir une censure rapide en appliquant purement et simplement leur programme, voire en gouvernant par voie réglementaire.
Pour sortir du blocage politique, les uns et les autres vont devoir apprendre un nouvel exercice : la construction d’une coalition parlementaire. Au vu des semaines que nous venons de passer, cet apprentissage risque de prendre du temps… s’il est même possible. Il reste 306 jours avant la possibilité d’une nouvelle dissolution…