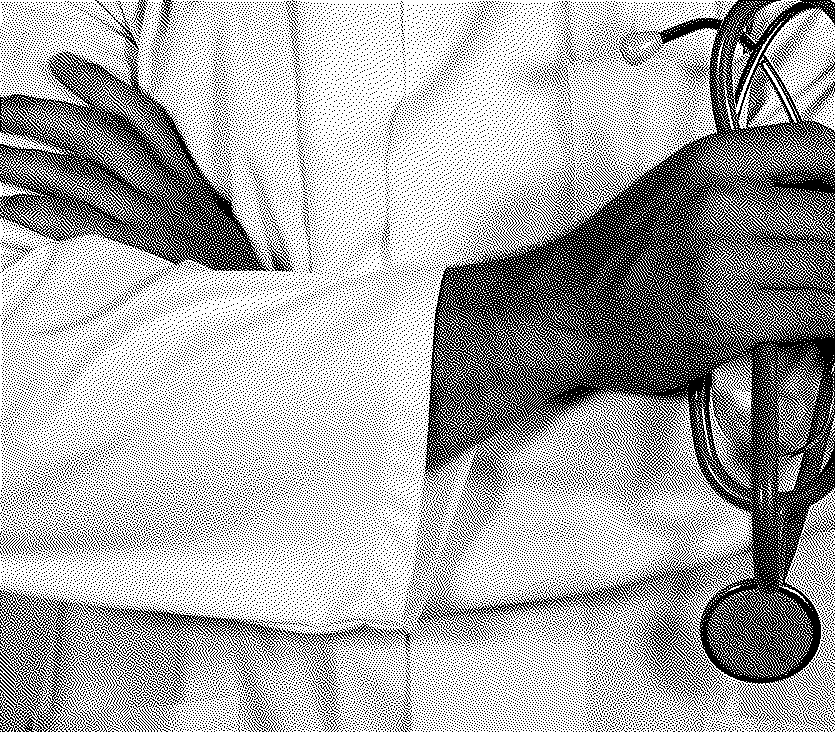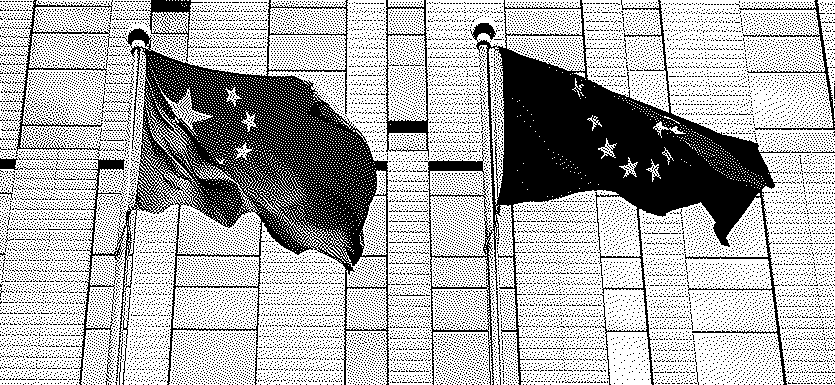Aux Etats-Unis, l’histoire de la santé mentale est liée au nom des Kennedy. Car c’est JFK qui a tourné la page de Vol au-dessus d’un nid de coucou et rompu avec l’enfermement asilaire. « Je propose un programme national de santé mentale pour aider à l’inauguration d’une approche et d’une ambition entièrement nouvelles en matière de soins pour les troubles mentaux. Cette approche repose principalement sur les nouvelles connaissances et les nouveaux médicaments acquis et développés ces dernières années, qui permettent à la plupart des patients souffrant de maladies mentales d’être traités rapidement et avec succès dans leur propre communauté et de retrouver une place utile dans la société ». Ces mots sont ceux de John F. Kennedy lors de l’une de ses dernières adresses au Congrès en février 1963, quelques mois avant sa mort. Son Community Mental Health Act, partie intégrante de la politique de la Nouvelle frontière, a porté le mouvement de désinstitutionalisation de la psychiatrie aux Etats-Unis, avec la construction de centaines de centres communautaires de santé mentale en alternative à une relégation asilaire contre laquelle JFK s’était personnellement engagé.
Cet héritage progressiste et solidaire, le président Trump et son secrétaire d’Etat à la santé Robert F. Kennedy, neveu du précédent, entendent bien le discréditer et le mettre à bas. Non pas certes en revenant à l’enfermement asilaire. Mais en faisant de la santé mentale l’un des nouveaux fronts de la guerre populiste contre la science. Les camps sont clairement identifiés : d’un côté, la médecine, les sciences et les progrès thérapeutiques, qui spéculeraient sur les maux des gens vulnérables ; de l’autre, le bon sens et l’expérience ancestrale, les psychédéliques naturels, la discipline et les valeurs simples, qui guérissent en mode basiquement transitif.
C’est que le champ de la santé mentale offre à l’arrogance du « bon sens » un confortable boulevard de préjugés stigmatisants fort bien partagés : quel enfant hyperactif n’a jamais lu dans les yeux de son entourage qu’une bonne dose de discipline vaudrait mieux que les gélules qu’on lui prescrit ? Qui s’offusquera autour de lui, si ses parents se voient conseiller de lui proposer, à la place d’un traitement médicamenteux, un peu d’homéopathie, des séances de sophrologie ou bien un diffuseur d’huiles essentielles ? En France comme aux Etats-Unis, il est facile de susciter l’adhésion du public en professant qu’un lifestyle ‘« sain »’ suffit à repousser la frontière des souffrances mentales des enfants : celles-ci seraient des déviances simples et sociales, et la frontière que la psychiatrie propose entre normal et pathologique serait construite, artificielle, voire surtout destinée à vendre des médicaments.
Et c’est ainsi que l’optimisme progressiste, que motiveraient plus encore aujourd’hui qu’hier les « nouvelles connaissances » et les « nouveaux médicaments » vantés il y a soixante ans par JFK, est désormais au cœur de la mise en cause méthodique et agressive de la psychiatrie à laquelle s’emploie le président Trump avec son acolyte Robert F. Kennedy, en s’attaquant en premier lieu à la santé mentale des enfants, au nom du simple bon sens.
Make America Healthy Again
Le président Donald Trump a créé en février 2025 une commission intitulée Make America Healthy Again (MAHA). Dédiée à la lutte contre les maladies chroniques, elle est présidée par le secrétaire d’Etat à la santé Robert F. Kennedy (RFK). Dans l’executive order qui la met en place, la santé mentale est clairement désignée comme cible de premier rang.
Améliorer la santé mentale, pour l’administration Trump, ce n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, promouvoir la prévention, le diagnostic, la déstigmatisation et l’accès aux soins des personnes qui souffrent de troubles du comportement et de maladies mentales, ou bien favoriser le progrès des connaissances et des traitements dans le champ de la psychiatrie.
L’objectif affiché est même plutôt inverse : stigmatiser la psychiatrie et combattre sa pharmacopée. La principale mission confiée à la commission « MAHA » est en effet d’évaluer « la menace » que représenteraient les médicaments psychiatriques sur ordonnance, en particulier les anti-dépresseurs et les antipsychotiques.
L’idée générale explicite est que les médicaments prescrits en psychiatrie, et notamment en psychiatrie de l’enfant, sont non seulement trop souvent prescrits, mais même intrinsèquement dangereux, addictifs et contre-productifs pour la santé mentale. Aux Etats-Unis, selon les Center for disease control, un adulte sur cinq a bénéficié d’une prise en charge pour sa santé mentale dans l’année, et 16,5% des patients adultes reçoivent un traitement médicamenteux ; chez les enfants âgés de 5 à 17 ans, ces proportions sont respectivement de 15% et 8%. Au moment où RFK est installé par Trump pour présider cette commission MAHA, chacun a en tête aux Etats-Unis les positions anti-science qu’il a prises sur la pharmacopée en psychiatrie jusque devant le Sénat lors de son audition fin janvier 2025 : d’une part, la prise d’antidépresseurs pourrait bien être, selon lui, la vraie responsable du passage à l’acte des assassins lors des school shootings (une idée démentie dès 2019 par les données analysées par le FBI, qui montrent que les assassins ne prenaient pas de médicaments) ; d’autre part, il dit avoir constaté jusque dans sa famille que le sevrage en anti-dépresseurs1 serait encore plus dur que celui à l’héroïne.
Adossée à pareilles déclarations, la création de la commission MAHA sous la présidence de RFK, et son ciblage explicite contre la prescription en psychiatrie, ont immédiatement suscité la plus vive inquiétude chez les professionnels de la santé mentale. L’American Psychiatric Association a riposté en affirmant son attachement à la science et aux traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité, rappelant : « La recherche montre que pour certains diagnostics, le traitement le plus efficace pour les enfants souffrant d’un trouble mental est une combinaison d’intervention psychothérapeutique et de médicaments. Les médicaments psychiatriques, lorsqu’ils sont prescrits et utilisés conformément aux instructions de médecins hautement qualifiés, comme les psychiatres, sont sûrs, efficaces et, dans de nombreux cas, peuvent sauver des vies ». Les auteurs ont en ligne de mire que le suicide est la deuxième cause de mortalité des jeunes américains de 10 à 24 ans.
Au Congrès également, le programme de la commission MAHA a rapidement suscité la mobilisation. Dans une lettre commune adressée fin mars aux deux chambres, une vingtaine de membres du Congrès ont vivement critiqué les positions de RFK, au motif qu’elles « promeuvent des théories non démontrées et carrément fausses ». Pour les élus signataires, l’une des plus fortes inquiétudes est que ces positions accroissent la stigmatisation en santé mentale et dissuadent les patients de rechercher des soins appropriés. Leur interpellation au ministre est claire : « Il est impératif que vous vous fondiez sur le consensus médico-scientifique largement établi au sujet des causes et du traitement des troubles du comportement et des troubles mentaux. (…) En énonçant un lien erroné entre médicaments psychotropes et school shootings, et en faisant une comparaison fausse entre anti-dépresseurs et héroïne, vous renforcez des stéréotypes dangereux et vous perpétuez une stigmatisation négative à l’encontre de ceux qui souffrent d’un trouble ou d’une maladie mentale, alors même que vos mots ont un impact particulier dans votre position de secrétaire d’Etat ».
En écho à ces positions publiques, l’inquiétude s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, de nombreux acteurs jugeant que l’objectif à moyen terme de l’administration Trump au travers de la commission MAHA est tout bonnement de restreindre tout accès aux médicaments psychiatriques, pour les enfants, voire pour l’ensemble des patients. L’inquiétude est à vif chez les professionnels et dans les associations de patients.
La latitude dont disposerait Kennedy pour passer ainsi aux actes à moyen terme n’est pas tout à fait claire ; on peut en tous cas s’inquiéter du pouvoir que lui confère l’autorité qu’il a de fait à la fois sur (entre autres) le National Institute of Mental Health au sein des NIH, et sur la Food and Drug Administration qui réglemente les médicaments. Rappelons ici que RFK, en accord avec la ligne DOGE, a l’ambition de réduire drastiquement les effectifs de ces agences ; le New York Times, qui recense déjà 20.000 licenciements sur l’ensemble du secteur de la santé, en dénombre 3.500 pour la FDA au 15 avril, dont l’essentiel de sa direction et le directeur lui-même. « La FDA telle que nous l’avons connue est terminée, la plupart des dirigeants ayant des connaissances institutionnelles et une compréhension approfondie du développement et de la sécurité des produits n’étant plus salariés » a commenté récemment Robert Califf, ancien directeur sous l’administration Biden. Quant à la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, elle connaît actuellement des coupes à l’échelle de bureaux entiers, ses dispositifs de surveillance sont menacés et son site Internet est à ce jour «403 forbidden ».
Pour l’heure, l’executive order qui a créé la commission MAHA se concentre spécifiquement sur les prescriptions en pédopsychiatrie, et non chez les adultes. Aucune action précise n’est dessinée : l’objectif de la commission est de proposer dans les 100 jours une évaluation de « la menace posée par la prescription d’antidépresseurs, d’antipsychotiques, de stabilisants de l’humeur, de stimulants et de médicaments anti-perte de poids », puis de produire une stratégie adaptée pour 2026.
Anti-psychiatrie et populisme
Reste que la menace est palpable. Les déclarations antérieures de RFK comme de Donald Trump ne laissent guère de doutes quant à leur volonté de discréditer brutalement la psychiatrie et ses traitements.
Si certains élus démocrates et citoyens réunis sous le hashtag #DiagnoseTrump interrogent volontiers la santé mentale du président Trump, à quoi il répond en affirmant qu’il est un « génie très équilibré »2, lui n’hésite pas à attaquer ses adversaires en utilisant des termes psychiatriques : Hillary Clinton serait « instable mentalement et inapte »3 et Joe Biden serait « mentalement déficient, tout le monde le sait […] Je ne pense pas qu’il puisse même passer un test cognitif »4. Mais en dépit de cette appétence pour la nosographie, Trump et RFK sont de farouches opposants à la psychiatrie et à sa pharmacopée.
Pour critiquer la psychiatrie, leur argumentaire utilise plusieurs registres classiques du populisme. Le premier est naturellement l’accusation portée contre une élite attachée à sa rente : par exemple, lors d’une interview avec Joe Rogan en 2023, RFK a déclaré : « Il y a un million d’enfants de moins de cinq ans qui prennent des antipsychotiques aux États-Unis. L’utilisation de ces médicaments a augmenté de 300% depuis 2000, non pas parce que nous avons plus d’enfants psychotiques, mais parce que nous avons plus de psychiatres »5. Le registre critique est ici classique, au moins depuis Molière : s’il y a des malades, c’est surtout parce que les médecins y ont intérêt.
Le deuxième registre critique, naturellement, est de dénoncer la collusion des élites et le poids des lobbys pharmaceutiques : « La psychiatrie, déclarait RFK en 2019, est devenue incroyablement lucrative pour les compagnies pharmaceutiques. Le DSM [Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux] est constamment élargi pour inclure de nouveaux troubles, créant ainsi de nouveaux marchés pour les médicaments »6. De même, dans son livre The Real Anthony Fauci paru en 2021, il écrit : « Les compagnies pharmaceutiques ont financé la recherche psychiatrique, ont financé les départements de psychiatrie des universités, ont financé les revues psychiatriques et ont créé le DSM, transformant ce qui était autrefois un domaine axé sur la psychothérapie en un domaine dominé par la pharmacothérapie »7.
Intérêt d’une élite intellectuelle combiné avec la perspective de profits industriels : la critique de la pharmacopée psychiatrique coche les cases du cocktail des arguments classiques du populisme. Avant d’examiner la séduction qu’exerce sur l’opinion pareil argumentaire, il faut préciser les alternatives que promeuvent RFK et Trump.
Place à la Nature
En janvier, le New York Times a publié un long papier sur l’histoire personnelle de RFK, arguant qu’on ne pouvait comprendre ses combats politiques qu’à la lumière du récit de rédemption qu’il a forgé lui-même pour magnifier son propre parcours de vie. « J’ai tellement de squelettes dans mon placard », a-t-il déclaré pendant la campagne pour la présidence en 2023, « que s’ils pouvaient voter, je pourrais être le roi du monde. »
Sa toxicomanie précoce à l’héroïne, son comportement sexuel compulsif et ses plongées profondes dans les théories du complot ont de longue date été scrutés au microscope du prestige de son nom. Il a fait de son propre rétablissement post-addiction une légende au service de ce qu’il défend de longue date : la (re)connexion avec la nature. Ce plaidoyer a nourri son combat d’avocat écologiste contre les lobbys, et a fait de lui ces dernières décennies, aux yeux de nombreux Américains, un véritable « croisé qui a poursuivi les pollueurs d’entreprises, nettoyé les rivières et fait pression pour protéger l’eau potable de New York », selon les mots du New York Times.
Mais, soulignent les observateurs, c’est avec la pandémie de Covid-19 qu’il a enfin trouvé sa véritable mesure, en s’affichant comme grand défenseur de la santé des enfants grâce à son site antivax appelé Children’s Health Defense, et en poursuivant sans relâche la FDA devant les tribunaux au sujet des vaccins pédiatriques en général et de la vaccination Covid des enfants et adolescents en particulier – sans parler des effets du vaccin contre la rougeole, marqueurs du complotisme et de sa notoriété.
Le combat de RFK contre la vaccination des enfants est bien connu, ne serait-ce qu’avec l’actualité de l’épidémie de rougeole outre-Atlantique. Mais il faut bien avoir en tête que ce qui nourrit le combat antivax de RFK nourrit tout aussi bien sa volonté d’ouvrir aussi d’autres fronts de lutte anti-science au sein des politiques de santé. Au premier rang desquels : la critique de la psychiatrie, et notamment de la pédopsychiatrie.
Le principe est le même : en appeler à un retour vers la nature, vanter les vertus de la discipline de bon sens et des régimes sains, dénoncer la collusion des élites médicales avec « big pharma », prêcher l’accès de chacun, par lui-même, au meilleur de soi-même – que ce soit en matière d’immunité ou en matière de santé mentale.
RFK est attaché à des remèdes naturels : la santé s’indexe d’abord au lifestyle de bon sens. Air frais, alimentation bio, sommeil réglé sur une saine fatigue musculaire… ces composantes évidentes d’une bonne hygiène de vie ne sauraient nuire, et le simple bon sens, même dénué de tout penchant ésotérique, valide sans la moindre restriction leur bénéfice ! Mais RFK dénonce explicitement combien les spéculations des médecins, scientifiques et intellectuels s’y opposent, eux qui sont selon lui portés à vainement intellectualiser et médicaliser les dérives d’une modernité dont le bon sens le plus élémentaire sait très bien quoi penser : « Nous vivons dans une société qui préfère donner un diagnostic psychiatrique et un médicament à un enfant plutôt que de remettre en question nos systèmes éducatifs défaillants, notre alimentation industrielle, et nos expositions environnementales toxiques »8.
Cette appétence pour la reconnexion aux vraies valeurs naturelles flirte bien sûr assez vite avec une spiritualité ésotérique qui vienne corroborer la haine de la modernité. RFK a déclaré à un animateur de radio chrétien conservateur qu’en tant que jeune homme accro et troublé, il avait subi un « éveil spirituel » lui révélant « qu’il devait changer d’une manière profonde et fondamentale ».
« Vivre dans un monde nouveau avec l’esprit des anciens »
Il faut relever ici le vocabulaire de l’éveil (awakening) qui fait signe vers ce que l’on nomme désormais le « wokisme de droite ». Comme l’a souligné récemment Guillaume Lancereau dans une enquête sur ce sujet pour Le Grand Continent, les thuriféraires des « valeurs traditionnelles » occupent une position spécifique dans la galaxie Trump. Quelles que soient les allégeances religieuses qu’ils revendiquent9, ces tenants d’un « wokisme de droite » souhaitent « enchaîner l’humanité présente et celle à venir aux devoirs que leur assigneraient certains héritages historiques arbitrairement sélectionnés ».
Parmi ces héritages, la sagesse des communautés rurales et la proximité avec la nature viennent appuyer l’invocation des valeurs supposées que seraient la « famille », le « travail » et la terre, pour mieux critiquer l’indigence qu’engendre la grande ville démoralisante… On trouvera ainsi dans le récit intitulé « Comment j’ai rejoint la Résistance » que J.D.Vance a fait de sa propre conversion au catholicisme en 2020 les traits caractéristiques de cette haine de la modernité : « Qui, se demande-t-il, pourrait regarder les statistiques sur ce que notre culture et la politique menée au début du XXIe siècle ont engendré — la misère, l’augmentation des taux de suicide, les « morts de désespoir » dans le pays le plus riche du monde — et douter que les péchés des parents aient un quelconque effet sur leurs enfants ? ». Sa critique de l’hédonisme et du consumérisme, qu’il aime bien adosser à sa lecture d’Augustin, est à la fois morale et sociale : comme le souligne Le Grand Continent, « les comportements hédonistes qu’il flétrit sont avant tout ceux de l’élite romaine/washingtonienne, par opposition à la masse des gens ordinaires qui aurait su garder le sens des valeurs morales ».
Le Grand Continent a de fait souligné combien les valeurs de la ruralité comptent pour l’électorat de Trump : « En majorité blanc — bien que Trump ait significativement amélioré son score parmi les électorats hispaniques et afro-américains —, vivant dans des zones rurales, désindustrialisées et loin des centres économiques qui sont les véritables poumons de l’Amérique, les électeurs de Trump ont voté pour le candidat républicain non pas car celui-ci peut se targuer d’être « l’un des leurs », mais parce qu’ils ont été séduits par son discours de rupture ». L’un des marqueurs de ce discours est, comme l’analyse encore Le Grand Continent, la chanson « Rich Men North of Richmond », devenue hymne républicain qui parle à tous ceux qui se sentent contraints par la modernité à « vivre dans un monde nouveau avec l’esprit des anciens » (c’est le refrain). A ceux-là, Trump promet un retour à des valeurs traditionalistes. Mais, comme l’écrit Guillaume Lancereau, « à tout prendre, ces exhortations seraient peut-être plutôt à rapprocher des lamentations moralisantes qui se faisaient entendre aux heures de l’hellénisme décadent ou de la romanité piteuse » : c’est ce que pourrait confirmer en effet l’appétence de cette galaxie pour les substances psychédéliques.
Vive la « technologie psychédélique »
L’un des fondamentaux du plan que poursuit RFK, allié en cela à une partie des membres de l’entourage de Trump comme Elon Musk et Peter Thiel, c’est le plaidoyer prosélyte en faveur de l’usage de substances psychédéliques. (Re)trouver en profondeur la vertu des énergie naturelles se passera dans des « fermes de bien-être » où les médicaments seront proscrits mais les champignons hallucinogènes et l’Ayahuasca bienvenus, en complément d’un régime sain, de la pharmacopée Ayurveda et des remèdes naturels de la naturopathie.
C’est que les breuvages psychédéliques retrouvent aujourd’hui aux Etats-Unis une visibilité troublante – au premier rang desquels l’Ayahuasca, une drogue hallucinogène maniée par les guérisseurs d’Amazonie, désormais fort prisée des yogis new-age, et dont RFK fait à répétition un éloge prononcé : il a annoncé en 2024 qu’il veut en légaliser l’usage depuis qu’elle a, dit-il, aidé son propre fils à « cicatriser » le décès de sa mère. Pareille légalisation serait une prise majeure.
Ses usagers racontent de l’Ayahuasca qu’elle « peut aider à faire tomber les barrières émotionnelles souvent créées par des traumatismes ou des malentendus passés, faisant ainsi obstacle à des relations profondes et significatives ». Bien qu’illégal à ce jour aux Etats-Unis, l’usage de l’Ayahuasca peut bénéficier d’un statut protégé si la consommation est organisée sous forme de cérémonie dans le cadre d’une « église » depuis un arrêt de la Cour suprême datant de 200610. Alors qu’une étude publique récente rapporte que la consommation d’hallucinogènes aux Etats-Unis est la plus élevée jamais enregistrée chez les adultes, cette industrie psychédélique attire les investisseurs qui profitent de cette première ouverture. Les start-ups se bousculent pour essayer de breveter les ingrédients clés que l’on trouve dans les champignons magiques (psylocybine), l’Ayahuasca et d’autres substances psychédéliques, ancestrales ou non. C’est que les futuristes de la Silicon Valley voient dans les psychédéliques une voie potentielle vers l’illumination mondiale et financent massivement la « medecine psychédélique », notamment Kimbal Musk, frère d’Elon et grand utilisateur d’Ayahuasca, le capital-risqueur Stephen Juvertson, ou encore Peter Thiel : la startup « Atai Life Sciences » qu’il soutient explore l’utilisation de traitements psychédéliques pour les maladies mentales et a été évaluée à 3,19 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq en 2021.
Investis dans les années 1960-70, plutôt à gauche, comme des « agents de déconditionnement » (c’était là l’expression préférée de Timothy Leary, ce psychologue gourou du LSD licencié d’Harvard pour les expérimentations qu’il a conduites et que Nixon appelait « l’homme le plus dangereux d’Amérique »), les psychédéliques ont été explorés puis écartés en tant que piste de recherche prometteuse sous l’administration Nixon, en particulier par un rapport du NIH publié en 1970 qui concluait : « les allégations thérapeutiques pour ce médicament ont été plus de la nature de témoignages religieux ou de déclarations de conviction clinique que d’observations et d’interprétations scientifiques sérieuses ». Ce rejet est désormais mythifié comme un péché originel symbolique des méfaits du « deep state » par une floraison de start-ups qui parient sur la rentabilité de ces substances pour soigner la dépression, l’anorexie, l’hyperactivité, etc.
Il est vrai que depuis août 2024 ces perspectives d’enrichissement ont été un peu obscurcies avec le rejet par la FDA d’une demande d’approbation, fondée sur deux essais de phase 3 contre placebo, pour l’ecstasy (MDMA) en complément de la psychothérapie dans le traitement du stress post-traumatique. Le magazine Science a alors souligné que la recherche clinique en « médecine psychédélique » soulève des enjeux méthodologiques complexes : ont ainsi pu être déplorés dans le cadre de cette demande d’approbation les influences subies par les patients inclus, leur absence d’information sur les risques associés dans le bras test (risques cardio-vasculaires, addiction, pensées suicidaires), la question de l’apport propre de la psychothérapie associée (non-réglementée par la FDA) et enfin les conflits d’intérêt de cliniciens souvent militants de la légalisation sans l’avoir toujours déclaré.
S‘il est vrai que des résultats scientifiques encourageants ont été publiés sur l’usage médical encadré de certaines drogues psychédéliques dans le traitement de la dépression ou du stress post-traumatique, la littérature scientifique n’envisage aujourd’hui cette piste que dans des indications spécifiques, principalement en échec d’un traitement médicamenteux, et toujours en association avec une psychothérapie. La compréhension des mécanismes neurobiologiques suscités par ces drogues progresse, et les derniers résultats suggèrent qu’ils favoriseraient la neuroplasticité structurelle, tout comme certaines classes d’antidépresseurs. Pour autant, la communauté médico-scientifique s’inquiète d’un décalage majeur entre l’enthousiasme que de premiers résultats pourraient susciter dans l’opinion et la réalité du progrès des connaissances, alors que les connaissances manquent encore notamment sur les effets négatifs et les motifs de contre-indication. « Les scientifiques craignent que le battage médiatique du public soit en avance sur les preuves » notait ainsi l’American Psychiatric Association en juin 2024, soulignant le besoin non seulement d’études de meilleure qualité menées sur des effectifs conséquents, randomisées et multicentriques, mais aussi de données probantes sur le rôle, l’impact et la pratique de l’accompagnement nécessaire en psychothérapie pour guider le « voyage » sous substance et son « intégration » au cours des semaines qui suivent. La crainte majeure, même si ces drogues devaient un jour être classées comme médicaments, serait de voir les patients s’auto-médiquer ; la question de l’encadrement des pratiques reste un sujet ouvert à la recherche. Mais les réquisits scientifiques d’une recherche probante freineront-ils longtemps les intérêts financiers en jeu ?
Ceux-ci sont en tous cas abrités dans un discours eschatologique explicite. Ces derniers mois, plusieurs enquêtes dans les médias américains, par exemple celle du média social-démocrate Compact, ont cherché à décrire un phénomène inattendu : la « médecine psychédélique » est désormais liée à la religion car elle aurait tenu une place importante dans les origines… du christianisme. C’est la thèse de l’ouvrage The Immortality Key du jeune avocat Brian Muraresku, un familier du podcast de Joe Rogan et qui fut invité, en 2020, sur CNN pour un sujet au titre stimulant : « Did Hallucinogens Play a Role in the Origin of Religion? ». « Si l’Eucharistie originelle était psychédélique », demande le journaliste de CNN à Muraresku, « cela signifie-t-il que les catholiques reçoivent un placebo depuis des milliers d’années ? ». Reste que Jésus, selon le récit de Muraresku qui entend proposer là une refondation radicale du christianisme, était probablement une sorte de gourou-pharmacien dispensant la sagesse avec des doses de champignons magiques. Sacré parmi les best-sellers du New York Times, l’ouvrage sera proposé bientôt sous forme de série télévisée, et la réédition poche de 2023 bénéficie d’une nouvelle préface de l’un des journalistes les plus vénérés d’Amérique : Michael Pollan. On y apprend qu’avec une simple pilule, il est possible d’avoir accès à « un Dieu qui efface la dépression et l’anxiété comme un chirurgien cosmique, efface la peur de la mort et envoie une vague de choc d’amour à travers votre cœur fragile ». Alors que le Nouveau Testament est décrit dans l’introduction comme « obsolète et impénétrable », les drogues psychédéliques sont présentées comme une « technologie » sacrée, un chemin authentique et scientifiquement validé vers le salut, capable de « sauver la civilisation occidentale ». « En fin de compte », a déclaré Muraresku dans un Reddit Q&A 2020 pour promouvoir le livre, « je vois une énorme opportunité pour l’Église d’engager cette discussion. Et au moins considérer comment la technologie psychédélique pourrait être exploitée pour les fidèles de la manière la plus prudente, responsable, sûre, efficace et sacrée ».
La « technologie psychédélique » est bel et bien au cœur d’une eschatologie futuriste. On le voit par exemple chez le vendeur de substances psychédéliques le plus visible aujourd’hui, le milliardaire allemand Christian Angermayer. Interviewé en 2021, il a déclaré que l’économie mondiale perd des milliards de dollars par an à cause des « personnes déprimées », alors que moins de 10 % de tous les êtres humains sont selon lui vraiment heureux : la médecine psychédélique qu’il vend permettrait de régler ce problème. Mais Angermayer promet également de « guérir le vieillissement » et de prolonger la vie humaine d’un siècle. Couplée à l’IA, dit-il aussi, la « technologie psychédélique » pourrait éliminer le besoin de la retraite en permettant bientôt de « reformer les personnes de 60 et 70 ans à de nouvelles compétences ». Il faut dire que, d’après ceux qui en promeuvent l’usage, par exemple en France le Yogascope, l’Ayahuasca permet un nettoyage intégral des « toxines physiques et énergétiques » (c’est en tous cas un purgatif puissant) couplé avec une « reconnexion profonde à soi-même, aux autres et à la nature » qui engendrerait, sous condition d’une « alimentation consciente » et de l’accompagnement d’un « chaman expérimenté », un vrai redémarrage intégral de toutes les fonctions vitales, émotionnelles, psychiques et sensitives…
Prosélytisme mercantile
La « technologie » psychédélique est désormais promue dans un cadre new age qui commande de la coupler aux produits bien-être et à un lifestyle sain : ceci promet un marché juteux dont RFK lui-même est un acteur clé. Rappelons d’abord que les théories promues par RFK sont l’objet d’un marché lucratif dans tous les pays développés : celui du développement personnel, de l’hygiène de vie et des lifestyle coachs ou « coachs de vie ». L’accès naturel salvateur au meilleur de soi, on peut de nos jours aisément se le faciliter – moyennant finance.
Le journal The Guardian vient d’ailleurs d’enquêter en détail sur les droits de propriété de la marque « Make America Healthy Again » (inspirée, chacun l’aura compris, du sigle MAGA) : RFK vient de la déposer pour commercialiser des produits de naturopathie (compléments alimentaires, vitamines, huiles essentielles) en gestion partagée avec M. DelBigtree, un gourou fameux féru de régimes Ayurveda et de divers breuvages psychédéliques candidats à la légalisation commerciale. Si, pour l’heure, la boutique MAHA en ligne vend surtout des casquettes et des bougies, le producteur de télévision et directeur de communication de la campagne présidentielle de RFK Del Bigtree ne fait pas mystère de son prosélytisme : la lutte contre les « forces sombres de la tyrannie médicale » sera dure, mais « même face à la persécution, les arts de guérison, y compris la chiropraxie, l’homéopathie et l’ayurveda, n’ont jamais faibli ; leur esprit indépendant était un phare de lumière pour l’humanité, nous apprenant que notre corps peut souvent se guérir sans médicaments, chirurgies et interventions coûteuses ».
Wellness Farms
Mais en attendant de pouvoir remplacer complètement la pharmacopée médicale par ces élixirs « naturels », l’idée force de RFK, largement détaillée lors de sa campagne présidentielle, c’est la création de « fermes de bien-être » pour traiter les troubles de santé mentale et permettre aux gens, malades ou non, d’aller bien mieux… Avec, ou sans, des clôtures barbelées ? Manifestement sans. Et c’est là que le réel à venir déjoue le savoir.
Inspirées, comme l’a détaillé récemment The Atlantic dans une enquête très fouillée, des pratiques du XVIIIᵉ siècle, ces fermes « wellness » visent à promouvoir la guérison des maladies mentales par le travail manuel et un environnement naturel. « Ils vont cultiver leur propre nourriture, de la nourriture biologique, de la nourriture de haute qualité, parce que beaucoup de problèmes de comportement sont liés à l’alimentation », a déclaré Kennedy à propos des malades qu’il voudrait soigner dans ces fermes.
Le point crucial est que les enfants et adultes qui fréquenteraient ces fermes seraient par là-même engagés sine qua non à renoncer à tout traitement médicamenteux : la guerre contre la science n’est pas une simple hypothèse, elle est un postulat concret fondamental. L’objectif de premier rang de ces fermes, c’est d’arrêter les médicaments !
Ne nous y trompons pas : la psychiatrie cherche bien aujourd’hui à évaluer scientifiquement l’efficacité et l’efficience d’un complément « lifestyle » au traitement médicamenteux des troubles psychiques. L’interface entre la santé physique et la santé mentale est de plus en plus largement reconnue dans la littérature, et le rôle des « facteurs liés au mode de vie » (comme l’activité physique, l’alimentation et le sommeil) dans l’apparition et le traitement des troubles psychiatriques suscite un intérêt scientifique croissant11. Dans le projet porté par RFK cependant, il s’agit bien d’une alternative purement et simplement naturelle aux médicaments, le travail manuel et le régime sain tenant lieu d’unique cure. L’arrêt de la médication est l’objectif premier.
Le débat a fait rage ce dernier mois dans les médias et sur les réseaux sociaux pour savoir si RFK envisageait de rendre la fréquentation de ces fermes obligatoire pour certains patients, et notamment en guise de cures de désintoxication pour les usagers de drogues. Il n’y a cependant pas de trace fact-checked de position en ce sens. Ce que souhaite RFK à ce stade, c’est offrir la possibilité aux malades de se sevrer des médicaments pour choisir un mode de vie sain.
Selon lui, la piste est particulièrement indiquée pour les enfants, et singulièrement les enfants noirs. Dans un podcast diffusé l’année dernière, il a déclaré que des fermes de bien-être exemptes de médicaments psychiatriques seraient particulièrement utiles pour les enfants noirs : « Tous les enfants noirs sont maintenant mis sous Adderall12, sous IRSR (anti-dépresseurs), sous benzos, qui sont connus pour induire la violence. Et ces enfants vont avoir une chance d’aller quelque part et d’être re-parentés ».
Autisme : la cible clé
La référence à l’Adderall cible ici les diagnostics d’hyperactivité dits TDAH, une bête noire centrale pour RFK. Lors de son audition devant le Sénat, il a affirmé que 15% des enfants aux Etats-Unis sont traités pour hyperactivité – un chiffre faux, puisque selon les CDC la proportion est de 5%. Pour RFK, les traitements TDAH ne sont rien de moins qu’un « poison ». Mais c’est encore sur le diagnostic et le traitement des troubles du spectre de l’autisme qu’il concentre ses critiques les plus déterminées, comme lors de son audition de confirmation au Sénat en janvier : « Le taux d’autisme est passé de 1 sur 10 000 à 1 sur 34 aujourd’hui. Cela ne peut pas être expliqué simplement par une meilleure détection. Quelque chose dans notre environnement cause cette épidémie, et la psychiatrie ne fait que traiter les symptômes au lieu de chercher les causes »13. Ces données de prévalence sont toutefois mises en cause par plusieurs sociétés savantes et les CDC eux-mêmes reconnaissent les limites méthodologiques de ces estimations14.
Mais Trump et Kennedy, eux, affirment connaître la cause de cette augmentation des diagnostics : c’est la vaccination rougeole-oreillons-rubéole (ROR) qui expliquerait l’« épidémie d’autisme ». Cette thèse est aujourd’hui, depuis l’étude truquée d’A. Wakefield en 1998, le marqueur capital du complotisme. Or, en dépit des nombreuses publications qui l’ont invalidée, Trump vient de lui donner une caution officielle en annonçant le 10 avril, lors d’une réunion publique du Cabinet, le lancement d’une vaste étude des autorités sanitaires américaines pour établir, d’ici septembre, « ce qui a causé l’épidémie d’autisme » aux Etats-Unis. « Et nous serons en mesure d’éliminer ces facteurs », a-t-il assuré. De façon très explicite, Trump a affirmé que les vaccins pourraient être les responsables de l’autisme : « C’est possible qu’il faille qu’on arrête de prendre quelque chose, ou de manger quelque chose, ou peut-être que c’est un vaccin », a dit le Président. Marqueur du complotisme antivax, ce discours sur le vaccin antiROR ne vise cependant pas « seulement » à discréditer la vaccination : il porte aussi l’attaque contre la recherche sur l’autisme, ses causes et ses traitements, et à travers elle, plus généralement, contre la psychiatrie et la santé mentale.
Il traduit en fait une attaque véritablement frénétique tout bonnement contre la science : cinq jours plus tard, le 15 avril, lors d’une conférence de presse pour la parution des derniers chiffres du CDC concernant les troubles du spectre de l’autisme (TSA), RFK a affirmé que la recherche sur les facteurs génétiques de l’autisme avait été investie à tort et devait être stoppée, au profit de recherches sur ses facteurs environnementaux. Affirmant, à rebours de toutes les évidences, que « l’autisme est une maladie évitable » puisque, croit-il savoir, « beaucoup d’enfants autistes étaient pleinement fonctionnels et ont régressé à cause d’une exposition environnementale à l’autisme à l’âge de deux ans », il décide que le paradigme scientifique dans lequel il faut désormais conduire la recherche sur les TSA, est celui d’une épidémie évitable liée à une « toxine environnementale » qui seule peut expliquer les chiffres actuels. Son raisonnement relève de la parodie : nous savons, note-t-il que « les gênes ne causent pas d’épidémies » ni de maladie évitable ; or « l’épidémie d’autisme est réelle » et c’est « une maladie évitable » ; donc, cqfd, « la quantité d’argent et de ressources investies dans l’étude des causes génétiques est une impasse ». Et à ceux qui doutent de son syllogisme, RFK répond sans hésiter en invoquant sa recette : un peu de science mais surtout beaucoup de bon sens : « J’ai fait référence à un certain nombre d’études. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres dans la littérature scientifique qui font voler en éclats cette mythologie selon laquelle l’épidémie d’autisme n’est pas réelle. Si vous lisez la littérature, il est absolument indéfendable de continuer à promouvoir cela, mais il n’est pas nécessaire de lire la littérature. Il suffit d’un peu de bon sens ».
Quelle séduction sur l’opinion ?
Ces discours dits « de bon sens » hostiles à la médicalisation des troubles du comportement et des troubles mentaux, chez les adultes ou les enfants, trouvent un écho puissant dans l’opinion.
Mettre en doute la frontière entre normal et pathologique que la psychiatrie propose, interroger sa posture de neutralité scientifique au regard des fonctions sociales et politiques qu’elle assume à l’égard de la marginalité ou de la déviance, déplorer le recours aux médicaments autant qu’on déplorait hier l’enfermement asilaire, et en appeler finalement au bon sens naturel populaire pour « gérer » les comportements déviants : ces postures critiques ont toujours accompagné l’histoire de la psychiatrie. On peut bien s’horrifier de ce qu’en disent Trump et ses associés, mais il importe d’en mesurer l’impact potentiel en France aussi.
Tout d’abord, et comme l’a signalé la Miviludes dans son rapport 2024, le public des coachings bien-être et nature connaît en France un essor majeur, très inquiétant dans la mesure où la critique de la médecine n’y est jamais bien loin, et où la proposition fondamentale de ces discours est toujours que chacun peut accéder au meilleur de soi par lui-même, en renouant avec sa nature. La mission souligne ainsi que « les dérives sectaires ne se limitent pas aux croyances ésotériques et investissent également les domaines de l’alimentation, de la santé ou du bien-être » : l’ésotérisme rencontre ici le goût pour les remèdes naturels et une certaine méfiance pour la chimie. Si la Miviludes met surtout en avant cette année l’impact mortifère des dérives sectaires sur les patients atteints de cancer, elle souligne aussi les risques qu’encourent les patients en psychiatrie. Le rapport insiste, dans son analyse de l’activité 2024, sur le fait que des pratiques psychédéliques sont de plus en plus accessibles auprès des dits « praticiens non-conventionnels de santé à visée thérapeutique » comme les naturopathes, chiropracteurs, acupuncteurs, etc. : chez eux, « un public sensible aux questions écologiques, et à la puissance de la nature recourt aux pratiques inspirées du chamanisme ».
L’inspiration générique de ce courant alternatif porté sur les psychédéliques, note la mission, « s’inspire des pratiques sud-américaines, avec l’usage de huttes de sudation ou l’usage de produits stupéfiants. Dans un cadre rituel, les stagiaires peuvent ingérer, à jeun, de l’Ayahuasca, une préparation hallucinogène originaire d’Amérique du sud marquée par la présence d’un puissant psychotrope naturel qui plonge ses utilisateurs dans un état de conscience et de perception modifié. Le néo-chamanisme peut impliquer aussi la purge au Kambo où les participants s’infligent sur des brûlures cutanées du poison tiré d’une grenouille amazonienne entaillée. Ces substances donnent lieu à bon nombre d’effets physiologiques secondaires et des désordres psychologiques profonds plus ou moins durables ». De nombreux signalements de ce type traités par la Miviludes dans son rapport d’activité 2024 rapportent des interruptions de traitements (neuroleptiques) et se concluent par une hospitalisation… en psychiatrie.
Il faut bien reconnaître que, indépendamment de ces dérives new age de tous bords qui offrent un terrain propice aux préférences exprimées par RFK, la posture critique à l’encontre de la psychiatrie reçoit de longue date un certain écho dans notre pays. Les critiques que diffusent RFK et Trump rejoignent en de nombreux points le discours qu’il est désormais convenu d’appeler de l’« antipsychiatrie ». A l’origine, ce que le courant critique de l’antipsychiatrie a dénoncé dans les dernières décennies du XXe siècle, sous la plume de Robert Castel ou de Michel Foucault par exemple, c’est l’enfermement asilaire, analysé comme une entreprise (bio)politique qui vise de façon larvée le contrôle social des populations en s’abritant sous l’autorité d’une science ou technique supposée neutre mais dont l’objet réel est le contrôle politique de la déviance. Parler de « médicalisation de la folie » a toutefois conduit certains à étendre plus loin la critique, au-delà de l’enfermement asilaire, jusqu’à la psychiatrie post-désinstitutionalisation : ce serait alors la possibilité même d’une posture médico-scientifique neutre qui serait suspecte, dès lors qu’elle traite d’objets sociaux aussi signifiants que la déviance, la marginalité, les troubles du comportement. Le discours critique contre la médicalisation de la folie ne doit pas nous paraître exotique au motif qu’il guide la croisade d’un Kennedy Jr obsédé par l’autisme : il est présent dans l’imaginaire collectif et il est déjà, depuis des décennies, l’objet d’une guerre culturelle.
D’une critique initiale, sous la plume par exemple de R. Castel, de l’aliénisme répressif du XIXe siècle en tant qu’entreprise sociopolitique, le mouvement de l’antipsychiatrie a désormais étendu sa dénonciation jusqu’à contester la validité même de la catégorie de maladie mentale. On pensera notamment aux positions libertariennes du psychiatre hongrois Thomas Szasz (The Myth of Mental Illness, 1961 et ou The Manufacture of Madness, 1970) qui professe que les pathologies mentales sont des constructions sociales et politiques. On pensera, plus récemment, à l’influence mondiale de Robert Whitaker, éditeur du webzine à succès Mad in America dont le sous-titre est « Science, Psychiatry and Social Justice » et qui critique la pharmacopée psychiatrique, journaliste du Boston Globe présélectionné pour le prix Pulitzer 1999 du service public avec une série d’articles « remettant en question l’éthique de la recherche psychiatrique dans laquelle des patients sans méfiance recevaient des médicaments censés aggraver leur psychose », selon le verbatim Wikipedia.
De là, la critique de la pharmacopée psychiatrique a pris son essor depuis la découverte des premiers neuroleptiques et anti-dépresseurs dans les années 1950 qui permirent le progrès des connaissances sur les causes neurochimiques des maladies mentales. C’est ce qu’illustrent à plein de nombreux débats ces dernières années, y compris en France, autour de l’idée que la psychiatrie construit toujours le caractère déviant des comportements qu’elle traite : la « camisole chimique » qu’elle promeut aujourd‘hui remplacerait l’asile qu’elle professait hier, là où la souffrance des patients importerait bien moins aux pouvoirs en place que le contrôle social des marges.
Il faut se souvenir qu’il y a seulement dix ans, la publication de la nouvelle édition internationale du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) a suscité en France comme aux Etats-Unis d’innombrables pétitions, appels au boycott, et déclarations expertes dénonçant une ambition néfaste destinée, sous couvert de science, à fabriquer des maladies mentales sans fondement pour pousser le monde entier à la consommation de psychotropes. Outre le constat qu’entre la première édition du DSM en 1952 et les années 2000, le nombre de pathologies classées a triplé ; outre aussi la crainte, chez certains, de constater la volonté des éditeurs d’intégrer les données des neurosciences et les progrès de l’imagerie ; l’angle majeur de la critique était bien, comme aujourd’hui dans la bouche de RFK, que les psychiatres « « pathologisent » de simples anomalies de comportement ». Pourquoi ? La réponse du psychanalyste Richard Gori était la suivante dans Le Monde en 2013 : « Parce que nous sommes, de plus en plus, dans une société de contrôle. On assiste à une médicalisation de l’existence. Le DSM est le symptôme d’une maladie de société, d’une manière de gouverner qui ne repose plus sur l’autorité des grands récits religieux ou idéologiques mais sur la pression normative. Il s’agit de fabriquer les discours de légitimation d’un contrôle social, au nom de la raison technique et de l’objectivité scientifique ».
La neutralité scientifique attribuée à la psychiatrie n’est-elle qu’un construit socio-politique, le maquillage, aux couleurs de la science, d’un bio-pouvoir cynique au service du contrôle des marges ? La dénonciation d’une instrumentalisation de la science à des fins de domination sociale, politique et économique a historiquement nourri la culture médicale de la gauche, lectrice par exemple du Nemesis médicale d’Ivan Illich en 1975, qui veut « penser l’institution industrielle à partir du paradigme de l’entreprise médicale » et dont les premiers mots sont : « L’entreprise médicale menace la santé. La colonisation médicale de la vie quotidienne aliène les moyens de soins. Le monopole professionnel sur le savoir scientifique empêche son partage. Une structure sociale et politique destructrice trouve son alibi dans le pouvoir de combler ses victimes par des thérapies qu’elles ont appris à désirer. Le consommateur de soins devient impuissant à se guérir ou à guérir ses proches ». Les mots de ce penseur décroissant qui revient aujourd’hui en vogue laissent entrevoir comment peut se dessiner un pont entre retour à la nature, éloge de la convivialité dans la communauté15, défiance à l’égard de la pharmacopée médicale et préférence pour les remèdes naturels.
Plus près de nous, en 2023, ce sont les chiffres de la prescription de médicaments en pédopsychiatrie qui ont fait l’objet de nombreuses critiques.
A ce titre il faut avoir en tête l’importante visibilité médiatique de la psychologue Caroline Goldman, pourfendeuse de l’éducation positive mais aussi des diagnostics de troubles du neuro-développement, qui a notamment assuré 40 chroniques sur France Inter à l’été 2023. Pour elle, c’est la solution pharmacologique qui crée bien souvent l’occasion du diagnostic, et non l’inverse : les diagnostics de troubles du spectre de l’autisme et de troubles de l’attention seraient dans l’immense majorité des cas de purs construits qu’on soigne avec des médicaments au lieu de travailler sur le « savoir-être » des enfants. Sur instagram, elle note que « la psychanalyse (dont elle se revendique) admet parfaitement l’existence de troubles attentionnels et d’agitation (elle les traite depuis toujours) mais elle réfute l’existence du trouble TDAH, qui a été inventé à partir d’une molécule dans un labo pharmaceutique américain ». Dans son podcast Carnet psy, elle juge donc que les médicaments du TDAH ne sont rien d’autre qu’un « opium de la population scolaire ». A l’inverse, dit-elle dans l’une de ses chroniques, il serait temps de s’atteler à la tâche éducative d’offrir à l’enfant, en prévention de ces troubles, un environnement capable « d’encourager sa gentillesse et de le sensibiliser au bonheur de rendre heureux » : c’est à nous, parents et éducateurs, qu’il appartient, dit-elle, d’apprendre aux enfants à « être sympas ».
En 2023, dans un rapport intitulé « Quand les enfants vont mal », le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, membre du réseau France stratégie, a aussi souhaité alerter les autorités sur la montée de la consommation de médicaments psychotropes chez les enfants et adolescents. Cette consommation a effectivement augmenté de façon massive dans la dernière décennie : +62,58 % pour les antidépresseurs ; +78,07 % pour les psychostimulants ; +155,48 % pour les hypnotiques et sédatifs et +48,54 % pour les antipsychotiques entre 2014 et 2021. Quelle est la cause de cette croissance ? Le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge a sa propre réponse : c’est parce qu’un « effet ciseaux entre l’augmentation de la demande et le déficit structurel de l’offre de soin » condamnerait les enfants à être « plus exposés que les adultes à la souffrance psychique, mais aussi à la médication ». La position suggère que la médication des enfants est, d’une manière ou d’une autre, le produit d’un construit social bien davantage que le produit de leurs souffrances, qui ne sont à leur tour elles-mêmes qu’un construit trivial lié à l’offre de soins.
Pareille position a déclenché la controverse et, en réponse, plusieurs pédopsychiatres ont vertement dénoncé cet alarmisme sans fondement. Ils font valoir que si la pente de la hausse est forte, c’est surtout parce qu’on est partis de très bas ! Les prescriptions n’augmentent qu’à la juste mesure de la croissance considérable ces quinze dernières années des connaissances scientifiques sur l’efficacité des molécules et sur les pathologies elles-mêmes : « forcément, lorsque l’on part de très peu et quand on se met à en prescrire un peu plus, les chiffres explosent », expliquait ainsi au Monde le pédopsychiatre Olivier Bonnot en 2013, rappelant que ce n’est que depuis une quinzaine d’années que les psychotropes sont prescrits à des enfants qui, faut-il le rappeler, sont tout bonnement en souffrance et demandent de l’aide. Il faut aussi ajouter qu’aucun dispositif valable d’épidémiologie (cohorte) ne permet de suivre de façon méthodologiquement fiable ces évolutions en France.
Les évolutions qui sont en marche sont certainement complexes et appellent des interprétations nuancées. S’agissant des diagnostics de troubles du neurodéveloppement, de nombreuses hypothèses sont travaillées : le phénomène de densification des populations autour de zones urbaines a favorisé l’accès aux soins, une meilleure connaissance des troubles a favorisé le diagnostic également, et la permutation des diagnostics de déficit intellectuel vers l’autisme a profondément changé la représentation des troubles. L’impact des expositions environnementales, de la pollution ou de l’alimentation sont aussi au cœur des recherches en cours dans une discipline qui s’attelle à comprendre l’interaction de ces expositions avec les facteurs génétiques des troubles. Citons, en non-spécialiste, s’agissant par exemple des cheminements scientifiques en cours sur le spectre de l’autisme, ces lignes d’introduction d’un papier récent publié dans Nature : « La prévalence des troubles neurodéveloppementaux, y compris les troubles du spectre autistique (TSA), a augmenté dans le monde entier, bien qu’elle soit très variable d’une région ou d’un pays à l’autre. (…) Les troubles neurodéveloppementaux, y compris les TSA, sont supposés avoir une origine multifactorielle, avec des déclencheurs génétiques et environnementaux reconnus. (…) De plus en plus de preuves scientifiques établissent un lien entre les TSA et les expositions environnementales dans le cadre d’une interaction avec des facteurs génétiques. Plus précisément, les modifications épigénétiques de l’expression des gènes par les produits chimiques toxiques pourraient représenter le mécanisme de cette interaction gène-environnement ».
On le pressent à la lecture : chaque mot est pesé au trébuchet dans pareil exposé, et la complexité scientifique trouve, dans ce domaine comme dans d’autres, un miroir déformant dans l’opinion publique. Et ceci plus encore peut-être ici, s’agissant de la santé mentale des enfants, dont chacun est bien enclin à se juger expert par expérience ou simple bon sens, et où l’ambition de pouvoir éviter la souffrance sans passer par la chimie relève de l’instinct le plus élémentaire.
Mais le bât blesse là où les enfants souffrent et ont, de fait, besoin d’une aide. En la matière, savoir, est-ce pouvoir ? La France vient de se doter du dispositif scientifique qui permet de connaître les souffrances de ses enfants : l’enquête Enabee, dont la Grande conversation a rendu compte ici en 2024, montre qu’un enfant sur six – donc au moins deux à trois enfants par classe à l’école, sont en souffrance psychique16.
Que ferons-nous de ce savoir troublant ? Trump et RFK répondent sans hésiter par un bréviaire d’absurdités réactionnaires et cruelles, de l’arrêt de la vaccination au yoga, en commençant par (re)mettre les enfants noirs dans les champs de maïs avec, dans les cas les plus difficiles sans doute, un peu d’Ayahuasca à la ferme.
En bons cabots, experts populistes, ils disposent pas à pas leurs pierres délétères dans le jardin de ceux qui voudraient, avec plus ou moins d’intensité militante anti-système et naturophile, que la nature et le bon sens œuvrent bien mieux que ne le font la science et les psychiatres au service des enfants.
La question est de savoir ce que nous leur rétorquons.
La première étape de réponse est sans doute de constater avec la Miviludes que non, il ne nous est pas vraiment indifférent que la ménagère, déprimée ou mère d’un enfant hyperactif, dépense son salaire dans des huiles essentielles et cérémonies secrètes Ayahuasca, comme il lui chante. L’essor de ces pratiques n’est pas juste l’expression d’errances intimes sur fonds privés ; car ces errances se terminent finalement souvent en psychiatrie, à la charge de tous, et elles sont surtout un terreau savamment entretenu par certains dans une guerre culturelle contre la science dont nous ferons tous les frais. Ceci implique une première réponse publique déterminée sur le front de la régulation des « pratiques alternatives » et de la défense de l’esprit critique : la dérive ésotérique n’est pas une déclinaison de la liberté d’expression, ni même un choix pathétique faute d’accès à la science. Le droit, pour chacun, d’accéder aux évidences pour des choix de vie rationnels est au fondement de notre culture humaniste et démocratique : céder, sous couvert de tolérance à l’égard de l’errance privée, sur l’exigence impondérable de ce combat, c’est fragiliser nos valeurs. Nos opposants dans la guerre culturelle contre la science ne s’y tromperont pas.
Justifier avec bienveillance les dérives ésotériques en arguant de la difficulté d’accéder à l’excellence clinique n’est pas plus approprié que de se cacher derrière leur caractère privé. La réponse se jouera ici surtout sur le front du soin, de la prévention et de l’information : en miroir du délire ésotérique, une médecine de qualité et fondée sur des preuves doit être accessible à tous, à l’écoute de tous, sensible aux difficultés de tous. En France, en cette année 2025 où la santé mentale est proclamée grande cause nationale, un Institut du cerveau de l’enfant, centre de soins et de recherche d’une ampleur inédite, ambitionne de « révolutionner la compréhension du développement cérébral de l’enfant ». Doté de 60 millions d’euros dont deux tiers provenant de l’Etat, cet institut hospitalo-universitaire « est un modèle inédit, décloisonné qui va unir la recherche scientifique, la pratique médicale et les sciences de l’éducation pour mieux comprendre le développement du cerveau de l’enfant et donc mieux prévenir et mieux accompagner les enfants et leur famille », a expliqué lors du lancement en mars Adrien Taquet, président du Conseil de surveillance de l’Institut, rappelant qu’en France, un enfant sur six présente des troubles du neurodéveloppement.
Le mot d’ordre de cet Institut – décloisonner les approches médicales et éducatives – semble pouvoir être une réponse substantielle aux démons qu’agite outre-Atlantique la rhétorique trumpiste contre la science et la pédopsychiatrie. « Afin de fournir aux enfants les outils nécessaires à leur apprentissage, leur éducation et leur santé, nous développons une approche transversale et cohérente – en évitant l’habituelle approche compartimentée – entre santé et éducation, normal et pathologique, cerveau et esprit, émotions et cognition. Cette approche intégrée permettra de répondre aux multiples défis auxquels sont confrontés les enfants d’aujourd’hui, et en particulier les plus vulnérables d’entre eux, dans un environnement en mutation rapide ».
Des enfants qui se confrontent à de « multiples défis » difficiles dans un monde mouvant et qui ont besoin d’aide : qu’ils y arrivent ou non, et que cela soit « normal » ou bien « pathologique », la question essentielle demeure de leur offrir le soutien qu’ils attendent, en famille, à l’école, et par la mobilisation des chercheurs, des soignants et de toute la société : c’est là tout l’objet d’une cause érigée en Grande cause, en cause dont chacun cause, en conversation nationale à bon escient.
Certes, cette Grande cause ne pourra pas faire l’impasse sur des questions techniques et politiques, comme celles relatives à l’accès aux soins, autour par exemple du débat récemment (ré)ouvert par le délégué ministériel à la santé mentale dans l’Express sur l’articulation entre psychologues et psychiatres : il y aurait tout à gagner à ce que la complémentarité des compétences ne reste pas trop mystérieuse et soit plus transparente aux yeux de ses usagers. Mais au-delà cependant de ces enjeux (cruciaux) de paramétrage de l’offre, le spectre des « fermes de bien-être » et la haine du progrès thérapeutique outre-Atlantique doivent nous rappeler que la santé mentale reste, avant d’être une question d’offre de soins à parfaire, un enjeu de la guerre culturelle qui concerne la science, l’intelligence et la solidarité humaniste, la défense de la démocratie contre les démagogues, les sophistes et les populistes.