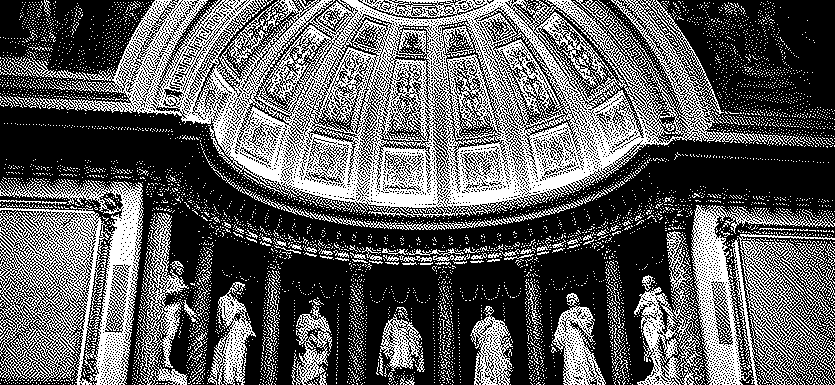Face à l’accumulation des risques — dérèglement climatique, intensification des catastrophes naturelles, vieillissement démographique, montée des vulnérabilités sociales et tension croissante sur nos systèmes de santé et d’assurance — il devient indispensable de repenser en profondeur notre approche collective de la protection. Historiquement, notre modèle social s’est construit sur une logique essentiellement réparatrice : un socle de droits universels garantis, intervenant une fois les risques survenus. Ce paradigme, hérité du XXe siècle, a permis des avancées majeures, mais il montre aujourd’hui ses limites face à des risques systémiques, cumulatifs, fréquents et de plus en plus coûteux.
Il est désormais nécessaire de faire évoluer notre modèle vers une approche plus préventive, capable d’anticiper les risques sanitaires, sociaux et environnementaux et d’éviter qu’ils ne se réalisent. Il ne s’agit pas seulement d’apporter de cette façon un surcroît de sécurité mais d’assurer la pérennité de l’ensemble de notre architecture de protection en évitant qu’elle ne croule sous la charge des réparations. De supplément d’âme assurantiel, la prévention tend ainsi à devenir un enjeu existentiel de notre système de protection.
C’est dans cette perspective que Terra Nova s’est associé à Aéma Groupe et son Observatoire de la Protection, dans le cadre d’un cycle de réflexion consacré durant l’année 2024 à la culture de la prévention. Ce travail collectif, impliquant experts, représentants des métiers de l’assurance des personnes et des biens, citoyens et acteurs institutionnels, visait à interroger nos modes actuels de gestion des risques, encore trop souvent réactifs, fragmentés et centrés sur la réparation. Nous avons voulu faire émerger des idées nouvelles, formuler des propositions concrètes, ouvrir le débat avec d’autres acteurs. Pendant près d’un an, ce cycle a été nourri par des interventions d’experts, des ateliers participatifs et des résultats d’enquêtes menées auprès des Français.
Cet article revient sur les enseignements issus de cette démarche, met en lumière les principaux enjeux, identifie les leviers à activer et présente plusieurs pistes pour faire de la prévention une dimension structurante de notre modèle social.
La prévention peut être comprise comme l’ensemble des mesures visant à empêcher la réalisation, l’aggravation ou la récurrence d’un risque. En matière sanitaire, par exemple, elle recouvre trois niveaux : primaire (éduquer aux bons comportements, se vacciner…), secondaire (procéder à des tests et examens de dépistage pour avoir une détection précoce des pathologies) et tertiaire (suivre les patients malades de manière à éviter les crises aiguës). Au-delà de la sphère sanitaire, la culture de la prévention renvoie à une dimension collective et sociétale. Elle suppose l’adoption durable de comportements, de normes sociales et de dispositifs institutionnels destinés à anticiper les risques pour empêcher leur réalisation. L’enjeu est de passer d’une logique réparatrice à une logique proactive et systémique, impliquant tous les acteurs – individus, entreprises, institutions publiques, assureurs, etc.
1. Prévenir pour préserver : sauver un système de santé à bout de souffle
Le modèle français de protection sociale, fondé en 1945, repose aujourd’hui sur un équilibre de plus en plus précaire. Au sein de ce modèle, le système de santé occupe une place majeure : la France y consacre 11,8 % de son PIB1, un niveau qui la place au troisième rang des pays de l’OCDE, derrière les États-Unis et l’Allemagne. Mais ce système, qui a longtemps été une source de fierté nationale, ne parvient plus à équilibrer ses comptes. Les dépenses de santé ne cessent de croître et le déficit de la branche maladie pourrait atteindre 15 milliards d’euros en 2025. Et les perspectives démographiques contribueront à le mettre un peu plus sous tension : la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans passera d’un Français sur dix en 2017 à un sur six en 2050. Par ailleurs, la durée de vie en incapacité progresse plus vite que l’espérance de vie. Autrement dit, l’espérance de vie sans incapacité (ou en bonne santé) stagne, tandis que la période de la vie passée avec des limitations physiques ou mentales s’allonge. Cela pose un enjeu majeur pour les politiques de santé publique, de prévention et de protection sociale. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère des Solidarités et de la Santé, le coût de la dépendance, aujourd’hui estimé à 1,4 % du PIB, pourrait doubler d’ici 2060.
Le vieillissement de la population, qui se traduit par une demande accrue de soins, n’est cependant qu’un des moteurs de cette dynamique. Comme le souligne Nicolas Revel dans une note publiée par Terra Nova2, la prévalence de nombreuses pathologies chroniques – cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, troubles psychiques – est en forte hausse, indépendamment des seuls facteurs démographiques. Ces évolutions tiennent notamment à nos modes de vie (alimentation, consommation de tabac et d’alcool, etc.), mais aussi à une exposition croissante à des risques environnementaux. Déjà, près de 25 millions de personnes en France vivent avec une maladie chronique ; ce nombre continuera d’augmenter, faisant peser une pression accrue sur notre système de soins.
Dans le même temps, les ressources du système s’amenuisent : la baisse de la natalité réduit mécaniquement le nombre de cotisants, tandis que les effets du changement climatique – évènements extrêmes tels que les canicules, nouvelles vulnérabilités sanitaires – ajoutent des risques supplémentaires à un système déjà sous tension. Au-delà des déséquilibres financiers qu’il engendre, c’est le paradigme même de notre système de santé, construit historiquement sur une logique de réparation qui montre aujourd’hui ses limites. Cette approche essentiellement curative n’est plus suffisante – ni pour maîtriser les dépenses, ni pour répondre durablement aux risques auxquels notre société est confrontée.
Or, malgré son omniprésence dans les discours politiques et institutionnels, la prévention reste le parent pauvre du système de santé français. Comme le rappelait François Bourdillon, ancien directeur général de Santé Publique France, lors d’une intervention dans le cadre du cycle, la France dispose de fortes marges de progression. Certes, l’espérance de vie à la naissance, comme à 65 ans, y est élevée et témoigne d’un bon niveau global de santé. Mais cette moyenne masque des disparités marquées entre les sexes et, surtout, un mauvais positionnement en matière de mortalité prématurée, c’est-à-dire de décès évitables survenant avant 65 ans. En 2010, le taux de décès prématurés chez les hommes était ainsi 24 % plus élevé en France qu’au Royaume-Uni, et 54 % plus élevé qu’en Suède. Ces écarts illustrent une réalité préoccupante : la France échoue à prévenir efficacement les décès évitables, faute d’investissements à la hauteur et d’une stratégie cohérente en matière de prévention.
Depuis des années, elle est célébrée comme un levier d’avenir, mais les actes n’ont jamais réellement suivi les intentions. La France souffre d’un sous-investissement structurel en matière de prévention, que révèle la comparaison avec plusieurs de ses voisins européens. Si l’on veut dire les choses simplement : la France est aujourd’hui un mauvais élève de la classe européenne en matière de prévention. Ce retard s’observe dans les trois dimensions constitutives de la prévention :
- La prévention primaire vise à agir en amont des risques et pour éviter leur réalisation (par la promotion d’une alimentation plus saine, d’une activité physique régulière, de la vaccination etc.). Mais elle reste mal financée, insuffisamment structurée et faiblement pilotée. En la matière, les signes d’alerte s’accumulent. La France se distingue par une couverture anormalement basse des vaccinations non obligatoires (grippe, papillomavirus), un retard préexistant au Covid-19 qui s’est encore aggravé depuis. Le tabac reste un fléau : malgré une baisse du nombre de fumeurs, notre pays affiche l’un des taux de tabagisme les plus élevés d’Europe. Quant aux risques liés à l’alcool, ils restent sous-estimés, voire tabous.
La prévention secondaire, centrée sur le dépistage précoce des maladies, est freinée par une faible couverture et de fortes inégalités d’accès. Le taux de dépistage du cancer du sein atteint 47 % en France, contre 54 % en moyenne européenne ; celui du cancer colorectal plafonne à 34 %, contre 36 % ailleurs. Nos performances restent également insuffisantes pour les pathologies cardio-métaboliques.
Quant au domaine de la prévention tertiaire, consistant à éviter la survenue de crises aiguës chez les patients déjà atteints par des malades chroniques, il reste à ce jour largement négligé, alors même que ces pathologies explosent : non seulement elles affectent un nombre considérable de personnes (25 millions de personnes aujourd’hui en France) mais, comme le fait observer Nicolas Revel, les dépenses de santé qu’elles occasionnent représentent les deux tiers de la dépense totale et près des trois quarts de sa progression annuelle. En réalité, c’est là que se jouent les marges d’efficience les plus décisives pour l’avenir de notre système de santé. Face à la progression des maladies chroniques, il doit urgemment se transformer pour mieux prévenir les complications, renforcer l’accompagnement et améliorer la qualité de vie des patients. Cela suppose de revoir en profondeur nos pratiques, notre organisation et nos outils. La prévention permet donc au système dans son ensemble d’être plus résilient, car elle le rend plus soutenable, mais c’est également un progrès pour l’ensemble des hommes et des femmes qui vivront en meilleure santé.
Joint au développement des outils numériques et des objets connectés pour le suivi en continu des patients, l’usage des données de santé constitue à cet égard une opportunité majeure. Comme le rappellent Mélanie Heard et David Gruson dans leur rapport « IA et santé : pourquoi l’action publique ne peut plus attendre ? », l’intelligence artificielle peut produire des bénéfices significatifs pour les patients, les professionnels de santé et l’ensemble du système. En amont du recours à l’intelligence artificielle, les données de santé représentent un levier essentiel pour renforcer l’efficience des actions de prévention. C’est d’ailleurs l’une des orientations formulées par la Caisse nationale de l’Assurance maladie dans son rapport “Propositions pour 2026. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses”, qui préconise le développement d’une prévention personnalisée à partir des données des assurés, afin d’adapter les messages et les offres de manière individualisée. Une telle démarche ne pourra toutefois pleinement aboutir qu’en s’appuyant sur une collaboration renforcée entre les différents acteurs, notamment les mutuelles. En effet, leur implication permettrait d’aller plus loin dans cette personnalisation, en complémentarité avec l’Assurance maladie
2. Un nouveau paradigme : penser la prévention comme une stratégie transversale
Longtemps cantonnée au champ de la santé, la prévention s’étend aujourd’hui à une approche beaucoup plus large et transversale. L’émergence de la notion de « culture de la prévention » traduit cette évolution : il ne s’agit plus seulement d’éviter des maladies mais de construire une réponse globale aux risques sanitaires, sociaux, économiques ou environnementaux auxquels notre société est confrontée. Si ce passage à une échelle supérieure est nécessaire, c’est parce que la coïncidence des crises dans un avenir proche risque de rendre le paradigme de la réparation insoutenable : si rien n’est fait pour contenir voire réduire la réalisation des risques, le cumul des crises écologiques, épidémiologiques et démographiques dans les trois ou quatre décennies qui viennent pourrait avoir raison de l’ensemble de notre modèle de protection, que l’on parle des grandes assurances sociales ou des assurances privées.
Cette réponse suppose une capacité collective à anticiper, à s’adapter et à agir en amont, pour éviter que les crises ne surviennent ou pour en atténuer les effets. Elle implique aussi que chacun, à son niveau, joue un rôle actif dans la gestion de sa santé, mais aussi dans la construction d’une société plus résiliente. Elle implique enfin que les conditions de notre environnement (exposition à un certain nombre de polluants et perturbateurs endocriniens par exemple) soient améliorées, ce qui ne peut pas reposer sur la seule responsabilité des individus.
Ce changement de paradigme nécessite de revoir en profondeur notre manière de concevoir l’action publique. Le système français reste largement tourné vers la réparation, car la prévention souffre d’un défaut structurel : ses effets sont différés, peu visibles (on ne peut souvent les objectiver que par des raisonnements contrefactuels peu intuitifs), et difficiles à inscrire dans des exercices budgétaires année après année. Pourtant, de nombreuses études démontrent que les politiques préventives sont parmi les plus efficaces à moyen et long terme, tant en matière d’impact social que de maîtrise des dépenses publiques.
Un domaine illustre particulièrement cette logique : celui de la petite enfance. Comme l’a montré Florent de Bodman dans ses travaux pour Terra Nova, les premières années de la vie sont décisives pour les trajectoires individuelles. Investir tôt — dans l’accueil, la santé, le développement du langage, la socialisation — permet de réduire les inégalités dès l’origine, de favoriser la réussite éducative et d’éviter des dépenses sociales futures. Ce type d’intervention améliore la santé mentale, réduit l’échec scolaire et les risques de précarité, tout en renforçant la cohésion sociale. Florent de Bodman plaide ainsi pour une stratégie d’investissement social, à l’image des pays nordiques, qui considèrent les dépenses en faveur de la petite enfance non comme un coût, mais comme un levier de transformation durable de la société.
Cette même logique devrait s’appliquer à un autre champ critique : la gestion des risques climatiques. Le dérèglement climatique met en effet sous pression croissante notre système d’indemnisation des catastrophes naturelles, le dispositif CatNat. Ce mécanisme repose sur une surprime obligatoire intégrée aux contrats d’assurance, répartie entre les assureurs (44 %), la Caisse centrale de réassurance – CCR (44 %) – et le Fonds Barnier dédié à la prévention (12 %). En retour, l’État garantit une couverture illimitée des sinistres via la CCR s’il venait à être appelé dans une situation critique.
Jusqu’à récemment, ce système semblait robuste : la garantie de l’État n’a été activée qu’une seule fois, en 2000 après les tempêtes Lothar et Martin. Mais cette sécurité appartient au passé. La fréquence et l’intensité des événements climatiques s’accroissant, les sinistres se multiplient, les années « calmes » deviennent rares et la capacité financière du régime s’érode — en témoigne la fonte de la provision d’égalisation de la CCR depuis 2017. Comme beaucoup d’autres pays, la France est entrée dans un régimed’instabilité chronique. Les épisodes extrêmes (inondations, sécheresses, canicules) se banalisent et se cumulent parfois sur une même année. Bien que la mortalité causée par les catastrophes naturelles ait considérablement diminué au cours du XXe siècle, les populations affectées (blessées, déplacées, etc.) sont plus nombreuses, et les coûts économiques, eux, explosent.
Face à cette nouvelle donne, le régime CatNat peine à s’adapter. Une réforme technique ou financière peut être nécessaire (comme celle qui a conduit à augmenter le niveau de la « surprime » pour catastrophes naturelles dans les contrats), mais elle ne suffira pas : il faut repenser sa soutenabilité du modèle de manière systémique. Cela suppose d’agir simultanément sur trois leviers :
- Limiter le réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, car plus les températures augmentent, plus les sinistres seront fréquents et coûteux. La transition écologique est aussi un enjeu assurantiel.
- Adapter le financement du régime, notamment en renforçant la trajectoire budgétaire. L’augmentation de la surprime CatNat de 12 à 20 % en janvier 2025 est un premier pas mais elle reste insuffisante sans pilotage à moyen terme.
- Renforcer la prévention collective : aujourd’hui encore, les territoires sont insuffisamment préparés. Cela suppose d’agir sur l’aménagement (désartificialisation des sols, normes de construction contre le risque RGA…), les infrastructures, la formation des populations aux situations de crise, et la diffusion d’une culture du risque.
Les catastrophes, aussi spectaculaires soient-elles, ne suffisent pas toujours à susciter une réaction à la hauteur. Un paradoxe s’installe : la multiplication des événements extrêmes alimente à la fois la volonté d’agir et un sentiment d’impuissance. Selon l’étude OBSCOP 20243 menée par EDF, l’inquiétude face au changement climatique est en recul depuis trois ans à l’échelle mondiale (40 % de personnes se déclarent « très préoccupées », soit -3 points). En France, le repli est encore plus marqué : la part des « très préoccupés » est passée de 35 % à 29 %.
Or, l’adaptation seule ne suffira pas. Si nous renonçons à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, nous nous condamnons à une spirale d’aggravation : un monde à +4 °C, ce sont des zones entières rendues inhabitables, des risques systémiques hors de contrôle, des dommages humains et économiques incommensurables. Autrement dit, un monde inassurable et la ruine du paradigme de la réparation, avec ce qu’elle charriera immédiatement dans son sillage ; le retour d’une insécurité généralisée, comme en avaient connu les femmes et les hommes des siècles passés.
Investir dans la prévention, c’est aussi associer les populations. Trop souvent, elles ne sont pas préparées aux risques. En octobre 2024, lors des inondations de Valence, en Espagne, des habitants sont descendus dans des parkings souterrains pour essayer de prendre leur voiture et y ont perdu la vie. À l’inverse, au Japon, les politiques de sensibilisation ont permis d’ancrer une véritable culture du risque dès le plus jeune âge : tous les enfants savent ce qu’ils doivent faire en cas de séisme.
Les outils existent : former, alerter, anticiper, inciter. Mais ils restent largement sous-utilisés. Il est temps de faire de la prévention un pilier central de notre réponse aux risques. À défaut, les conséquences seront majeures : non seulement pour notre sécurité physique, mais aussi pour la stabilité de nos institutions et la cohésion de notre société.
3. Qu’en pensent les Français ? Entre flou conceptuel et attente forte
Tout au long de ce cycle, plusieurs enquêtes menées par l’Observatoire de la Protection d’Aéma Groupe et l’IFOP sont venues nourrir nos réflexions. Depuis 2021, un baromètre annuel est réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 3 000 personnes âgées de 18 ans et plus. Il permet de suivre l’évolution des perceptions et attentes des Français en matière de protection, qu’il s’agisse de santé, de bien vieillir, de pouvoir d’achat ou encore de changement climatique. Ce baromètre met en lumière, d’année en année, les priorités sociales émergentes et les préoccupations individuelles. Depuis 2024, le périmètre de l’enquête s’est élargi à cinq autres pays européens (Allemagne, Suède, Royaume-Uni, Italie et Pologne), offrant ainsi une lecture comparée des enjeux actuels et futurs de la protection en Europe. Voici les principaux enseignements.
a) Une disposition de principe, mais une culture encore fragile
La prévention reste une notion relativement floue pour une majorité de Français. Selon le baromètre annuel de la protection4, 56 % des personnes interrogées déclarent ne se la représenter que de manière approximative, seuls 35% des français se représentent clairement la prévention. Cette méconnaissance n’est pas homogène dans la population : elle recule significativement chez les personnes âgées (45 % des 65 ans et plus donnent une note de compréhension élevée), les diplômés du supérieur (43 %), les catégories aisées (49 %) ou encore les habitants de l’agglomération parisienne (42 %). En d’autres termes, la culture de la prévention reste socialement et territorialement inégalement répartie. Contrairement aux Français, les citoyens des cinq pays européens interrogés disent se représenter plus clairement la notion de prévention : ils sont 70% des italiens, 64% des polonais ou encore 62% des allemands.
Pour autant, la disposition à agir semble présente : seuls 15 % des répondants affirment ne pas être prêts à modifier leur mode de vie en faveur de la prévention. Mais cette volonté se heurte à une hiérarchie implicite des engagements. Les changements les plus consensuels sont aussi les moins contraignants, à l’image d’un mode de vie plus sain (48 %, avec un pic à 53 % chez les 65 ans et plus). En revanche, les gestes plus engageants — rénovation du domicile (25 %), suivi d’ateliers ou formations (19 %), réduction de certains usages de transport (17 %) — peinent à mobiliser. Et l’idée de déménager pour fuir une région à risques naturels ne convainc que 9 % des sondés, malgré une sensibilité croissante aux effets territorialisés du changement climatique.
b) Des priorités différenciées selon les risques
L’investissement personnel ou financier dans la prévention varie fortement selon le type de risque envisagé. Le risque santé mobilise davantage (46 %) que le risque domestique (30 %) ou le risque climatique (28 %), pourtant croissant. Le risque numérique (17 %) et routier (13 %) suscitent un engagement nettement plus faible, témoignant d’une hiérarchie des perceptions de gravité et de proximité. Ces écarts suggèrent que la prévention est encore largement perçue à travers le prisme du risque individuel et sanitaire, plutôt que comme une stratégie collective face à des vulnérabilités systémiques.
c) Une attente forte, freinée par des obstacles socioculturels
Lorsqu’ils sont exposés à une définition plus complète de la culture de la prévention, les Français identifient plusieurs freins à son adoption. En tête, la difficulté à changer des habitudes ancrées (27 %), suivie par le coût des mesures préventives (20 %) et le manque d’information (17 %). En revanche, des explications fréquemment invoquées dans le débat public, comme la déresponsabilisation individuelle ou institutionnelle ou la surconfiance dans la technologie, sont peu citées (moins de 10 %). Il faut donc davantage compter avec des obstacles culturels, cognitifs et économiques qu’avec des postures idéologiques.
d) Inquiétude croissante, confiance résiduelle : un système sous tension
Une autre enquête, menée cette fois en décembre 20245, révèle également une tension singulière entre une inquiétude croissante et un sentiment de protection qui, paradoxalement, progresse légèrement. Les Français sont très préoccupés par les risques globaux — géopolitiques, climatiques, sanitaires —, mais expriment en parallèle une certaine confiance dans les mécanismes existants de protection sociale. Comment comprendre ce paradoxe ?
Une hypothèse plausible est celle d’un décalage entre la solidité perçue du système actuel et la conscience qu’il ne suffira pas face aux menaces à venir. Les dispositifs sociaux offrent encore une forme de sécurité pour les risques « traditionnels » mais apparaissent de moins en moins adaptés à la complexité des vulnérabilités contemporaines : crise climatique, pénurie de soignants, risques systémiques, ruptures d’approvisionnement, catastrophes naturelles. Cette angoisse latente nourrit une attente nouvelle vis-à-vis de l’action publique, centrée non plus sur la réparation mais sur l’anticipation. Dans ce contexte, la prévention émerge comme une réponse attendue face à l’imprévisible. Elle cristallise l’aspiration à une protection qui ne se contente plus d’intervenir après coup mais qui prépare, avertit et protège en amont. Encore faut-il que les moyens, les structures et la pédagogie soient au rendez-vous pour en faire une véritable culture partagée.
4. Lever les verrous : ce qui freine vraiment la prévention
Néanmoins,instaurer une véritable culture de la prévention suppose de surmonter un certain nombre d’obstacles structurels, culturels et politiques. Ces freins, bien identifiés, expliquent en grande partie pourquoi la prévention reste souvent marginale dans les politiques publiques, malgré les discours favorables dont elle fait l’objet.
Le premier frein tient au modèle de financement. La prévention est encore largement perçue comme une charge budgétaire, et non comme un investissement stratégique. Ses bénéfices, parce qu’ils consistent à éviter des problèmes futurs, sont par définition invisibles : on mesure difficilement ce qui n’a pas eu lieu. Cela rend plus complexe sa valorisation économique, alors même que les études montrent son potentiel considérable en matière de « coûts évités », de santé publique mais aussi d’économies à long terme pour les finances publiques.
Deuxième frein : le manque de formation et de culture partagée autour de la prévention. Les professionnels de santé sont majoritairement formés à diagnostiquer et à soigner, pas à prévenir. Il en est de même dans les autres secteurs – urbanisme, éducation, ingénierie, numérique – la logique préventive est encore trop peu présente dans les cursus de formation. Or, la prévention ne peut être efficace que si elle est pensée de manière transversale, à tous les niveaux de l’action publique et privée.
Troisième difficulté : l’absence de coordination entre les nombreux acteurs concernés. Les politiques de prévention sont aujourd’hui fragmentées entre les services de l’État, les collectivités territoriales, l’Assurance maladie, les agences sanitaires, les mutuelles d’assurance, les entreprises ou encore les associations. Faute de gouvernance partagée et d’objectifs communs, les actions se juxtaposent sans toujours se renforcer. Le résultat est une efficacité limitée, souvent bien en deçà des ambitions affichées.
Enfin, il existe une forme de résistance sociale à la prévention, plus diffuse mais non moins déterminante. Elle s’enracine en partie dans des mécanismes psychologiques : difficulté à se projeter dans l’avenir, refus de savoir, sentiment d’impuissance… Ces freins, parfois inconscients, limitent l’efficacité des démarches individuelles et collectives de prévention, et compliquent le passage à l’action. De plus, promouvoir des comportements plus sains ou plus durables — arrêter de fumer, mieux se nourrir, réduire l’usage de la voiture — suppose de modifier des habitudes profondément ancrées, voire de toucher à des libertés perçues comme fondamentales. Or un tel changement ne peut advenir sans une parole publique crédible, cohérente et digne de confiance. Cette confiance, aujourd’hui fragilisée, est pourtant indispensable : la prévention ne peut se déployer sans l’adhésion active des citoyens. Elle appelle, en ce sens, à davantage de transparence et de co-construction.
Lever ces freins est indispensable pour faire de la prévention un levier efficace de transformation sociale.
5. Cinq priorités pour une stratégie de prévention à part entière
En appui des réflexions menées sur la culture de la prévention lors du cycle de l’Observatoire de la Protection d’Aéma Groupe6, nous proposons de structurer une véritable politique nationale de la prévention autour de cinq axes prioritaires :
1. Faire de la prévention un levier stratégique dans tous les champs de l’action publique
Aujourd’hui, la prévention reste pensée en silos, sans vision systémique. Les politiques publiques, les dispositifs d’alerte ou les plans d’action sectoriels négligent l’interconnexion croissante des risques. Or, le dérèglement climatique favorise les maladies respiratoires, le vieillissement de la population exige une adaptation des territoires et des mobilités, les nouvelles technologies multiplient les cyber-risques — y compris sur des infrastructures vitales. Il est urgent de diffuser une culture de la prévention dans tous les domaines de l’action publique, et d’en faire un axe structurant des politiques de santé, de transition écologique, d’éducation, de travail ou encore de sécurité.
2. Valoriser les coûts évités dans les modèles économiques et budgétaires.
La prévention est encore trop souvent perçue comme une dépense, alors qu’elle constitue un investissement stratégique à long terme. Intégrer la logique des « coûts évités » — en matière de santé, de sinistralité, d’infrastructures ou d’accompagnement social — permettrait de réorienter les arbitrages publics en faveur d’actions préventives. Tant que nous resterons dans une logique de court terme, la prévention restera marginalisée dans les priorités budgétaires.
3. Mobiliser les sciences comportementales pour rendre la prévention concrète et efficace :
Nudges, incitations, marketing social, communication ciblée : les outils ne manquent pas pour accompagner les changements de comportements7. Encore faut-il les utiliser de manière transparente, cohérente et stratégique. La prévention ne peut réussir sans adhésion des citoyens. Or, elle est souvent perçue comme descendante, technocratique, voire punitive. Le déficit de confiance envers les institutions, nourri par les scandales passés (sang contaminé, glyphosate, gestion du Covid), mine la légitimité des politiques préventives. Les mesures coercitives (taxes, interdictions) sont mal acceptées si elles ne sont pas accompagnées d’explications claires. Le consentement à la contrainte nécessite transparence, dialogue et démonstration des bénéfices.
4. Former les professionnels à la logique de prévention, dès les cursus initiaux.
La prévention est un métier à part entière, qui repose sur des compétences spécifiques : données probantes, coordination, animation territoriale, conduite du changement. Or, ces compétences sont encore très peu présentes dans les formations. Nous manquons de professionnels formés en santé publique, en éducation à la santé, en résilience territoriale. Il est donc essentiel d’intégrer la prévention dans les cursus initiaux et la formation continue, pour une large diversité de professionnels : soignants, enseignants, urbanistes, ingénieurs, travailleurs sociaux, etc.
5. Instaurer une gouvernance claire, partagée et dotée de moyens. Le morcellement des responsabilités — entre l’État, les collectivités, l’assurance maladie, les complémentaires santé, les assureurs et les associations — nuit à la lisibilité et à l’efficacité des politiques de prévention. Sans pilotage stable, stratégie nationale et coordination entre les acteurs, il est impossible de construire une politique cohérente et pérenne. Les actions de prévention reposent encore trop souvent sur l’initiative privée d’acteurs, notamment assurantiels, non coordonnées par une vision publique stratégique. La prévention doit être dotée d’une gouvernance transversale, légitime, financée et capable de mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour d’objectifs partagés. Les plans de prévention doivent désormais se doter d’objectifs clairs, cohérents et mesurables, assortis d’indicateurs de suivi et d’une gouvernance lisible. Il est impératif de clarifier les rôles entre les acteurs nationaux et territoriaux pour déployer une politique de prévention ambitieuse, structurée et enfin à la hauteur des enjeux.
Conclusion
Au terme de cette réflexion, une conviction s’impose : la culture de la prévention en France reste incomplète, alors même qu’elle devrait occuper une place centrale dans notre modèle social. Construire cette culture, c’est reconnaître que la prévention ne relève pas uniquement de la technique ou du bon sens. C’est une manière d’agir en amont des crises, de parier sur notre capacité collective à anticiper plutôt qu’à réparer. En ce sens, elle porte une vision : celle d’une société qui ne subit pas, mais qui se prépare. Cela suppose aussi de s’appuyer sur les solidarités concrètes. Les grandes institutions — l’État, les régimes d’assurance, les droits sociaux — ne peuvent fonctionner durablement sans lien avec des formes de solidarité plus proches, plus incarnées. Déployer la prévention au plus près des territoires, c’est accepter de reconnaître notre vulnérabilité, d’admettre que personne n’est à l’abri, et qu’il faut penser collectivement les protections à mettre en place. C’est sur cette base que peut se construire une approche plus juste des risques.
Les attentes existent. Les Français demandent à être mieux protégés, plus tôt et de manière plus équitable. Mais les conditions pour y répondre ne sont pas encore réunies : ni dans les budgets, ni dans les organisations, ni dans les priorités politiques. Changer cela est une question de responsabilité. Si l’on veut que la prévention cesse d’être un angle mort de l’action publique, il faut en faire une priorité claire, dotée de moyens, de pilotage, et d’un vrai soutien politique. Pas un supplément d’âme mais une composante essentielle d’un modèle plus durable, plus protecteur, et plus cohérent avec les risques d’aujourd’hui. Le temps presse !