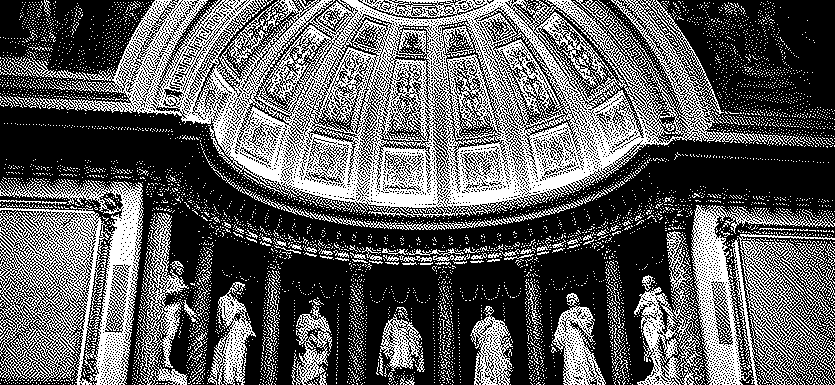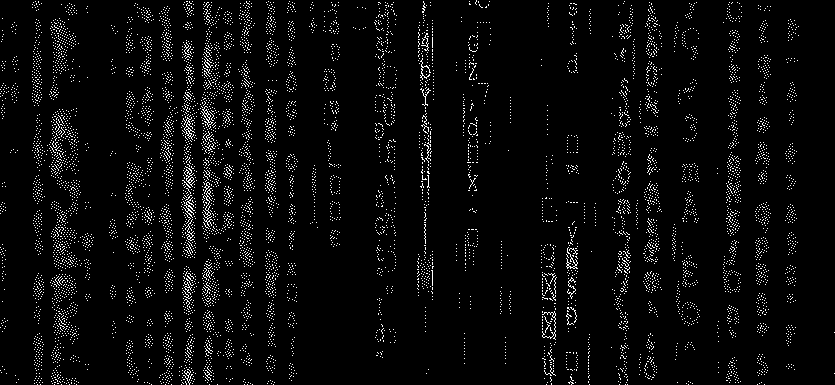Avec des collègues de Yale, Harvard et d’autres universités, nous avons utilisé l’IA pour comparer des vidéos d’espaces publics des années 1970 à des séquences récentes, filmées aux mêmes endroits à New York, Boston et Philadelphie. Les résultats sont éloquents : les piétons marchent plus vite, s’attardent moins, et interagissent plus rarement.
Dans un monde où smartphones, Netflix et compagnons alimentés par l’IA nous éloignent des lieux physiques et des relations réelles, cela n’étonne guère. Pourtant, si la technologie fait partie du problème, elle peut aussi faire partie de la solution. En l’utilisant pour étudier nos espaces urbains, nous pouvons collecter des données, détecter des dynamiques, tester des aménagements — et repenser l’agora pour notre époque.
L’étude des interactions urbaines a toujours fasciné les esprits curieux. Parmi eux, William “Holly” Whyte, qui filmait dans les années 1970 les places et parcs new-yorkais. Il observait où les gens s’asseyaient, comment ils occupaient l’espace, ce qui les rapprochait. Dans The Social Life of Small Urban Spaces (1980), il formule une maxime aussi simple que lumineuse : « Ce qui attire le plus les gens, ce sont les autres gens. »
À partir de ses séquences, Whyte proposait des recommandations concrètes : des bancs « aussi profonds que deux dos humains », des chaises mobiles pour suivre l’ombre ou le soleil. Son approche a sauvé Bryant Park et marqué durablement notre conception humaine — et humaniste — de l’espace public.
Mais ses recherches étaient coûteuses à reproduire : analyser ces films image par image prenait des mois à des équipes entières. Aujourd’hui, cela appartient au passé. Nous avons numérisé les vidéos originales de Whyte et les avons comparées à des séquences récentes filmées aux mêmes endroits : Bryant Park, les marches du Met à New York, Downtown Crossing à Boston, Chestnut Street à Philadelphie.
Puis nous avons entraîné une IA pour analyser ces deux corpus. La « vision par ordinateur » — la même qui permet aux voitures autonomes de détecter piétons et cyclistes — excelle aussi à analyser des scènes urbaines denses, suivant simultanément des centaines de personnes. Ce qui prenait des mois à Whyte, l’IA le fait en quelques minutes.
Alors, que s’est-il passé entre 1970 et 2010 ? Comme l’expose notre récente publication dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, la vitesse de marche a augmenté de 15 %. On s’arrête moins. Les dyades — ces duos qui se retrouvent puis poursuivent leur chemin ensemble — se raréfient. Downtown Crossing, autrefois animé, est devenu un simple lieu de passage. Même à Bryant Park, pourtant repensé selon la vision de Whyte, les interactions sociales ont décliné. Les villes ne se sont pas vidées, mais une part de leur essence s’est dissipée.
Les causes sont multiples : l’accélération des rythmes de travail, la pression du temps, la disparition de la flânerie. Peut-être préfère-t-on Starbucks à un parc. Le regard du flâneur quitte la rue pour se poser sur son smartphone.
Ce glissement affaiblit notre tissu social. En ligne, nous dérivons dans des bulles de filtre personnalisées, scrollons l’inconfort, éloignons la dissidence. L’espace public, lui, reste admirablement sans filtre : il invite au désordre, à la surprise, à la rencontre. Un supporter d’une équipe adverse vous tient la porte. Vos enfants jouent avec d’autres qui parlent une langue différente. Si nous passons moins de temps dans ces lieux, nous risquons de perdre la tolérance — et avec elle, l’habitude de la citoyenneté.
Ironie du sort, la technologie qui nous replie sur nous-mêmes pourrait aussi nous faire sortir. Les réseaux sociaux créent l’addiction car leurs algorithmes scrutent en permanence ce qui nous plaît. Et si nous utilisions ces mêmes outils pour analyser les espaces publics extérieurs ? Nous pourrions aller plus loin encore : donner à chaque parc, chaque place, chaque coin de rue son William Whyte virtuel.
Quels types de mobilier favorisent l’interaction ? Un point d’eau ou un peu de verdure créent-ils un microclimat plus accueillant ? Quels jeux publics brisent la glace ? On pourrait tester des interventions temporaires, les évaluer par IA, itérer par essais et erreurs — et faire évoluer nos espaces avec la même logique adaptative que la nature.
Les architectes ne doivent pas craindre ces outils, comme nous l’exposons cette année à la Biennale d’architecture de Venise. Mais dans quel esprit les utiliser ?
D’abord, avec humilité. Les espaces publics du passé étaient loin d’être parfaits — souvent excluants envers les femmes, les minorités, les personnes en situation de handicap. Il ne faut ni les sacraliser, ni abandonner l’avenir à une technologie froide : optimiser la vie publique à partir de la seule donnée reviendrait à reproduire les erreurs du modernisme autoritaire. L’IA peut révéler des dynamiques, pas dicter ce qui est juste.
Ensuite, avec curiosité. L’espace public est vivant : il réagit à la chaleur, à la lumière, à la géométrie, aux usages. Une intervention minime — un banc à l’ombre, une fontaine en période de canicule, un chemin sinueux plutôt qu’un raccourci — peut transformer les comportements. Dans une étude récente à Milan, nous avons constaté que le respect de la limitation à 30 km/h dépendait moins des panneaux que de la forme de la rue. Ce qui nous guide, ce n’est pas l’injonction, mais le design.
Enfin, avec une attention au climat. En Europe du Sud, les espaces urbains ont été conçus pour un climat qui n’existe plus. En Sicile, on peut désormais cultiver la mangue, mais les places publiques offrent encore peu d’ombre ou de protection thermique. Inspirons-nous de villes comme Singapour, où la végétation, l’eau et l’ombre sont orchestrées pour atténuer la chaleur. Si le climat change, l’espace public doit s’adapter.
Le vrai défi est peut-être là : trop longtemps, les concepteurs ont dessiné à distance, imaginant comment les gens devraient se comporter sans les observer. Aujourd’hui, nous avons les outils pour voir ce que les gens font vraiment. Pour tester des hypothèses. Identifier le plaisir, prototyper la proximité. Non pour optimiser, mais pour veiller. Pour prendre soin.
Bien utilisés, ces outils peuvent ralentir le déclin de nos liens publics. L’agora n’est pas morte. Elle doit être réinventée. Et si nous sommes attentifs et intelligents, l’IA pourrait bien nous y aider. Elle pourrait même nous faire entendre autre chose : la fragile, insaisissable symphonie du commun.
Note de contexte :
La Biennale d’architecture de Venise 2025, intitulée Intelligens. Natural. Artificial. Collective, sous la direction de Carlo Ratti, se tient jusqu’au 23 novembre 2025. Elle explore l’adaptation face à la crise climatique à travers une pluralité d’intelligences — naturelle, artificielle, collective — et place l’architecture au cœur d’une transformation nécessaire et interdisciplinaire.