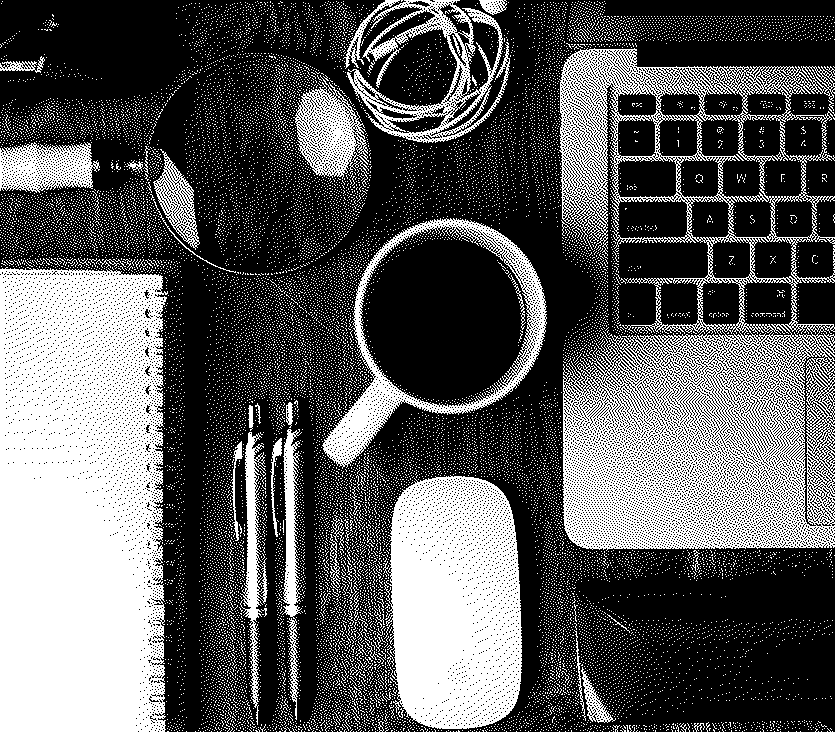Dans Le travail est la solution (éditions Hermann, juin 2025), Franck Morel et moi partons du constat que le travail a été de facto délaissé comme objet politique par la totalité des forces politiques de ce pays. Tantôt au profit d’une vision essentiellement gestionnaire (l’impératif absolu est la création d’emplois), tantôt au nom d’une vision d’un travail devenu absurde, pathogène et aliénant (il faudrait travailler moins pour le rendre supportable). Pourtant, le fait qu’une majorité absolue de travailleurs d’âge actif votent pour des partis « hors système » devrait nous alerter sur l’ampleur des maux liés au travail aujourd’hui, qui sont bien réels, même s’ils ne sont pas ceux de la civilisation de l’usine. Tant il est vrai qu’on ne construit pas une démocratie sereine et apaisée sur un monde du travail frustré. C’est à partir de ce constat que notre essai propose un certain nombre de pistes de solutions visant à réconcilier les Français avec le travail. Retour sur quelques-uns des thèmes abordés dans cet ouvrage que nous souhaitons soumette à la discussion.
1. La question du « travail qui ne paie plus » et les propositions fiscalo-sociales pour remédier à cette situation
C’est bien connu, le travail est trop « taxé » en France. Certes, il est toujours possible, comme la plupart des organisations syndicales, de considérer les cotisations sociales comme du « salaire différé » (puisqu’il ouvre droit à des revenus en cas de réalisation de certains risques sociaux : retraite, maladie, chômage, accidents du travail…). Telle était d’ailleurs à l’origine la justification de financer l’essentiel de la protection sociale sur l’assiette « travail », en partageant l’effort entre salariés (cotisations salariales) et employeur (cotisations patronales). C’était, en substance, le compromis de 1945 du Conseil National de la Résistance.
Avec la généralisation progressive de la couverture maladie dès les années 1970, le déplafonnement des cotisations et enfin la création et la montée en puissance de la CSG à partir de la fin des années 1980, cet idéal-type a été définitivement perdu de vue. Plus récemment, la prise en charge par l’Etat de quelque 80 milliards d’allégements de charges patronales et l’introduction de la CSG dans le financement de l’assurance chômage ont accéléré cette évolution de long terme. Au point que l’on peut estimer que 54 % de la protection sociale est aujourd’hui financée par d’autres ressources que les cotisations sociales assises sur le travail, en premier lieu de la TVA, de la CSG (voir par exemple le rapport d’Antoine Bozio et Etienne Wasmer : « Les allégements de charges sociales sur les bas salaires : une inflexion nécessaire »).
Malgré cette grande diversification des financements de la protection sociale, assumée par tous les gouvernements successifs depuis plus de trente ans quelle que soit leur couleur politique, la question des charges pesant sur le travail est à présent bien installée dans le débat politique. Il faut dire que 80 ans après le pacte fondateur de 1945, quand l’employeur débourse 100 euros, le salarié encaisse un revenu de 54 euros. Il ne faut donc pas s’étonner que la question des charges pesant sur le travail s’installe au cœur des débats politiques au moment où jamais les questions liées au pouvoir d’achat n’ont été aussi élevées dans les préoccupations des Français depuis que les principaux baromètres d’opinion existent.
C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les propositions tendant à soulager le poids des charges sur le travail en les basculant sur d’autres assiettes. Et ce, alors que l’on constate que les marges de manœuvre sont singulièrement limitées.
A gauche, il s’agit de basculer davantage de financement sur le capital. Belle idée en théorie, car il n’y a aucune raison que les revenus du capital ne participent pas au financement de la protection sociale, ceci d’autant plus que notre Etat Providence bénéficie aussi aux détenteurs du capital ! Malheureusement, ces propositions achoppent sur le fait que l’assiette « revenus du capital », à l’instar de l’assiette « revenus du travail » est déjà plus lourdement taxée en France qu’ailleurs. Partant, il est difficile d’aller très loin dans cette direction, d’autant que l’assiette « revenus du capital » s’avère extrêmement volatile et sensible à l’ampleur de la fiscalité qui la frappe (alors même que les dépenses de protection sociale croissent à un rythme très régulier) : l’expérience de la baisse des taux de prélèvements sur les revenus du capital avec l’introduction de la « flat tax » en 2017 qui a conduit à une hausse des recettes est venue nous le rappeler.
A droite, et du côté du patronat, la tentation est grande de mettre en place une « TVA sociale », opération consistant à diminuer certaines cotisations patronales comme l’assurance maladie en échange d’une hausse de la TVA. L’argument est une nécessaire rationalisation des financements de la protection sociale : certaines des cotisations actuelles financent des dépenses universelles qui n’ont aucune raison de n’être financées que par le travail. Malgré son bon sens apparent, cette opération est doublement difficile : d’une part, elle est particulièrement impopulaire (la TVA est l’impôt le moins bien admis socialement avec les taxes sur le carburant et la taxation des héritages) ; d’autre part, elle dépendrait d’une conjoncture économique favorable). Quant à son impact sur la compétitivité économique, il ne serait sensible que si l’opération était réalisée sur une très grande ampleur (au moins 3 points de TVA).
En réalité, toutes les assiettes fiscales sont déjà saturées en France, donc les marges de manœuvre sont singulièrement limitées pour procéder à un « big bang » du financement de la protection sociale. Certes, comme nous le proposons dans notre essai, il est tout à fait possible d’aller plus loin dans le sens de la rationalisation du financement de la protection sociale, en clarifiant ce qui relève du domaine contributif (financé par les cotisations sociales) et ce qui relève de la solidarité (financé par l’impôt). Toutefois, il ne faut guère se faire d’illusion sur la possibilité de relancer le pouvoir d’achat par un jeu de bonneteau sur les assiettes fiscales et sociales.
2. La question du « travailler plus pour gagner plus »
La question du pouvoir d’achat est en tête des préoccupations des Français depuis plus de 20 ans dans tous les sondages, souvent au coude à coude avec celle du chômage. Le ralentissement marqué des salaires depuis les années 2010 et la diminution sensible du chômage a propulsé le pouvoir d’achat très au-dessus des autres thématiques au cours de l’année 2025. Au point de préempter la plupart des arbitrages budgétaires actuels, alors même que l’état de nos finances publiques ne permet plus, de toute évidence, de soutenir artificiellement le pouvoir d’achat des ménages de travailleurs.
Dans ces conditions, le slogan sarkozyste « travailler plus pour gagner plus » couronné de succès en 2007 retrouve une nouvelle jeunesse. L’idée est de créer du pouvoir d’achat pour les salariés les plus modestes, non pas en mettant à contribution les finances publiques, mais en contrepartie d’un surcroît de création de richesses. L’appétence des salariés français pour effectuer des heures supplémentaires (très marquée chez les salariés modestes, beaucoup moins chez les cadres aux forfaits d’après les enquêtes d’opinion) invite également à réfléchir dans ce sens.
Le fait que les salariés français à temps plein soient parmi ceux dont la durée annuelle effective de travail en Europe soit la plus faible est naturellement un argument supplémentaire : si la France pouvait se targuer d’une productivité horaire supérieure à ses voisins européens et égale à celle des Etats-Unis dans les années 1990, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans ces conditions, il n’est plus possible de justifier que les salariés français aient une durée du travail inférieure aux autres. La situation actuelle explique en grande partie pourquoi les salaires par tête sont devenus aussi faibles en comparaison avec des pays comme l’Allemagne ou la Suisse. Et pour les salariés rémunérés au-delà du salaire moyen, l’effet négatif de cette situation sur le pouvoir d’achat n’est pas compensé par les transferts sociaux dont ils bénéficient en retour. Au point que le consentement à financer l’Etat social de la part des travailleurs commence sérieusement à s’éroder et pourrait devenir une préoccupation politique majeure dans les prochaines années.
Un autre élément militant en faveur d’un accroissement de la durée du travail est l’absence de lien entre le temps de travail effectif et le sentiment de subir une charge de travail excessive. Si toutes les enquêtes mettent en évidence les dégâts psychologiques causés par l’intensification du travail au cours des dernières années, elles démontrent également que ce n’est pas l’allongement de la durée du travail en elle-même qui cause ces pathologies : en réalité, on peut très bien être en burn out en travaillant 35 heures par semaine. En sens inverse, une bonne organisation et de bonnes relations au travail permettent de travailler davantage sans effets négatifs pour la santé.
Bien entendu, il n’est pas question de proposer un « retour aux 39 heures » ou, plus généralement, troquer les « 35 heures » contre un quelconque nouveau seuil aussi arbitraire qu’inadapté au modèle économique de nombreuses entreprises. Ce que nous proposons dans notre ouvrage repose sur deux principes.
Il s’agit d’une part de promouvoir la liberté : possibilité pour un employeur et ses partenaires sociaux de décider librement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, celui-ci restant à 35 heures (ou 1607 heures par an) par défaut. De même, il n’y aurait plus de contingents réglementaires d’heures supplémentaires, les limites fixées par le droit européen (48 heures par semaine et repos hebdomadaires) suffisant à assurer une protection suffisante pour les travailleurs. De même, le plafond de 218 jours pour les salariés au forfait annuel en jours (qui revient à attribuer l’équivalent de 7 semaines de congés annuels au minimum) serait supprimé, les négociations sociales et l’accord individuel permettant d’aller bien au-delà.
Il s’agit d’autre part d’éviter que le franchissement du seuil de 35 heures entraîne des surcoûts excessifs pour l’employeur, décourageant totalement celui-ci de faire réaliser des heures supplémentaires par ses salariés. Le surcoût actuel (de l’ordre de 40 % par rapport à une heure normale pour les salaires en-dessous du salaire médian) explique largement le faible impact des assouplissements précédents des 35 heures sur le nombre effectif d’heures supplémentaires accomplies. Pire, une partie des allégements de charges sur les bas salaires (environ 15 milliards sur les 80 milliards d’euros selon le rapport Bozio et Wasmer précité) sont les héritiers des allégements de charges Aubry destinés à compenser la hausse des salaires horaires résultant des passages aux 35 heures et, de ce fait, contribuent à financer la baisse du temps de travail.
La solution que nous préconisons est de diminuer drastiquement les charges patronales pesant sur les heures supplémentaires (afin d’éviter un surcroît de coût du travail par rapport aux heures normales). Afin d’éviter un surcoût pour les finances publiques, une partie des allégements de charges sur les bas salaires seraient mobilisés pour financer cette détaxation des heures supplémentaires. Il s’agit donc tout simplement de transformer une subvention au non-travail en une incitation à la hausse du temps de travail. Evidemment, ce mécanisme aboutirait à ce que les entreprises dynamiques augmentant la durée du travail se voient favorisées au détriment des entreprises restant strictement à 35 heures, lesquelles verraient les charges patronales légèrement accrues.
Dans ce schéma, le seuil de 35 heures disparaîtrait de fait, sans être remplacé par un nouveau seuil tout aussi arbitraire, mais par un système réglementaire et fiscalo-social permettant à chaque entreprise et chaque collectif de travail d’adapter librement la durée du travail à ses propres contraintes.
3. La question de la pénibilité du travail et de l’usure professionnelle : vraies et fausses pistes de solution…
Il est regrettable que la question de la pénibilité ne soit apparue au premier plan qu’à l’occasion des récentes réformes des retraites. En réalité, le sujet a très longtemps été traité via la spécificité des pré-retraites et de la retraite à 60 ans. Ces dispositifs ont conduit à supprimer toute incitation des entreprises à traiter le sujet et à créer une forme de collusion entre les employeurs, les salariés et leurs représentants satisfaits de cet équilibre gagnant–gagnant pour les deux côtés (mais dramatiquement perdant pour le taux d’emploi et les finances publiques…). De fait, la pénibilité a été le parent pauvre des négociations sociales dans les branches professionnelles et c’est peu dire que le patronat s’est longtemps satisfait des nombreux dispositifs de départs anticipés en retraite.
Ce n’est qu’à l’occasion des reports progressifs des curseurs légaux de l’âge du départ en retraite (durée de cotisation et âge d’ouverture des droits) que la question s’est imposée et, avec elle, plus généralement, celle de l’emploi des seniors. La prise de conscience du sujet est toutefois encore très insuffisante. En témoigne par exemple le fait que les branches professionnelles ne se sont pas emparées des possibilités de financement d’action en faveur du maintien des seniors en emploi permises par la réforme des retraites de 2023 (création du fonds d’investissement et de prévention de l’usure professionnelle).
A défaut de dialogue social efficace sur le sujet, deux mécanismes ont été développés pour répondre à cette question. Le premier repose sur l’idée séduisante que la pénibilité pouvait être mesurée sur la base de critères réglementaires et donner droit à des « points pénibilité » dans le cadre du compte de prévention de la pénibilité (C2P). Dans ce schéma, on le sait, l’accumulation de points donne des droits à des formations censées permettre de se repositionner ou de validations de trimestres afin de partir plus tôt en retraite. Ce dispositif, on le sait, n’a pas été une solution satisfaisante pour traiter la question : des critères administratifs difficiles à mesurer, la faible appétence des salariés et de leurs employeurs à s’en saisir pour aménager les fins de carrières…
Le second est le dispositif bien plus puissant dit des « carrières longues » qui existe au niveau national et obéit à des critères nationaux et uniformes. On sait que celui-ci permet à ceux qui ont commencé à cotiser tôt (entre 16 et 21 ans) et ont cotisé au-delà d’une durée déterminée de partir avant l’âge légal.
Face à l’incapacité d’objectiver les situations de pénibilité, il a ainsi été décidé de laisser partir plus tôt les personnes qui ont commencé à travailler plus tôt que la moyenne. L’idée est que ces personnes sont a priori usées professionnellement et auraient une espérance de vie plus faible que la moyenne. Las, les études statistiques ont démontré que le fait d’entrer tôt sur le marché du travail n’entraînerait pas une réduction de l’espérance de vie bien au contraire, donnant ainsi raison au vieil adage populaire selon lequel « le travail, c’est la santé ». Ce constat est en réalité assez logique : d’une part, une grande partie des personnes ayant commencé tôt à travailler ont progressivement évolué vers des métiers non pénibles. D’autre part, il existe un biais de sélection en faveur de ces salariés dans la mesure où ils n’ont pu atteindre les durées exigeantes requises que parce qu’ils n’ont connu ni interruptions pour longue maladie ni longs épisodes de chômage et de pauvreté qui sont autant de facteurs de diminution de l’espérance de vie.
Face à l’échec (et, s’agissant des carrières longues, au coût) de ces dispositifs, nous proposons de donner les bonnes incitations aux partenaires sociaux pour s’emparer sérieusement du sujet de la pénibilité. A notre sens, les solutions ne se situent pas au niveau interprofessionnel, mais doivent être recherchées métier par métier au niveau des branches professionnelles sur la base à la fois de l’analyse des situations professionnelles concrètes et de la fréquence des situations d’invalidité ou d’inaptitude professionnelles médicalement constatées.
Concrètement, il est proposé de supprimer progressivement les dispositifs de carrière longue et de laisser la possibilité aux branches professionnelles de négocier en replacement des dispositifs de retraite anticipé dont elles détermineraient librement les modalités (conditions d’éligibilité, niveau des prestations versées, durée de la période). Ces dispositifs de « retraite-pont » seraient financés par des caisses d’assurance dédiées alimentées par des cotisations des employeurs et des salariés des branches concernées. Devant supporter les coûts de ces départs précoces, les négociateurs devraient restreindre leur accès à des situations d’usure professionnelle précoce objectives et auraient également toutes les bonnes incitations à modifier en conséquence leurs politiques RH à destination des travailleurs vieillissants et à mettre en place des dispositifs de prévention de l’usure professionnelle.
4. La question du partage de la valeur ajoutée : état des lieux et que faire ?
Le débat autour de la question du partage de la valeur ajoutée en France est pollué par l’affirmation fausse parfois véhiculée dans les médias selon laquelle la part de la rémunération du travail dans l’ensemble de la valeur ajoutée serait en diminution au bénéfice des revenus du capital. Pourtant, les statistiques de l’INSEE prouvent le contraire et démontrent une remarquable stabilité de ces deux parts, contrairement à ce que l’on peut observer dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis.
Pour autant, la question apparaît pertinente si l’on observe aussi bien l’évolution de la concentration des patrimoines (donc si l’on considère le stock et non les plus de revenus) que le décrochage entre le niveau des salaires et le prix des actifs immobiliers. Autrement dit, le sentiment de déclassement des salariés a des racines objectives. Ce n’est pas un hasard si les débats autour de la taxation des patrimoines (et notamment de l’héritage) reviennent au cœur des discussions politiques et ceux-ci sont évidemment légitimes.
Toutefois, la taxation des patrimoines, qui induit une diminution de la rentabilité des investissement productifs quand elle touche l’outil de travail est à notre sens une mauvaise façon d’aborder la question. Plutôt que de jouer sur la redistribution secondaire, il nous semble plus pertinent de favoriser un meilleur partage de la valeur ajoutée au niveau de la distribution primaire, c’est-dire avant intervention de la fiscalité. C’est dire que la question du partage de la valeur là où elle est produite devrait être plus que jamais au cœur de la réflexion, dans le prolongement de la vieille idée gaulliste de l’association du capital et du travail. Dans cette perspective, nous proposons deux pistes de réflexion.
La première consiste à généraliser la participation des salariés au capital par divers mécanismes. Il est par exemple proposé de généraliser la participation via la constitution de fonds de participation par filière ou sur une base géographique permettant aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier d’une partie de la participation versée par les grandes entreprises, leur employeur étant de son côté incité à abonder cette participation venue de l’extérieur. Il est également proposé d’associer un avantage fiscal aux différents dispositifs de rémunération en capital (par exemple sous forme de distribution d’actions ou de participation à des LBO) lorsqu’elles bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise et ne sont pas réservés au top management.
La seconde piste consiste à développer un pilier par capitalisation obligatoire au sein du régime général de retraite. La situation de notre régime de retraite par répartition rend en effet l’essor de la capitalisation indispensable pour éviter l’appauvrissement des futurs retraités. Cependant, il serait inéquitable qu’il ne concerne que les salariés des grandes entreprises, notamment les cadres, comme c’est le cas aujourd’hui avec les plans d’épargne retraite. Une telle réforme serait de nature à doter tous les salariés, y compris les plus modestes de ressources en capital pour préparer l’avenir.
Bien sûr, on pourra objecter que la difficulté de la transition d’un régime à un autre est très grande et nécessiterait des efforts financiers importants à court terme alors même que nos finances publiques sont exsangues. Cependant, un examen approfondi de la question montre que des voies de passage existent, la principale consistant à mettre les retraités actuels à contribution pour amorcer le fonds de capitalisation nécessaire à l’opération. Il s’agirait sans doute d’une opération politiquement impopulaire auprès de nos aînés. Mais serait-elle finalement plus impopulaire que la méthode consistant à rafistoler encore et toujours le système actuel en désavantageant toujours plus les nouvelles générations qui sont en train s’apercevoir qu’elles sont les grandes perdantes ?