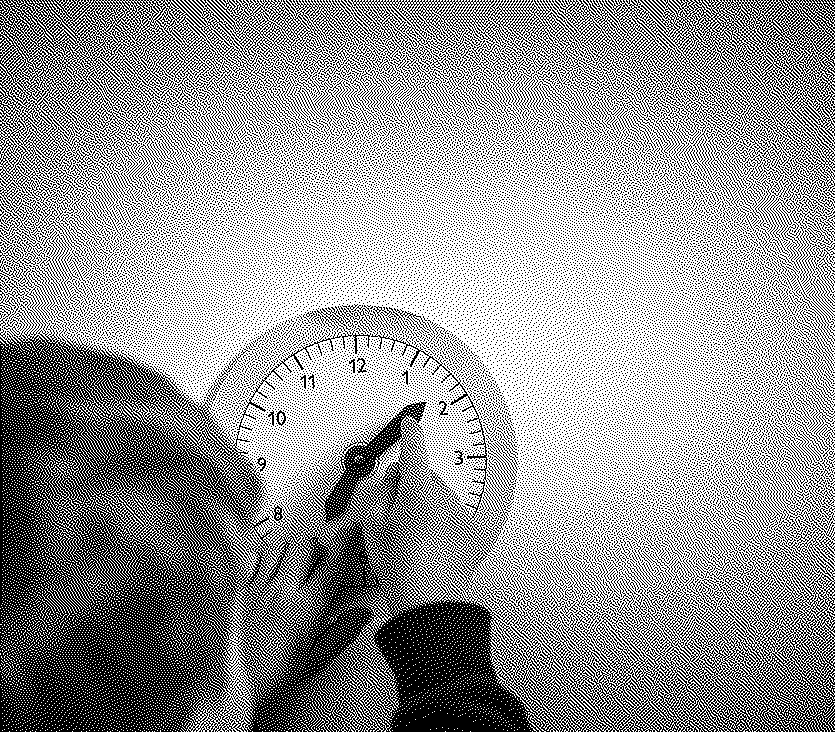Dans sa note dédiée à la refondation de la psychiatrie, le CPPRS souligne à juste titre que les 6% que la prévention représente dans les dépenses globales de santé de notre pays sont notoirement insuffisants1.
Dans les logiques gestionnaires qui gouvernent les politiques de santé, la recherche du moindre coût, aurait pu conduire pourtant de façon évidente à promouvoir ce domaine encore sous-développé des politiques de santé, voire carrément en friche concernant la santé mentale, alors que tant d’expériences montrent leur intérêt2. Est-ce par incapacité à regarder au-delà des indicateurs d’efficacité immédiate ? Est-ce du fait de la faible visibilité dans une campagne de communication ? Pour nous, derrière l’argument de l’absence de « culture de prévention », se cache surtout une absence de volonté politique.
Investir réellement dans la prévention en santé mentale exige selon nous une approche à trois niveaux, relativement peu compatibles avec les approches gestionnaires actuelles : se donner des objectifs à long terme ; choisir des indicateurs de santé mentale ; connaitre les facteurs de risque et de protection. Mais le choix d’indicateurs en matière de santé mentale, tout comme l’identification des facteurs de risque, sont affaire de choix politiques : ils empiètent en effet directement sur les objectifs d’une politique véritablement sociale. En effet, malgré le manque encore important de moyens pour des recherches sur ces thèmes, nous savons déjà que la pauvreté, l’immigration, la violence, qu’elle soit sociale ou intrafamiliale, la maltraitance, le stress scolaire, l’isolement social, le défaut d’accès aux soins, pour les parents ou leurs enfants, ou celui plus général de l’accompagnement périnatal, et enfin les addictions, constituent des facteurs principaux de décompensation psychique – pour n’en citer que quelques-uns parmi les plus notables3.
Ainsi, les adolescents délinquants pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse sont majoritairement issus de classes sociales défavorisées, chez qui se cumulent les effets des inégalités. Leur parcours est marqué par une succession de rencontres ratées, que ce soit dans leur environnement familial, social ou institutionnel. Cela suggère que des recherches sur les facteurs de risque environnementaux en pédopsychiatrie seraient bien peut-être, à nos yeux, bien plus nécessaires que celles qui sont menées dans d’autres domaines comme la neurobiologie. Non pas que ce domaine ne soit pas digne d’intérêt, mais tout miser sur les neurosciences, comme c’est le cas actuellement, relève au mieux d’un pari, au pire d’une croyance, alors que ses apports sont si faibles pour les patients4. L’individu n’est pas un système clos seul produit de ses gènes et de sa biologie, il est un corps sensible, en dialogue permanent avec son environnement par ses sens, ses affects et sa parole.
Entre la neurobiologie, le neurodéveloppement, d’un côté et la santé mentale, de l’autre, la psychiatrie qui seule s’occupe des affections mentales est incitée à rester derrière ses murs médicaux, et de ne pas s’occuper de politique de santé. Or, la pédopsychiatrie travaille depuis des années avec les différents acteurs de la vie sociale, mais pourrait le faire bien davantage au travers des réseaux de prévention et de soin.
La pédopsychiatrie est confrontée à un manque de moyens dans les structures publiques de prévention, qui sont pourtant présentes sur l’ensemble du territoire : professionnels de la petite enfance, réseaux de périnatalité, centres de protection maternelle et infantile, services de pédopsychiatrie, santé scolaire. Dans cette liste, la pédopsychiatrie française est exsangue avec seulement 500 praticiens actifs dont la moyenne d’âge est de 62 ans, sans parler des inégalités territoriales majeures, et avec une prévision de chute de 27% de ses effectifs à l’horizon 20305,6 alors qu’il faut quinze ans pour former des professionnels opérationnels. Or ce constat s’accompagne de celui de l’accroissement des besoins (demandes en augmentation dans les centres médico-psychologiques de l’enfant et en hospitalisation7, augmentations des tentatives de suicide8 et de l’anorexie en particulier suite à la pandémie de COVID 199,10,11, de l’addiction12,13,14, des troubles somatoformes15,16, des troubles de l’insertion scolaire17…
La médecine scolaire abandonnée depuis des lustres n’est pas en meilleure condition avec en 2021, 900 médecins scolaires pour 12 millions d’élèves, soit un médecin pour 13 000 élèves, bien loin du ratio des 5 000 préconisés18. Sans parler, ici aussi, des inégalités territoriales. C’est ainsi que, alors que les enfants passent une grande partie de leur vie à l’école, il n’y a pas de prévention scolaire en santé mentale, ni en psychiatrie, alors que des campagnes de sensibilisation, la présence de psychologues, ou bien d’autres professionnels, comme les infirmières scolaires actuellement débordées par ces questions, coordonnés par des psychiatres, pourraient développer des réseaux de prévention très efficaces. Ce d’autant plus que la dernière enquête de santé publique France fait état de 13% des 7/11 ans avec un possible trouble probable de santé mentale19.
Les effets de cette absence de prévention s’observent lorsqu’on s’intéresse aux parcours des étudiants, qui n’ont pas plus de dispositifs de soins et de prévention à leur disposition, et qui présentent souvent des difficultés psychologiques anciennes, en lien parfois aussi avec la pression scolaire.
La périnatalité, elle aussi, est en difficulté, malgré la création d’une option tardive dans le cadre de la réforme du troisième cycle dont le référentiel n’est toujours pas publié. Si l’on considère que le fondement est un réseau local à l’échelle d’une maternité, il sera alors plus que compliqué de mettre en place une prévention efficace. D’autant que déjà plus de 40 % des départements20 se situaient en dessous des normes minimales d’encadrement fixées par la loi du 18 décembre 1989 (en sage-femmes, puéricultrices et autres types de personnel soignant territorial) en 2012 et que cela ne s’est pas amélioré.
Concernant l’addictologie, les Centres de Soins en d’Accompagnement Prévention en Addictologie (CSAPA) doivent rechercher des financements spécifiques pour les activités de prévention, tant le « P » de prévention n’est presque jamais budgétisé par les ARS. Déjà en juin 2018, le Quotidien du médecin titrait : « Faute de médecins la prise en charge des addictions est gravement menacée » ; le moins que l’on puisse dire, c’est que cela ne va pas mieux aujourd’hui alors qu’il est impossible d’avoir un recensement du nombre d’addictologues en France , hormis les 850 établissements et services de santé adhérents et plus de 500 professionnels (issus du soin, de l’éducation, de la prévention) inscrits à la Fédération Addictions, pour l’accompagnement et la réduction des risques. Pourtant, les problématiques sont bien connues, que ce soit du côté des produits de plus en plus nocifs qui déferlent sur le marché des toxiques, la méconnaissance des dangers chez les consommateurs (comme celui du protoxyde d’azote ou du fentanyl), et la faiblesse des campagnes de prévention du ministère (prévention (les « info-service » drogues, alcool et tabac, le mois sans tabac, les campagnes alcool et sécurité routière…).
Concernant la protection de l’enfance (Aide Sociale à l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse), les moyens sont aussi très limités. Alors que les mineurs qu’ils accueillent cumulent les risques de produire des troubles psychiatriques, les carences d’encadrement dans l’accompagnement conduisent régulièrement à des impasses qu’on retrouve parfois à la « une » des journaux. Le travail conjoint avec la pédopsychiatrie, du côté de la prévention comme du soin, est mission impossible avec les effectifs actuels.
Ce travail en silos est très préjudiciable pour de nombreux enfants et adolescents, qui, après une succession de difficultés et carences familiales, se retrouvent « mal » pris en charge par les services qui devraient prendre soin d’eux. C’est-à-dire que les institutions n’arrivent pas à leur offrir des facteurs environnementaux suffisamment protecteurs afin qu’ils puissent grandir en évitant une évolution vers une décompensation psychique et/ou la délinquance.
À ce constat doit s’ajouter celui d’un déficit de médecins généralistes et des pédiatres, acteurs eux-aussi incontournables de la prévention dans le cadre de la santé des enfants et des adolescents.
Le CPPRS ne formule dans ses propositions aucune position en matière de réseaux sociaux, dont on a vu le côté délétère lorsqu’ils ont été en colonisés par les « antivax » lors des différentes vagues de Covid, témoignant encore l’inconséquence de l’État dans ses attributions régaliennes et organisationnelles. Cette toxicité s’exprime au quotidien par une désinformations inquiétante au sujet des addictions, des troubles des conduites alimentaires et troubles psychiatriques de l’enfant et de l’adolescent comme l’autisme, les dysphories de genre ou des TDAH, pour les plus visibles. Les soignants de terrain se trouvent de plus en plus en confrontés à des revendications, parfois très agressives, de militants associatifs ou de parents désorientés, fondés sur des autodiagnostics, de troubles existants ou d’autres non médicaux comme le « haut potentiel intellectuel », empêchant paradoxalement, selon nous, l’accès aux soins et à une prise en charge adaptée.
Nous militons pour un retour à une gestion plus décentralisée des besoins en santé et de la politique de prévention comme cela se pratique chez nos voisins scandinaves avec le succès que l’on connait. En effet, leur expérience d’une gestion décentralisée de l’offre de soins au plan régional, d’un financement faisant appel à des prélèvements davantage assis sur le revenu, et enfin d’une politique de prévention et de promotion de la santé plus active faisant appel aux collectivités locales et aux associations d’usagers, pourrait servir d’exemple. Les programmes de prévention mis en œuvre dans les pays scandinaves bénéficient le plus souvent d’un protocole d’évaluation répondant à des critères internationaux, permettant de stopper les actions inutiles et de poursuivre et soutenir les actions qui ont démontré leur efficacité21,22.
Nous militons également pour une formation à deux niveaux. Le premier, devrait inclure la prévention à côté de l’enseignement clinique, pour dispenser une formation sur la pratique de terrain pilotée par des universitaires choisis pour leurs qualités d’enseignant et de soignant et non pas sur leur score de « Sigaps » (Sigaps (points attribués pour les publications référencées Pubmed) et décalés des réalités et des besoins. Le deuxième niveau, devrait se fonder sur une formation basée sur la recherche où les publications, les points et les « Impact factor » trouveraient leur légitimité. A côté des problèmes de moyens, le désinvestissement de l’expérience clinique au profit de la recherche théorique, aboutissent à la déliquescence observée du système de santé du fait de l’éloignement entre besoins et recherches non-cliniques. Le manque d’universitaires en pédopsychiatrie comparée aux autres spécialités, cinq fois moins que la cardiologie23, pourrait être l’occasion de cette réorganisation. En effet, alors que le système actuel devrait articuler les deux niveaux autours d’enseignants chercheurs, la promotion du chercheur fondée sur les logiques de points pour les publications, l’éloigne du soin qu’il délaisse dans son enseignement. Cette double logique creuse le fossé entre les praticiens du quotidien, non seulement confrontés à la réalité du terrain clinique, des usagers, de la collaboration entre professionnels de santé, des carences de moyens, des malades mais aussi des manageurs gouvernant les équipes à partir d’hypothèses théoriques et financières, des chiffres décorrélées des difficultés réelles, une distance pas toujours accompagnée de bienveillance. Les recommandations de la haute autorité de santé sont à l’image de cette dérive préférant contrôler la pratique et les praticiens, que prévenir les troubles : agir sur les déterminants sociaux et familiaux, ainsi que promouvoir l’étayage psychologique des élèves. La logique de la compétition généralisée portée par le classement « parcoursup », possède des affinités électives avec l’idée de qualités individuelles décontextualisées des relations affectives et du contexte social, qui rendrait l’individu ou sa neurobiologie seul responsable de son destin.
Nous militons aussi pour la création de réseaux de soins et de prévention transversaux, avec des coordinateurs choisis par la profession, dont le but serait d’animer les complémentarités et proposer des campagnes de prévention locales en fonction des besoins. Nous souhaitons que l’Éducation nationale collabore avec la pédopsychiatrie, puisqu’elle accueille non seulement tous les enfants et les adolescents, mais aussi, sans compétence suffisante, des jeunes souffrant de troubles handicapants. Promouvoir « la bienveillance » comme cela se fait depuis la circulaire de l’éducation nationale de 201424, ne devrait pas être un vain mot, mais un véritablement programme d’amélioration du dialogue entre les élèves et les enseignants, et de façon plus générale de meilleure considération de la santé mentale des élèves.
Nous militons enfin pour une prévention qui ne soit pas en « one-shot » par campagne mais en continu, prévention où l’on ne ferait pas l’économie d’infirmières en pratique avancée, de psychologues et d’éducateurs spécialisés formés pour un travail en continu, ou encore celle des médecins en cumul emploi-retraite qui pourraient être d’un utile secours à la communauté.
Il faut en effet restructurer comme le démontre fort bien la note du CPPRS, « LA PSYCHIATRIE PUBLIQUE » mais pas que, car il est nécessaire d’évoluer vers une réelle coopération entre établissements privés/ESPIC/public aussi bien dans le cadre de l’hospitalisation que des consultations et soins de suite. Cela passe aussi par une réforme des remboursements sécurité sociale (alléger la convention avec les psychologues et permettre plus de séances prises en charge, et l’étendre aux psychomotriciens libéraux, ergothérapeutes libéraux, éducateurs libéraux)25, afin de l’adapter aux réalités d’aujourd’hui, par une politique volontariste de lutte contre les déserts médicaux, si besoin avec de réelles incitations financières et le soutient d’une pratique collective et collégiale, en réseau, autour de l’organisation de secteur. Enfin, la question des relations avec les maisons départementales du handicap est un enjeu décisif souffrant de retards problématiques.
La dégradation de l’offre de soins en pédopsychiatrie, confrontée à l’accroissement des besoins, implique de s’engager dans une véritable politique de prévention en continuité avec la pratique pédopsychiatrique. Cette politique de santé mentale doit articuler un principe de recherche avec celui de réseau. De recherche, car il faut parfaire la connaissance des indicateurs avec les facteurs de risques, d’une part, et évaluer les effets de la prévention sur ces indicateurs, d’autre part. Le réseau, car il y a de nombreux intervenants auprès des enfants et adolescents, des parents et des institutions chargé de l’accueil de mineurs. Une politique de prévention doit développer une coordination entre ces différents partenaires, non pas uniquement en vue d’une meilleure orientation, mais aussi pour commencer un soin au plus près du début des troubles, avec les moyens déjà existant, en régulant les réponses, et en précisant les manques dans le parcours de prise en charge, pour l’attribution de moyens supplémentaires. Toutefois, prévenir implique aussi de former, informer et travailler sur les facteurs de risques psycho-sociaux, à l’origine des maladies mentales. Pour cela, il serait nécessaire de créer des pôles universitaires de prévention, administrés par des pédopsychiatres universitaires, ayant autorité pour planifier, organiser et coordonner les efforts, sur des territoires définis.
Nous souhaitons par la promotion de la prévention, donner la possibilité d’agir sur l’environnement social et scolaire. Pour cela il serait nécessaire, face à l’urgence, de mettre sur pied un conseil scientifique, à l’image de ce qui s’est fait pour l’épidémie de covid, pour orienter les politiques du Gouvernement.
En réponse à la note du CPPRS, nous proposons donc une recommandation spécifique à la pédopsychiatrie : la création de pôles de prévention universitaires intersectoriels, en charge de coordonner des structures de soins, d’accueil et d’encadrement des mineurs, avec des moyens pour développer des politiques de prévention non seulement secondaire et tertiaire, c’est-à-dire d’accès au soin et de réadaptation, mais aussi de prévention primaire sur les facteurs de risque de déclenchement des troubles et de rechute.