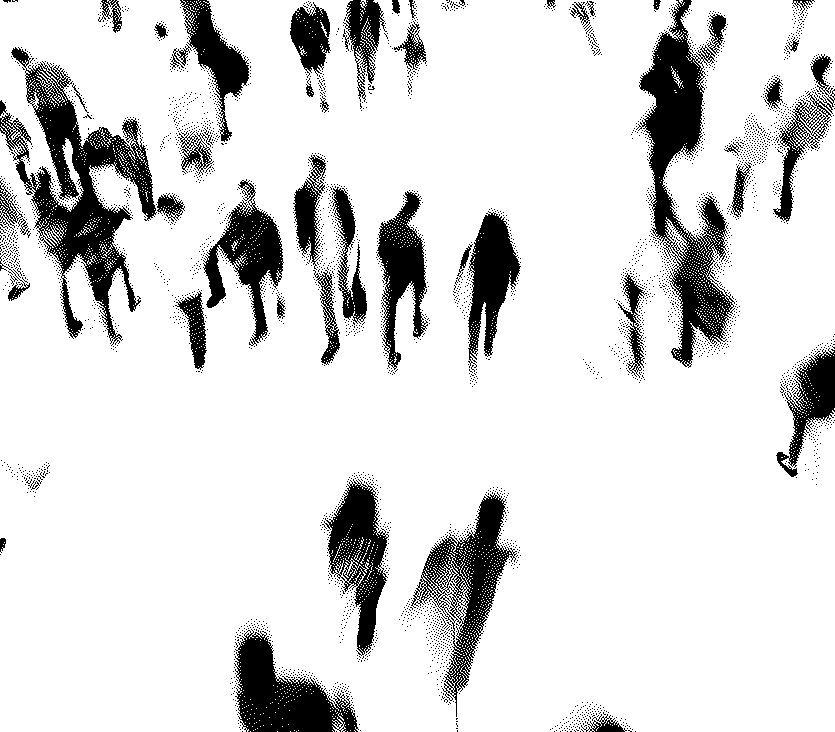Propos recueillis par Thierry Pech
La Grande Conversation – Quel bilan faites-vous de ces bientôt deux années de pandémie et notamment de l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail ?
LAURENT BERGER – L’ampleur des conséquences sur le marché du travail aurait pu être nettement plus importante. Du fait des dépenses publiques massives en faveur de l’emploi, des aides aux entreprises, aux salariés, aux demandeurs d’emploi pendant la crise, on est pour le moment dans une situation bien meilleure que ce qui avait été anticipé il y a 18 mois. Je rappelle que 40 milliards ont été dépensés pour financer l’activité partielle et que 9 millions de salariés en ont bénéficié. Ce qui a permis de ne pas licencier massivement, contrairement à ce qui s’était passé en 2008–2009 lors de la crise financière, de maintenir les salariés dans l’emploi, de protéger leurs compétences et de rebondir beaucoup plus rapidement ensuite.
La crise sanitaire a aussi été une période d’innovation. Grâce au dialogue, aux concertations et aux propositions des uns et des autres, dont la CFDT, on a élargi l’activité partielle à des publics comme les assistantes maternelles ou les saisonniers. L’Etat et les organisations syndicales et patronales se sont réunis en juillet 2020 et on a créé l’activité partielle de longue durée (APLD). Il y a eu des milliers d’accords dans les entreprises pour sauvegarder l’emploi, ainsi que des aides massives à l’embauche des jeunes, notamment en apprentissage : parce qu’on avait fait évoluer l’apprentissage, on a atteint un nombre d’apprentis plus important que jamais. En somme, la politique de soutien à l’économie, aux entreprises et aux travailleurs a été efficace et a permis le rebond rapide que nous connaissons actuellement, en dépit du fait que la pandémie n’est pas terminée.
Mais, dans le même temps, certains travailleurs ont subi la crise de plein fouet. En particulier ceux qui étaient en CDD et en intérim et qui n’ont pas bénéficié de l’activité partielle. Non qu’ils en aient été écartés, mais cette réflexion n’a pas eu lieu sur le terrain. Du fait du premier confinement, certains ont peiné à retrouver rapidement un emploi et d’autres sont allés grossir ce qu’on appelle le « halo du chômage », c’est-à-dire une situation d’entre deux : « je cherche du travail, mais je ne suis pas forcément disponible », « je suis disponible, mais je n’ai pas fait d’actes de recherche d’emploi », etc.
Cette fragilité des salariés en CDD ou en interim a particulièrement frappé les jeunes. L’Insee a montré que la crise sanitaire avait mis un coup de frein à l’insertion des jeunes, avec des disparités importantes au sein de la jeunesse. On a dû réfléchir à une nouvelle façon d’aider ces jeunes. C’est pourquoi on s’est beaucoup battu à la CFDT pour une garantie jeunes universelle. Le contrat d’engagement est une première étape dans cette direction.
En outre, certains secteurs ont payé plus cher que d’autres. On a vécu des transferts d’activité importants entre certains secteurs, je pense notamment à la branche Hôtellerie, cafés, restauration où les réorientations professionnelles ont été nombreuses.
Enfin, cette crise a eu un impact sur les chômeurs de longue durée. Ceux qui étaient déjà au chômage depuis un certain temps et qui, du fait des circonstances, ont eu encore plus de mal à trouver du travail à partir de mars 2020. Si vous étiez au chômage depuis un an en mars 2020, cela vous faisait souvent deux ans en mars 2021. Du coup, des chômeurs de longue durée se sont transformés en chômeurs de très longue durée, et des chômeurs qui n’étaient pas hors de l’emploi depuis très longtemps se sont transformés en chômeurs de longue durée. On a là un enjeu très fort à présent. Il faut relancer des dispositifs d’accompagnement très serrés pour les aider à reprendre pied.
LGC – La pandémie a aussi poussé beaucoup de salariés à réfléchir à leur rapport au travail. A la faveur des difficultés de recrutement dans plusieurs secteurs, est-ce qu’ils ne sont pas tentés de se dire que leur travail pourrait changer, voire qu’ils pourraient changer de travail ? Est-ce que vous observez des mouvements de ce type ?
LAURENT BERGER – Oui, mais c’est difficile d’en tirer une leçon générale car on est encore en phase d’observation et on n’est pas revenu à une situation vraiment normale. Ce qui est sûr, c’est qu’on avait déjà des mouvements de ce type du fait de la numérisation et du déplacement de la frontière entre monde professionnel et vie personnelle, plus poreuse que par le passé. On voyait déjà des jeunes (plutôt des jeunes diplômés, en réalité) qui disaient : « Pour nous, le travail, il faut qu’il ait un sens ». Ils cherchaient déjà des entreprises plus engagées sur un certain nombre de défis éthiques, climatiques, etc.
Mais le constat qui se profile aujourd’hui, sans qu’on soit encore capable de l’objectiver statistiquement, c’est que la vie au travail est bouleversée. On pense bien sûr à l’extension du télétravail. Mais il faut rappeler qu’il n’y a que 30% des travailleurs qui peuvent pleinement télétravailler. La crise a aussi fait ressurgir la situation des 70% qui ne peuvent pas et, parmi eux, ceux qu’on a qualifiés de « seconde » ou de « première ligne ». Ceux-là se sont manifestés en disant : « Nous aussi, on est là ! Et, comme vous réalisez mieux notre importance à présent, il va falloir nous écouter un peu. Et si vous ne nous écoutez pas, vous allez devoir faire sans nous ».
En outre, parmi ceux qui ont télétravaillé, beaucoup l’ont fait sous une forme de contrainte, que ce soit lors du premier confinement ou du fait des exigences sanitaires ultérieures. Face à cette contrainte, certains ont dit : « C’est super. Je peux travailler chez moi, je gagne du temps, je suis équipé, j’ai les moyens de faire mon travail correctement ». Et quand cela avait été bien négocié dans l’entreprise, ils avaient des cordes de rappel pour faire évoluer leur situation en cas de difficultés. Mais il y a aussi ceux qui ont dit : « Moi, je n’en peux plus ».
Il faut tenir compte des salariés plus fragiles psychologiquement, de ceux qui ont besoin du lien social du travail, de ceux qui ont des enfants sur les genoux toute la journée, de ceux qu’on vient de recruter et qui se trouvent un peu livrés à eux-mêmes, etc. Au total, ça fait pas mal de monde depuis deux ans. C’est pourquoi il va falloir à nouveau négocier sur le télétravail. Il faut aller vers le volontariat et organiser la réversibilité des situations. On peut vouloir télétravailler davantage à un moment de sa vie et rencontrer des difficultés à un autre moment.
Et puis, collectivement, le télétravail a aussi bouleversé les relations de travail. On ne travaille pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. On se frotte, on discute, on se confronte et ça produit de la compétence collective. J’apprends de toi, tu apprends de moi, on a des moments informels où l’on échange, etc. Le télétravail a un peu asséché tout ça. Du point de vue de la compétence collective, il y a un risque sur le long terme de perte de créativité et d’innovation. A quoi s’ajoute un risque de perte de cohésion, parce que, quand on est en visio devant tout le monde, on oublie de demander si le petit est toujours malade ou de prendre des nouvelles des vieux parents. Or, c’est tout cela qui crée du lien social, de l’empathie, qui motive pour se donner un peu plus quand il le faut et se lever tôt le matin en étant content de retrouver ses collègues, de partager une galette des rois pendant un quart d’heure et de réaliser la tâche qui nous est assignée. Tout cela crée un risque pour les entreprises d’assèchement, de moindre créativité, de difficultés d’intégration des nouveaux arrivants.
C’est pourquoi je crois qu’un des sujets majeurs demain, c’est le sens et le devenir du travail, et pas à la façon dont il a été traité ces dernières années. Ce n’est pas qu’une question d’horaire de fin, de durée légale, de réglementation, etc. C’est une question de qualité de vie au travail, de qualité du travail et de capacité d’expression des salariés sur leur travail.
LGC – Les crises de recrutement dans plusieurs secteurs placent les salariés dans une position plus favorable dans les négociations avec les employeurs. De plus, la pandémie a souligné la grande utilité sociale de certains qui n’ont pourtant pas toujours vu leur rémunération évoluer en conséquence. Enfin, on constate une pression croissante de l’inflation sur les prix de l’énergie et les produits alimentaires. Ce contexte justifie-t-il des revendications salariales plus offensives ?
LAURENT BERGER – Tous ces phénomènes jouent en effet sur la politique salariale actuelle. Les salariés ressentent manifestement l’inflation sur les prix de l’énergie. Mais on n’est pas encore dans ce qu’on appelle la spirale inflationniste, c’est à dire une boucle prix/salaires. En réalité, la conjoncture présente ravive des revendications et des problèmes structurels plus anciens d’inégalités salariales. Car les salariés ne sont pas tous égaux devant les épreuves actuelles. On le constate d’autant mieux que la CFDT devient de plus en plus une organisation de salariés plutôt modestes. Autrefois, nos plus gros syndicats venaient des fédérations Chimie-Énergie, Métallurgie, etc. Aujourd’hui, ce sont la Propreté Ile-de-France, la Sécurité Ile-de-France, les Services Bouches-du-Rhône, etc. C’est dans ces secteurs qu’on trouve les 2 millions de personnes pauvres qui occupent un emploi, c’est-à-dire ceux qui ne vivent pas dignement de leur travail.
Cela ne date pas de la crise sanitaire. Cette crise a surtout permis de faire émerger les problématiques des travailleurs dits « de seconde ligne ». On voit se former aujourd’hui des mobilisations autour de questions salariales qui sont en réalité assez anciennes. C’est le cas chez les salariés des particuliers employeurs, dans l’agroalimentaire, dans la propreté, dans la distribution… Des secteurs où on n’avait pas vécu un débrayage depuis 20 ans ! Ces travailleurs réalisent que c’est le moment de demander une revalorisation salariale de façon structurelle.
Mais il y a une forme de paresse de la part de beaucoup d’acteurs politiques qui pensent que la question peut se résumer au niveau du SMIC. Dans l’industrie agro-alimentaire, si on prend les métiers de la volaille, il y a douze coefficients à franchir avant de pouvoir espérer dépasser le SMIC. Ce qui signifie que, même en faisant bien votre boulot, en franchissant un échelon tous les 12 ou 18 mois, vous pouvez rester 15 ou 20 ans au SMIC… Je crois que les salariés de ces secteurs-là ont compris que c’était ça le premier problème. Et puis ils ont aussi compris aussi que dans certains secteurs, il n’y avait plus assez de salariés et que leur pouvoir de négociation en était accru. De fait, un cycle de négociations salariales s’est ouvert et il produit des résultats. Si on m’avait dit il y a deux ans qu’on obtiendrait 16% d’augmentation dans le secteur Hôtels, cafés, restaurants, je n’y aurais pas cru. On vient de signer un accord très intéressant chez Sodexo dans la restauration collective, un secteur qui a pourtant beaucoup souffert pendant la pandémie. Ce qui nous importe aujourd’hui, c’est d’abord de faire accepter qu’il y a un véritable problème structurel de reconnaissance du travail pour un grand nombre de salariés modestes.
Je me bats contre l’idée que la question salariale se résumerait à un sujet inflation/revalorisation. La vérité est que cette approche ne permet pas de tenir compte de ces inégalités structurelles. Lorsque vous êtes dans une entreprise donneuse d’ordre dans un secteur qui va plutôt bien, les négociations annuelles obligatoires débouchent souvent sur des revalorisations. Mais dans un grand nombre de branches professionnelles, la majeure partie des salariés ne sont pas dans cette situation. Et là, il y a un réveil. D’autant plus vigoureux qu’on a expliqué aux gens, pendant la crise sanitaire, qu’ils étaient beaucoup plus utiles qu’on ne l’avait imaginé.
A quoi s’ajoutent des écarts de rémunération entre les 10% les mieux rémunérés et les 10% les moins bien rémunérés, des écarts qui peuvent aller de 1 à 15 et qui tendent à s’aggraver entre catégories socioprofessionnelles et avec l’âge. Dans ces conditions, quand vous êtes au SMIC depuis 18 ans, parce que, dans votre branche professionnelle, vous devez franchir 12 échelons avant de pouvoir espérer dépasser le SMIC, et que votre voisin voit son salaire augmenter parce qu’il est dans une entreprise qui fonctionne plutôt bien, vous le vivez mal.
J’ai passé beaucoup de temps avec ces travailleurs ces dernières années et c’est de ça dont ils parlent, de la reconnaissance de leur travail. Je crois que cette période nous invite à réfléchir vraiment autrement à la question salariale dans notre pays, à la question du juste partage de la valeur ajoutée tout au long de la vie et des chaînes de valeur.
Vous avez parfois sur un même site industriel des salariés qui vivent des trajectoires totalement opposées. C’est le cas dans certaines grandes entreprises où les négociations annuelles obligatoires apportent de bonnes revalorisations aux salariés de l’entreprise principale, mais pas aux travailleurs qui, sur ces mêmes sites, s’occupent du nettoyage, de la sécurité, de la restauration collective, etc., parce que ces fonctions ont été externalisées. Voilà le sujet principal : ceux qui s’occupent du nettoyage, de la sécurité ou de la restauration collective contribuent, eux aussi, à la production du bien final. Ils y ont aussi leur part. Cela pourrait prendre la forme de participations ou d’intéressement, mais il faut trouver une solution.
En outre, il y a des secteurs qui ont beaucoup gagné pendant cette période et qui ne jouent pas le jeu. Auchan a distribué des centaines de millions d’euros de dividendes en août dernier et n’est pas capable de porter une proposition salariale qui serait juste de nature à couvrir l’inflation. Ce genre de comportement ne passe plus.
Par ailleurs, il vaut mieux s’occuper de réajuster aujourd’hui les salaires en fonction du partage de la valeur car les conditions risquent de se durcir à l’avenir. D’une certaine manière, l’inflation que l’on connaît aujourd’hui n’est que le prélude à l’inflation que génèrera la transition climatique quand le prix des matières premières, des denrées alimentaires, de l’énergie augmenteront sous l’effet des contraintes qu’on va se fixer collectivement et à juste titre. Cette inflation-là aura de forts impacts notamment sur les travailleurs les plus les plus modestes à travers les coûts du logement, des transports, etc. Si l’on veut être prêts à accompagner ces changements-là, il vaut mieux mettre de l’ordre et de la justice dans la politique salariale sans attendre.
Dans ces conditions, quand les politiques proposent une simple évolution du SMIC, ils ne sont pas à la hauteur du problème. Je suis président de la Confédération européenne des syndicats. On se bat pour un SMIC européen qui soit a minima à 60% du salaire médian dans chaque pays. En France, il est à 62% du salaire médian. Je ne dis pas que c’est suffisant. J’ai vécu avec un SMIC, je sais ce que c’est : c’est difficile. Ce que je vous dis, c’est que si on pense qu’on aura fait le boulot quand on aura parlé du niveau du SMIC, on se trompe.
LGC – Vous avez cité beaucoup de secteurs peu exposés à la concurrence internationale. Mais il y a des secteurs qui y sont fortement exposés et où l’augmentation des salaires peut engendrer un problème de compétitivité…
LAURENT BERGER – Mon point de départ est qu’il est normal de pouvoir vivre correctement de son travail. C’est pour ça qu’il y a un salaire minimum et des minimums de branche. Je pense qu’il faut commencer par faire un nettoyage de ces grilles qui commencent en-dessous du SMIC et qui condamnent les salariés à rester scotchés au SMIC pendant des années et des années. Et cela vaut aussi pour les fonctions publiques : parmi les gens qui, pendant le mouvement des gilets jaunes, ont occupé les ronds-points, il y avait beaucoup d’agents de catégorie C.
Le SMIC ne devrait être qu’un salaire de démarrage pour des salariés peu ou pas qualifiés. Trop souvent, il devient un salaire pérenne. C’est cela qui ne va pas. Quand vous avez pris un peu de responsabilité et gagné de nouvelles compétences dans votre travail, cette situation génère un légitime ressentiment.
C’est pourquoi je pense qu’il y a une responsabilité des branches professionnelles. D’ailleurs, plusieurs ministres l’ont dit récemment. Mais il ne sert à rien, quand on gouverne, d’être le ministère de la parole, il faut se donner les moyens de faire. Il faut réfléchir à la façon dont on contraint les branches.
Une fois qu’on aura fait ces ajustements structurels, on pourra passer à la question du juste partage de la valeur ajoutée créée. Mais ne nous racontons pas d’histoires : il n’y a pas de revendications salariales dans une entreprise qui est en train de décliner et de perdre de l’argent face à ses concurrents étrangers. Je ne vois pas ça. Les salariés et les représentants du personnel ne sont pas fous. Mais dans nombre d’entreprises, on crée de la richesse et elle doit être équitablement répartie. Quand on réfléchit à la répartition de cette richesse tout au long de la chaine de valeur, on butte rapidement sur la situation des entreprises sous-traitantes où cette répartition est bloquée. Nous avons plaidé pour une vraie réflexion sur ce sujet. Nous avons fait un travail préalable dans une délibération économique avec le patronat avec une attention particulière aux plus basses rémunérations, avec de l’intéressement et de la participation pour tous. Nous avons également demandé un dialogue social loyal sur les pratiques d’optimisation fiscale qui sont abusives. Aujourd’hui, quand on regarde ce qui se passe dans nombre d’entreprises, il n’y a pas de fraude fiscale. Mais l’optimisation fiscale, en revanche, se porte bien. Et elle ne prive pas seulement la puissance publique de ressources, elle conduit aussi à réduire les marges de la répartition de la valeur pour les salariés quand cette valeur a été exportée ailleurs de façon artificielle. Je discute suffisamment avec mes camarades néerlandais à la Confédération européenne des syndicats pour savoir comment ça se passe.
LGC – Ce quinquennat vu pas mal de réformes en matière de formation professionnelle. Quel bilan faites-vous de ce qui a été réalisé jusqu’ici et de ce qui doit l’être dans les années qui viennent ?
LAURENT BERGER – Il y a un vrai succès, c’est l’apprentissage. Il faut qu’on s’en réjouisse : 500 000 jeunes entrent désormais chaque année comme apprentis et se mettent ainsi sur une voie d’insertion professionnelle. Ensuite, il y a une volonté d’appréhender la formation plus simplement, avec beaucoup plus de facilités d’accès, notamment grâce au compte personnel de formation. Malheureusement, l’application en ligne du CPF reste dans une logique très individuelle : les gens font leur marché et ça ne correspond pas toujours à ce qui serait nécessaire ou souhaitable à la fois pour l’élévation de leurs compétences et pour les besoins de l’économie. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire évoluer. Mais nous avons beaucoup progressé sur ce sujet, il faut le dire.
En dépit de ces progrès, le réflexe formation n’est pas encore assez présent. On l’a vu pendant la crise sanitaire. Alors qu’on négociait des accords chômage partiel longue durée, c’était le bon moment pour former des salariés. On l’a vu également avec les demandeurs d’emploi pour qui une formation en adéquation avec les besoins de l’économie est, on le sait, stratégique.
Car quand on parle de difficultés de recrutement, il y a bien sûr une partie du problème qui concerne l’attractivité de certains métiers : des salaires trop bas, des conditions de travail trop pénibles, etc. Mais une bonne partie du problème tient aussi au fait que les compétences sont insuffisamment disponibles sur le marché du travail. Donc, la formation, c’est un outil décisif. Et pas seulement du point de vue strictement économique et matériel. Aussi du point de vue de la reconnaissance et de l’estime de soi. J’ai en tête une entreprise où l’équipe syndicale s’est beaucoup attachée à la formation des salariés. Aujourd’hui, quand ils en parlent, ils parlent de fierté, de reconnaissance, d’estime de soi, etc.
La formation, c’est aussi une façon de maîtriser son travail, d’avoir les moyens de le faire bien. On a analysé qu’une des premières causes de souffrance au travail, c’est quand on n’a pas les moyens de faire correctement son travail parce qu’on n’est pas suffisamment qualifié. La formation professionnelle, c’est donc aussi un outil d’émancipation, de gestion de son propre parcours.
Bien sûr, il faut que ça serve aussi à l’emploi. Et sur ce sujet, il faut articuler deux stratégies. D’abord, l’observation des besoins et la régulation des certifications professionnelles des formations. Nous travaillons sur ce sujet depuis plusieurs mois. Ce qui a conduit à l’accord du 15 octobre 2021 avec le patronat. L’idée est de se mettre davantage en situation d’analyser les besoins et d’y répondre par la formation. On manque souvent d’agilité parce qu’on a une vision trop nationale des problèmes. Les salariés de la branche Route me parlent du besoin de chauffeurs dans notre pays. Mais tant qu’on ne dit pas où exactement, on n’avance pas. Ca ne sert à rien de former des chauffeurs à Charleville-Mézières si on en a besoin à Montpellier !
Il faut se demander quelles sont les compétences utiles aujourd’hui sur le marché du travail et sur quels territoires, et ensuite former aux métiers à fortes perspectives d’emploi. Il n’y a pas d’états d’âme à avoir. La condition, bien sûr, est que ces métiers soient correctement revalorisés et qu’on ait un bon dialogue économique et social territorial.
Dernier point : les chômeurs. Il faut insérer, il faut former pour insérer et c’est la logique de l’alternance. Mais c’est aussi la logique d’autres dispositifs comme la préparation opérationnelle à l’emploi, qu’il faut activer beaucoup plus. Ici, on a moins un problème d’outillage que de mobilisation.
LGC – Certains salariés considèrent encore que la formation ne sert pas à grand-chose. Cette idée a beaucoup reculé mais il reste peut-être 10 à 15% des gens qui demeurent très critiques. Ils disent en substance « C’est bien beau tout ça, la formation, retourner à l’école, etc., mais au fond, je ne suis pas sûr du bénéfice. Et moi, je veux de la protection, des bons emplois tout de suite, comme autrefois ». Qu’est-ce qu’on répond à cette réticence à la formation professionnelle des publics qui sont parfois ceux qui en ont le plus besoin ?
LAURENT BERGER – D’abord, vous avez raison de dire que l’appétence à la formation a progressé dans le monde du travail et que c’est une bonne nouvelle. Mais il reste tous ces travailleurs et demandeurs d’emploi qui pensent que ça ne leur apportera rien. La réponse, c’est l’assurance que ça débouchera sur une entrée en emploi. Et là, les patrons ont une responsabilité. On les entend souvent dire : « il nous manque tant de postes à tel endroit ». Soyons conséquents : quand on envoie des gens en formation, il faut qu’ils puissent être sûrs d’avoir ces postes. Autrement, ça ne marche plus.
Mais l’accompagnement aussi est fondamental. C’est dans cet esprit qu’on a créé le conseil en évolution professionnelle : pour créer un réseau au profit de ceux qui n’en ont pas et les aider à s’orienter. En gros, c’est de l’anti brouillard et du GPS. Car ceux qui sont dans le brouillard ne savent pas toujours ce qu’ils veulent faire ni même ce qu’ils peuvent faire. Il faut commencer par identifier leurs compétences parce qu’ils en ont, même s’ils n’en ont pas conscience. Ensuite, on leur fait des propositions et on leur explique où ça peut les conduire.
Le syndicalisme a un rôle à jouer dans cette affaire. Je plaide par exemple pour que les militants de la CFDT qui ont des compétences dans ce domaine se mobilisent autour de cet objectif et se mettent au service des salariés. Car, si on ne commence pas par un accompagnement et une mise en confiance, on n’y arrive pas. Quand vous en avez bavé à l’école et quand, en plus, vous avez fait une expérience de formation professionnelle qui n’a pas été très gratifiante, la question de la confiance est fondamentale. Lors de notre prochain congrès, nous mettrons l’accent sur cette orientation pour que la CFDT puisse fournir ce service aux travailleurs.
LGC – C’est une orientation nouvelle pour une organisation syndicale…
LAURENT BERGER – Le syndicalisme porte des revendications, propose et négocie. Il s’engage. Mais il faut qu’il soit aussi de plus en plus au service des travailleurs. Le service des travailleurs, ce n’est pas de leur offrir des tickets de cinéma moins chers, etc. Il y a plein d’opérateurs qui le font. Je crois que c’est sur leur parcours professionnel qu’on est attendus. Des représentants du personnel comme des militants territoriaux peuvent très bien aider à accompagner. On a fait ça pour le tutorat à l’égard des jeunes, ça fonctionne plutôt bien. On peut le faire aussi bien pour des travailleurs.