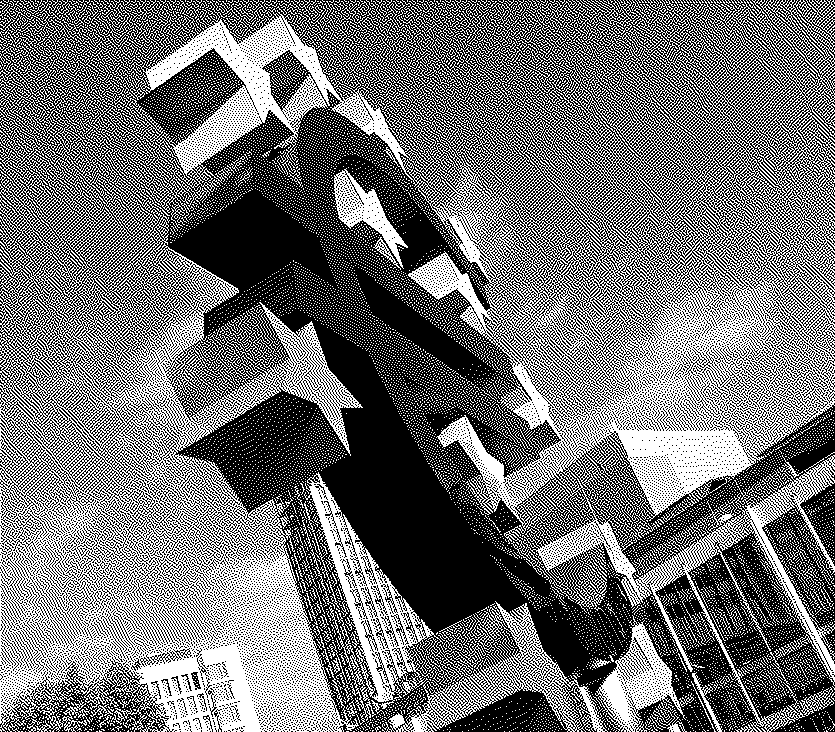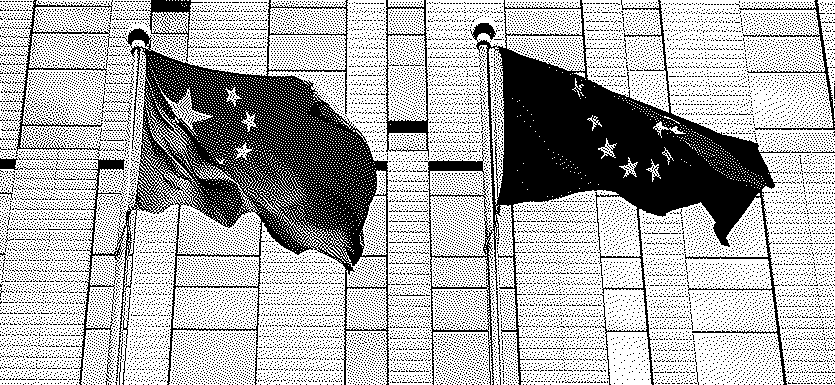D’abord, qu’est-ce qu’un actif sûr ? Il s’agit d’un actif dont les paiements sont quasi certains, sur la durée et quelles que soient les circonstances. La liste en est étroite : les emprunts d’État quand l’État est solvable, les réserves de la banque centrale auxquelles seules les banques commerciales ont accès, les dépôts bancaires et éventuellement les tranches basses des schémas de titrisation à la condition que les deux soient bien sécurisés. Mais il faut aussi de la liquidité et des coûts de transaction faibles, ce qui disqualifie la titrisation1 et demande pour les autres actifs une certaine masse critique.
L’or, souvent désigné comme valeur refuge, n’est pas un actif sûr car son prix varie fortement. Il y a toutefois avec l’or une coordination par laquelle, en situation d’inquiétude, chacun anticipe, souvent à raison, que les autres iront s’y réfugier. Car la sûreté d’un actif sûr vient aussi du fait qu’il est perçu comme sûr par tout le monde. Il se nourrit de confiance et en produit tout à la fois.
Au niveau international, les États-Unis sont les mieux placés pour fournir des actifs sûrs au travers des obligations et bons du Trésor. Ils remplissent les bonnes conditions : le pays se finance dans sa propre monnaie ; ses institutions et notamment son droit commercial sont solides ; le dollar est de loin la monnaie de paiement la plus répandue ; son inflation a été en général sous contrôle, malgré l’épisode post-Covid vécu récemment. Et, d’une façon que l’actualité nous rappelle, le pays jouit d’une force militaire sans égale.
Un actif sûr est donc activement recherché comme réserve de valeur à l’abri des aléas, comme étalon de valorisation et comme matière première pour fournir des collatéraux dans toute opération financière ou commerciale. On répugne à prendre des risques si on n’a pas, en repli, la possibilité de ne pas en prendre. Fondamentalement, le pays à la recherche d’actifs sûrs « achète » aux États-Unis un service d’assurance et de liquidité dont il tire profit.
Être le très grand producteur d’actifs sûrs au niveau mondial est un avantage énorme pour les États-Unis. On parle de « privilège exorbitant ». La demande structurelle pour ses titres de dette réduit le coût de financement du Trésor et, par cascade, celui de l’ensemble de l’économie. Kenneth Rogoff, dans son dernier livre, estime entre 0,5 et 1% du PIB un tel avantage, ce qui va jusqu’à un tiers du déficit courant des États-Unis. Et ce chiffre ne prend en compte ni l’avantage géopolitique que confère aux États-Unis cette position de plaque tournante de la finance internationale ni la faculté de financer à peu de frais ses politiques contracycliques lors de crises internationales, puisque l’argent qui afflue fait spontanément baisser les taux d’intérêt de tout le pays.
Au total, ce service d’assurance et de liquidité est très bien rémunéré, même s’il se loge dans les replis du compte financier de la balance des paiements plutôt que dans sa balance commerciale. Le reste du monde n’est pas le resquilleur en matière de sécurité financière (et militaire) que décrit Trump. D’où la surprise à voir la légèreté dont ce dernier fait preuve dans la gestion de cet actif majeur. Mais certains jugent que la perte de crédibilité allait de toute façon s’accroître avec le temps sachant la dérive continue des comptes publics étatsuniens. Car la facilité à dépenser est un autre trait, moins positif, de l’avantage exorbitant.
De quels atouts dispose la zone euro ?
L’UE partage avec les États-Unis quelques traits qui pourrait en faire une vraie productrice d’actifs sûrs à l’échelle internationale : taille de l’économie, stabilité politique, solidité de son droit ainsi qu’une politique cohérente et soutenue de la BCE, sa banque centrale. Mais l’euro est loin encore de cocher toutes les cases.
D’abord, il n’est que faiblement une monnaie de transaction pour le commerce international, en partie, il faut le noter, parce que la zone montre un excédent commercial structurel : elle est donc plutôt acheteuse de devises, qui sont spontanément celles du pays auquel elle achète, que vendeuse d’euros. Le privilège exorbitant s’accompagne en effet le plus souvent d’un déficit commercial, comme on le sait maintenant par les récriminations de Trump, sans nier qu’ici cause et effet s’entremêlent.
Déloger le dollar comme monnaie des échanges commerciaux est difficile en raison de l’importance de l’effet de réseau s’agissant des monnaies. Quand le Lesotho veut commercer avec l’Uruguay, le plus commode est de passer par des transactions croisées avec le dollar. À tel point même que certains pays utilisent le dollar comme monnaie acceptée pour les transactions intérieures. Une image commode du phénomène est pour toute entreprise française la bascule à l’anglais dans toute réunion dès qu’un locuteur non francophone entre dans la salle.
De plus, l’Europe, en tant qu’institution, fabrique très peu de dette publique fongible et liquide, malgré des déficits publics parfois très élevés chez les pays membres. On ne compte en fait que 1.000 Mds€ environ de dettes émises par les institutions européennes au sens large : 689 Mds€ pour l’UE, 210 Mds€ pour le fonds de stabilisation européen, 78 Mds€ pour le mécanisme de stabilisation bancaire, auxquels on peut rajouter 218 Mds€ d’endettement de la BEI (voir Benassy-Quéré, 2025). Il faudrait pour le moins consolider ces encours pour en faire un gisement attractif, mais qui resterait, en tout état de cause, trente-six fois moins important que la dette publique étatsunienne.
Les dettes des États membres sont des substituts imparfaits. En particulier, l’État membre n’est pas endetté dans sa propre monnaie, mais dans la monnaie de l’Union, régi par une banque centrale qu’il ne contrôle pas (voir le cas de la Grèce en 2011). L’Allemagne fournit le meilleur papier mais, jusqu’à l’arrivée de M. Merz et son plan de dépenses à hauteur d’un trillion d’euros, lutte à réduire son endettement public, ce qui, ajouté aux rachats par la BCE, assèche le marché du Bund (emprunt d’Etat à long terme) allemand. Les acteurs se replient sur des papiers de moindre qualité, dont la dette française qui acquiert du coup l’avantage, si l’on peut dire, d’être abondante et très liquide – et donc d’offrir par substitution un (petit) privilège exorbitant, indice comme aux États-Unis d’une facilité à la dette et à la dérive budgétaire.
Une période incertaine s’ouvre
Le moindre standing financier des États-Unis pousse en théorie les chances de l’euro ou d’autres monnaies comme actif de paiement et de réserve, dans la logique du privilège exorbitant. Mais on vient de voir qu’on ne peut guère aujourd’hui s’attendre à un mouvement important s’agissant de l’euro. C’est le cas plus encore, pour d’autres raisons, de la Chine et de sa monnaie, le renminbi.
Ce n’est pas une bonne configuration. On aurait d’un côté une puissance dominante mais moins capable – ou moins désireuse – de fournir au reste du monde ce bien public que sont les actifs en dollars. Stephen Miran, un économiste dont on dit qu’il influence fortement Trump, recommande par exemple de limiter le refinancement par la FED, banque centrale des États-Unis, des banques centrales étrangères demandeuses de dollars, ce qui veut dire freiner fortement son rôle de « prêteur en dernier ressort », un élément clé de la stabilité financière. Et de l’autre côté, des blocs économiques qui n’ont pas les moyens de prendre le relais. Cela pourrait évoquer cette période économique difficile de l’entre-deux-guerres, suite à la crise financière de 1929, où la Grande-Bretagne se trouvait incapable d’approvisionner en livres le commerce mondial quand les États-Unis le refusaient ou ne s’en sentaient pas capables. Cette conjonction a certainement amplifié la crise économique de l’époque, selon l’analyse magistrale qu’en a fait Charles Kindleberger en 1973.
Une obligation plus qu’une opportunité
On n’est certainement pas à un moment aussi dangereux. Mais tout pousse à ce que l’UE fasse les réformes propres à donner un statut international plus large à l’euro. On a là tout l’enjeu du marché unique de l’épargne et de l’investissement et de la réglementation bancaire unique que souligne le Rapport Draghi. Il faut donner davantage d’homogénéité et de liquidité aux instruments de financement des entités publiques et privées européennes. À défaut d’un émetteur souverain pour toute l’Union, il faut pour le moins harmoniser les circuits de financement, les statuts de l’épargne réglementée, le droit des obligations, des faillites et d’autres domaines du droit commercial.
Plus que d’une opportunité difficile à saisir, il s’agit d’un impératif. Car ce que montre le changement en cours aux États-Unis, c’est à quel point l’Europe est aujourd’hui dépendante du bon vouloir de ce pays quand elle doit se procurer les services de sécurité, de paiement et de liquidité financière qui lui sont indispensables, à quel point aussi elle peut subir des forme de chantage ou de coercition dans sa propre politique étrangère, à quel point elle confère un avantage informationnel important aux États-Unis dès lors que leurs institutions financières « savent tout ce qui se passe » en matière d’échanges commerciaux ou financiers impliquant l’Europe. Et cette dépendance ne peut que s’accroitre si l’on bascule d’une logique de contrats à long terme enveloppés de confiance mutuelle à une approche purement transactionnelle et opportuniste qui contredit la notion même de confiance. Il devient dangereux dans ce contexte que l’industrie des paiements en Europe soit en grande partie entre les mains d’acteurs comme Visa ou Mastercard, ou que les services de courtage pour le financement des entreprises soient rendus en grande partie par des acteurs sous la possible influence du gouvernement américain.
Dans un parallélisme étonnant avec le dossier de l’OTAN et de la sécurité militaire rendue par les États-Unis à l’Europe, les « trumperies » ont au moins l’avantage de mettre au grand jour cette faiblesse stratégique en matière de souveraineté, et donc in fine de sécurité. À l’Europe d’y remédier.