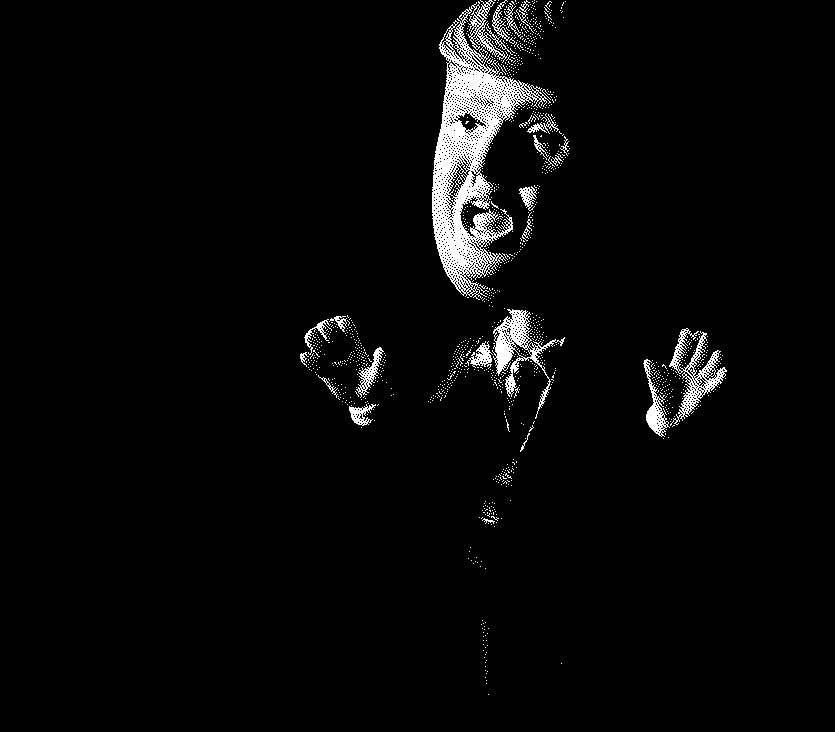Les décisions judiciaires de juges fédéraux qui ont suspendu ou annulé les actes exécutifs du président Trump en 2025 ouvrent un duel ou plutôt une série de duels particulièrement médiatisés (1). Les injonctions universelles ont nourri un débat sur le rôle des juges fédéraux (2). Avec un pouvoir exécutif ouvertement disruptif au sein des institutions constitutionnelles, c’est le rôle même des juges qui est discuté dans le contexte étatsunien (3). On peut alors prolonger quelques réflexions sur les rapports entre la justice et le pouvoir dans les reconfigurations politiques contemporaines, car c’est bien la contextualisation du mouvement en cours dont il faut prendre la mesure (4).
1. Les décisions de justice contre les décisions de Donald Trump
Depuis son investiture en 2025, le président Donald Trump a émis un grand nombre d’actes dont la formalisation juridique reste floue et qui sont souvent qualifiés d’executive order1. Ces actes ont porté de vastes politiques publiques et en ont surtout démantelé d’autres. Un séquençage serré fait penser à une logique d’efficacité au cœur d’une présidence souvent dite impériale et du projet de révolution qu’illustrait le project 2025. La tradition de ces actes exécutifs au champ très vaste est ancienne mais elle s’est accélérée sous les deux mandats de Donald Trump, sorte de traduction juridique d’un décisionnisme qui s’affranchit des contraintes juridiques – ou plutôt les modèle à sa mesure. Aussi la dérive vers une prise de décision centralisée et personnelle aux mains d’un chef d’État n’est pas nouvelle aux Etats-Unis ou dans d’autres démocraties libérales pourtant organisées, depuis au moins deux siècles, selon une séparation des pouvoirs.
Les pouvoirs des juges sont réels et anciens, notamment dans le champ du droit public où diverses juridictions se sont vu conférer ou ont acquis, singulièrement depuis le XIXe siècle, des prérogatives de contrôle des autorités publiques, comme c’est le cas dans de nombreux pays. Si certains comme la France disposent d’une justice administrative ou constitutionnelle spécialisée, aux États-Unis, la justice est compétente dans tous les domaines et la distinction pertinente est plutôt celle de l’échelle entre les États et le niveau fédéral. Il existe à côté des juges répartis dans les États un système judiciaire fédéral avec 94 cours situées dans autant de districts fédéraux, compétentes pour les demandes en première instance des requérants situés dans leur ressort. Il existe quelques tribunaux spécialisés pour certains litiges. 13 cours d’appel sont compétentes dans treize circuits réunissant les 94 juridictions par groupes d’États et au niveau national pour l’une de ces cours et pour certains contentieux. La Cour suprême des Etats-Unis est compétente pour connaître en dernier ressort des litiges fédéraux, même si elle sélectionne de fait peu d’affaires. Il y a un peu plus de 800 juges fédéraux nommés à vie par le président et confirmés par le Sénat.
Dans la suite d’actes exécutifs adoptés par Donald Trump depuis début 2025, de nombreuses saisines de la justice ont pu donner lieu à diverses décisions de juges fédéraux. Celles-ci ont suspendu la suppression d’agences fédérales ou le licenciement d’agents, l’interdiction de délivrer des passeports portant la mention transgenre, entre autres cas médiatisés. Ces décisions ont souvent émis un type d’acte judiciaire nommé nationwide ou universal injunction : un juge fédéral peut, au nom de cette pratique ou de cette théorie qui n’est inscrite dans aucun texte, donner un effet à sa décision au-delà de l’effet plus traditionnel d’une décision judiciaire sur les parties aux litiges, c’est-à-dire un ou plusieurs défendeurs et requérants. Concrètement, le juge en question associe à sa décision une ordonnance qui prohibe l’application générale de la mesure ou son application à des situations similaires.
L’injonction est dite nationwide puisque la mesure est prise par l’autorité fédérale à l’échelle du pays, ou universelle puisqu’elle s’applique à tous, avec une dimension matérielle plus que territoriale. Le fondement juridique évoqué par les juridictions ou les défenseurs des injonctions universelles est l’équité, grâce à laquelle le juge doit pouvoir accorder un « complete relief » c’est-à-dire une satisfaction des parties y compris vis-à-vis des tiers lorsqu’elles le demandent2. Il est souvent avancé qu’il s’agit d’un moyen d’unifier la jurisprudence au sein de la common law face au risque de fortes disparités des décisions des juges de districts, qui plus est parce qu’ils décident la plupart du temps en juge unique et non en tant que juridiction collégiale3.
L’enjeu de ces décisions tient à chaque litige particulier ainsi qu’aux possibilités d’appel auprès des cours de district. Alors que la Cour suprême n’avait jamais fait jurisprudence sur le sujet, elle a suspendu, le 23 juin, l’effet de la décision avec injonction universelle de la Cour du district du Massachussets qui jugeait inconstitutionnel l’acte exécutif permettant l’expulsion d’immigrants. L’opinion majoritaire de la Cour ne justifiait pas sa décision. Le 27 juin en revanche, la Cour a rendu une seconde décision dans une autre affaire concernant un décret exécutif qui supprimait le droit du sol et donc la délivrance de papiers pour de nombreuses personnes nées sur le sol américain de parents étrangers. La plainte avait été déposée par 22 États démocrates et de nombreuses associations et mères enceintes d’enfants à naître alors privés de ce droit. La Cour suprême estime dans cette décision que les injonctions universelles prononcées par les juges « excèdent probablement (likely exceed) le pouvoir d’équité que le Congrès a conféré aux juridictions fédérales »4.
La Cour rattache en effet l’équité à la définition qu’en donne le Judicial act de 1789. La lecture originaliste de l’opinion majoritaire s’intéresse en particulier aux pouvoirs d’équité des juges en Angleterre au moment de l’adoption de cette loi. Mais l’article III de la Constitution des États-Unis qui énonce le pouvoir judiciaire lui peut aisément être dit favorable5 ou du moins agnostique sur la question6. Quoi qu’il en soit, par l’usage du « probable », la Cour ne se prononce pas sur le principe même des injonctions, en vertu d’une tradition qui laisse les juges libres de leurs moyens et interprétations, l’équité étant précisément une intervention du juge hors du droit ordinaire et écrit au nom de principes de justice constitués par la jurisprudence. La pratique ne va donc pas s’arrêter même si les fondements pour la renverser en appel ou lors d’un recours en urgence devant la Cour suprême semblent significativement renforcés.
2. Le débat sur les pouvoirs d’exécution des juges fédéraux
La critique des injonctions universelles se retrouve aussi bien dans la doctrine universitaire, lorsqu’elle estime qu’il n’existe aucun fondement juridique à un tel pouvoir7 qu’au sein du milieu politique et singulièrement du gouvernement fédéral lorsqu’il est visé. De fait, diverses difficultés juridiques se posent : la contradiction entre injonctions rendues par les divers juges ; la rareté des décisions qui font précédent de la part des juges de districts ; le gel d’une question de droit là où l’injonction localisée permet souvent des affaires devant plusieurs circuits et une réponse juridique plus satisfaisante au problème posé ; un risque pour d’autres justiciables qui peuvent être défavorisés par la demande de ceux en cause ; un risque enfin de forum shopping de juge en juge afin d’obtenir l’injonction désirée8. Dans un rapport rendu en 2018, l’Attorney général Jeff Sessions, sous le premier mandat Trump, reprochait à ces injonctions de permettre à un seul des 600 juges fédéraux de faire obstacle à la loi ou à une politique publique, estimant qu’il s’agissait d’un excès de pouvoir de la part de la branche judiciaire9.
Dans une opinion concordante à l’affaire dans laquelle la Cour a validé le muslim ban décidé par Donald Trump en 2017 déjà, le juge Clarence Thomas – un conservateur nommé par George Bush – a largement critiqué les injonctions universelles10, jugeant que les avantages retirés par les justiciables qui ne sont pas partie au litige ne peuvent être qu’accidentels11. La décision majoritaire remettait en vigueur le décret suspendu en première instance sans toutefois statuer sur la technique mobilisée par le juge fédéral. Peu après, les sénateurs et représentants porteurs de deux projets de loi qui ne sont pas allés jusqu’au vote12 ont cherché à interdire purement et simplement l’effet des injonctions au-delà des seules parties aux litiges. S’il l’on prend en compte les craintes légitimes exprimées vis-à-vis de cette pratique dans la structure de la jurisprudence, il pourrait a minima être envisagé de délimiter la pratique en lui donnant un cadre législatif plus adapté que la loi de 178913. Par exemple, les principes guidant leur usage permettraient de mieux évaluer leur nécessité selon les affaires tout en soumettant la mise en œuvre de ces principes à l’appel14.
Mais cette discussion mesurée ne tient pas longtemps dans le contexte sociopolitique actuel. L’opinion majoritaire de la juge Amy Coney Barrett dans la décision du 27 juin 2025 affirme que la défense ou la critique de la pratique de l’injonction universelle ne peut s’appuyer que sur des arguments politiques – c’est pourquoi il faudrait selon elle s’en remettre aux pouvoirs des juridictions mis en œuvre au moment de leur création au XVIIIe siècle15. Le juge, comme le président, doit être soumis au droit16. C’est alors une certaine conception du juge qui s’exprime : « les juridictions fédérales n’ont pas un pouvoir général de contrôle du pouvoir exécutif ; elles résolvent des litiges en conformité avec les pouvoirs qui leur ont été conférés par le Congrès17 ». Rien n’est moins sûr : on pourrait très bien arguer que c’est la Constitution qui habilite les juges à décider et que l’équité sur laquelle la Cour suprême rabat les pouvoirs d’exécution n’est que l’une des pratiques offertes par la common law.
L’équité est précisément cette pratique qui échappe aux lois en offrant une flexibilité acquise par la pratique judiciaire au fil de la jurisprudence. Il n’est de toute façon pas des prérogatives des cours de districts de produire des précédents, puisque leurs décisions ne sont valides qu’aussi longtemps qu’elles n’ont pas été examinées en appel ou par la Cour suprême, qui exprime d’ailleurs bien ici qu’elle a le dernier mot. Deux conceptions de la justice apparaissent ainsi dans la discussion entre un juge restreint à la résolution d’un litige entre parties et la justice comme production normative et un respect des normes supérieures, visant à empêcher qu’une décision publique inconstitutionnelle garde un effet dans l’ordre juridique 18. Cette dernière position est bien connue en France ou dans les systèmes juridiques prompts à se reconnaître dans un droit écrit et une hiérarchie des normes, avec des juridictions de droit public dont le rôle est de faire le procès à un acte ou à la loi en vertu de normes ou d’habilitations jugées supérieures.
3. Le pouvoir judiciaire, contre-pouvoir ou « juristocratie » ?
La tendance de la justice exerçant une fonction constitutionnelle doit être contextualisée à l’aune des transformations du pouvoir. On dit souvent que ces mises en forme juridiques expriment des opinions politiques, mais que veut-on dire par là ? Il serait faux de réduire l’activité des juges à un simple positionnement partisan ou même idéologique, tant les motivations des acteurs publics sont complexes, liées à leur position institutionnelle, à la multiplicité de magistrats, aux dynamiques collégiales ou corporatistes et bien sûr aux individualités. Il est ainsi plus intéressant de procéder à une contextualisation sociopolitique et une historicisation des pouvoirs des juges, ce qui n’obère pas une position théorique sur le droit. La question est ancienne et largement débattue depuis la création des États-Unis. Le pouvoir judiciaire a pu être vu à l’époque de la Convention de Philadelphie comme un pouvoir modérateur mais aussi l’un des pouvoirs seulement chargés du respect de la Constitution.
Le juge constitutionnel en particulier19 fait l’objet d’une objection contre-majoritaire fondée sur une conception représentative ou populaire de la démocratie mais il n’a jamais été question de le soumettre au politique puisque les trois pouvoirs, aux Etats-Unis, ont été pensés de manière à s’équilibrer et à se confronter. D’où il a pu être défendu que l’intervention du juge reste capitale pour mener la discussion publique à raisonner constitutionnellement20. Les différents arguments mobilisables sont certes politiques, mais c’est aussi une approche fonctionnelle ou procédurale du politique : le juge sert à maintenir les conditions du régime démocratique au sein duquel sont discutées les décisions publiques21, et il sert également à résoudre des litiges ou à réguler des conflits de fond dans une démocratie complexe, c’est-à-dire la vie de la cité marquée par une pluralité d’institutions, sans même parler des vues exprimées en leur sein ou en dehors d’elles.
Politique s’entend ainsi, institutionnellement, par la nature même des pouvoirs qui se confrontent et s’équilibrent, y compris les pouvoirs particuliers que les juges mettent en œuvre dans leurs décisions ou à l’appui de leur exécution par différents destinataires. Il ne s’agit pas d’estimer que le juge est une instance suprême, au contraire. Depuis les années 2000, une riche littérature a postulé qu’un juge constitutionnel trop important pouvait non seulement avoir son propre agenda politique, mais également servir les intérêts politiques et sociaux inscrits par un pouvoir donné dans les instruments normatifs22. Il s’agit ici surtout du contrôle de constitutionnalité des lois, qui n’est pas en cause dans les affaires fédérales concernées même si l’interprétation de la Constitution et leur confrontation aux décisions présidentielles relèvent bien d’un contrôle judiciaire du pouvoir politique. Plus historiques, ancrées dans une tradition critique de gauche, d’autres analyses ont surtout insisté sur le fait que les juges et les droits pouvaient être amenées à défendre un progressisme juridique face à un conservatisme du pouvoir politique ou l’inverse, selon les configurations partisanes et la sociologie judiciaire23.
Il est alors possible d’envisager concrètement les relations entre les pouvoirs du point de vue des tentatives de modeler la jurisprudence par la nomination et les contraintes procédurales imposées aux juridictions24. Une version armée du juge s’oppose à une version désarmée, en quelque sorte. C’est ce qu’appelait le juriste et historien américain Samuel Moyn en poussant les démocrates à s’intéresser au pouvoir judiciaire afin d’encadrer mieux celui de la Cour suprême, plutôt que de rouvrir à chaque décès d’un membre le débat sur la composition idéologique de la juridiction25. Samuel Moyn écrivait deux ans avant la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health organization qui a restreint le droit à l’avortement au grand dam des progressistes. La décision majoritaire s’appuyait au moins de manière rhétorique sur le pouvoir du juge, en renvoyant la question à chaque État alors que la Cour avait proclamé le droit pour tout le pays dans une décision de 1973. La jurisprudence conservatrice récente de la Cour ne doit pas faire oublier que le droit a toujours été sujet à diverses influences idéologiques, et ne sert pas nécessairement le discours progressiste des droits humains ou l’idée selon laquelle le juge serait leur garant naturel26.
Il y a au cœur de l’argument de Moyn un scepticisme vis-à-vis des possibilités du libéralisme de réaliser pleinement l’idéal des Lumières d’un sujet de droit doté d’une volonté émancipatrice27. Cette idée radicale se défend politiquement, selon l’auteur américain, au lieu de supposer que le droit ou la justice appartiennent à une sphère de vérité dotée de sa propre morale. Mais il convient d’accentuer la nécessaire historicisation de cette critique : aux États-Unis en particulier, l’idée d’un « gouvernement des juges28 » est née de la jurisprudence conservatrice de la Cour suprême qui faisait obstacle aux avancées sociales du début du XXe siècle – on a pu parler d’ère Lochner – quand un changement de composition a vu apparaître, sous la présidence du juge Warren, une appréciation plus positive de l’activisme judiciaire par les progressistes, liée aux décisions qui ont ouvert le mouvement des droits civiques. La célèbre décision Brown v. Board of education de 1954 qui a permis la déségrégation dans les écoles a d’ailleurs pu être vue comme un renouvellement des pouvoirs du juge favorable à l’injonction universelle29. Il s’agissait ici de la Cour suprême ; en outre, un dialogue s’était ouvert avec les législatures dans la mise en œuvre des décisions concernées30.
4. Un cas de tension entre le pouvoir des juges et le pouvoir exécutif contemporain
L’essor du rôle des juges fédéraux depuis les années 1960 est le reflet d’une extension du droit fédéral et de l’usage accru d’executive orders de plus en plus vastes et unilatéraux31. Les injonctions universelles s’inscrivent alors dans une pratique visant à rendre les décisions de justice exécutoire efficaces face à une pluralité d’acteurs publics et privés notamment en matière constitutionnelle32. Contrairement à ce que l’on pourrait croire ou entendre d’ailleurs33, ce type mécanisme n’est pas nouveau : il pouvait simplement prendre d’autres noms34, parmi d’autres innovations procédurales rendues nécessaires par le contrôle du pouvoir politique et administratif par le juge35. C’est pourquoi la justification juridique de ce contrôle a pu être fondée sur l’interprétation du rôle qu’accorde la Constitution aux différents pouvoirs36. Le pouvoir d’un seul juge pour arrêter – temporairement et sous réserve de l’appel – un acte exécutif peut alors être vu comme une garantie démocratique37. De ce point de vue, le juge a plus de pouvoir mais l’autorité exécutive se renforce également, et de manière plus générale et plus descriptive, l’intervention accrue du juge dans l’espace public des sociétés contemporaines répond à l’extension du domaine de la légalité38.
Preuve en est que l’administration Trump et ses soutiens ont dénoncé avec une virulence modérée les quelques décisions judiciaires concernant les nombreux actes exécutifs adoptés depuis janvier 2025. A l’invocation du politique face au droit, l’Amérique MAGA a largement préféré une stratégie juridique. Si les juges peuvent être considérés comme un pouvoir « politique » lorsqu’ils semblent jouer en faveur du camp adverse, les présidents démocrates comme républicains ont pu pâtir d’injonctions universelles – tous n’ont pas instrumentalisé les institutions de la même manière. Mais un gouvernement habile sait qu’il ne doit pas défaire une autorité qui pourrait, un jour, le servir, comme l’illustre la décision du 27 juin de la Cour suprême, très restrictive vis-à-vis de la définition même du rôle des juges fédéraux comme celui d’un contre-pouvoir. La décision d’un juge peut ralentir un décisionnisme souvent impétueux, mais l’Amérique MAGA poursuit une stratégie au long cours avec un tiers des juges fédéraux actuels qui ont été nommés par Donald Trump.
La leçon à tirer de ces reconfigurations profondes des rapports entre les pouvoirs des juges et le pouvoir politique dépasse le défi trumpiste lancé aux institutions libérales. Le droit et la justice peuvent présenter différents contenus et il n’y a pas une seule manière de définir l’État de droit face à sa violation : une réaction formaliste et trop défensive n’envisage pas la manière dont l’État de droit, selon l’éthique qui l’anime et l’usage qu’en font les acteurs, peut s’opposer à la démocratie autant qu’il peut la défendre39. Difficile à évaluer, le pouvoir des juges est relationnel et contextuel, il ne peut jamais être l’équivalent de celui de l’exécutif, puisqu’il n’a pas de force sans l’assentiment des autorités ou des acteurs sociaux. Dans le contexte d’une reconfiguration du pouvoir au sein des institutions du libéralisme politique, ce sont deux positions différentes du juge qui s’expriment : conservateur en s’en tenant à des affaires ciblées, activiste ou transformateur en ayant la capacité d’avoir un impact sur une politique publique. Cette position varie selon l’évolution même du pouvoir politique et constitutionnel. Ainsi entre l’injonction nationale émise par un seul juge ou une décision de justice qui ne s’intéresse pas aux effets de ses décisions dans l’espace politique, le choix déprendra de la conception que l’on se fait de la réaction des contre-pouvoirs historiques au phénomène contemporain d’une centralisation décisionniste de l’exécutif.