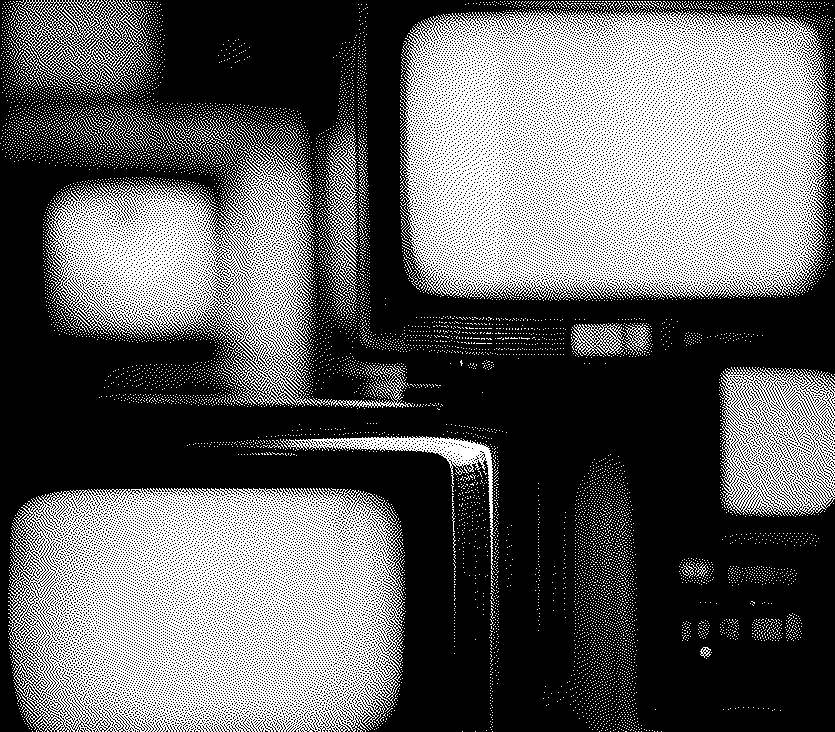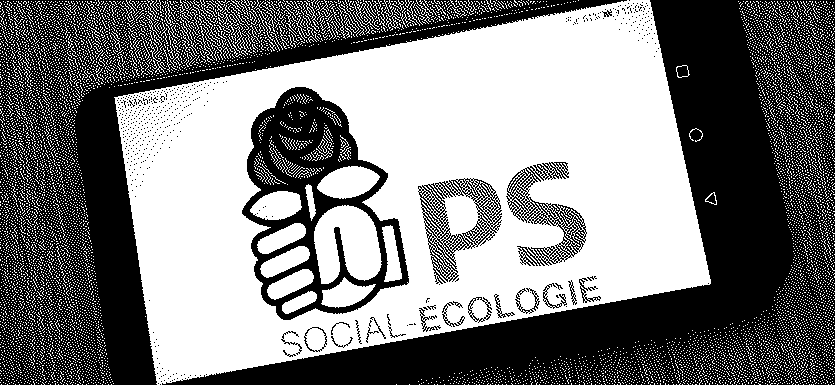« Toi, t’es une merde
», « abruti
», « bouffon
», « tocard
»… Ces mots argotiques et insultants n’ont pas été employés lors d’une altercation ordinaire, comme il est parfois possible d’en surprendre au quotidien. Ils ont été prononcés par Cyril Hanouna, l’animateur vedette de la chaîne C8, à l’endroit d’un élu de la République, Louis Boyard. Invité le 12 novembre 2022 sur le plateau de l’émission « Touche pas à mon poste », le jeune député LFI venait notamment d’accuser Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne C8, d’avoir « déforesté le Cameroun
» et de faire partie des « cinq personnes les plus riches [qui] appauvrissent la France et appauvrissent l’Afrique
»1. Ce sont donc ces propos qui ont déclenché l’ire de « Baba
», piqué au vif en raison de sa proximité avec Vincent Bolloré (son « grand frère
», comme il le nomme, auquel il déclare vouer une « fidélité indéfectible »2), et reprochant à Louis Boyard, pour un temps chroniqueur de « TPMP
», de « cracher dans la main qui [l’]a nourri
».
Les téléspectateurs de l’émission sont certes coutumiers des coups de colère de Cyril Hanouna, qui participent de l’économie générale de l’émission fondée en grande partie sur la double logique du clash et du buzz. L’animateur n’en est pas à ses premiers débordements, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs signalements auprès de l’Arcom3, entraînant dans certains cas mises en demeure et sanctions financières. À la suite de cette séquence, le régulateur a d’ailleurs été de nouveau saisi et a sanctionné C8 de la plus forte amende de son histoire, 3,5 millions d’Euros4. Et Louis Boyard a porté plainte pour « injure publique envers une personne chargée d’une mission de service public
». Les emportements d’Hanouna s’inscrivent donc dans la routine programmatique de « TPMP ». Il n’en reste pas moins que c’est la première fois, dans l’histoire de la télévision française, qu’un représentant politique est traité d’une telle manière par un animateur.
Comment en est-on arrivé là ? Au-delà des propriétés mêmes de l’émission et du style personnel de son animateur, il importe de considérer cette séquence comme le produit des nombreux bouleversements intervenus au cours de ces dernières décennies au sein de l’écosystème médiatique et de leurs conséquences sur les représentations du politique. Sous l’effet du développement et de l’imposition des médias de masse (télévision et internet plus particulièrement) ainsi que d’un important renouvellement des genres de programmes, le message politique semble être passé sous le signe du préfixe « dé- ». Celui-ci indique la persistance d’une action contraire, « dé-constructrice ». Le message s’est ainsi progressivement désubstantialisé, dépolitisé et désinstitutionnalisé, désacralisant ceux qui l’incarnent. Chemin faisant, avec les nouvelles habitudes prises, le phénomène a écrasé les codes discursifs et libéré les formes plus archaïques de la violence dans les interactions publiques. Il dépasse ainsi le simple espace des médias pour devenir un des symptômes majeurs de la nouvelle période politique dans laquelle nous sommes entrés. Ces transformations ont certes été rendues possibles parce que les acteurs politiques ont consenti à s’y ajuster, mais on ne saurait sous-estimer le poids de ce que les médias ont fait à la politique depuis près d’un demi-siècle, en soufflant sur les braises de sa violence originaire. Le processus peut se décomposer en trois dynamiques principales.
1. Régime médiatique et évidement du discours politique
Si un acteur politique peut désormais se faire insulter sur un plateau de télévision par un animateur, c’est tout d’abord parce que sa parole est perçue comme n’ayant plus de valeur. Cette démonétisation du discours politique procède d’une dynamique d’évidement : évidement lexical et syntaxique, évidement lié aux contraintes de la mise en images, évidement résultant du registre de discours pour « faire peuple
» en s’adressant à un auditoire plus étendu. Ces évidements sont aussi de véritables moteurs de la brutalisation. Avant l’avènement des médias de masse, les discours politiques étaient le plus souvent des discours substantiels, complexes, idéologiques. Ce type de discours n’a certes pas complètement disparu aujourd’hui et se laisse encore entendre lors des périodes à forte intensité politique comme les campagnes électorales. Pour autant, il paraît clair que le discours politique s’est tout à la fois simplifié (pour se réduire à quelques mots), déspécialisé (pour s’aligner sur les normes du parler ordinaire) et rétracté (pour occuper un temps de parole toujours plus court). Or cette nouvelle économie discursive a été en grande partie commandée par le régime médiatique de la télévision, avant d’être à nouveau bouleversée par le régime médiatique des réseaux sociaux. Ainsi, la mise en forme du politique à la télévision s’est structurée autour de la publicité, du spectacle, et du « mal-parler », et a ouvert la porte à la brutalisation numérique.
Le rôle de la publicité
La première de ces modalités réside dans l’application des techniques publicitaires à la politique, qui procède de l’introduction puis de la généralisation des techniques de vente utilisées dans le domaine commercial. On sait que, dès l’Antiquité, la politique a commencé à emprunter, dans le champ de la rhétorique, des techniques de persuasion de type commercial. En témoignent les « phrases magiques
» (ou slogans) utilisés par les acteurs politiques à Rome, ou encore les inscriptions retrouvées sur les murs de la ville de Pompéi, ensevelie sous les laves du Vésuve, en 79 de notre ère, alors que la campagne pour l’élection des duumvirs battait son plein. Et à chaque époque, la politique a assimilé les techniques de vente les plus avancées. Dans les années 1950, aux États-Unis, le marketing s’en est emparé. Si publicitaires et attachés de presse travaillent déjà avec des personnalités des deux grands camps politiques américains depuis la fin du XIXe siècle, la campagne présidentielle de Dwight Eisenhower en 1952 marque a posteriori la première collaboration étroite entre un candidat, une agence de publicité (BBDO – Batten, Barton, Durstin, Osborne) et un spécialiste de la publicité télévisuelle, Rosser Reeves (de la société Ted Bates). Un principe majeur en est le fondement : la simplification. Tandis que Bruce Barton recommande de faire passer un « message court et simple
»5, Rosser Reeves élabore les spots de campagne sur la base d’une « promesse unique de vente
». Les vingt-cinq clips élaborés (les premiers du genre) durent entre 20 et 60 secondes et sont regroupés sous l’appellation générique « Eisenhower answers America
», tandis que le discours se concentre sur l’émission d’une idée-force6. Couronnée par la victoire du candidat républicain, cette campagne représente la « première tentative réussie de « vendre » un candidat à la présidence en usant des mêmes techniques que celles utilisées pour vendre du savon et du dentifrice
»7. C’est précisément pour cette raison qu’elle sera si décriée à l’époque, notamment par les démocrates, qui s’offusquent que la politique puisse être réduite à de telles pratiques. Mais le succès d’Eisenhower n’en contribue pas moins à fonder la croyance dans l’efficacité du recours au marketing politique, qui va par la suite non seulement s’intensifier mais se systématiser. En France, la première campagne publicitaire d’un candidat date de l’élection présidentielle de 1965. Elle est pilotée par Michel Bongrand, alors directeur de l’agence de publicité Services et Méthodes, pour le compte de Jean Lecanuet. Une campagne dite « à l’américaine », fortement inspirée de celle de John F. Kennedy en 1960 (Lecanuet se présente lui-même comme le « Kennedy français
» et va jusqu’à répliquer sur ses affiches la posture et le sourire ultrabright du démocrate8) et exploitant pour la première fois les ressources télévisuelles9 et sondagières (Bongrand s’associe à la SOFRES). Là encore, le message principal prend la forme simplifiée d’un slogan, répété à l’envi lors des interventions du candidat ou décliné sur ses différents supports de communication : « Un homme neuf, une France en marche
». Inattendu, le score de Lecanuet au premier tour de scrutin est rapidement attribué (surtout par Bongrand10) à son style général de campagne, en rupture avec les « conventions de la propagande politique
»11 de l’époque. Le marketing électoral, et peut-être plus encore la capacité à se vendre à la télévision, sont désormais perçus comme indispensables. 1965 marque ainsi le début de l’association entre acteurs politiques et agences de publicité (George Pompidou avec Havas, François Mitterrand avec RSCG…). Depuis lors, le poids des publicitaires dans la fabrique du politique n’a cessé de croître, suivant un processus plus large d’externalisation de tâches autrefois réservées aux équipes partisanes (communication, production programmatique, campagnes, événements,…) et désormais confiées à des instances considérées comme expertes (que l’on songe au travail de l’agence CLM/BBDO au moment de la refondation du RPR en UMP au début des années 2000, ou au rôle de l’agence Jésus & Gabriel dans l’élaboration de la campagne d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017). L’intervention croissante des publicitaires a eu un impact sur le discours politique. Le recours généralisé au marketing (quel que soit le support de communication12) a non seulement produit un effet de réduction mais aussi de standardisation de la parole politique autour de catégories de plus en plus schématiques ou élémentaires. Cécile Alduy a récemment proposé une analyse lexicométrique de près de 1350 discours13 tenus entre 2014 et 2016 par les principaux prétendants à l’élection présidentielle de 2017, soit un total de 2,5 millions de mots. Sa principale conclusion : à quelques rares exceptions près (notamment Jean-Luc Mélenchon), les hommes politiques partagent une langue très uniformisée14. Ce que constate encore la sociologue Corinne Gobin : « le même vocabulaire politique, et les mêmes expressions, se trouvent dans la bouche de quasi tous les membres de la classe politique
»15. Cette homogénéisation se repère encore assez bien au niveau des slogans utilisés par les candidats à l’élection présidentielle française au cours de ces dernières décennies : ils tendent à s’ordonner autour d’un même ensemble de « mots-valeurs », si limité qu’il peut rendre confuse leur origine politique et en devenir interchangeables. On pourra ici s’amuser à faire l’exercice. A quel(le)s candidat(e)s faut-il attribuer les slogans suivants ? (1) « Avec la France, pour les Français
», (2) « Le président de tous les Français
», (3) « Un président pour tous les Français
», (4) « Il faut un président à la France
», (5) « Il faut une France forte
», (6) « De toutes les forces de la France
», (7) « La France unie
», (8) « La France pour tous », (9) « Une force pour la France », (10) « La France de toutes nos forces
», (11) « La France présidente
», (12) « Oui, la France
», (13) « Une volonté pour la France
», (14) « Debout la France
», (15) « Choisir la France
», (16) « Ensemble la France !
»16. Ainsi, à force de puiser dans un même lexique, les mots de la politique se vident de leur sens, la parole politique se démonétise.
Le spectacle et la logique de la « petite phrase »
L’évidement du discours politique est aussi lié à la mise en images télévisuelles. Comment donner à voir la politique sur le petit écran ? Sous une forme susceptible de retenir l’attention du téléspectateur : celle d’un spectacle agonistique, autrement dit d’une mise en scène centrée sur l’exploitation de son essence conflictuelle. Le premier grand affrontement politique de l’histoire de la télévision remonte à la campagne présidentielle américaine de 1960 et oppose John Fitzgerald Kennedy à Richard Nixon. Des quatre débats réalisés par les principales chaînes américaines, on ne retiendra finalement que le premier (le 26 septembre, à Chicago, dans les studios de NBC), celui où les qualités télégéniques du jeune sénateur démocrate vont apparaître de manière si évidente (face à un vice-président républicain affaibli par une hospitalisation de deux semaines en raison d’une infection au genou) qu’on va se persuader que la télévision est susceptible de faire ou de défaire une élection. En France, le premier débat télévisé pour l’élection présidentielle est organisé lors de l’entre-deux-tours du scrutin de 1974 – des « duels politiques
» se tiennent déjà à la télévision depuis le milieu des années 196017. Inspiré par le débat américain, Alain Duhamel espère pouvoir reproduire le dispositif à la télévision française et obtient l’accord des trois principaux candidats à l’élection, dont François Mitterrand et Valéry Giscard D’Estaing. Le « face à face » – Mitterrand parlera de « corps à corps
» – se tient le 10 mai 1974 et réunit 22 millions de téléspectateurs (près de la moitié de la population française de l’époque). Le débat est tout autant technique que tendu et connaît son point d’acmé lorsque, piqué au vif par François Mitterrand sur la politique fiscale, Valéry Giscard d’Estaing assène, dans une scansion prononcée, sur un tempo ralenti, et en fixant son adversaire droit dans les yeux, la réplique fameuse : « Je trouve toujours choquant et blessant de s’arroger le monopole du cœur. Vous n’avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J’ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres
». Le débat sur le débat qui s’engage par la suite va se focaliser pour l’essentiel sur les effets de cette « petite phrase », finalement reconnue, a posteriori, comme le point de bascule de l’affrontement en faveur de son auteur. Oubliées la diversité des échanges, la sophistication des points de vue : le débat ne vaut finalement plus que pour le moment où le coup fatal (de facto le plus spectaculaire) est asséné. Dès lors, s’installe la croyance selon laquelle il suffit de quelques mots pour emporter la lutte politique. Comme le souligne justement Christian Delporte, « les commentaires des médias [ont construit] le mythe du débat de 1974. Ce sont eux qui relèvent les petites phrases giscardiennes, soigneusement préparées, sur « l’homme du passé » et le « monopole du cœur » (formule prononcée vers la fin de l’émission). […] Ce sont eux encore qui, utilisant abusivement les résultats du sondage de l’IFOP, désignent Giscard vainqueur de l’affrontement
»18. Les acteurs politiques, et notamment les protagonistes du débat, vont eux-mêmes contribuer à nourrir cette croyance. Dans ses Mémoires, Valéry Giscard d’Estaing affirmera : « Je crois que j’ai été élu président de la République grâce à une phrase de dix mots : « Mais, monsieur Mitterrand, vous n’avez pas le monopole du cœur ! »
»19, tandis que François Mitterrand finira par admettre qu’il a été déstabilisé par la réplique giscardienne et qu’il a été défait dans ce débat. Non seulement la mémoire de ces confrontations se réduit aujourd’hui à l’évocation de ces petites phrases (minorant l’importance de celles où elles ont été moins marquantes), mais leur traitement médiatique consiste pour l’essentiel à en faire l’exégèse. Les commentaires relatifs au dernier débat présidentiel en date opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron en offrent une assez bonne illustration, soulignant ici que ce qui est au cœur de l’attention réside bien dans la « phrase choc », la « punchline » : « Débat Macron-Le Pen : les 15 meilleures punchlines entre les deux candidats
» (La Dépêche, 21 avril 2022) ; « « Gérard Majax
» ; « Ripoliner la façade
» : les meilleures punchlines du débat Macron-Le Pen
» (Le Soir, 20 avril 2022) ; « Présidentielle 2022 : 8 punchlines à retenir du débat Macron-Le Pen
», RTL, 21 avril 2022).
On peut dire que la petite phrase fait partie depuis longtemps (toujours ?) de l’expression politique. Elle en constitue un véritable genre, peut-être en est-elle le cœur. Les exemples abondent, du « Veni, vidi, vici
» de César au « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace
» de Danton, du « Qui m’aime me suive !
» de Philippe VI de Valois au « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat
» de Churchill. Les petites phrases sont des condensations de la valeur au nom desquelles la politique se mène et elles en fixent le souvenir. Mais dans le mouvement général de condensation discursive qu’imposent les médias contemporains, un glissement s’opère. La petite phrase désormais, poliment, « assassine » et met en mémoire le coup porté. On est certes loin de l’insulte, mais ici commence peut-être la brutalisation des relations politiques dans le langage.
Parler mal pour communiquer mieux
En passant à la télévision, la politique a changé de public pour se retrouver exposée au « grand public ». Dans les années 1950, seuls 10% des foyers français sont équipés d’un récepteur de télévision. Sa possession constitue un critère de distinction sociale : elle est le privilège d’« innovateurs aisés » et il faut près de sept mois de travail à un ouvrier pour acquérir un poste20. Il en va tout autrement à partir des années 1980, où le taux d’équipement dépasse déjà les 90% (il est aujourd’hui de 91,3%, en baisse depuis 2018, avec une moyenne de 1,5 écran par foyer21). Comme le relèvent justement Pierre Leroux et Philippe Riutort, « l’information politique, du fait de l’élargissement de son public, s’est transformée » afin de pouvoir correspondre à des individus « mettant en œuvre des catégories de jugement liées à des compétences parfois faiblement corrélées à la raison politique censée gouverner le citoyen dans les régimes démocratiques. La maîtrise de la rhétorique et de l’exposé argumenté ont ainsi joué dans les médias un rôle moins décisif
»22. L’arrivée des médias de masse a en effet contraint les acteurs politiques à opérer un travail de nivellement du langage spécialisé de la politique pour l’ajuster au langage profane du citoyen. Ce travail a commencé en France dans les années 1980 : il se repère aisément à l’aune de l’évolution du discours de Laurent Fabius. Diplômé de Sciences Po Paris, agrégé de lettres modernes, énarque, issu d’une famille détentrice d’un fort capital culturel, le jeune Premier ministre va pourtant faire le choix de réduire son vocabulaire aux mots les plus fondamentaux du langage afin de maximiser ses chances d’être parfaitement compréhensible lorsqu’il s’exprime. Ce choix s’impose d’autant plus que sa communication se distingue « d’emblée par la prépondérance du recours à la télévision
»23. Laurent Fabius se trouve même à l’initiative de la création d’une émission dans laquelle il apparaît régulièrement, Parlons France : l’émission a notamment pour vocation d’expliquer de manière « didactique » les mesures gouvernementales dans un registre d’expression simplifié, rempli d’« évidences
», d’« anecdotes
» et d’« expressions familières
» – une pauvreté langagière que des études lexicographiques soulignèrent à l’époque24. Mais cette entreprise de simplification du discours poursuit également une autre finalité : celle de permettre aux acteurs politiques de paraître proches du « peuple », donc plus authentiques (selon une conception misérabiliste qui voudrait que le « peuple » s’exprime simplement). Ainsi, aux Etats-Unis, le discours politique n’a jamais paru aussi indigent que dans la bouche de Donald Trump. Lors des trois débats présidentiels de 2016 et à l’occasion de ses discours d’investiture, le représentant républicain n’a prononcé que 965 mots distincts, répétés 7,7 fois, ses phrases se réduisant par ailleurs, en moyenne, à l’utilisation de 12 mots, et 62% de ces mots étant monosyllabiques25. Comme le remarque Maixent Chenebaux, 80% des discours de Donald Trump se composent seulement de 480 mots (contre 665 mots pour Hillary Clinton, soit un écart de 38%).
Ce nivellement peut encore prendre la forme d’une mise à distance des normes habituelles du discours politique en matière de registre. Les prises de parole de Nicolas Sarkozy en sont un bon exemple, puisque l’ancien président, pourtant orateur de talent, avec son expérience d’avocat, n’a jamais cessé de subvertir les règles du langage pour tenter de construire une représentation distanciée de son rôle, entre erreurs grammaticales (« Si y en a que ça les démange d’augmenter les impôts
… » ; « On se demande c’est à quoi ça leur a servi ?
»), abandon du « ne » explétif dans les négations (« J’écoute, mais je tiens pas compte !
»), erreurs de syntaxe verbale (transitif / intransitif : « Je remercie à chacun
»), double marquage des pronoms (« Le Premier ministre, il a dit…
»), fautes de genre (« On commence par les infirmières parce qu’ils sont les plus nombreux
»), défauts de prononciation (« ch’ais pas
», « ch’uis
», « m’enfin
», « y a
»), erreurs de conjugaison et aberrations verbales (« Quelles qu’avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous au fond pour la même idée de la liberté, la même idée de la civilisation
»), registre oral populaire ou encore phrases énigmatiques (« Je voudrais leur dire qu’on a reçu un coup de pied au derrière, mais que c’est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur
»)26. Ainsi, tout se passe finalement comme s’il fallait parler mal pour communiquer mieux ou, plus précisément, comme s’il fallait exploiter le potentiel d’efficacité politique de l’impolitesse et de l’incorrection. Le style discursif de l’actuel président, Emmanuel Macron, amateur de vocabulaire raffiné, de phrases complexes et de références littéraires paraît démentir cet usage populiste de la parole, mais les écarts qu’il s’autorise (ses dérapages ?) en révèlent cependant la tendance de fond (cf. infra). Ainsi, ce principe de simplification devenu norme du discours politique a engendré trois types d’effet : effet de disqualification si cet impératif de simplicité n’est pas respecté ; effet de dépolarisation du politique quand la réduction grammaticale et sémantique conduit à la stéréotypie ; effet de brutalisation quand les formes du langage font affleurer à tout propos le ressort réactif de l’émotion.
2. De la personnalisation à l’intimisation : la dépolitisation
Si un acteur politique peut désormais se faire insulter sur un plateau de télévision par un animateur, c’est ensuite parce qu’il n’est plus tellement perçu à travers la fonction qu’il incarne mais surtout à travers la personne qu’il est. L’écran des « rôles thématiques » – « député », « président », « sénateur », « maire », etc. – n’oppose plus à la familiarité directe sa barrière naguère infranchissable, et le politique apparaît désormais dans sa nudité : c’est l’individu lui-même, dans sa présence et dans son corps, qui est appréhendé, livré au ressentiment ou à la vindicte. En passant à la télévision, la personnalité politique s’est ainsi dépolitisée. Dans la bordée d’insultes que Cyril Hanouna déverse sur Louis Boyard, il est clair que l’animateur ne voit pas en lui le député, mais l’ancien chroniqueur de son émission, salarié de Bolloré, et il l’accuse de « cracher dans la soupe
». N’est-ce pas un peu grâce à lui et à Bolloré qu’il a été élu député ?
De la légitimité institutionnelle à la légitimité personnelle
« La politique, autrefois, c’étaient des idées. La politique, aujourd’hui, ce sont des personnes
», affirme Roger-Gérard Schwartzenberg en ouverture de son livre sur l’État-spectacle27. Cette assertion manque cependant de nuances car la politique, autrefois, c’était aussi des personnes – quoique dans un sens différent de celui qui caractérise l’évolution actuelle : des personnes comme « personnalités » et non comme individus ordinaires à rabaisser. En effet, du temps où les notables dominaient la scène politique, au XIXe siècle, il n’était nullement question de défendre une cause ou de promouvoir un programme. Il s’agissait plutôt de se faire élire sur sa personne, en satisfaisant les attentes de sa clientèle électorale, autrement dit, en échangeant des votes contre la promesse de gratifications diverses (services, emplois, décorations, ouverture de comptes chez des commerçants). « Les liens de confiance mutuelle qui ont durant tant de temps existé entre nous rendent inutile un long programme électoral
», déclare ainsi le Baron Eschasseriaux, candidat en 188128. L’invention et l’imposition des nouvelles manières de faire de la politique, celles d’« entrepreneurs » démunis de ressources financières mais désireux de conquérir le pouvoir, vont conduire sous la IIIe République à une redéfinition des modalités de la transaction électorale. Le vote va progressivement s’échanger désormais contre des biens immatériels : la personne s’efface derrière les idées, au nom du collectif – ce qu’illustre assez bien cet extrait d’une profession de foi de Jules Guesde datant de 1893 : « Citoyens, choisi comme porte-programme du Parti ouvrier par l’unanimité de vos groupements socialistes et syndicaux, je croirais être indigne du mandat qui m’a été imposé en vous entretenant de ma personne. Peu importe en effet qui je suis et ce que j’ai pu tenter […]. C’est de vous qu’il s’agit ; c’est des travailleurs de l’usine et du champ, qui crient vers vous et font appel à votre intelligence pour les affranchir en vous affranchissant
»29. La IIIe République consacre ainsi un modèle de représentation politique, celui de l’« impersonnelle exemplarité
»30, qui va perdurer jusque dans les années 1950.
Ce modèle va cependant vaciller avec l’avènement de la télévision comme média de masse. L’intérêt pour la personnalité des acteurs politiques et leur vie privée précède certes l’installation du petit écran dans les foyers français et remonte au moins à la fin du XIXe siècle31. Il s’intensifie dans les années 1930 avec le développement de la presse magazine, dans laquelle les représentants politiques hésitent de moins en moins à s’afficher. Le point de basculement intervient sans doute en 1953, lorsque René Coty ouvre les portes de son domicile à Paris-Match : sur les photos qui servent d’illustrations à l’article, le nouveau président de la République apparaît ceint d’une courte robe de chambre, en train de choisir un disque devant son gramophone, tandis que son épouse, Germaine, s’adonne à la pâtisserie dans la cuisine. C’est la première fois qu’un haut responsable de l’État se donne ainsi à voir.
Le développement de la télévision va cependant accentuer considérablement cette dynamique de personnalisation quasi-charnelle de la représentation politique, également encouragée par la présidentialisation du régime. Pour les acteurs politiques, il en est ainsi fini de « l’interdiction d’exister comme individu
»32. Ce changement ne va pas forcément de soi. De Gaulle, par exemple, se montre dans un premier temps particulièrement réticent à l’idée de passer à la télévision – parler de sa personne et non de sa politique lui donnant l’impression, comme il disait, de « se mettre en pyjama devant les Français
». Tout change avec le scrutin présidentiel de 1965, première élection au suffrage universel direct mais aussi première campagne électorale télévisée. Conseillé par Michel Bongrand, Jean Lecanuet choisit non seulement de s’exposer en famille sur ses prospectus de campagne mais aussi de commencer par parler de lui lors de sa première intervention télévisée : « Voici notre première rencontre. Vous allez donner vos voix, il est naturel que vous connaissiez celui qui vous les demande, surtout lorsqu’il s’agit d’un homme neuf. Je dois donc me présenter à vous. Reconnaissez qu’il est très difficile de parler de soi. Enfin, essayons
». Et le candidat centriste de déplier pendant quatre minutes les principaux volets de sa biographie tout en insistant sur ses qualités d’homme ordinaire (« Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes
»). La prestation de Jean Lecanuet est largement remarquée et commentée par la presse, notamment en ce qui concerne sa « façon de se présenter lui-même aux électeurs
»33. Parler de soi devient ainsi un atout pour gagner en politique. S’opère dès lors un glissement incarnatif dans les modes de représentation du politique : Georges Pompidou met en scène sa vie privée devant les équipes de télévision de Pierre Desgraupes pour l’émission Quatrième mardi (1970) ; François Mitterrand évoque ses goûts littéraires avec Michel Polac dans le programme Bibliothèque de poche (1970)34 ; Valéry Giscard d’Estaing se risque à jouer un morceau d’accordéon en présence de Danièle Gilbert pour Midi Première (1973)… Les épouses et les enfants des acteurs politiques sont également sollicités et leur présence s’impose rapidement comme une nouvelle norme communicationnelle en politique. On observe ainsi un processus de redéfinition des fondements de la légitimité politique, légitimité qui n’est plus simplement institutionnelle mais surtout, désormais, personnelle. Cette transformation ne constitue pas seulement l’amorce d’un changement dans les modalités d’évaluation du politique, dorénavant apprécié sur la base de critères qui lui sont de plus en plus étrangers (la vie familiale, les activités de loisirs, les relations de couple, etc.) ; elle est également porteuse d’un lent processus de banalisation de la perception de l’activité politique et de celles et ceux qui la font. On ne saurait certes sous-estimer les effets de politisation liés à de telles représentations du politique en individu ordinaire peopolisé. Mettre en avant sa personne en politique, ce n’est pas seulement répondre à un objectif de proximité pour gagner en popularité, c’est aussi donner la possibilité aux citoyens profanes d’entrer en contact avec la politique. Mais au risque potentiellement de la trivialiser. Car un corps qui s’expose devient un corps vulnérable. Il offre davantage de prises à l’adversaire que le corps institué et abrité derrière son rôle.
Le politique saisi par les genres programmatiques de l’intime et du divertissement
Ce phénomène va se trouver aggravé par les profondes transformations qui interviennent dans le paysage politique français à partir du début des années 1980 et qui marquent le passage de la « paléo-télévision » à la « néo-télévision »35. Jusqu’alors, la télévision était une télévision d’État, institutionnelle, avec un nombre limité de chaînes et de créneaux de diffusion, programmant des émissions à vocation essentiellement didactique ou ludique, et à destination d’un récepteur passif fasciné par la technologie télévisuelle. La politique s’y donne encore à voir, pour l’essentiel, à travers des formats respectueux de la fonction des acteurs qui l’incarnent, qu’il s’agisse d’entretiens, d’émissions politiques ou de journaux télévisés, et les interactions sont assurées par des journalistes spécialisés. Tout change avec l’avènement d’une télévision en grande partie libérée de la coupe étatique (avec la loi de septembre 1986), certes publique mais aussi désormais surtout privée, avec un nombre progressivement illimité de chaînes et un principe de diffusion ininterrompue, le tout à destination d’un récepteur érigé au rang de « coproducteur » des émissions. Dans ce nouvel écosystème télévisuel, la place des émissions politiques se retrouve non seulement réduite mais reléguée en deuxième partie de soirée (car jugées insuffisamment rentables en termes d’audience, notamment par les chaînes privées36). Ces programmes perdent de leur dimension solennelle et événementielle (à l’instar du principal rendez-vous télévisuel politique des années 1980, L’Heure de vérité, déclassé pour être reprogrammé le dimanche midi, à partir de 1991, avant d’être arrêté en 1995), au profit d’un traitement de plus en plus léger de la politique dicté par les deux genres prédominants de la néo-télévision :
- l’intime, avec notamment l’apparition et la généralisation des émissions de talk-show et de reality-show dévoilant la vie d’individus ordinaires (François Jost parle de « spectacularisation de l’individu quelconque »37) et les difficultés (familiales, financières, psychologiques, sexuelles…) qu’ils rencontrent – la télévision se posant ici dans un rôle curateur (Avis de recherche, 1980 ; Psy Show, 1983 ; Sexy Folies, 1986 ; Perdu de vue, 1990 ; Cas de divorce, 1991 ; La nuit des héros, 1991 ; L’amour en danger, 1993, etc.)38 ;
- le spectacle, avec notamment le développement des émissions de divertissement, comme Champs-Elysées de Michel Drucker, Dimanche Martin de Jacques Martin, Sacrée soirée de Jean-Pierre Foucault, Carnaval ou Sébastien c’est fou de Patrick Sébastien, etc.
Ce qui est en effet remarquable à partir des années 1980, c’est l’interpénétration entre ces genres et la politique. Entre 1985 et 1989, Questions à domicile s’impose ainsi comme l’une des principales émissions politiques. Animé notamment par Anne Sinclair, le programme consiste à délocaliser le plateau TV sur le lieu de vie même des acteurs politiques39. La plupart d’entre eux – y compris Jean-Marie Le Pen – sont de fait conviés à ouvrir les portes de leur maison, au plus près de leur intimité familiale.
Puis ce sont les émissions de talk-show ou d’infotainment qui prennent le relais, où, par définition, il s’agit de s’informer tout en se divertissant. Or à partir des années 2000, « la majorité des invitations de représentants politiques – hors JT – se réalise désormais dans le cadre [de ces] émissions […] revendiquant une composante récréative
»40 : Vivement dimanche de Michel Drucker, On ne peut pas plaire à tout le monde de Marc-Olivier Fogiel ou encore Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Erik Neveu a analysé les principaux traits communs entre ces émissions, où il s’agit de « mettre en images une politique distrayante
»41 : ambiance décontractée, codes vestimentaires relâchés, usage du tutoiement et des prénoms par les animateurs (plutôt que des fonctions), recours à un vocabulaire argotique, questions souvent déstabilisantes, refoulement du discours politique. En somme, tout est fait pour éviter le politique, principe ouvertement revendiqué par les producteurs de ces émissions comme offrant la garantie d’une audience optimale.
Entre temps, la présence d’acteurs politiques dans les émissions de divertissement se fait croissante : 21 invitations en 1962, 127 en 200442. La participation à ce type de programme, a priori improbable, devient ainsi rapidement incontournable. Jacques Chirac se retrouve interviewé par une marionnette, Jack Lang déclame un sketch, Lionel Jospin chante Les feuilles mortes, Jacques Toubon accepte de se faire hypnotiser, avant se faire transpercer le bras par une aiguille… N’importe quel type d’émission semble dès lors susceptible d’être investi : Hervé de Charrette participe à l’Académie des 9 (programme de jeu), François Mitterrand au Club Dorothée (programme pour enfants), René Monory à Mambo Satin (programme pour enfants), Louis Mermaz à Tournez Manège (programme de jeu)43.
Ainsi, ce que ces émissions installent, c’est la croyance – instituée par les médias mais acceptée par les acteurs politiques – selon laquelle une représentation dépolitisée de la politique est susceptible de retenir davantage l’attention du public. Mais ce lieu commun de la rhétorique classique, la captatio benevolentiae, modernisé et désormais surinvesti, a changé de statut : il était réservé à l’exorde (séduire avant de passer aux choses sérieuses), il devient une fin en soi. Et il se transforme ainsi en piège. Car les acteurs politiques ne sont plus sollicités pour ce qu’ils sont ou ce qu’ils font, mais plus simplement pour divertir : on rit, mais aussi et peut-être surtout, on rit d’eux.
Ces deux tendances télévisuelles (l’intime et le divertissement) n’ont jamais cessé depuis lors de travailler un peu plus les représentations médiatiques du politique. En 1992, alors qu’elle exerce les fonctions de ministre de l’Environnement, Ségolène Royal invite les équipes de télévision de TF1 et Antenne 2 à la maternité où elle vient d’accoucher de Flora, son quatrième enfant, pour célébrer une « première » dans l’histoire de la République, l’accouchement d’une ministre en exercice : « J’ai hésité, c’est vrai que ce n’est pas facile, déclare Ségolène Royal dans le reportage d’Antenne 2, parce que c’est en même temps une vie privée, donc à laquelle on a droit, mais en même temps, c’est vrai que c’est assez exceptionnel, et je le fais aussi pour la cause des femmes
». En 2001, Michel Rocard, invité sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, de Thierry Ardisson, accepte de répondre à une interview « Alerte rose ». Après avoir dû se prononcer sur cette question (« Est-ce que vous préférez une femme qui baise bien mais qui est infidèle ou une femme qui baise mal mais qui est fidèle ?
»), l’ancien Premier ministre doit encore trancher sur l’interrogation suivante : « Est-ce que sucer, c’est tromper ?
». En 2013, Laurent Wauquiez, alors vice-président de l’UMP, est encore interrogé par Thierry Ardisson dans le cadre de l’émission Salut Les Terriens. Lorsque l’animateur lui demande s’il est « porno », l’homme politique répond : « Non. Mais j’aime bien le sexe
». Thierry Ardisson enchaîne en lui demandant s’il consulte des sites pornographiques. Ce à quoi il répond : « Oui, comme tout le monde
». Processus incrémental, l’intimisation du politique ne semble plus avoir de fin, comme en témoigne encore l’un des derniers programmes en date du genre, Ambition intime. À la croisée de l’infotainment et de la télévision de l’intimité, l’émission qui est animée par Karine Lemarchand illustre parfaitement cette manière toujours plus prégnante et dépolitisée de traiter de la politique. En cherchant à « tuer les clichés qui systématiquement encadrent leur réputation
», pour reprendre le discours officiel de l’émission, le programme entend ainsi montrer que les acteurs politiques ne seraient pas ceux que l’on croit et s’intéresse, dans cette perspective, à l’ordinaire de leur vie. Mais en procédant de la sorte, l’émission ne fait finalement que rendre ces candidats un peu plus ordinaires, tendant à faire oublier ce qu’ils sont fondamentalement mais plus encore qui ils sont politiquement. Le cas de Marine Le Pen apparaît à ce titre exemplaire. Invitée à deux reprises, en 2016 et en 2021, l’ancienne présidente du Front national a pu s’y exprimer librement sur sa passion pour le jardinage (« contribuer à embellir le monde quand on fait fleurir une fleur
»), sur son amour des chats, sur son père ou encore sur sa colocation avec Ingrid, sa meilleure amie, sans jamais que le programme, les idées, le discours du RN ne soient abordés. On comprend dès lors que l’émission ait pu être perçue comme participant de sa stratégie de dédiabolisation, qui consiste précisément à effacer les racines et les orientations extrême-droitières du parti, sans modifier pour autant ses principes.
La dilution médiatique du politique est un processus qui est toujours en cours, donnant l’impression qu’il devient désormais impossible d’appréhender la politique en elle-même et pour elle-même. Ainsi, poussant l’abandon du rôle qui les définit comme tels (maire, ministre, etc.) jusqu’à la métamorphose, les acteurs politiques n’en finissent pas de se donner en représentation pour ce qu’ils ne sont pas. On les invite ainsi à participer à des programmes de télé-réalité censés leur permettre de mieux comprendre ce qu’est… la réalité. Diffusée le temps d’une soirée sur D8 en décembre 2014, l’émission Politiques Undercover avait pour vocation de proposer à des femmes et à des hommes politiques de se fondre, déguisés, dans la vie quotidienne des Français : Samia Ghali (sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire du 8e secteur de Marseille) en secrétaire à la recherche d’un logement ; Thierry Mariani (ancien ministre des transports sous François Fillon, ancien membre de l’UMP, membre du RN) dans la peau d’un handicapé en fauteuil roulant ; le député (Les Républicains) et ancien président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, en brancardier dans un service des urgences.
De même, ils s’éloignent de l’interaction avec des journalistes pour se rapprocher des influenceurs, espérant ainsi toucher les jeunes, que ce soit sur Youtube, comme Emmanuel Macron avec McFly et Carlito, ou dans les entretiens avec les candidats à la présidentielle, menés sur sa chaîne par l’influenceuse Magali Berdah, qui a été chroniqueuse chez Cyril Hanouna.
3. L’hypermédiatisation numérique du politique
Comprendre comment un animateur peut en venir à insulter un député sur un plateau de télévision implique enfin de s’intéresser aux conséquences de l’hypermédiatisation sur les modalités de traitement médiatique du politique. Par hypermédiatisation, il faut entendre un phénomène aussi récent qu’inédit d’intensification des modalités de production et de diffusion médiatiques engendré tout à la fois par :
- la généralisation d’appareils personnels de production et de consommation d’informations : 95,7% des ménages possèdent un téléphone portable, 82,8% un ordinateur (fixe, portable, tablette ou netbook). Si les inégalités d’équipement persistent en fonction du niveau de vie44, on ne compte pas moins de 5,5 écrans en moyenne par foyer pour regarder de la vidéo45 ;
- la généralisation de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux numériques : 85,6% des ménages possèdent une connexion internet ; 77 % de la population âgée de 15 ans ou plus déclarent être équipée d’un téléphone mobile46. En France, on dénombre 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Facebook, 26,5 millions pour Instagram, 16,1 millions pour Twitter, 15 millions pour Tik Tok, dont le temps moyen d’utilisation par jour s’élève à 95 minutes (4 fois la durée moyenne passée sur Snapchat, 3 fois sur Twitter, 2 fois sur Facebook et Instagram) ;
- la généralisation d’un mode de production de l’information ininterrompu, soutenu notamment par le développement des chaînes d’information en continu, de plus en plus prescriptrices dans les modes d’appréhension de l’actualité.
Dans ce nouveau régime médiatique, jamais l’information n’a été produite avec une telle intensité, densité et rapidité. Chaque minute, dans le monde, en 2021, ce sont 2 millions de snaps qui sont envoyés, 583 000 tweets qui sont postés, 167 millions de vidéos qui sont visionnées sur Tik Tok, 240 000 photos qui sont publiées sur Facebook, 184,9 millions d’emails qui sont rédigés. En 2010, Eric Schmidt, alors président exécutif de Google, rapportait qu’il faudrait une capacité de mémoire de 5 exaoctets (5 milliards de milliards) pour enregistrer tous les mots qui ont été prononcés par les êtres humains depuis l’origine de l’humanité jusqu’en 2003. En 2010, il était généré près de 5 exaoctets de contenu tous les 2 jours47. En 2013, il ne fallait plus que 10 minutes48. Combien aujourd’hui ?
Condensation et propagation
Ce nouveau régime médiatique signe la fin de la domination de la télévision et le début de l’hégémonie des plateformes numériques. Le changement de régime affaiblit la capacité du système médiatique à structurer l’agenda politique, à identifier les enjeux qui intéressent l’opinion publique et à les expliciter, à dessiner les lignes de clivages entre les forces politiques pour faciliter la formation des opinions des citoyens. Le nouveau rapport de forces entre réseaux sociaux, médias d’opinion d’un côté et médias d’information de l’autre, se repère dans la volatilité de l’agenda, le fractionnement des publics et la brutalisation du discours politique. Dans les médias d’opinion, la recherche du clash conduit à une confrontation surjouée, où les points de vue extrêmes chassent les points de vue modérés. La reprise des extraits les plus violents sur les réseaux sociaux est poussée par les algorithmes de recommandation qui sélectionnent les contenus susceptibles de générer des clics et d’amplifier la polarisation. Cette propagation du message par les utilisateurs, stimulés par les algorithmes, génère aussi sa fragmentation. Ce sont des morceaux d’information qui circulent, décontextualisés, des citations approximatives, parfois volontairement déformées. Un message réduit à un seul mot ne peut plus être fragmenté. À cette condensation maximale répond l’expansion de l’interprétation. Le succès d’un « mot » se mesure à l’abondance des commentaires qu’il va susciter, préemptant la scène médiatique, capturant l’attention, et imposant son supposé contenu au détriment de tout autre49.
Ainsi le nouveau régime médiatique n’a pas seulement profondément affecté les comportements sociaux, en générant un niveau d’addiction particulièrement fort qui peut aller jusqu’à revêtir des formes pathologiques, comme la nomophobie. Il a également considérablement transformé les manières de faire des acteurs politiques, en accentuant les tendances existantes, et en produisant une évolution de la parole politique. L’imposition de Twitter comme principal support numérique de communication en politique a très largement consacré le processus de réduction discursive, en limitant encore un peu plus les modalités d’expression de la politique, tout d’abord à 140 signes puis, depuis 2017, à 280. Un format idéal (et économique) pour les journalistes, pour lesquels les tweets des acteurs politiques sont désormais devenus une source centrale d’information. La parole politique se trouve ainsi contenue dans un nombre de caractères qui n’a jamais été aussi restreint, lui retirant presque toute substance. Les usages politiques de Twitter par Donald Trump (46000 tweets entre 2009 et 2021, jusqu’à 468 tweets en une semaine en 2020) en offrent à ce titre une illustration presque caricaturale. Mais le point de contraction ultime de cette évolution discursive de près d’un demi-siècle réside assurément dans l’usage du hashtag, « élément technodiscursif
»50 censé pallier le nombre limité de signes disponibles sur le réseau, qui ne s’écrit qu’en un seul mot et ne souffre aucun espace. A force d’être condensé, le discours politique semble ainsi s’être évaporé – une évolution qui a donc commencé avec l’adaptation du discours politique à la télévision et qui se poursuit aujourd’hui avec les réseaux sociaux.
Cette contraction est un des signaux majeurs de la brutalisation des échanges. Le couple expansion / condensation est une propriété si générale du discours qu’elle accompagne toute notre éducation au langage (expansion : apprendre à développer – c’est la dissertation ; condensation : apprendre à réduire – c’est le résumé). Or, cette condensation connaît deux orientations possibles : la synthèse d’un côté (triomphe de la raison) et le cri de l’autre (triomphe de l’émotion). Le processus continu de condensation qui culmine avec les contraintes médiatiques (du pitch et de la pastille jusqu’au tweet) en arrive ainsi à la forme minimale du mot, là où se cristallise l’émotion dans le registre polémique : le juron et l’insulte.
Quant à la propagation, elle se manifeste par l’accroissement infini des possibilités d’énonciation sur les réseaux sociaux. Soumise à des contraintes minimales, chaque parole est légitime, et chacune a sa chance de percer le plafond de verre de la notoriété. Les like fonctionnent comme une élection en continu, et on peut voter cent fois par jour. Du même coup s’affaiblissent les moments politiques ritualisés de l’expression politique – les rendez-vous du calendrier électoral, attracteurs d’adhésion dans les régimes démocratiques. La possibilité d’expression permanente, libre et anonyme, a pour corollaire le désintérêt de l’expression ponctuelle instituée.
Temporalités médiatique et politique
La domination des médias sociaux et des médias d’opinion se traduit par un alignement de la temporalité politique sur la temporalité médiatique. Si les acteurs politiques n’ont finalement jamais cessé de se placer dans une perspective d’ajustement à la logique médiatique51, l’intensification et l’accélération de la production de l’information les contraignent désormais à adopter des pratiques de plus en plus en rupture avec les fondements de l’activité politique, autrement dit sans pouvoir prendre le temps de la réflexion, de la concertation et de l’évaluation. Le rapprochement des temporalités politique et médiatique jusqu’à l’impératif de simultanéité, telle que l’impliquent les médias numériques, devient une règle de production discursive.
La multiplication des effets d’annonce en est un résultat visible : « inverser la courbe du chômage », « réduire les déficits », « privilégier la transparence », « travailler plus pour gagner plus », « choc de simplification », « devoir d’efficacité », etc. Soit autant de mots le plus souvent dénués de substance politique, dont l’accumulation indéfinie « interdit la mémoire »52. On retrouve ici l’un des principes de la gouvernance présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui pouvait affirmer : « il y a 20 ans, on agissait, puis on communiquait. Moi je fais l’inverse. Le premier étage de l’action, c’est la communication
»53 – une pratique se traduisant également par un travail législatif souvent réalisé dans l’urgence pour mieux coller au fil événementiel de l’actualité (ce que l’on désigne sous l’appellation de « politiques émotionnelles » ou « politiques publiques médiatiques »).
D’où également une tendance croissante aux « sorties » médiatiques. Pour s’assurer une attention minimale dans une économie médiatique saturée, les acteurs politiques n’hésitent plus à recourir aux « coups d’éclats » – ce que François Hollande appelait la « stratégie du coup d’éclat permanent »54. Le cas récent de Sandrine Rousseau en offre une illustration idéal-typique puisqu’au prix de diverses déclarations (« Il faut changer de mentalité, pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité
») et révélations (« Julien Bayou adopte des comportements de nature à briser la santé morale des femmes
»), la députée Europe Ecologie Les Verts est parvenue pour un temps au moins à percer le brouhaha médiatique et à capter l’intérêt des médias. En témoigne le nombre conséquent d’articles qui lui ont été consacrés (avec notamment cette une de L’Obs datée du 29 septembre 2022, citant la formule de François Hollande : « Sandrine Rousseau. Le coup d’éclat permanent
») et qui permettent de comprendre que l’évaluation des acteurs politiques procède désormais moins de l’appréciation de leur action que de leur capacité à s’adapter à cette nouvelle économie médiatique pour s’y imposer – ce dont témoigne assez bien cet extrait d’un article de Marianne : « Capacité à cliver, mise en avant des émotions, maîtrise du nouveau tempo médiatique : en un an l’écoféministe s’est propulsée au rang des personnalités politiques de notoriété nationale. Dans son énergie comme dans ses excès, Sandrine Rousseau apparaît totalement en phase avec l’époque
»55.
D’où, encore, une exigence de synchronisation avec l’évènement en train de se faire. L’information étant produite et transmise en continu, les acteurs se doivent de se montrer également en continu, et si possible sur les lieux de production de cette information. Ainsi, rares sont les événements médiatisés sur lesquels ils ne sont pas sommés de faire acte de présence. Dans le cas contraire, les représentants politiques s’exposent désormais systématiquement à des coûts réputationnels, comme Dominique Voynet (alors ministre de l’Environnement) se refusant dans un premier temps, et au prétexte que « cela ne servirait à rien
», à quitter l’île de la Réunion où elle est en vacances pour se rendre sur les plages de Bretagne et constater les dégâts suite au naufrage du pétrolier Erika (1999) ; Georges W. Bush tardant à se rendre à la Nouvelle-Orléans pour y soutenir les populations frappées par l’ouragan Katrina, à l’origine de l’une des plus grandes catastrophes naturelles de l’histoire du pays (2005) ; le gouvernement de Manuel Valls indifférent pendant près de 48 heures au sort de Rémi Fraisse, jeune militant écologiste décédé sur les lieux du projet de barrage de Sivens – une position que le Premier ministre avait justifiée en arguant qu’« on ne fait pas de la politique en courant après l’événement
» (2014) ; Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, annonçant le protocole sanitaire de la rentrée de janvier 2022 depuis l’île d’Ibiza, alors que la France connaît une nouvelle vague de Covid ; etc. Ainsi, la capacité gestionnaire des politiques semble dorénavant se mesurer à l’aune de leur capacité à gérer médiatiquement l’événement. L’accélération du temps médiatique est telle qu’elle conduit certains acteurs à tenter de le devancer pour engranger des profits de visibilité liés au fait d’être le premier à réagir. Mais de telles pratiques peuvent s’avérer également coûteuses dès lors que la signification donnée à l’évènement est contredite par les faits. Elles deviennent alors vecteurs de frustration, suscitant l’impatience et la colère jusqu’à la violence. Ainsi en accusant des manifestants d’avoir cherché à s’introduire dans les locaux de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (alors qu’on apprendra un peu plus tard qu’ils tentaient de s’y réfugier pour échapper aux forces de l’ordre lors du défilé du 1er mai 2019 à Paris), le ministre de l’Intérieur de l’époque, Christophe Castaner, a pu se voir reprocher d’avoir « parlé trop vite
» et de « courir après l’information
»56. La temporalité médiatique sur laquelle s’indexe de plus en plus la temporalité politique tend ainsi à fragiliser les discours et les acteurs en responsabilité, jusqu’à la brutalisation du débat.
La brutalisation du débat politique
Le terme de brutalisation, tel que son sens a pu être actualisé par Romain Badouard57, désigne le « processus de banalisation et de légitimation de la violence dans le débat public
». Les origines de ce processus sont en grande partie de nature médiatique et sont à rechercher dans le développement des réseaux sociaux et des chaînes d’information en continu. Un principe relie les régimes discursifs qui sont au fondement de ces médias : celui de la polémique continue. Tandis que les chaînes d’information qui ont choisi de devenir des chaînes d’opinion célèbrent le culte du clash58, les médias sociaux se nourrissent de la haine en ligne59. La possibilité d’entrer directement en contact avec son interlocuteur, l’absence de médiation dans les échanges, l’anonymat derrière lequel peuvent se retrancher trolls et haters pour s’exprimer en toute impunité, les formats d’écriture, souvent courts, qui favorisent des dynamiques de simplification et de radicalisation des propos, les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, qui tendent à privilégier des contenus violents (ou mensongers) car davantage générateurs d’audience, la faiblesse des moyens mis à disposition des plateformes gouvernementales pour permettre un traitement efficace des centaines de milliers de signalements qui sont faits chaque année par des internautes… Toutes ces propriétés des réseaux sociaux ont créé les conditions d’énonciation d’une parole relâchée et violente vis-à-vis des acteurs politiques sur Internet, qui se retrouvent moqués, stigmatisés, insultés, menacés. Ils sont les cibles principales de la violence verbale et du discours de haine.60
Ce nouveau dispositif a également modifié les modalités de prise de parole des acteurs politiques. Ce qui est désormais attendu d’eux, c’est qu’ils s’affranchissent des règles du discours politique autorisé, qu’ils subvertissent les fondements de la discussion raisonnée, qu’ils transgressent et agressent. De la petite phrase on est ainsi passé à la punchline, du débat à la dispute61, du duel au clash. En conséquence,la politique ne se joue plus réellement sur la base d’un affrontement argumentatif ou idéologique, mais à travers des altercations où tous les coups verbaux semblent permis. Ces pratiques discursives sont certes presque aussi anciennes que la politique62. Mais ce qui est remarquable, c’est leur installation comme nouvelle norme de discours. Or cette norme semble désormais valoir pour tous les acteurs politiques, y compris ceux qui exercent les plus hautes fonctions (ou qui aspirent à les exercer), et donc a priori les moins à même de s’y plier. On pense par exemple aux propos d’Emmanuel Macron en janvier 2022 : « les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder
»63. Cet écart par rapport aux attendus langagiers d’un président de la République a pour le moins surpris – le chef de l’État s’exprimant le plus souvent dans un vocabulaire châtié – et a produit l’effet escompté : générer du buzz. Il reste qu’en parlant de la sorte, Emmanuel Macron détourne aussi l’attention : la question centrale des modalités de l’action publique sanitaire (alors débattue au Parlement) disparaît derrière celle de savoir si le président de la République a « dérapé » ou bien marqué des points en termes de communication. La politique s’efface derrière la polémique. D’autres exemples impliquant des chefs d’Etat en exercice ou des candidats à la présidence peuvent être encore pris dans l’actualité récente : on pense par exemple au débat du 29 septembre 2020 entre Joe Biden et Donald Trump, où les deux prétendants n’ont cessé de s’invectiver, ou aux propos haineux que se sont échangés Luiz Inacio Lula da Silva et Jair Bolsonaro lors de leur affrontement télévisé du 29 septembre 2022. Même au sommet, le langage politique semble s’égarer vers la vulgarité et la violence.
Ces pratiques discursives trouvent un écho amplifié dans les émissions dont le dispositif repose sur l’exploitation de la polémique. Dès lors, etsous prétexte de chercher à conquérir un électorat qu’ils ne parviennent pas à atteindre par d’autres moyens, les acteurs politiques finissent par contribuer eux-mêmes à la dégradation de la parole publique. Il suffit, pour s’en convaincre, de visionner un extrait du débat opposant Eric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon lors de l’émission « Face à Baba » animée par Cyril Hanouna, le 28 janvier 2022. Rien n’y est audible, sinon les propos particulièrement virulents échangés entre les deux prétendants à la présidence de la République. Précisons que cette séquence aura permis à la chaîne C8 de se hisser à la troisième position des meilleures audiences réalisées pendant la soirée, en réunissant 1,8 million de téléspectateurs.
L’imposition d’un nouveau régime de véridiction
Ce qui a également changé avec l’hypermédiatisation, ce sont les modalités du vrai et du faux en matière d’information. Il y a une quarantaine d’années, les médias (certes placés sous la coupe de l’État en ce qui concerne la radio et la télévision) étaient encore en mesure d’offrir un socle d’informations similaires, partagées par l’ensemble des citoyens. L’établissement des faits se faisait de manière relativement consensuelle, et l’affrontement des points de vue s’opérait à partir d’un « forum central » avec une unité de temps, de lieu et de public64. Trois principes caractérisent alors l’information : l’équilibre dans l’octroi de la parole aux différentes sensibilités politiques (au mépris cependant des tendances les plus extrêmes) ; la modération (les journalistes s’interdisant jugements de valeurs et expression d’opinions personnelles) ; l’indépendance (dans le respect des institutions et du pouvoir politique, les journalistes adoptant une distance critique à l’égard des différents agents d’influence du pouvoir).
C’est ce cadre, qui permettait un débat civil sur un agenda politique négocié, que le nouveau régime médiatique a fait voler en éclat. Les télévisions et radios généralistes mettaient sous les yeux de tous les citoyens le même message politique, au même moment. Aujourd’hui, c’est l’inverse : des messages différents, des moments différents, des cibles différentes. Le forum central s’est désintégré au profit d’un chaos informationnel fait de micro-messages, d’informations personnalisées et de bulles de filtres. La délibération devient impossible : le débat est désynchronisé, l’information est désaffiliée et le plus souvent impossible à sourcer, tant les modalités de son émergence sont multiples et opaques.
L’affaiblissement des principes de neutralité et de modération du débat public a repoussé de manière inédite les limites du dicible. Tout sujet polémique, aussi mineur soit-il, est susceptible de devenir un sujet majeur de l’agenda politique. Et les polémiques se succèdent sans discontinuer.
Ces logiques sont tout à la fois plurielles et complexes, mais elles permettent de comprendre les conditions d’avènement de ce que l’on nomme l’ère de la « post-vérité » (terme forgé par Steve Tesich en 1992 et popularisé en 2004 par Ralph Keyes). Comme le résume Christian Salmon, « ce n’est pas tant que le mensonge soit devenu la norme et que la vérité soit interdite ou exclue, c’est leur indifférenciation qui est désormais la règle. Vérité et mensonge. Réalité et fiction. Toutes ces oppositions, et donc ces catégories, ont été dynamitées »65. Certes, les rumeurs, fausses vérités ou vérités alternatives en politique ne datent pas d’hier66. Mais ce nouveau régime d’énonciation a entraîné une modification majeure : la croyance dans la capacité véridictoire du discours politique s’est effondrée, et les acteurs politiques ont pris une part active à ce phénomène, à commencer par Donald Trump. L’équipe de fact-checkers du Washington Post a estimé que le président républicain avait délivré 30 573 mensonges et approximations au cours de son mandat, concernant notamment les chiffres de l’emploi, l’économie, ou la pandémie de Covid-19. Ainsi, pendant quatre années, le président des Etats-Unis n’aura jamais cessé de mentir, jusqu’à mettre en péril la démocratie américaine en arguant du vol de l’élection et encourageant l’assaut de ses soutiens sur le Capitole.
_
La banalisation de la violence politique résulte donc d’un lent processus de dégradation de la parole politique. Appauvrissement, rétrécissement, dépolitisation, brutalisation, sont les symptômes de cette dégradation. Ils permettent de mieux comprendre comment un animateur peut aujourd’hui s’autoriser à s’adresser avec autant de violence et de mépris à un élu de la République.