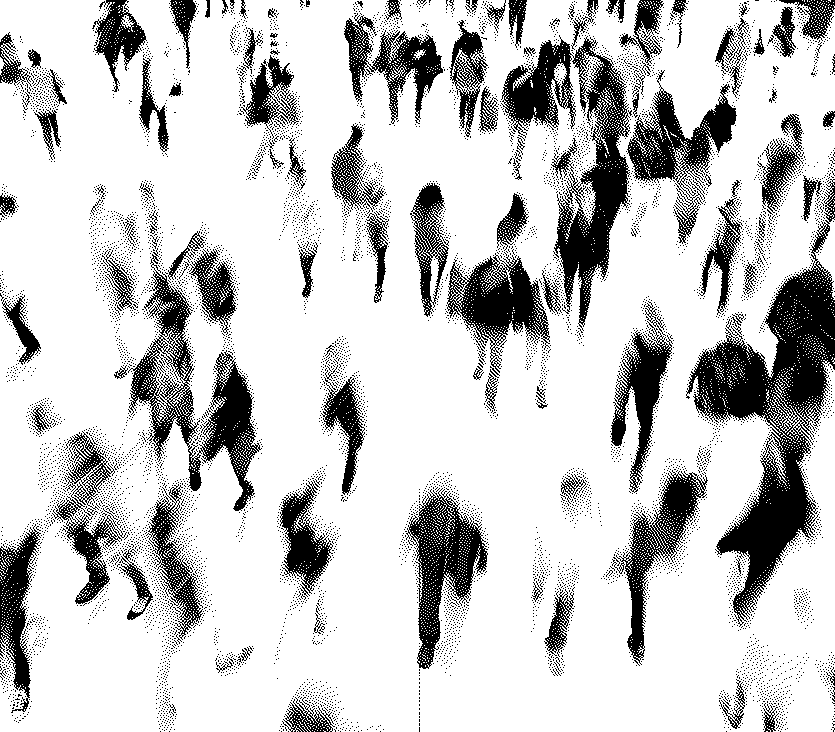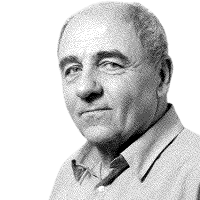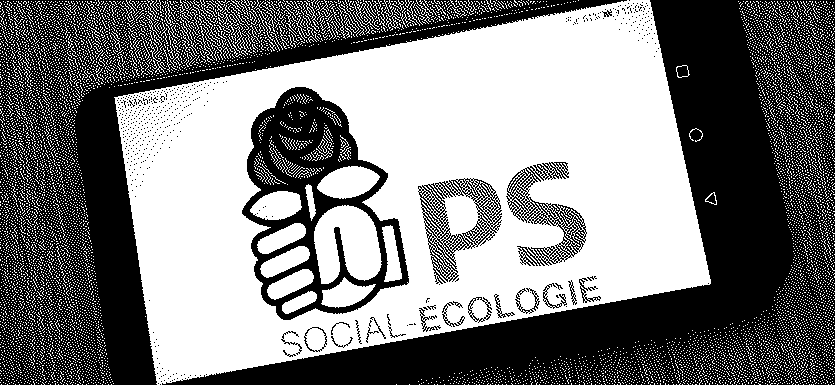Ainsi naquit la NUPES, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. En quelques jours a surgi l’acronyme de la discorde. Cette union de la gauche et des écologistes, qui semblait impossible pendant la campagne présidentielle, s’est nouée sans difficultés juste après. Et très vite aussi, des voix se sont élevées contre elle. Le clivage entre ceux qui la soutiennent et ceux qui s’y opposent, a une forte dimension générationnelle. Au point que certains défenseurs de l’accord revendiquent cette rupture entre générations comme l’un des aspects positifs de l’union. Ils sont enfin débarrassés des éléphants. Byebye boomer. Les millenials prennent le pouvoir. Peut-on trouver une signification politique à ce clivage ?
Il est vrai que les vieux kroumirs de la gauche et de l’écologie sont particulièrement remontés contre cette soumission de leurs partis à la France insoumise. Bernard Cazeneuve annonce son départ du Parti Socialiste dans ces termes : « l’indépendance de la nation n’a jamais signifié la rupture de ses alliances militaires ni l’accommodement avec des régimes autoritaires ou des dictatures, sur notre continent ou sur d’autres » et « la réorientation des politiques de l’Union ne saurait se traduire par la destruction du projet européen qui permettrait à d’autres de décider, à notre place, de notre destin
». François Hollande fustige un accord électoral qu’il considère comme une reddition, Jean-Christophe Cambadélis et Stéphane Le Foll sont à l’unisson et actent « la fin du parti socialiste
». Du côté des écologistes, Daniel Cohn Bendit, José Bové et Jean-Paul Besset signent dans Le Monde une tribune (L’accord des Verts avec la France insoumise est une escroquerie) qui commence ainsi « N’avez-vous pas honte, camarades d’Europe Ecologie-Les Verts ? Passer un pacte avec les souverainistes de La France insoumise, ouvrant la voie du renoncement à d’autres mouvements de pensée qui ont construit le progrès humain à travers les âges, revient, à nos yeux, à sacrifier l’essentiel : le principe démocratique ; son universalité et son intangibilité.
»
Il est tout aussi vrai que les responsables du PS qui appartiennent à la génération suivante, éprouvent un sentiment de libération à l’égard de la tutelle des éléphants et ne s’en cachent pas. Olivier Faure dit par exemple, lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro du 8 mai : « On ne parle que des barons, pas des gens modestes… ceux-là se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant
». Et Pierre Jouvet, le négociateur PS de l’accord, s’emporte : « Si la gauche en est là aujourd’hui, c’est de la faute de qui ?… Qui a fait que la gauche qui était aux responsabilités, qui avait tous les pouvoirs, s’est retrouvée écroulée ? Ce n’est pas la responsabilité de ma génération ! Je dis aux éléphants : laissez-nous faire, vous avez sabordé le parti quand il était au plus haut niveau. Maintenant ça suffit, laissez-nous avancer !
»
Le conflit de générations est donc très clairement posé, du moins du côté des millenials. Comment l’interpréter ?
Une première différence saute aux yeux : les boomers sont des « anciens ». Ancien Premier ministre, ancien Président de la République, anciens ministres, anciens députés européens, ils ont fait leur vie et ne sont plus partie prenante. Les millenials, eux, sont au mieux députés sortants et plus souvent aspirent à le devenir. Ils en ont marre d’attendre et l’élection présidentielle a réduit spectaculairement leurs perspectives d’accès au pouvoir. Ils ont une carrière politique à construire. Ils considèrent que cet accord est une condition de leur survie politique. Banale divergence d’intérêts donc, mais cela ne suffit pas à expliquer le haut-le-cœur ressenti par les boomers. Il y a plus.
La seconde différence est aussi une affaire d’âge. C’est l’expérience vécue du « socialisme réel ». Les boomers sont nés entre 1943 et 1960, leur formation politique s’est faite au contact du totalitarisme soviétique, la question de la frontière entre social-démocratie et communisme était au cœur de tous les débats. L’idée que le contrôle total de l’Etat sur l’économie débouche sur la dictature était devenue évidente à gauche, après des décennies de confrontations et d’invectives. Et il était admis également que l’économie administrée n’apporte ni la prospérité, ni la réduction des inégalités. La social-démocratie européenne de l’après-guerre s’est construite sur ce socle. Les générations entrées en politique après la Chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’empire soviétique, n’ont pas la même culture et leur perception de la frontière entre démocratie et totalitarisme est beaucoup plus floue. Le populisme de gauche, la percée des démocraties illibérales, l’assimilation du libéralisme au néo-libéralisme ont déplacé les lignes et créé une confusion idéologique. L’oubli a fait le reste. Le goulag ? Quel goulag ? Pour la nouvelle gauche, la liberté n’est plus une vertu cardinale, et l’Etat de droit pèse parfois moins lourd qu’une souveraineté populaire réduite à l’expression du suffrage et des majorités du moment. Dans le texte de Bernard Cazeneuve, comme dans celui de Jean-Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn Bendit, la guerre en Ukraine occupe une place fondamentale, alors qu’elle est totalement absente de l’accord signé par le Parti Socialiste et les Verts avec la France Insoumise. Un silence assourdissant.
Un dernier élément doit être pris en compte. C’est l’affaiblissement de la place du programme dans la négociation d’un accord. Le « programme » de la NUPES est sorti plusieurs jours après la signature des accords d’investiture entre les partis, qui ont occupé la plus grande partie des négociations. Le statut du « programme » ressemble de plus en plus à celui des Conditions Générales d’Utilisation (les fameuses « CGU ») que nous passons notre temps à accepter, sans les lire, pour accéder aux applications de nos smartphones. Pour la plupart des utilisateurs, valider des CGU n’est pas consentir, et personne ne réfléchit vraiment aux conséquences considérables de ces validations. Il suffit pour s’en convaincre de mesurer l’incroyable désinvolture de Julien Bayou, le patron d’Europe Ecologie Les Verts, à l’égard des désaccords programmatiques de la NUPES. “Il y a des désaccords qui sont constants. Ils ne sont pas nouveaux. Au Parlement européen, nos groupes écologistes et insoumis votent très différemment sur les sanctions à l’égard de la Russie ou autre”, note-t-il, mais “l’international n’est pas vraiment le domaine de l’Assemblée, quoi qu’on en pense. Sous la Ve République, c’est le domaine de la Présidence”. Et il semble ignorer que sur la question essentielle de la livraison d’armes à l’Ukraine, le désaccord est total : “Je n’ai pas le sentiment que la France insoumise, aujourd’hui, dit que livrer des armes à l’Ukraine est une bêtise
”, tente-t-il, avant d’être interrompu par les journalistes en plateau: “si, si
”. “Elle continue de le dire ?
”, s’interroge-t-il alors, avant de consentir à cette autre divergence : “Je trouve effectivement que c’est un point de désaccord.
” Et d’ajouter: “on a mis ça de côté
”. C’est simple la politique, après tout.
Par une ruse dont l’histoire est coutumière, cet adieu aux boomers de la gauche et de l’écologie se fait à travers un programme dont le parfum rétro est capiteux. D’ailleurs beaucoup de ses défenseurs soulignent sa ressemblance avec le Programme Commun de Gouvernement négocié entre socialistes, communistes et radicaux de gauche en 1973–74, pour affirmer une continuité historique. Ils oublient ou font semblant d’oublier qu’à l’issue des élections législatives de 1973, le rapport de forces entre socialistes et communistes était équilibré, et que François Mitterrand avait placé trois verrous dans cette négociation : l’Alliance Atlantique, l’Europe et les institutions. Ce sont précisément ces trois verrous qui ont sauté dans le programme de la NUPES et qui provoquent l’ire des boomers. Ils oublient aussi qu’il n’a pas fallu deux ans, après l’élection présidentielle de 1981, pour que les socialistes ouvrent la « parenthèse de la rigueur », dont les insoumis disent qu’elle ne fut jamais refermée, malgré les multiples budgets en déficit et l’augmentation continue de la dette publique. La controverse en cours entre Terra Nova et Jean-Luc Mélenchon montre que cette question du réalisme du programme économique est toujours ouverte. Elle est au cœur de la fracture entre gauche de gouvernement et gauche de protestation, mais comme socialistes et verts ne croient pas vraiment que la NUPES puisse gagner ces élections, elle aussi est « mise de côté ».
La social-démocratie française a ceci de particulier qu’elle a toujours été fascinée et presque subjuguée par l’idée révolutionnaire, le fantasme de la rupture avec le capitalisme, le fait d’appartenir à la « vraie gauche »1. C’était vrai en 1981, ça l’est de nouveau en 2022. Olivier Faure a résumé cela lors du Conseil National du PS qui a entériné l’accord avec les insoumis, en appelant les socialistes à retrouver « une expression, une capacité à embrasser le mouvement social, ne pas nous limiter à dire que nous serions simplement faits pour gouverner
».
La question est donc toujours la même : peut-on sortir de la fascination pour l’extrémisme de gauche ? Les millenials et la génération Z pourront-ils apprendre à faire la différence entre radicalité (s’attaquer à la racine des problèmes) et extrémisme (pousser une position jusqu’à l’absurde) ? Leur perception de l’urgence écologique les incite à confondre l’une avec l’autre. Beaucoup d’entre eux sont séduits par la « rupture avec le capitalisme » et voient dans la démocratie libérale, un obstacle à l’aspiration révolutionnaire. Cette idée que la pureté politique réclame une rupture unique et brutale, quelles qu’en soient les conséquences, est toujours bien vivante. Elle s’ancre dans une conception non seulement religieuse mais intégriste de la politique.
Bruno Latour a montré que l’écologie politique pouvait difficilement se fondre dans un grand récit révolutionnaire2. Elle réclame des alliances multiples, elle se décline dans des conflits divers, elle change le paradigme politique. Mais les résultats de la présidentielle 2022 prouvent que la fascination pour les extrêmes demeure puissante au sein des jeunes générations.
La NUPES sera-t-elle un feu de paille qui, par une autre ruse de l’histoire, annoncera l’agonie de l’extrémisme comme horizon indépassable de la gauche, comme en mai 68, l’efflorescence de tous les gauchismes a signé le crépuscule du marxisme-léninisme ? Ou au contraire va-t-elle installer durablement dans le paysage politique français, une extrême-gauche vintage et impuissante, qui fera de l’agit-prop son fonds de commerce ? Si les nouvelles générations de responsables écologistes et socio-démocrates veulent traiter les problèmes de la société française à la racine, il leur faudra vaincre le vertige de l’extrême. Et dire byebye au plus boomer d’entre tous, un certain Jean-Luc Mélenchon.