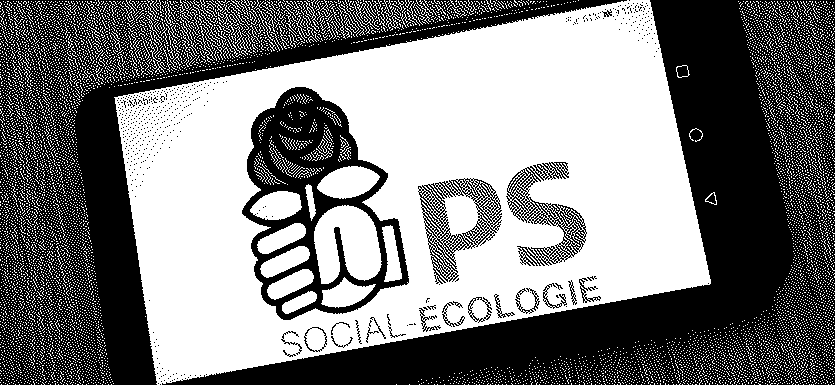L’intention peut surprendre de la part de celui qui fut longtemps identifié à une gouvernance verticale et jupitérienne. Elle n’en répond pas moins à une nécessité : non seulement parce que cet engagement correspond aux attentes de l’opinion et parce qu’il complète les rouages habituels de la démocratie représentative, mais aussi parce qu’il est de nature à consolider une légitimité de plus en plus fragilisée par la fragmentation des suffrages et la polarisation de l’offre politique. Sa mise en œuvre nécessitera toutefois de la méthode et de la constance dans l’exécution car, dans ces domaines, il y a loin de la coupe aux lèvres.
1. Être gouverné, oui, mais de façon plus attentive
Octobre 2021. 50 Français recrutés par BVA pour la Grande Conversation sont invités à répondre à la question : quelles qualités attendez-vous du prochain Président de la République ? Sur le forum en ligne, les participants énumèrent les valeurs traditionnellement associées à la fonction : courage, autorité, indépendance, détermination… Mais très vite ils insistent sur une autre dimension : « l’écoute et la proximité ». Ils veulent que le ou la futur(e) Président(e) de la République « sache écouter et comprendre
» : « Par exemple, cette grande conversation que nous menons devrait être organisée par le gouvernement lui-même afin qu’il comprenne ce que les Français attendent de lui
», confie l’un d’eux.
Cette attente porte un désir d’expression : entre autres épisodes du quinquennat finissant, le Grand Débat national et la Convention citoyenne pour le climat ont montré que les Français ont de l’appétence pour la discussion publique et qu’ils ne s’y dérobent pas. Elle porte également un besoin de reconnaissance : le sentiment de ne pas être écouté voisine avec le reproche d’une forme de mépris, voire d’arrogance, que le président-candidat a pu expérimenter à ses dépens ces cinq dernières années. Mais elle souligne aussi l’épuisement d’un régime de représentation réduit à un simple geste de délégation du pouvoir : dans l’esprit des membres de la communauté citoyenne, le « bon gouvernant » est au contraire celui qui, fort du mandat qui lui a été confié par les électeurs, construit avec eux une relation continue d’échange et d’interaction.
Ce qui s’exprime ici, ce n’est pas le refus d’être gouverné : la proximité et l’attention n’écrasent ni ne contredisent les qualités du répertoire gaullien mises en avant par les participants (courage, autorité, indépendance, etc.). Le dénivelé entre gouvernants et gouvernés n’est pas contesté : l’exécutif demeure une instance de décision et de commandement dans l’esprit des citoyens ; la demande d’ordre et d’autorité publique n’a peut-être même jamais été aussi forte depuis longtemps et elle cohabite avec une demande d’efficacité des politiques publiques… Toutefois, aux yeux des citoyens, l’élection ne donne pas seulement à l’élu un mandat pour décider : elle marque aussi le début d’un dialogue entre gouvernants et gouvernés. Les citoyens consultés veulent être gouvernés, mais de façon plus attentive et plus interactive.
N’en déplaise aux partisans d’une VIe République, dans les rangs de la communauté citoyenne, personne ne demande pour cela un grand soir institutionnel. La réponse classique des libéraux politiques (division et équilibre des pouvoirs, surveillance de l’exécutif, etc.) ne dit rien de ce qui préoccupe en l’espèce les citoyens : la manière dont on doit non pas contrôler démocratiquement le gouvernement, mais gouverner démocratiquement. L’exécutif reste aux yeux de la plupart des libéraux politiques un organe d’exécution qu’il s’agit de contrôler et de limiter alors qu’il a pris partout la dimension d’un organe d’initiative, de fabrication des normes et de mise en mouvement de l’action publique. Les citoyens l’ont compris et, dans l’ensemble, accepté. Ce qu’ils demandent à présent, c’est que la relation de pouvoir ne soit pas une relation de domination et qu’elle ne leur retire pas la totalité de leurs compétences. Une demande que Pierre Rosanvallon avait parfaitement située dans son livre Le bon Gouvernement (Paris, 2015).
Ce qu’il s’agit de transformer si l’on veut répondre à cette demande, c’est la façon même de faire vivre les échanges entre l’exécutif et la société. Pour l’essentiel, le changement se joue dans l’usage du pouvoir au quotidien et l’organisation de sa relation avec les gouvernés. C’est la philosophie pratique du pouvoir exécutif qu’il faut renouveler pour jeter les bases d’une « démocratie d’interaction » (Rosanvallon) qui organise des rendez-vous en dehors des élections, structure l’écoute, anime la délibération collective, recherche les voies du consensus… En somme, le pouvoir exécutif n’est pas un organe qui veille et agit pendant que la société dort ; c’est un organe de décision qui, en s’éclairant des retours de la société, la stimule et donne à chacun la possibilité d’exister comme citoyen actif en face de lui.
« Gouverner ensemble », c’est donc déconfiner l’exercice du pouvoir et apprendre à gouverner avec les Français : avec le conseil des citoyens, des forces productives, des territoires, des scientifiques, etc.
2. Les nouveaux habits de Bonaparte ?
La proposition soulève cependant un point de discussion auquel il faut s’arrêter. Il ne va pas de soi que cette « démocratie d’interaction » doive prioritairement se réaliser dans les relations entre gouvernés et gouvernants. Elle pourrait être pensée au contraire et même prioritairement dans la relation entre représentés et représentants, ce qui n’est pas la même chose. L’engagement qui est pris ici l’est au titre de l’exécutif et non du Parlement. D’aucuns y verront assurément une forme de « bonapartisme » ou encore la préfiguration d’une forme de régime quasi-plébiscitaire à l’âge de la démocratie d’opinion, plaçant systématiquement en face-à-face le Président de la République et les Français.
Cette critique qui avait déjà fait florès au moment du Grand Débat national, ne me semble pas parfaitement recevable dans la circonstance. Pour deux raisons. La première est que, telles qu’elles se dessinent dans le programme du président-candidat, les formes de cette démocratie d’interaction ne procèdent pas fondamentalement d’un face-à-face personnel entre le chef de l’Etat et les Français. Si l’on examine ce programme, elles épousent presque toujours la même matrice : 1) l’exécutif formule le problème à résoudre et les objectifs à atteindre, 2) des parties prenantes délibèrent des voies et moyens pour atteindre ces objectifs, 3) l’exécutif décide enfin (actes réglementaires, projet de loi, crédits budgétaires…) éclairé des propositions des citoyens ou des parties prenantes, ou facilite la conclusion d’accords sectoriels voire de quasi-contrats locaux.
Qu’il s’agisse des grandes concertations annoncées sur l’école ou l’offre de soins dans les déserts médicaux, des négociations sectorielles et territoriales dans le champ de la transition écologique, d’exercices de délibération citoyenne (comme la convention citoyenne proposée sur la fin de vie) ou encore de l’ouverture à la démocratie sociale sur les sujets sociaux, les formes envisagées ne consistent en tout cas pas dans un face-à-face entre le chef de l’Etat et les citoyens français. L’expérience de la Convention citoyenne pour le climat a même clairement montré que ce genre d’audaces démocratiques pouvait déboucher sur des positions contrastées par rapport à celles de l’exécutif. La place accordée dans ce type d’exercice à la délibération contradictoire cadre en effet très mal avec un quelconque bonapartisme. En réalité, loin de les dissoudre, ces exercices sont susceptibles de construire de nouvelles médiations.
En somme, les opposants à Emmanuel Macron s’échinent à déceler partout les indices d’un nouveau césarisme là où se jouent au contraire, pour l’ancien apôtre du jupitérisme, un défi de réinvention des formes démocratiques du pouvoir exécutif.
3. Conjurer le risque de l’impouvoir
La seconde raison est que cette focalisation sur la relation gouvernants/gouvernés est d’abord l’effet de nos institutions avant d’être celle d’un programme ou d’un leader. Il serait certes souhaitable d’approfondir les interactions entre représentants et représentés, c’est-à-dire entre Parlement et citoyens. J’ai moi-même proposé en ce sens que les prochaines conventions citoyennes se tiennent dans le sein du Parlement pour en revivifier l’esprit de délibération et pour matérialiser la complémentarité du travail parlementaire et de ces initiatives. Mais, nos institutions étant ce qu’elles sont et le Sénat faisant systématiquement obstacle à leur révision, si modeste fût-elle, cela ne serait en pratique d’aucun secours. Pire, cela pourrait creuser un peu plus les frustrations : les représentés ainsi mobilisés mesureraient en effet très rapidement les très faibles marges de manœuvre d’une assemblée dont la majorité des membres ont été élus dans le sillage et sous les couleurs du Président et sont en réalité, bon gré mal gré, ses obligés.
A l’inverse, à institutions constantes, il me semble urgent de démocratiser davantage l’exercice du pouvoir exécutif en tant que tel. Cette voie s’est cherchée depuis 2019, d’abord avec le Grand Débat national puis avec la Convention citoyenne pour le climat, deux prototypes dont il faut reconnaître les vertus et les limites. Elle pourrait et elle devrait se donner demain de plus vastes ambitions.
Qu’il revienne à celui qui incarnait naguère encore le jupitérisme de les porter est peut-être l’une de ces ruses auxquelles l’histoire nous a habitués. C’est François Mitterrand qui jeta les bases de l’Union économique et monétaire et accompagna le virage libéral de la mondialisation. C’est peut-être Emmanuel Macron qui devra jeter celles d’une démocratisation du pouvoir exécutif.
C’est d’autant plus urgent que la fragmentation et la polarisation de l’offre politique combinées aux effets du scrutin majoritaire à deux tours aux élections législatives aboutissent depuis vingt ans à des majorités fortes en droit mais faibles en fait.
D’un côté, nos institutions donnent mécaniquement à ceux qui gouvernent tous les moyens légaux de l’action publique, et à ceux qui les critiquent toutes les raisons de déplorer ad nauseam l’hyperprésidentialisation du régime. Elles installent les vainqueurs du suffrage dans l’illusion qu’ils pourront gouverner conformément au vieux « modèle de modernisation élitiste ». Bien décrit par Pierre Grémion1, ce modèle qui se forme à la fin de la IVe République et qui connaît son âge d’or dans les années 1960 repose sur trois piliers : 1) des leaders politiques qui « expriment la distance à la politique politicienne que recherche la haute administration et qui incarnent le volontarisme politique nécessaire au projet modernisateur
» (les figures tutélaires de cet idéal sont Mendès à gauche et De Gaulle à droite) ; 2) un Etat anticipateur qui « fait la leçon à la société
» et réunit toute une série d’outils d’analyse et de prévision au service de ce « pilotage global » ; 3) de « petits réseaux activistes et minoritaires
» travaillant « sur le mode de la conspiration
», baptisés « forces vives
» et réunis avec les représentants de l’Etat anticipateur dans le cadre du Plan, « sorte d’université parallèle de la décision publique, intermédiaire entre les machines administratives et le Parlement
». Cette vision de l’action publique va souvent de pair avec l’idée que la France est plus belle et plus grande que les Français eux-mêmes, et qu’il faudrait la servir presque malgré eux2.
Les présidents réformateurs du XXIe siècle ne se sont jamais véritablement remis de ce modèle et de son âge d’or. Bien que le Plan ait vécu, que les organisations représentant les « forces vives » se soient sensiblement affaiblies, que l’Europe et la décentralisation aient capté une partie du pouvoir d’exécution qui était celui de leurs ainés, la haute fonction publique a continué de se penser comme le siège de la rationalité technique et le copilote du pays au côté de leaders politiques qui ont continué à se rêver en Mendès ou en De Gaulle. L’idée d’une alliance entre des technocrates anticipateurs et des élus issus du suffrage universel est toujours au cœur de leur philosophie pratique de l’action publique, comme l’ont montré avec éclat les 18 premiers mois du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.
Or cette alliance de l’élu et du technocrate ne garantit plus à elle seule l’acceptabilité des réformes proposées, si tant est qu’elle y ait jamais suffi. Car, dans le même temps, nos institutions donnent aux gouvernants une assise toujours plus étroite dans la société : Emmanuel Macron ne totalise que 18% des inscrits au premier tour de l’élection de 2017 et moins de 44% au second ; quelques semaines plus tard, les candidats LREM remportent plus de 50% des sièges de l’Assemblée nationale en ayant rassemblé seulement 13,4% des inscrits au premier tour des législatives et 16,5% au second. En 2022, le candidat à sa réélection ne rassemble encore que 20% des inscrits au premier tour de la présidentielle et 38,5% au second.
Or rien dans notre système électoral et institutionnel n’encourage en réalité les candidats à la recherche d’un plus large rassemblement. Promettant au vainqueur de l’élection présidentielle au suffrage universel direct sa possible (quoique toujours hypothétique) confirmation aux élections législatives quelques semaines plus tard, les règles du jeu et l’expérience des cycles électoraux passés depuis vingt ans l’incitent au contraire à rechercher le plus large pouvoir institutionnel plutôt que la plus large assise populaire.
Le solde de cette arithmétique institutionnelle, c’est qu’à peine sorti des urnes, le pouvoir légal risque de devoir batailler avec le spectre de l’impouvoir. Face aux Bonnets rouges en 2013, face aux Gilets jaunes en 2018–2019, et dans bien d’autres situations encore, la division de la société a révélé la fragilité de notre système politique et a mis en exergue son côté « faux dur ». Ce risque de l’impouvoir sera peut-être encore plus fort en 2022. Guidées par la construction obsessionnelle de majorités homogènes et fortes permettant d’assurer la stabilité de l’exécutif, nos institutions finissent en réalité par le fragiliser dans la conduite pratique des affaires publiques.
Pour sortir de cette contradiction, il serait souhaitable de passer à un scrutin proportionnel (et non seulement à une « dose de proportionnelle ») pour les élections législatives. Celui-ci conduirait certainement à des majorités plus incertaines mais représenterait plus fidèlement la diversité des sensibilités dans le pays. Il pousserait surtout à rechercher des coalitions de gouvernement, comme c’est le cas dans de nombreux pays de l’Union européenne où nous sommes, depuis le Brexit, le dernier Etat membre à pratiquer le scrutin majoritaire aux élections législatives. Ce faisant, il accoucherait peut-être de gouvernements et de majorités plus composites, mais il leur donnerait en même temps une assise beaucoup plus large dans la société.
Par ailleurs, le risque d’instabilité, partout dénoncé par les conservateurs sur ce sujet, n’emporte guère la conviction. Les institutions de la Ve République sont-elles réellement gages d’une plus grande stabilité politique par rapport aux régimes parlementaires, comme on le pense souvent à Paris ? La comparaison avec notre voisin allemand est éloquente à ce sujet. De 1974 à 2021, soit presque un demi-siècle, l’Allemagne a compté en tout et pour tout quatre chanceliers, dont les deux très longs règnes de Helmut Kohl (16 ans) et d’Angela Merkel (plus de 15 ans). Dans le même temps, la France épuisait six Présidents de la République successifs (dont deux seulement ont été réélus à la faveur d’une cohabitation) et 32 gouvernements (soit un nouveau gouvernement en moyenne tous les 18 mois)…
A défaut de pouvoir réviser notre constitution, un changement du mode de scrutin sera donc nécessaire pour rendre à la politique sa capacité de représenter plus largement la société et d’y trouver une assise plus consistante et plus sûre. Hélas, ce changement n’est pas envisageable d’ici les prochaines élections législatives de juin 2022 : bien qu’une telle réforme relève d’une loi simple, notre législation interdit de modifier les règles du scrutin dans les douze mois qui précèdent sa tenue, a fortiori donc dans les quelques semaines qui nous séparent désormais de l’échéance.
Dans l’état actuel de notre système politique, il paraît donc éminemment souhaitable de se diriger vers un art de gouverner plus coopératif et de considérer que, si nos gouvernants la reçoivent de l’élection, leur légitimité ne s’accomplit et ne se maintient durablement que dans l’exercice d’une conversation démocratique continue avec le pays. Cette conversation passe sans doute par les canaux de la participation et de la délibération citoyenne. Mais une société est toujours plus que la somme des individus-citoyens qui la composent : elle est aussi constituée de collectifs, d’organisations civiles, d’agents économiques et sociaux qui sont, eux aussi, appelés à la discussion. Ce sont tous les membres de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, élèves…) qu’il faut réunir sur le destin de l’école ; ce sont les patients et tous les professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens…) qu’il faut faire dialoguer dans les territoires et les bassins de vie pour améliorer l’accès aux soins ; ce sont toutes les parties prenantes d’un secteur économique (entreprises, organisations professionnelles, syndicats, financiers…) qu’il faut faire négocier pour identifier les modèles d’affaires et d’organisation les plus favorables à l’accélération de la transition écologique, comme nous le préconisions récemment avec Pascal Canfin… C’est aussi faire vivre en amont de la décision la discussion entre le savant et le politique sur un modèle moins décisionniste et plus pragmatique, comme le montre Mélanie Heard dans ses leçons de la crise Covid.
Rassembler les Français, ce n’est pas les réunir tous les cinq ans autour d’un projet, mais les réunir tout au long du mandat. C’est cela qu’il convient d’incarner et de mettre en œuvre aujourd’hui.
Reste que cette « gouvernance refondée » appelle non seulement un dessin plus précis, mais aussi un autre exercice de la citoyenneté. On peut en effet attendre du pouvoir en place qu’il donne à chacun une espérance raisonnable de s’engager et de servir la cité. Mais on doit aussi attendre de chacun un engagement plus actif dans les affaires collectives. Pour le dire autrement, il faut que la « liberté des modernes » (la jouissance des droits individuels, des libertés publiques et l’assurance de n’être jamais sous le joug d’aucune domination arbitraire) fasse une plus grande place à la « liberté des anciens » (l’exercice collectif et direct d’une part de la souveraineté, de la délibération et de la participation publique)3. Cela suppose aussi une nouvelle pédagogie des vertus civiques que l’on veut faire prospérer.