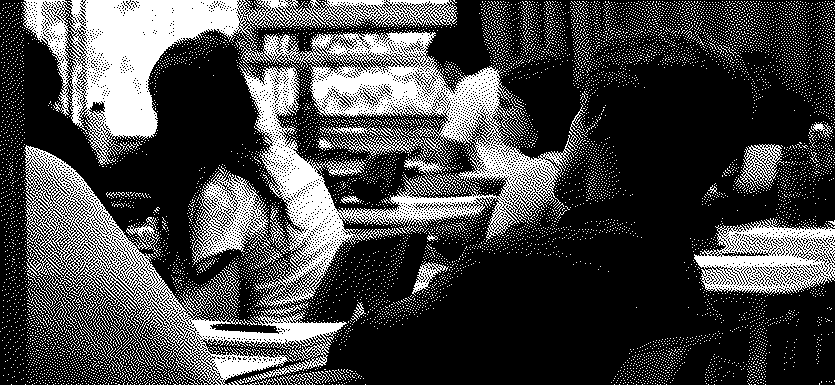Partout la presse se fait l’écho de l’insatisfaction grandissante des populations à l’égard du logement. Ce sujet ressort comme un enjeu majeur, notamment à l’occasion des échéances électorales. Les logiciels d’intelligence artificielle permettent de le vérifier, qui à défaut de toujours fournir des réponses pertinentes, offrent un reflet de ce qui s’écrit sur ce sujet, à tout le moins sur les opinions dominantes dans chacun des pays envisagés1. L’utilisation de ces outils, non pour leur fonction d’IA générative, mais comme super-moteur de recherche, ouvrent l’accès aux sources d’information locales. Celles-ci viennent compléter les données les plus aisément accessibles, notamment celles réunies par l’OCDE et la Fédération hypothécaire européenne (FHE), lesquelles permettent de juger de la situation de la France par rapport aux autres pays membres2. Le travail de l’OCDE a également servi de base à diverses études auxquelles nous nous référons. Le risque de mauvaise interprétation des résultats de l’IA comme celui qui tient à la fragilité du rapprochement de données issues de systèmes statistiques de différents pays sont évidents : nous les assumons, étant plus soucieux ici d’évolution et d’ordre de grandeur que de précision.
I. Une crise mondiale
Crise du logement et crise de l’immobilier
A la question sur l’existence d’une crise du logement, la réponse est toujours affirmative, même en prenant soin d’écarter ce qui relève d’une crise de l’immobilier. En effet, l’emploi indifférencié du terme crise du logement3, bien qu’utile pour interpeler les pouvoirs publics, n’éclaire en rien des phénomènes aussi différents que la difficulté pour certains ménages d’accéder à un logement et de l’effort qu’ils doivent y consacrer d’une part, et les mouvements qui affectent l’activité du secteur immobilier, diminution des mises en chantier, tassement des ventes de logements, allongement des délais de commercialisation, d’autre part. A cet égard, le terme de crise laisse entendre que la situation normale (de non-crise) serait celle où l’activité immobilière progresse dans la stabilité des prix. Or l’une des spécificités du marché immobilier est précisément que la croissance de l’activité y est concomitante à la hausse des prix et, qu’à l’inverse, diminution de l’activité et baisse des prix vont de pair. La nouveauté observée aujourd’hui presque partout tient à ce que la crise immobilière actuelle ne s’accompagne pas de baisses de prix significatives à la mesure des hausses précédemment intervenues.
C’est le discours tenu sur la crise dans les pays à économie libérale développée qui nous intéresse ici, pays où la logique du marché gouverne en partie le secteur du logement, une autre partie du parc, variable selon les pays, relevant de l’économie administrée. Commençons par demander à Chat Gpt « Quels sont les pays de l’OCDE où la crise du logement est le plus grave ? » Apparaissent dans l’ordre, les États-Unis, le Royaume Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle Zélande, tous confrontés à des prix qualifiés d’inabordables. La France ne figure pas dans cette liste. Le critère sur lequel repose ce classement n’apparait pas. En revanche, à la question « Dans quels pays est-ce un problème politique de première importance ? », la France est en tête, suivie par les pays classés parmi ceux où la crise est la plus grave. Cependant, lorsque la question « Y a-t-il une crise du logement ? » est directement posée pour chacun des pays, dans la langue locale, la réponse est toujours positive et fait référence aux difficultés des ménages pour accéder à un logement dont la qualité et la localisation répondent à leur choix, mais aussi au taux d’effort qu’ils doivent supporter, surtout s’ils veulent devenir propriétaires.
Un premier constat, absolument général, concerne la cherté des logements. La hausse des prix a été supérieure à la croissance des revenus. Quoiqu’à des degrés variables, l’effort que les ménages doivent consentir pour se loger a considérablement augmenté dans tous les pays. Partout, l’accession à la propriété est devenue plus difficile, notamment pour les jeunes. La croissance du taux d’effort des locataires a également été supérieure à celle de leurs revenus.
Vient ensuite la pénurie de logements dits abordables, mais si celle-ci est surtout aiguë dans les zones urbaines où la demande est forte, poussant même les jeunes à retarder leur mariage dans certains pays. Le manque de logements sociaux, et l’allongement de la durée des files d’attente pour y accéder, est surtout mis en avant dans les pays qui ont, ou ont eu, un parc social très important comme la France, l’Autriche, ou l’Angleterre. La plupart des pays font également état d’une progression du nombre de sans-abri. Si la crise du logement est un thème qui a constamment été à l’ordre du jour, bien qu’avec une acuité inégale, depuis la fin du XIXe siècle, aujourd’hui celle-ci ne concerne plus seulement les populations pauvres ou modestes.4
II. Le socle commun de la crise
Comment expliquer, qu’aucun des pays développés à économie de marché ne parvient à répondre de façon satisfaisante à la demande de logements de ses habitants, et ce, malgré la diversité des politiques suivies dans ce domaine ? Le volume et la nature de la demande ont-ils changé ? Comment se déterminent les prix et les loyers ? Quels sont les freins à l’extension de l’offre ?
Le poids de la démographie. L’affirmation générale d’une pénurie de logements peut-elle s’expliquer par la croissance de la population ? Depuis 1990, la population totale des pays membres de l’OCDE a connu une croissance modérée, passant, selon les données de la Banque mondiale, d’environ 1,1 milliard en 1990 à environ 1,39 milliard en 2023. Le taux de croissance annuel de la population a diminué au fil du temps. L’immigration a permis de compenser le déclin de la fécondité. L’espérance de vie accrue et la baisse des taux de natalité ont conduit à un vieillissement de la population. Celui-ci et surtout l’évolution de la composition des ménages se sont traduits par un accroissement significatif de la demande et de la consommation de logements par personne. La taille moyenne des ménages s’est réduite, passant de 2,4 personnes en 2007 à 2,2 en 2022 dans l’UE, une tendance similaire étant observée dans l’ensemble de l’OCDE. La proportion de ménages composés d’une seule personne a fortement augmenté, atteignant 36,2 % des ménages de l’UE en 2022, contre 26 % en 2007.5 Au sein de l’OCDE, la surface de logements par personne est inégale puisqu’elle est de l’ordre de #42 m² en moyenne et va de # 23 m² au Japon à # 68 m² aux États-Unis. Cependant, partout, tant le nombre de pièces que la surface par personne a augmenté. Il est difficile de trouver des données agrégées de cette évolution mais l’exemple de la France est parlant. En France, de 1970 à 2013, la surface des logements a augmenté de 30% et le nombre de personnes par ménage a diminué, si bien que la surface par personne a presque doublé (passant de 23 à 40 m²)6. Les logements sont plus chers, mais ce ne sont pas les mêmes logements, ni en termes de surface, ni en termes de confort.
La métropolisation de la demande Autre phénomène déterminant, la majorité de la croissance démographique dans les pays de l’OCDE s’est concentrée dans les zones urbaines, et plus particulièrement dans les grandes aires métropolitaines. Par exemple, la population urbaine des pays membres de l’OCDE est passée d’environ 800 millions en 1990 à plus de 1,1 milliard en 2023. L’OCDE utilise des définitions de « zones urbaines fonctionnelles » qui incluent non seulement la ville-centre, mais aussi sa zone d’influence et de navettage, ce qui donne une meilleure image de la taille réelle des agglomérations. Les grandes métropoles ont vu leur poids économique augmenter de manière disproportionnée par rapport à leur part de population. Elles sont devenues des centres majeurs d’innovation, d’investissement et de création d’emplois dans les secteurs à forte valeur ajoutée (services, technologies, finance).
Les freins à l’accroissement du parc
Dans la plupart des pays, à des degrés divers, la réglementation est considérée comme le principal frein au développement de l’offre, qu’il s’agisse de la détermination des zones constructives ou des formes de la construction, limitation des hauteurs, taille minimale des parcelles rapportée à la surface construite, etc. C’est un sujet partagé par tous les pays, mais c’est le thème majeur de débat au Royaume Uni, notamment à propos de l’étendue des green belts autour des grandes villes et aux États -Unis, où ces réglementations qui dépendent des États ou des municipalités sont accusées de répondre à des objectifs de ségrégation sociale et raciale.
La hausse des prix et des taux d’effort
Un parc majoritairement détenu par les ménages
Si le logement est le premier poste de la dépense des ménages, c’est aussi le premier élément de leur patrimoine. Le taux de propriétaires occupants dans les pays de l’OCDE a connu une tendance globale à l’augmentation de 1990 jusqu’à la crise financière de 2008, suivie d’une stabilisation ou d’un léger déclin dans certains pays depuis lors, notamment chez les jeunes ménages. En moyenne, environ 65-70% des ménages âgés de 50 ans et plus sont propriétaires de leur logement7. Dans tous les pays, le parc locatif privé est presque entièrement, parfois en grande part, détenu par les ménages et c’est entre eux que s’effectue l’essentiel des transactions8. Le fait que le logement constitue l’investissement privilégié des ménages, que ce soit pour l’habiter eux-mêmes ou pour le louer, contribue à la hausse des prix. En effet, aux yeux de ces propriétaires, l’investissement immobilier est à la fois un placement à l’abri de la perte brutale qui menace les valeurs mobilières, l’espoir d’une plus-value et un bien qu’ils pourront éventuellement utiliser pour eux ou pour leur famille9. Ainsi, le choix de l’investissement immobilier ne résulte pas de la seule comparaison avec les rendements des autres formes de placements : actions, obligations, etc. De ce fait, loyers et prix, sans être déconnectés, obéissent à des déterminants différents10. Les prix des logements ne sont pas aussi corrélés aux loyers escomptés au jour de la transaction que ceux des bureaux ou des locaux commerciaux. Au sein de l’OCDE, le rapport entre les prix et les loyers des logements a augmenté de 31,90 % depuis 2015.
La formation des prix : une logique d’enchères
Le marché des logements obéit à une logique d’enchères dont les ménages sont donc les principaux acteurs. Le prix des logements neufs se détermine en fonction du prix des logements anciens, le prix du foncier jouant le rôle de variable d’ajustement11. Seuls les logements du secteur hors marché, pour l’essentiel ceux du secteur social, échappent à cette logique. Dès lors que l’allocation des ressources se fait par les prix, lorsque sur un périmètre déterminé la demande est supérieure à l’offre, les prix s’ajustent en fonction de la solvabilité des candidats en compétition. L’évolution des prix, observée sur le moyen terme, découle donc, d’une part du montant de l’épargne et de la fraction de leur revenu et que les acquéreurs pourront y consacrer et d’autre part du volume de l’offre proposée sur le marché. L’évolution des loyers, si elle dépend du volume de l’offre locative, reste plafonnée à la part de leur revenu que les locataires peuvent affecter à leur loyer. L’évolution respective des prix et des loyers, en ce qu’elle pèse sur le rendement locatif, influe néanmoins sur le niveau de l’offre mise sur le marché, que celle-ci découle de la construction de logements neufs ou de l’affectation de logements anciens à la location.
La solvabilité des acquéreurs
Selon les données de l’OCDE et d’autres institutions internationales telles que la Banque des Règlements Internationaux (BRI), environ 70 à 80% des acquisitions de logements dans les pays membres de l’OCDE se font avec un recours à un crédit immobilier12. La solvabilité des acquéreurs dépend donc à la fois de la part de leur patrimoine qui peut être consacrée à leur apport personnel, et de leur capacité d’emprunt. Cet apport personnel peut être constitué par la revente d’un logement. Nous n’avons pas trouvé de données globales consolidées sur l’évolution de la part de l’apport personnel dans les achats de logements au sein de l’OCDE, mais celle-ci augmente nécessairement avec la proportion des acheteurs déjà propriétaires de leur logement et parmi eux d’acheteurs-vendeurs et donc avec la diminution corrélative de la part des primo-accédants. A défaut de statistique globale pour l’OCDE, il est possible de le déduire des études conduites aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Selon cette estimation, la part des logements achetés par des ménages déjà propriétaires de leur logement devait être de l’ordre de 60 % dans les années 1990, de 64 % dans les années 2000, de 68 % dans les années 2010 et proche de 75 % dans les années 2020. Cette trajectoire reflète une tendance structurelle globale, avec des variantes nationales (plus forte au Royaume-Uni, États-Unis, plus lente en Europe du Sud).
La capacité d’emprunt des ménages est d’autant plus sensible au niveau des taux d’intérêt que dans certains pays comme la France la durée des prêts tend à s’allonger avec la baisse des taux. La baisse de l’inflation amorcée à partir du milieu des années 1980 s’est accompagnée d’une baisse des taux d’intérêt. La politique de quantitative easing est venue accentuer ce mouvement, provoquant un accroissement de la masse monétaire et venant alimenter une inflation générale de la valeur des actifs, de façon temporaire ou durable sans que l’on soit en mesure de répondre. Au sein de l’OCDE, le coefficient de monétisation (masse monétaire en % du PIB) a augmenté de près de 15 points entre 1995 et 2019, montrant que la quantité de monnaie croît plus vite que le PIB nominal.
Une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI)13 tend à montrer que la politique de création monétaire, menée par les banques centrales, le quantitative easing aurait eu un effet négligeable, voire insignifiant, sur la croissance économique, la création d’emplois ou l’augmentation des revenus. En revanche, il aurait massivement fait grimper la valeur des actions et autres actifs financiers. Alors que la baisse des taux entraîne une hausse des prix, la hausse des taux n’a pas provoqué de baisse des prix des logements dans les mêmes proportions. Cette forte résistance des prix ne concerne pas que la France et des évolutions similaires s’observent dans presque tous les pays de l’OCDE.
L’augmentation de la valeur des actifs a eu pour corollaire un accroissement des inégalités patrimoniales et générationnelles. Selon les données de l’OCDE, en 2000 environ 35 % de la population des pays membres était âgée de 50 ans ou plus, alors que ce sont 45 % en 2020, avec des variations selon les régions. Ces ménages entre lesquels se déroule une partie importante des transactions ont bénéficié de la hausse des prix et participent au maintien de leur niveau. En France, ce sont d’ailleurs les communes qui ont bénéficié du plus fort taux d’arrivée de retraités qui ont connu les plus fortes hausses de prix depuis 10 à 15 ans. Les conséquences de cette inflation de la valeur des actifs alimente le sentiment d’injustice qui sous-tend les crises politiques dans de nombreux pays dès lors que la baisse ou la stagnation du pouvoir d’achat des catégories modestes est mise en relation avec l’explosion de la valeur des patrimoines et des revenus du patrimoine. Le débat politique tend à se focaliser sur les cas extrêmes, le 1 %, parfois même les 0,01 % des plus riches, mais ces derniers ne sont pas en concurrence avec le reste de la population pour les mêmes logements. C’est l’écart entre le patrimoine des ménages propriétaires, sans emprunt hypothécaire en cours, a fortiori les multipropriétaires et ceux qui cherchent à accéder à la propriété qui est à l’origine de l’explosion des taux d’effort de ces derniers.
La part des dépenses consacrées au logement a considérablement augmenté puisque de 12 à 13 % des budgets des ménages de l’OCDE, elles sont en 2023 aujourd’hui de l’ordre de 20 à 22 %, ce qui correspond à une hausse de près de 75 % du poids relatif du logement dans le budget familial. L’Insee indique pour la France que la part du logement dans la dépense de consommation finale des ménages est passée de 15,5% en 1995 à 27,3% en 2023. En France, l’augmentation des loyers a évolué comme le revenu global des ménages, donc très en retrait de l’évolution des prix de l’immobilier. Le niveau atteint par les prix a fortement réduit la demande des primo-accédants, ce qui s’est traduit par une baisse du pourcentage de propriétaires occupants dans la plupart des pays européens. Ce recul de la primo-accession qui pèse sur le marché locatif a été aggravé par une baisse de l’effort public en faveur du logement social et par la tendance, majoritaire, à la résidualisation du parc. Cependant, la solvabilité des locataires a diminué du fait de leur appauvrissement, dans le secteur privé comme dans le parc secteur social, ce qui s’explique en partie par le fait qu’une part des plus aisés parmi les locataires a accédé à la propriété.
Les changements d’usage du parc, qu’ils résultent de la transformation de logements en bureaux ou, ce qui est plus actuel, de locations saisonnières à destination touristique et ouverte au monde entier, est réelle, mais il est difficile d’en apprécier l’impact quantitatif dans les grandes villes à l’attrait touristique. Les discours militants expliquent fréquemment la hausse des prix par la financiarisation du secteur du logement et par la spéculation. Or la financiarisation est loin d’être un phénomène général. Au contraire, dans de nombreux pays et singulièrement en France, le patrimoine représenté par les logements est peu financiarisé, puisqu’il est détenu en direct par les ménages. De la même façon, si la spéculation existe, les calculs effectifs qui sous-tendent le pari spéculatif sont rarement définis.
III. Une crise d’une inégale gravité
Si la crise du logement semble affecter tous les pays de l’OCDE, elle ne revêt pas la même acuité partout. La richesse des données réunies par l’OCDE14 permettent de juger de la façon dont se situe, au cours de la période 2000/202315, notre pays par rapport à l’ensemble formé par les pays de l’OCDE16 et par rapport à chacun d’entre eux. La même chose existe en matière de fiscalité immobilière au sein des pays membres17. La France est deuxième en nombre de logements par habitant, après l’Espagne, ces deux pays ayant une forte proportion de résidences secondaires ; elle est cinquième en ce qui concerne la surface moyenne du logement par habitant18 avec 41 m² pour 43 m² pour la moyenne de l’OCDE. Elle est la troisième, derrière le Japon et le Canada en nombre de logements construit pour 1000 h.
La répartition des statuts d’occupation y est assez équilibrée. La France se situe dans la moyenne haute pour la proportion de locataires du parc social, avec le parc social le quatrième plus important19 en pourcentage de sa population. Elle se situe en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE en ce qui concerne la sur-occupation et la surcharge du coût du logement pour les personnes à faible revenu.
La hausse des prix immobiliers est la manifestation la plus visible de la crise. Le prix réel des logements a augmenté de plus de 40 % en moyenne au cours de la dernière décennie pour l’ensemble des pays de l’OCDE, avec une forte accélération au début de la pandémie de COVID
Seuls l’Italie et le Japon ont des prix moyens du logement sur l’ensemble de leur territoire inférieurs à ceux de la France. Le résultat s’avère presque identique si l’on se réfère au rapport entre le prix et le revenu. En revanche, de 2000 à 2023, la France a connu une évolution des prix (+85 %) largement plus forte que la moyenne des pays membres de l’OCDE (+ 61%).
Cependant, dans tous les pays étudiés, sauf au Japon et en Allemagne, les loyers ont augmenté plus qu’en France. La France avec un taux d’effort moyen des locataires de 27 % (en pourcentage du revenu disponible) apparait, avec l’Allemagne et l’Autriche comme l’un des trois pays les moins mal lotis, par comparaison avec les États-Unis ou l’Angleterre (38%), voire par rapport à la moyenne OCDE (33%). Toutefois, la France se situe mal si l’on s’intéresse aux seuls locataires privés à faible revenu consacrant plus de 40 % de leur revenu au loyer. On ajoutera, avec toutes les difficultés que présente ce type de comparaison, que la France consacre un effort très important aux dépenses d’allocation logement.
Partant de la base de données de l’OCDE (Affordable Housing Database, AHD), Christophe André et Thomas Chalaux20 se sont efforcés de bâtir une typologie des systèmes de logement dans l’OCDE. On se rapportera directement à leur travail pour plus de détails ainsi qu’à l’analyse qu’en a faite Christine Whitehead21, dont la conclusion est sans nuances. « Cependant, le résultat le plus immédiatement important est peut‑être une simple analyse des corrélations, qui suggère que les facteurs du marché sont beaucoup plus étroitement corrélés aux résultats que les politiques du logement ». Cela peut s’expliquer en partie par des lacunes des données. En particulier, on notera que l’information sur l’ampleur des interventions publiques est insuffisante. En outre toutes les formes d’intervention n’ont pas été répertoriées. Mais cela reflète également l’opinion partagée par de nombreux chercheurs, selon laquelle le logement est plus affecté par l’environnement économique au sens large que par des interventions spécifiques au logement.
IV. Le rôle de la politique du logement
La plupart des Etats conduisent des politiques du logement actives même en ce qui concerne la fraction du parc qui obéit à la logique du marché. Encore faut-il en préciser les objectifs.
Politique du logement, objectif de premier ordre et objectifs annexes
Il s’agit en premier lieu de permettre aux ménages de trouver un logement répondant à leurs attentes de localisation et de confort et compatible avec leurs ressources. A cela s’ajoutent des préoccupations annexes, que l’on ne mentionnera ici que pour mémoire, mais qui viennent fortement infléchir les politiques conduites dans les divers pays de l’OCDE.
Soutien à l’activité du secteur du logement. La politique du logement est un puissant facteur conjoncturel de soutien de l’emploi. En France, l’État s’efforce de soutenir ou lisser l’activité du secteur de la construction. Tous les plans de relance prennent appui sur un accroissement des incitations financières à la construction : aide à la construction locative sociale, aide à l’accession et fiscalité favorable à l’investissement locatif. Par ailleurs, l’État est attentif à ce que le prix du logement ne pèse pas trop sur les salaires.
Appui aux aspirations patrimoniales et statutaires des ménages. Alors que la répartition des logements entre propriétaires occupants, locataires du parc social et locataires du parc privé était et demeure extrêmement diverse selon les pays, la plupart des politiques publiques adoptées à partir des années 1970 ont connu une évolution convergente tendant à encourager la propriété. Seules la Suisse et l’Allemagne font exception. Diverses motivations sont mises en avant pour justifier les politiques en faveur de l’accession à la propriété mais la préférence pour la propriété exprimée par les ménages constitue la principale légitimation de ces politiques. La politique peut difficilement aller contre une aspiration aussi généralement et constamment exprimée par les ménages.
Accroître la stabilité des personnes en place ou favoriser la mobilité. Tous les pays ne procèdent pas au même arbitrage entre les garanties de stabilité offertes aux personnes en place et l’accueil des nouveaux venus, au premier rang desquels figurent les jeunes. Ainsi les politiques de contrôle des loyers offrent-elles une garantie forte aux locataires en place, à l’abri de la concurrence des nouveaux candidats à la location. Les nouveaux baux proposés aux locataires anglais ne valent que pour six mois et le propriétaire est libre d’augmenter leur loyer ou de leur donner congé à chaque terme. De la sorte, les nouveaux arrivants, à condition qu’ils en aient les moyens, n’ont pas de difficultés à trouver un logement, tandis que les personnes en place n’ont aucune garantie de stabilité. La France privilégie, comme dans de nombreux domaines autres que le logement, la stabilité des personnes en place, ne serait-ce qu’avec les dispositions de protection des locataires.
Equilibre social Pour aller à l’encontre de la ségrégation géographique qui résulte naturellement du mouvement des prix, quand elle n’est pas favorisée par les autorités locales, les pouvoirs publics peuvent adapter les modalités d’aide ou des normes de construction à des objectifs de peuplement.
Lutter contre le sans-abrisme. Les politiques d’hébergement concernent des populations qui ne peuvent se loger par leurs propres moyens et ne relève donc pas d’une logique de marché et d’allocation par les prix.
Valoriser le parc existant et l’adapter au défi climatique constituent également des objectifs de grande importance.
L’objectif de premier ordre, les quantités et les prix
Cependant, le premier objectif de toute politique du logement, celui auquel fait principalement référence le terme de crise, tient à l’accès au logement des ménages et à la maîtrise de l’effort qu’ils y consacrent. C’est un objectif que poursuivent la plupart des pays de l’OCDE, mais auquel aucun ne semble apporter de réponse satisfaisante, ou à tout le moins suffisante. La question est donc celle des quantités et des prix. Laissons de côté, dans un premier temps tout ce qui relève du logement social, et plus largement tout ce qui n’obéit pas à la logique du marché, c’est-à-dire à l’allocation par les prix. Parmi les facteurs identifiés précédemment comme cause du socle commun de la crise, les plus déterminants sont hors d’atteinte des instruments de la politique du logement, stricto sensu, quand ils n’échappent pas largement au seul pouvoir du gouvernement. C’est au premier chef le cas du déséquilibre croissant entre l’augmentation de la masse monétaire et celle du PIB et l’inflation de la valeur de toutes les catégories d’actifs qui en résulte, lequel apparaît comme le principal facteur de la hausse des prix. L’inégalité croissante des patrimoines, quand bien même elle serait en partie alimentée par la hausse du prix des logements, ne relève pas non plus de la politique du logement. Les choses seraient-elles différentes si les personnes privées ne détenaient pas un quasi-monopole sur la propriété du parc locatif privé ? Question sans véritable objet tant partout l’évolution va en sens contraire, sauf en Suisse et en Allemagne. Dans la plupart des pays de l’OCDE, en dépit des efforts constants des pouvoirs publics, les investisseurs institutionnels (compagnies d’assurances, mutuelles, caisses de retraite, fonds d’investissement, banques, etc.) se sont retirés, à un rythme plus ou moins rapide, du parc locatif privé, lequel est désormais très majoritairement détenu par les ménages22. En France, alors que les investisseurs institutionnels détenaient 18 % du parc locatif privé en 1984, leur part est tombée à 3 % environ dudit parc et à 0,6 % du parc total de logements en 2018. De la même façon, l’État a peu de prise sur tout ce qui tient aux évolutions démographiques, à la réduction de la taille des ménages et à leur moindre stabilité, lesquelles ne sont pas non plus une spécificité française. S’agissant enfin de la localisation de la demande, partout la métropolisation des emplois s’est accusée sans que les politiques d’aménagement du territoire ne parviennent à contrebalancer cette évolution de façon décisive.
Dès lors que l’attention se porte sur le déficit d’offre de logements abordables, peut-on le quantifier et le localiser ? Certains pays procèdent à une évaluation du manque de logements en partant de la demande non satisfaite, d’autres en projetant à un horizon donné les besoins en logements neufs correspondant à l’évolution de la population. La demande dépend de ce que l’acheteur est disposé à payer et surtout capable de payer. Le concept de besoins en logements traduit à la fois l’incapacité du marché à faire face à la demande et le fait que la satisfaction de ces besoins tend à devenir un objectif de politique publique.23
Les freins à la construction de nouveaux logements
Le stock de logements disponibles dépend de la construction de nouveaux logements, mais aussi, des sorties du parc, par désaffectation, ou par changement d’usage. Les freins à la construction reflètent souvent la réticence des pouvoirs publics et donc celle des gens en place à voir s’installer de nouveaux arrivants ou certains types de nouveaux arrivants (NIMBY). La hausse de la solvabilité des candidats au logement n’est pas en cause, même si les prix sont souvent présentés comme trop élevés du fait du coût du foncier, alors même que ce coût est lié au prix des logements anciens présentés sur le marché. Hausser la solvabilité des acquéreurs potentiels pèsera sur les prix et non sur le volume de la construction. Les principales recommandations de l’OCDE24 dans ce domaine tendent donc à encourager une plus grande densité de logements dans les zones urbaines, à limiter les restrictions de croissance de ces zones urbaines, à transférer les pouvoirs d’urbanisme à des collectivités d’une dimension suffisante pour lutter contre l’attitude restrictive des habitants en place et à utiliser la fiscalité pour décourager la rétention foncière. Rien qui nous éloigne des débats français.25
L’accessibilité et les prix
Les prix obéissant à la loi de l’offre et de la demande, la logique voudrait que le niveau des prix soit fortement influencé par l’apport d’une offre nouvelle. Cependant, les nouvelles constructions ne représentant qu’un faible pourcentage de l’offre disponible sur le marché, 1,2 % à 1,3 % du parc total, son impact sur les prix ne peut être que très réduit et de surcroît difficilement mesurable, même si certains avancent des chiffres qui tiennent de l’acte de foi.26
Ce n’est pas le lieu ici d’évaluer les politiques de solvabilisation de la demande, qu’il s’agisse d’aide à la pierre ou d’aide personnelle, d’aide fiscale, d’aide à l’emprunt et sécurisation de l’offre de crédit dès lors que ces aides sont tournées vers la part du parc existant ou de la production nouvelle, régie pour l’accès des acheteurs ou des locataires par la logique du marché, c’est à dire dont l’allocation se fait par les prix. Toutes les études conduites dans ce domaine jugent à la fois de l’efficacité de ces politiques en ce qu’elles permettent aux ménages de se loger, que ce soit dans le parc locatif ou en accession à la propriété et mentionnent également leur contribution à la hausse des prix en ce qu’elles contribuent à solvabiliser la demande. S’inscrivent dans la même logique les propositions qui consistent à faciliter le transfert de patrimoine des plus âges aux plus jeunes et qui auraient pour effet d’alimenter la hausse des prix en accélérant l’effet de l’héritage. 27.
Quant aux mesures administratives qui limitent la progression ou le niveau absolu des loyers, outre qu’elles sont accusées de décourager l’investissement locatif, elles ne bénéficient pleinement qu’aux locataires en place et ce aux dépens des outsiders, au premier rang desquels les jeunes.
Aucun de ces volets de l’action publique en faveur du logement n’est inutile et les objectifs ici qualifiés de second ordre ne sont nullement négligeables, mais les comparaisons internationales qui précèdent montrent que nulle part, quelles que soient les aides, les incitations et les règles mises en place, le seul jeu du marché, c’est-à-dire l’allocation des logements par les prix ne permet de répondre à la demande de l’ensemble de la population et de limiter la hausse des prix du logement. L’effort des pouvoirs publics doit donc se renforcer dans deux directions. Du côté de l’offre, l’accroissement du volume de la construction exige un allègement des règlementations restrictives qui sont autant de freins à la construction. Du côté de la demande, l’allègement du taux d’effort des ménages modestes ne peut passer que par des mécanismes qui échappent à la logique du marché, sauf à alimenter la hausse des prix. Un différence importante entre les pays de l’OCDE tient donc à l’importance du parc « hors marché », c’est à dire pour l’essentiel du parc social. Le parc social loge en France 16 % des ménages pour près de 9 % dans l’OCDE. La difficulté tient à ce que dans les zones les plus coûteuses, l’écart entre les loyers du parc social et les loyers privés laisse de côté les catégories trop riches pour prétendre à un logement social et pas assez pour se loger sur le marché. En outre, le niveau des prix du marché restreint la frange de ceux qui peuvent devenir propriétaires, alors que c’est l’aspiration majoritaire des ménages. Pour ces raisons, la voie consiste probablement à diversifier les statuts d’occupation en élargissant la part de ceux qui échappent à la seule allocation par les prix.
Diversifier les statuts d’occupation
Les statuts d’occupation ne sont pas des catégories universelles28. Le bilan des avantages et inconvénients de chaque statut, au sens large, ne peut être dressé en bloc, mais doit tenir compte de l’ensemble des droits et contraintes associés à chacun d’entre eux. Les implications de chaque statut d’occupation ne peuvent se juger qu’en fonction des caractéristiques des autres statuts avec lesquels il est en balance. Pour ce faire l’analyse en bouquet de droits, s’inspirant du concept de bundle of rights des Anglo-Saxons, est la plus opérationnelle.
Plusieurs éléments justifient la préférence des ménages pour la propriété : ce qui à leurs yeux s’attache à la « dignité » du statut de propriétaire, leur stratégie d’accumulation patrimoniale qui peut être habillée en asset-based welfare, le droit à maintien dans les lieux illimité et insusceptible d’être remis en cause, l’étendue du droit de disposer de son logement, la possibilité d’aménager et de transformer son logement dans la limite du droit de l’urbanisme et des règlements de propriété, le droit de le vendre ou de le louer à la personne de son choix et à un prix librement déterminé, le cas échéant en réalisant une plus-value liée à l’évolution du marché etc. Même dans le cas de la pleine propriété, ces droits ne sont pas absolus. Ainsi, dans certaines villes françaises le propriétaire n’est-il pas libre de fixer le loyer, même d’une première location. Les propriétaires suisses ne sont pas libres de vendre leur logement à des non-nationaux. Il serait possible de multiplier les exemples. Le propriétaire d’une maison individuelle dispose d’une plus grande liberté d’aménagement de son logement que celui qui habite un logement en copropriété.
Diversifier les statuts d’occupation, permettrait d’introduire en fonction des situations particulières un continuum de statuts intermédiaires entre la pleine propriété et la location. C’est dans cette logique que s’inscrivent déjà des expériences comme celle du bail réel solidaire (BRS). Une caractéristique de ces statuts dits innovants, tient à ce qu’ils excluent la possibilité de tirer parti de la hausse générale des prix du marché pour réaliser une plus-value en cas de revente. Cependant, ce type de statuts intermédiaires, s’ils étaient appelés à se développer devraient obéir à un certain nombre de conditions qui sont rarement réunies par les statuts dits innovants actuellement29. On se contentera de les mentionner. Parfaitement définir le bouquet de droits qui s’attache à chaque statut particulier, établir une stricte transparence des règles d’attribution dans le cas d’une offre contingentée, éviter les engagements à très long terme insusceptibles d’être respectés ou même de faire l’objet d’un suivi effectif par l’administration ou par une instance spécifique. Enfin, si l’offre est contingentée, il est souhaitable d’identifier clairement le montant de l’aide publique injectée dans l’opération, quelle que soit sa forme.
Aucune des modalités de la politique du logement n’est à proprement parler inutile mais dans une économie libérale, le marché ne permet pas de résoudre ce qui est qualifié de crise du logement, les problèmes de solvabilité des plus modestes et dont ne sont victimes que ceux qui ne sont pas encore propriétaires ou n’ont pas encore remboursé les prêts qui leur ont permis d’accéder. Seules les formules hors-marché, c’est-à-dire qui échappent à la détermination du bénéficiaire par une enchère sur le prix peuvent répondre à la demande des catégories modestes de la population, qu’il s’agisse de parc social ou de nouveaux statuts d’occupation.