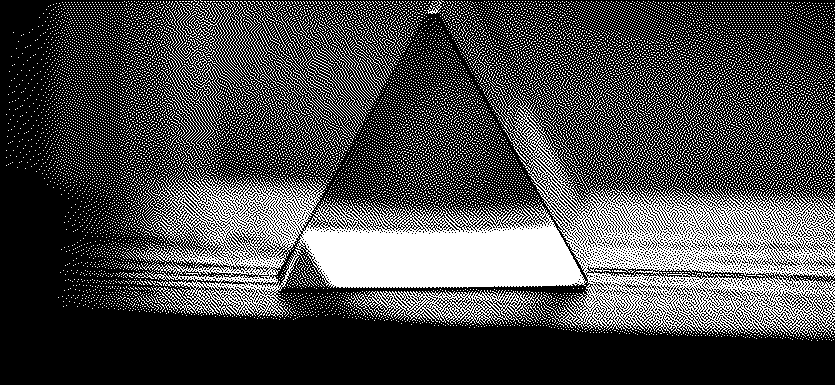« Enfin ! » C’est ce que j’ai pensé, le 7 mars dernier, lorsque j’ai eu le privilège d’assister à la projection d’une copie de travail du film Ni Chaînes Ni Maîtres du réalisateur Simon Moutaïrou. Enfin un film français sur l’esclavage avec une vraie ambition de réalisme, un vrai regard original et de vrais moyens. Enfin un film qui ose montrer la violence et la complexité de la société coloniale, et les contradictions de celles et ceux qui y vivaient. Enfin un film sur le marronnage, cet envers invisible du monde de l’esclavage, où les fugitifs se réinventaient dans le secret des forêts et des montagnes escarpées.
Enfin un film qui permettra de partager tout cela avec un grand public français encore largement ignorant de l’histoire de l’esclavage colonial français, et plus encore des résistances qu’il a suscitées. Enfin un film qui permettra de montrer tout cela aux élèves des collèges et des lycées (seulement à partir de la troisième, néanmoins, compte tenu de la violence montrée par à l’écran). Enfin un film qui convaincra les producteurs d’en produire d’autres, pour nourrir une cinématographie française particulièrement pauvre sur cette page de notre histoire.
Voilà ce que je me suis dit en mars de cette année, espérant que le film, programmé pour une sortie en septembre, c’est-à-dire après les grands festivals (Cannes et Venise), saurait trouver son public avec le soutien des grands médias et des critiques. Ce n’est pourtant pas exactement ce qui se passe depuis sa sortie officielle le 18 septembre dernier. Si le public est au rendez-vous, avec une stabilité des entrées d’une semaine sur l’autre qui témoigne d’un excellent bouche-à-oreille, force est de constater que le traitement du film par les grands médias, et notamment ceux du service public audiovisuel, n’est pas à la hauteur de ce qu’on pouvait anticiper, témoignant au contraire, par son minimalisme, ses non-dits et ses contresens, de cette gêne caractéristique de la façon dont, aujourd’hui encore, l’esclavage colonial français peut être perçu par une partie des « élites » françaises.
Un film jalon
Le film de Simon Moutaïrou constitue pourtant un jalon important dans l’histoire de la représentation de l’esclavage par le cinéma français. Il marque d’abord une rupture dans sa production : c’est en effet un film qui a été financé selon les canons traditionnels du cinéma français. Il est porté par une société de production (Chi-Fou-Mi Productions) qui appartient au grand groupe audiovisuel Mediawan, vaste consortium qui est aujourd’hui le premier producteur indépendant de contenus audiovisuels en Europe1. Il a bénéficié du financement des deux principaux soutiens du cinéma français, les groupes Canal+ et France Télévisions, ainsi que de l’avance sur recettes du CNC. Cela lui a garanti un budget conséquent, permettant à Simon Moutaïrou de tourner son film en décor naturel à l’île Maurice, là-même où l’intrigue se déroule, d’y faire tourner deux têtes d’affiche, Camille Cottin et Benoît Magimel, propres à attirer le grand public sur un sujet que chacun sait difficile, et de disposer d’un appui réel en promotion lors de la sortie du film (affiches, réseaux sociaux…).
Toutes ces caractéristiques n’ont rien d’exceptionnel : c’est le lot de la quasi-totalité des films français présents sur nos écrans. Mais, s’agissant de l’esclavage colonial français, il s’agit seulement du deuxième film en vingt ans à avoir été produit en France sur ce sujet : alors que, entre 2004 et 2023, la France a produit (ou co-produit de façon majoritaire) 4 161 films de cinéma, un seul autre long-métrage a abordé cette question : Case Départ, la comédie de Fabrice Eboué et Thomas Ngijol (1,8 millions d’entrées en 2011).
Sur la même période, après une décennie 2000 peu productive sur cette thématique, le cinéma américain nous a donné des films aussi marquants que Django Unchained de Quentin Tarantino (2012), Lincoln de Steven Spielberg (2012), Twelve Years A Slave de Steve MacQueen (2013, oscarisé), Birth of A Nation de Nate Parker (2016) ou encore The Woman King de Gina Prince-Bythewood (2022), qui ont attiré une audience cumulée de 7,8 millions de spectateurs en France (dont 4,3 millions pour le seul film de Quentin Tarantino, et 1,7 millions pour celui de Steve MacQueen). A ces films on peut ajouter les réalisations de plateforme et séries télévisées, particulièrement nombreuses ces dix dernières années aux Etats-Unis2, œuvres qui sont également diffusées en France.
Cette avalanche de productions américaines explique pourquoi, en ce qui concerne l’esclavage, l’imaginaire cinématographique et télévisuel des spectateurs français est dominé par les représentations issues de ce pays, tant dans les événements dépeints (les plantations du Sud, la guerre de Sécession) que dans la façon de les aborder.
Le film de Simon Moutaïrou est d’autant plus exceptionnel qu’il s’inscrit dans une cinématographie française de l’esclavage colonial particulièrement pauvre du côté des productions commerciales. En effet, depuis les années 1970, la plupart des films français de fiction qui ont affronté directement la représentation de l’esclavage colonial français à l’écran sont soit des téléfilms financés par le service public (la série Tropiques Amers en 2007, le diptyque Toussaint Louverture en 2012), soit des films de cinéma à petit budget financés par l’étranger (West Indies ou les Nègres marrons de la liberté (1979) de Med Hondo a été produit par l’Algérie) ou les collectivités d’outre-mer (Le Passage du Milieu (2000) de Guy Deslauriers, co-produit par la région Martinique), auxquels on peut ajouter les trois films que le réalisateur guadeloupéen disparu en 2023 Christian Lara a consacrés au soulèvement de la Guadeloupe en 1802 contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte3. Quelle que soit leur qualité, aucune de ces œuvres n’a disposé d’un budget conséquent ni d’une exposition suffisante pour leur permettre de rivaliser avec leurs homologues américains.
Seul Case Départ sort de cet ordinaire artisanal : le film s’est fait avec un budget convenable (6 millions d’euros environ) et il a trouvé son public à l’époque, avec un propos comique moins centré sur l’analyse de la société esclavagiste du 18e siècle que sur la façon dont la découverte de cette dernière fait évoluer ses deux héros contemporains – incarnant chacun la caricature d’un type particulier de Français noir (Thomas Ngijol en voyou attribuant ses avanies au racisme ambiant et Fabrice Eboué en élu local métis et fier de son assimilation) – soudainement transposés dans les Antilles de 1780, après avoir déchiré l’acte d’affranchissement de leurs ancêtres.
Pour trouver un film français dramatique et destiné au grand public évoquant l’esclavage colonial français du point de vue des esclaves, il faut remonter en fait à 1958, c’est-à-dire il y a près de soixante-dix ans, avec le film Tamango du réalisateur américain exilé en France John Berry, adaptation franco-italienne d’une nouvelle de Mérimée évoquant une révolte à bord d’un navire de la traite esclavagiste4 (sorti en 1996, Les caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau se situe à Saint-Louis du Sénégal en 1787, mais offre sur l’esclavage alors pratiqué dans ce comptoir français un regard qui apparaît aujourd’hui très marqué par l’eurocentrisme et l’exotisme colonial).
C’est dire si Ni Chaînes Ni Maîtres constitue une nouveauté radicale dans ce paysage particulièrement pauvre, à tous les sens du terme. Mais ce qui rend le film de Simon Moutaïrou réellement exceptionnel, y compris au regard des productions américaines récentes sur l’esclavage, c’est la nature de son projet, et les partis-pris artistiques avec lesquels il a décidé de raconter cette histoire.
Il y a tout d’abord le cadre historique : en choisissant de situer son récit dans la colonie française de l’île Maurice du 18e siècle, alors appelée Isle-de-France, le réalisateur braque son projecteur sur l’Océan Indien, une région très mal connue de l’histoire de l’esclavage colonial français. Marquée par des circulations spécifiques entre l’Afrique (de l’Est et de l’Ouest), Madagascar et les Mascareignes (La Réunion, alors appelée île Bourbon, et Maurice), cette région a vu se développer des sociétés coloniales aux traits semblables à ceux des sociétés caribéennes (on y applique également le Code Noir, dans une version spécifique adoptée en 1723 et dont le film illustre dans une scène particulièrement dramatique l’article 38 consacré aux sanctions à l’encontre des marrons récidivistes) mais dont l’histoire particulière a été bien moins représentée à l’écran que les sociétés esclavagistes antillaises, du Sud des Etats-Unis ou du Brésil.
Il y a ensuite l’angle de traitement retenu par Simon Moutaïrou. Si la production du film repose sur la présence d’une comédienne et d’un comédien « bankables » (Camille Cottin en chasseuse d’esclaves et Benoît Magimel en planteur esclavagiste), le récit se déploie du point de vue de deux personnages noirs, l’esclave lettré Massamba et sa fille Mati, interprétés par les Sénégalais Ibrahima Mbaye et Anna Diakhere Thiandoum, dont le film suit la fuite vers Fi-Boumi-diam-yi-dogue, une communauté marronne au sud-ouest de l’île, tout en illustrant avec poésie leur spiritualité, leurs récits intimes, la profondeur de leurs liens filiaux.
A ce choix de point de vue s’ajoute un choix de traitement : si le film montre un monde dans lequel la quasi-totalité des personnes noires sont réduites en esclavage, violentées et humiliées (y compris cet ancien soldat africain émancipé mais rejeté dans la clandestinité car privé de son acte d’affranchissement), ses personnages sont libres, dignes, fiers. Elles et ils ont une intériorité, un nom, des croyances et une capacité d’action et d’indépendance à travers le marronnage, qui est le véritable sujet du film. Ce phénomène consubstantiel à toute société esclavagiste recouvre non seulement la fuite des personnes en esclavage, mais également l’existence de communautés marrones dans les marges des territoires coloniaux, ce « royaume de l’intérieur » des mornes et des hauts, comme on l’appelait dans l’île voisine de La Réunion,5. Le film présente des modèles de personnages noirs complexes et agissants, positifs au-delà de leurs propres contradictions, confrontés à des personnages blancs complexes dont les attitudes illustrent différentes positions dans un univers d’injustice fondamentale.
La violence omniprésente de la société coloniale l’est également dans le film mais d’une manière qui témoigne de la réflexion éthique que le réalisateur a su mener sur sa représentation. Ne pas la montrer reviendrait à omettre l’élément central de l’ordre esclavagiste – la terreur imposée aux personnes en esclavage non seulement par les châtiments mais aussi par leur spectacle public – ; mais la caméra de Simon Moutaïrou choisit ce qu’elle veut montrer, veillant ainsi à éviter la frontalité provocante et voyeuriste du cinéma d’exploitation. On sait que la représentation de la violence extrême du crime contre l’humanité est un questionnement récurrent de la critique de cinéma, symbolisé par le célèbre article de Jacques Rivette dans les Cahiers du Cinéma sur une scène du Kapò du cinéaste italien Gilles Pontecorvo, dont Jean-Luc Godard résumera le propos dans sa formule fameuse : « le travelling est une affaire de morale »6.
Au-delà de ses conditions de production, un nouveau film sur un sujet si peu porté à l’écran par le cinéma français soulève nécessairement de nombreuses questions morales et artistiques –sur la violence bien sûr, mais aussi sur le traitement des rapports entre personnages blancs et noirs, sur la comparaison avec les films américains sur le même sujet, sur la représentation des rapports de genre… –, sans oublier, au-delà des enjeux cinématographiques, les questions mémorielles et historiques qu’il permet d’éclairer sur l’esclavage colonial français, a fortiori dans un territoire et une période aussi peu connus que l’île Maurice en 1759…
Silence et contresens
Face à un tel objet filmique, il semblait donc naturel d’attendre une couverture médiatique à la mesure d’une production aussi rare et originale dans le cinéma français. Ce n’est pas exactement ce que l’on a constaté depuis la sortie du film.
Dans la presse écrite, l’accueil a été plutôt favorable, avec une moyenne de 3,4 / 5 sur 21 critiques d’après le site agrégateur Allociné. Les critiques les plus favorables sont aussi les plus développées (La Croix, L’Humanité, Historia), qui s’arrêtent sur le projet du film, explicitant sa volonté de renouveler la représentation cinématographique de l’esclavage en retournant la narration classique, habituellement centrée sur les personnages blancs (positifs ou négatifs) pour mettre à l’honneur les personnages noirs et leur résistance symbolisée par l’éloge du marronnage – physique, spirituel, politique – qui court tout le long du film.
Les critiques plus mitigées (Télé Loisirs, Première) pointent principalement la forme du film, et notamment sa deuxième partie, tournée comme un survival (genre cinématographique dans lequel le héros doit compter sur ses propres forces pour sauver sa vie dans un environnement hostile), jugée plus faible que l’évocation brutale, mais plus classique, de la violence de la société coloniale donnée par la première partie, dominée par la figure du planteur Larcenet joué par Benoît Magimel. Est aussi relevée (par la critique de Première) comme une faiblesse du film la mise en image du mysticisme des deux personnages africains, Massamba et Mati.
Dans ce concert, on ne peut que relever l’absence du film dans la plupart des journaux habituellement classés à droite : à l’exception du Journal du Dimanche, qui y a consacré une petite chronique plutôt favorable (tout en pointant son scénario « simpliste et manichéen », expression quelque peu étrange s’agissant de la représentation d’un crime contre l’humanité, perçu comme tel dès cette époque7), Ni Chaînes Ni Maîtres ne fait l’objet d’un article dans aucune de ces publication : Le Figaro quotidien ainsi que le Figaro Magazine, Le Point, L’Express, Valeurs actuelles, Paris Match…
Plus surprenante est la manière dont le service public audiovisuel a traité – ou plutôt n’a pas traité – le film de Simon Moutaïrou. Eu égard à la nature de son sujet, à l’originalité de son traitement et à l’événement que constitue la sortie du premier film français commercial sur l’esclavage depuis 13 ans (et quatre ans après les grandes manifestations antiracistes de 2020, où les questions de l’esclavage, de sa mémoire et de sa (non-)représentation ont été spécifiquement mises en lumière), on aurait été en droit de penser que les chaînes de Radio France et France Télévisions (par ailleurs coproducteur du film) le mettraient à l’honneur.
Tel n’a pas été le cas, et il est intéressant de s’arrêter de façon plus précise sur le traitement dont le film a fait l’objet sur ces antennes. Du côté de France Télévisions, seules deux émissions ont accueilli l’équipe du film : Simon Moutaïrou et Camille Cottin à l’émission « C à Vous La Suite » le 9 septembre, et Camille Cottin dans l’émission « Beau Geste » animée par Pierre Lescure, le 24 septembre. Il n’est pas indifférent de relever qu’il s’agit dans les deux cas d’émissions produites par des sociétés appartenant à Mediawan, le groupe qui a porté, par le biais d’une de ses filiales, le financement de Ni Chaînes Ni Maîtres.
« C à Vous La Suite » est la seule émission de télévision à s’être vraiment arrêtée sur le film et son projet. Elle lui consacre une longue séquence de 14 minutes, durant lesquelles Camille Cottin a pu revenir sur ses interrogations en tant qu’actrice face à son personnage, symbole négatif d’une histoire écrasante, et Simon Moutaïrou a pu détailler ses intentions dans l’écriture et la réalisation du film. Ces 14 minutes représentent tout ce qu’on pouvait attendre du service public face à une œuvre pareille. Elles sont hélas restées un moment unique.
Sur France TV, le passage de Camille Cottin à « Beau Geste », l’autre émission où Ni Chaînes Ni Maïtres a été évoqué, s’est en effet limité, s’agissant du film, à une évocation de trois minutes durant lesquelles le mot « marronnage » n’est même jamais prononcé, tandis que Pierre Lescure y présente le Code Noir comme un progrès, voulu par Colbert pour « contenir » le « n’importe quoi » de la violence coloniale, répétant ainsi une fable depuis longtemps démentie par les travaux historiques sur la genèse de ce texte.
Ceux-ci montrent en effet que, d’une part, cet édit n’a pas été commandé par Louis XIV à son ministre Colbert en 1681 « pour empêcher que ce soit pire », comme l’affirme Pierre Lescure, mais pour affirmer le pouvoir royal sur les territoires alors déjà esclavagistes de la Martinique et de la Guadeloupe récemment rattachés au domaine royal (en 1674), et que, d’autre part, le contenu de cet Edit Royal se contente d’unifier en un texte unique édicté à Versailles des textes locaux épars, auxquels il n’ajoute ni ne retire aucune disposition juridique substantielle, mais auxquels il confère une validation royale, sans en étendre les dispositions à la métropole : la nouveauté du Code Noir en 1685 est donc qu’il marque le début officiel de « l’exception coloniale », l’an 0 du droit colonial français.
Il n’y aura pas d’autre émission consacrée au film, ni de sujet dans les journaux télévisés de France 2 et France 3, alors que, en juillet 2011, la sortie de Case Départ, le dernier film commercial français à évoquer l’esclavage, avait fait l’objet d’un sujet au journal de 20 heures de France 2, avec interview des deux co-réalisateurs. Le traitement du sujet illustre bien la façon dont le film avait été alors perçu, puisque, en conclusion de ce reportage, le commentaire relève que, à l’issue de cette aventure rocambolesque à l’époque de l’esclavage, les deux personnages remettront en cause leurs préjugés. Il fallait donc comprendre que, s’il y avait une leçon à retenir du premier film commercial français sur l’esclavage depuis des décennies, c’était aux hommes noirs de France de la tirer, et pas au reste de la société française, pourtant encore marquée par les stigmates de cette histoire…
Tout autre est le message de Ni Chaînes Ni Maîtres, qui s’adresse clairement à l’ensemble de la population française, à laquelle il présente une vision renouvelée de l’esclavage colonial et de ses victimes. Le film rappelle tout d’abord qu’il s’agit d’une page inscrite dans notre histoire nationale, qui a concerné de nombreux territoires ne se limitant pas aux actuels départements et collectivités d’outre-mer, et qui a impliqué l’Etat jusqu’à son chef le plus éminent (le Roi, commanditaire et signataire du Code Noir) ainsi que l’Eglise dans sa doctrine comme dans ses actes ; mais il le fait sans manichéisme, en montrant la diversité des positionnements à l’égard de l’esclavage au sein de la société coloniale, tant du côté des personnages blancs que des personnages noirs qui, une fois n’est pas coutume, sont volontairement mis au premier rang du film, plutôt que les deux têtes d’affiche Camille Cottin et Benoît Magimel.
C’est ce que semble regretter Laurent Delmas à la fin de l’émission hebdomadaire sur le cinéma de France Inter, « On aura tout vu », lorsqu’il expédie Ni Chaînes Ni Maîtres en quelques mots, en se contentant de critiquer la forme du film et les rôles insuffisamment développés de Camille Cottin et Benoît Magimel. Antoine Guillot n’en fait pas plus dans l’émission homologue de France Culture, « Plan Large », dans laquelle lui non plus ne l’évoque que dans la liste en bref des films de la semaine, pour déplorer la « complaisance regrettable dans la figuration explicite des exactions coloniales ». Les auditeurs devineront à peine qu’il s’agit d’un film sur le marronnage, et n’entendront parler dans aucune des deux émissions d’Ibrahima Mbaye et Anna Diakhere Thiandoum.
Au moins sauront-ils que le film existe, au contraire des auditeurs du « Masque et La Plume », la tribune critique la plus écoutée et sans doute la plus prescriptrice de France, qui ne lui a même pas accordé une mention dans les coups de cœur en fin d’émission, préférant, à côté des deux longs-métrages incontournables de la semaine (le Megalopolis de Francis Ford Coppola, et Les graines du figuier sauvage du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof), revenir sur deux autres films français sortis cette semaine-là, que les critiques présents jugeront inconsistants (Les barbares de Julie Delpy et le remake d’Emmanuelle par Audrey Diwan). Comme par ailleurs aucune des antennes de Radio France n’a invité Simon Moutaïrou ni les actrices et acteurs du film pour en parler, c’est toute une frange du public cinéphile qui s’est trouvée privée d’informations sur l’existence et l’originalité du film.
On pourra toujours trouver des explications à ce silence : le nombre de films sortis cette semaine-là, la présence parmi cette sélection de l’œuvre-monstre d’un cinéaste majeur, Francis Ford Coppola, la volonté de privilégier des films à l’économie plus fragile, comme le Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel. A titre de comparaison, Case Départ en 2011, s’il n’a pas lui non plus bénéficié d’une mention au « Masque et la Plume », s’est vu largement – et favorablement – évoqué dans plusieurs émissions comme « le Fou du Roi » de Stéphane Bern8 sur France Inter, « Le Rendez-vous »9 et « La fabrique de l’Histoire » d’Emmanuel Laurentin10 sur France Culture.
Il y a pourtant eu une journaliste du service public pour percevoir le vrai enjeu d’une œuvre comme Ni Chaînes Ni Maîtres : c’est Falila Gbadamassi, qui a signé pour le site internet de France Info une chronique informée et profonde du film de Simon Moutaïrou, le reliant à la fin de son article à « la revendication […] toujours prégnante chez les afrodescendants qui luttent encore contre une multitude de clichés et de préjugés », pour conclure : « Les dernières campagnes législatives en France et le déferlement de racisme, qui les ont accompagnées, ainsi que les récentes sorties de Donald Trump sur les Haïtiens immigrés, mangeurs de chats et de chiens, ne laissent planer aucun doute sur le sujet. »11
Angles morts
Car un film ne parle jamais uniquement de ce dont il parle : dans son sujet, dans son traitement, il parle aussi de son époque ; il ouvre les imaginaires ; il donne à voir et à entendre des héroïnes et des héros qui inspireront en retour les combats d’aujourd’hui, que ces derniers visent à réparer les injustices du passé ou qu’ils soient motivés par des urgences plus immédiates. Combien de personnes ont été sensibilisés à la mémoire des fusillés pour l’exemple de la Grande Guerre par Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick ? N’est-ce pas le succès du film Indigènes qui a conduit la France de Jacques Chirac à, enfin, décristalliser les pensions des anciens combattants des troupes coloniales, scandaleusement spoliés depuis tant d’années par la France pour laquelle ils avaient risqué leur vie12 ? Et aujourd’hui, le film L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine (qui bénéficie d’un partenariat avec France Inter) ne nous aide-t-il pas à mieux comprendre la précarité des vies obscures que mènent les immigrés clandestins qui travaillent en France en 2024 ?
S’agissant de la mémoire de l’esclavage, l’absence d’images et, plus généralement, d’un imaginaire français de cette histoire, conduit en France à une impression d’irréalité et d’extériorité lorsqu’il est question de ce phénomène qui pourtant a concerné 4 millions de victimes en plus de deux siècles d’exploitation coloniale déployée sur trois continents, de 1625 à 184813. Mais faute de récits historiques ou fictionnels largement partagés – aucun roman sur l’esclavage colonial français n’a marqué les mentalités en France comme La Case de l’Oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, Racines d’Alex Haley ou Beloved de Toni Morrisson, aucun film, aucune série de fabrication française n’a jamais pu rivaliser avec Django Unchained et Roots –, c’est dans un répertoire d’images liées au passé des Etats-Unis que le grand public français va habituellement puiser les images avec lesquelles il se représente cette histoire : on connaît la Guerre de Sécession mais pas la Révolution Haïtienne ni le soulèvement de la Guadeloupe ; on imagine volontiers les champs de coton du Mississippi mais pas les champs de cannes à sucre ou de café des Caraïbes ; on célèbre l’Underground Railroad mais pas les marrons de Guyane ; on se passionne pour le destin romancé de Kunta Kinte sans connaître celui, authentique, de Makandal…
Cette omniprésence dans les têtes de la mémoire états-unienne de l’esclavage conduit à une invisibilisation des figures françaises des combats pour l’abolition et pour l’égalité. Ces dernières sont pourtant nombreuses, dans le pays qui a vu la première révolte d’esclaves victorieuse, à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) sous la conduite de Toussaint Louverture ; qui a fini par affirmer sous la Révolution la « Liberté Générale » et l’égalité de tous les hommes quelle que soit leur couleur de peau, grâce à l’action d’hommes nés en métropole comme Mirabeau ou l’Abbé Grégoire ou issus des colonies comme Julien Raimond ou Jean-Batiste Belley ; et dont les colonies ont vu naître de grandes figures intellectuelles au rayonnement mondial, marquées par la mémoire de l’esclavage, d’Aimé Césaire à Maryse Condé. Et pourtant, malgré cela, un Xavier-Laurent Salvador peut encore affirmer en 2023 dans les colonnes du Figaro qu’il « est donc vrai que la France n’a pas de grande figure de la lutte contre l’apartheid ni la ségrégation »14.
Comment s’étonner dès lors que, lorsque la France a été interpelée sur le leg de racisme et de discriminations directement relié à son passé esclavagiste, comme cela a été le cas en 2020 après le meurtre de Georges Floyd, le premier réflexe de nombre de commentateurs a été de voir dans cette interrogation la marque de l’importation de débats propres aux Etats-Unis, sans rapport avec la situation française ? Plutôt que de réfléchir sur l’origine enracinée dans notre histoire coloniale des préjugés aux effets bien réels que, encore aujourd’hui, les personnes noires subissent en France, on a vu par exemple l’essayiste Barbara Lefebvre dénoncer « un mimétisme américano-centré et l’usage récurrent de comparaisons anachroniques (sur l’esclavage, le racisme, le sexisme) »15.
Toutes les expériences humaines ne produisent pas le même volume d’archives. Lorsqu’on parle de l’esclavage colonial français, les traces laissées par les propriétaires esclavagistes – livres de comptes, correspondances, peintures, objets et bibelots… – sont bien plus nombreuses, de par leur fortune et leur position sociale, que celles laissées par les personnes en esclavage elles-mêmes, privées non seulement de personnalité juridique mais également d’éducation et de propriété, et plus encore par celles et ceux qui, partis marronner, vivaient en marge de la société coloniale, dans des sites naturels reculés où seule l’archéologie parvient aujourd’hui à retrouver le souvenir de leur présence.
Eclipsée par l’omniprésence des références véhiculées par les industries culturelles américaines, invisibilisée par la faiblesse des sources, ostracisée par l’idéologie de l’anti-repentance qui récuse tout relecture de notre passé à l’aune des derniers apports de l’historiographie du phénomène colonial, la mémoire de l’esclavage colonial français est encore aujourd’hui pour la plupart des gens un angle mort de notre mémoire nationale, une histoire doublement périphérique, renvoyée aux particularismes de territoires d’outre-mer par ailleurs largement ignorés, et déconnectée des grands mouvements d’une Histoire nationale faussement perçue comme exclusivement hexagonale.
C’est dire si une œuvre comme Ni Chaînes Ni Maîtres est dans ce contexte importante : parce qu’elle illustre la réalité coloniale de la France de 1759, jusque dans l’Océan Indien où se déroule l’action du film ; parce qu’elle propose une mise en images inédite du marronnage, sur lequel on ne dispose que de très peu de sources d’époque, et moins encore qui proviennent des marrons eux-mêmes ; parce qu’elle retourne la narration traditionnelle en choisissant comme héros et héroïne deux marrons joués par un comédien et une comédienne noirs peu connus, alors que les deux vedettes du film – Camille Cottin et Benoît Magimel – incarnent deux facettes de la brutalité du système colonial, Cottin la chasseuse d’esclaves illuminée et Magimel le colon esclavagiste à états d’âme.
Ce retournement a un sens : celui de proposer, sur un sujet écrasant, des personnages positifs, actifs, en pleine possession de leur destin jusqu’au bout. Et cette représentation rompt ainsi avec les deux écueils des représentations de l’esclavage au cinéma, qui sont les deux faces d’un même contresens. Le premier est l’exaltation de la figure du « sauveur blanc », c’est-à-dire le fait de centrer l’intrigue sur un personnage blanc positif, en laissant les personnages noirs, victimes de l’esclavage ou révoltés, aux lisières de l’intrigue. Le problème, dans ce choix, n’est pas l’existence de ce type de personnage, qui peut correspondre à une réalité historique, d’autant plus importante à rappeler qu’elle démontre que, au temps de l’esclavage colonial, jamais celui-ci n’a fait l’objet d’un consensus au sein des pays qui le pratiquaient ; le problème de ce choix de traitement réside dans le fait que, dans un contexte où les films ayant pour toile de fond l’esclavage sont rares, et où l’immense majorité des films produits par les pays occidentaux reposent sur des héroïnes et héros blancs, il prive les spectateurs de la possibilité de s’identifier à des personnages noirs agissants, positifs et placés au centre de l’action.
Ce faisant, il alimente une autre tendance critiquable du cinéma comme de la littérature sur l’esclavage, celle qui entoure l’emploi des personnages noirs condamnés à la marginalisation ou à l’enfermement dans le stéréotype. Marginalisation quand ces derniers ne sont utilisés que pour des seconds rôles destinés à être relégués lorsque le film déploie ses vrais enjeux16. Enfermement dans le stéréotype lorsque le personnage noir est écrit en reprenant les poncifs traditionnellement associés à la noirceur dans l’imaginaire occidental construit par la culture populaire (caricatures, chansons, récits exotiques…). Cela est particulièrement délétère lorsqu’il est question de l’esclavage, quand l’intrigue dépeint les personnes en esclavage soit comme une masse indifférenciée17, soit comme des êtres frustes uniquement mus par leurs instincts, constamment sexualisés et incapables de noblesse d’âme18. A cela s’ajoute l’effet négatif que peut avoir sur le public le fait que les personnes noires soient constamment renvoyées à l’histoire de l’esclavage, entretenant de ce fait le raccourci « Noir = esclave » qui contribue, en ramenant toutes les personnes noires à cette seule page de l’histoire, à entretenir cet héritage de stéréotypes que la société coloniale esclavagiste nous a légué.
Simon Moutaïrou n’ignorait pas ces deux écueils, et c’est ce qui rend son film d’autant plus intéressant : en effet, il n’a pas seulement inversé la perspective en centrant son intrigue sur deux personnages noirs, il a assumé pleinement les conséquences de ce choix, notamment en faisant tourner Ibrahima Mbaye et Anna Diakhere Thiandoum en wolof, évitant ainsi cette convention problématique qui aurait vu Massamba et sa fille se parler en français dans l’intimité. Plus remarquable encore est le traitement qu’il a apporté à des personnages enfermés dans la grille raciale alors en construction dans la société coloniale de l’époque : ainsi, s’il n’a pas fait usage de la figure du « sauveur blanc », il a veillé à ce que ses personnages blancs présentent une gamme très large d’attitudes à l’égard de l’injustice intrinsèque de la société où ils évoluent, du nouveau gouverneur à la cruauté raciste implacable au fils du planteur Larcenet, nourri des idées des Lumières et qui affirme l’humanité des esclaves avec lesquels il a grandi ; du côté de ses personnages noirs, il présente d’abord Massamba en auxiliaire du système esclavagiste, qui se compromet pour survivre et épargner à sa fille les violences promises aux femmes dans ce système, tout en montrant son intériorité et sa spiritualité (ses visions à divers moments du film), qui témoignent du fait que l’esclavage n’a pas brisé son identité de féticheur ; et ce sera ensuite cette africanité jamais abdiquée qui unira les marrons au-delà de leurs différences, dans une belle scène de veillée à la fin du film.
Tout cela donne de l’épaisseur aux personnages et fait de Ni Chaînes Ni Maîtres un film dont on ne ressort pas avec le sentiment que la violence nous a été donnée comme un spectacle (comme dans Django Unchained), ni que le film a entretenu le stéréotype « Noir = esclave ». Massamba et sa fille nous sont montré dans leur humanité, jamais ils ne sont « chosifiés » par la caméra comme les figurants de leur propre histoire, et on ne peut qu’être frappé par la force du regard de Massamba à sa fille, dans l’avant-dernier plan, qui n’est pas le regard d’un homme défait, mais au contraire d’un irréductible résistant, vivante incarnation de la devise « La Liberté ou la Mort » qui n’a cessé d’animer les anciens esclaves de Saint-Domingue ou de Guadeloupe lorsqu’ils se battaient entre 1791 et 1804 contre les troupes anglaises, espagnoles puis napoléoniennes, fers de lance de l’ordre esclavagiste dans les Caraïbes.
Cette volonté de donner à voir des héros et des héroïnes noires en résistance dans le monde de l’esclavage, à travers l’évocation du marronnage qui fut une manifestation constante de cette résistance, était au cœur du projet de Simon Moutaïrou. On comprend à quel point une telle œuvre peut être importante pour un public noir en mal de représentations au cinéma qui cassent les stéréotypes traditionnels. Mais ce changement de perspective s’adresse tout autant aux spectateurs majoritairement blancs qui constituent le grand public en France. Car, au-delà du fait que le film donne à voir pour la première fois l’esclavage colonial à l’île Maurice au 18e siècle, c’est-à-dire une réalité historique totalement méconnue dans notre pays, la dés-essentialisation des personnages en esclavage à laquelle Ni Chaînes Ni Maîtres procède permet de déconstruire les stéréotypes qui nourrissent la négrophobie, et notamment l’équation « Noir = esclave », tout en offrant un regard inédit sur les complexités et les contradictions de la société coloniale.
Mais pour voir cela, il faut avoir vu le film de Simon Moutaïrou. C’est-à-dire au départ avoir eu envie de le voir. Et donc en avoir entendu parler.
C’est là où la façon dont le film a été traité lors de sa sortie pose problème : non pas seulement parce que ce traitement médiatique n’a pas été à la hauteur de l’événement cinématographique que son existence même représente mais aussi parce qu’il ne s’est apparemment trouvé dans les rédactions aucune personne pour percevoir cette importance, et tenter de rectifier les choses.
Et l’on peut remonter plus loin en arrière : terminé, en copie de travail, au début de l’année 2024, comment se fait-il qu’un tel film n’ait pas pu être sélectionné dans un grand festival, comme Indigènes ou Tirailleurs l’avaient été en 2003 et 2022, suscitant des événements lors de leur projection qui ont largement contribué à l’attente quant à leur sortie sur les écrans ? Pour une sortie programmée après l’été, cette absence de sélection en festival a clairement privé Ni Chaînes Ni Maîtres du booster de la visibilité que lui aurait donnée une présence à Cannes ou Venise.
Tout se passe comme si le film et son sujet restaient invisibles. Comme s’il n’intéressait pas. Comme s’il ne résonnait pas puissamment, et intelligemment, avec des enjeux contemporains que le cinéma français traite peu (la place des populations noires dans le récit national et leurs multiples façons d’exister dans notre pays), ou alors exclusivement sous l’angle de la comédie (avec Case Départ et Tout Simplement Noir, le second citant d’ailleurs le premier, avec une ironie bien ajustée 19).
Il ne fait pas de doute que ce désintérêt des grands médias et des grands festivals a privé le film d’une bonne partie de son public potentiel : avec une production de 8 millions d’euros environ, Ni Chaînes Ni Maîtres est en effet l’un de ces films dits « du milieu », ni blockbuster à budget pharaonique, ni film-témoignage réalisé avec les moyens du bord, qui ne trouvent leur public qu’avec le bouche-à-oreille et le soutien des médias qui les distinguent dans la masse des sorties d’une semaine. La bonne tenue des entrées du film de Simon Moutaïrou montre la force du bouche-à-oreille (a fortiori en l’absence de relais dans la presse une fois passée la première semaine). Mais la faiblesse de l’appui des grands médias, notamment audiovisuels, a clairement empêché une partie du public de le découvrir, celle constituée par les spectateurs qui suivent les recommandations des émissions prescriptrices, notamment du service public.
Ce désintérêt est le signe d’une double ignorance qui renvoie à la gêne profonde que suscitent dans notre pays les enjeux rappelés plus haut.
La première ignorance a déjà été pointée : c’est celle qui entoure l’histoire française de l’esclavage. La seconde est plus subtile, mais aussi plus insidieuse, c’est cette « ignorance qui s’ignore » qui, aux yeux d’Achille Mbembe commentant la pensée d’Edouard Glissant en 202120, constitue le plus grand obstacle à la naissance de ce Tout-Monde riche de tous les « autres » qui forment l’Humanité auquel aspire le poète martiniquais, cet état d’ouverture et de dialogue qu’il appelle « Relation » et qui est « en totale rupture avec toute forme de clôture sur soi, que celle-ci prenne la forme d’une clôture territoriale, nationale, ethno-raciale ou religieuse ».
Pour Mbembe, cette « ignorance qui s’ignore » est ce qui empêche les sociétés eurocentrées d’entrer dans cette « Relation » avec le reste du monde, et notamment cette partie de l’Humanité qui porte encore, dans nos yeux de Français, les stigmates de la colonisation que nous leur avons imposée.
A ces populations qui font partie depuis parfois des siècles de la nation française et qui demandent à être reconnues, écoutées, représentées jusque dans les fictions cinématographiques, on oppose un silence et une incompréhension maquillés en un « universalisme » qui n’est autre que le faux universel « décharné » dont parlait Aimé Césaire dans sa Lettre à Maurice Thorez de 1956. Un pseudo-universalisme qui affirme son ouverture et sa tolérance tout en n’étant fait que de « miroirs dont on attend qu’ils nous renvoient inévitablement une image de nous-mêmes »21.
C’est dans ce jeu de miroirs renvoyant toujours les mêmes images – la métaphore semble faite pour ce cinéma français de l’entre-soi, qui raconte toujours les mêmes histoires, avec les mêmes acteurs, dans les mêmes lieux, et pour ces médias qui se font les relais de ces films se dupliquant les uns les autres – qu’a disparu Ni Chaînes Ni Maîtres. Parce que, dans les grands médias, il ne s’est trouvé personne pour s’astreindre à cette exigence dont parlait Achille Mbembe, celle qui « permet non pas de parler incessamment de soi-même, ou d’autres mondes, souvent à leur place, comme s’ils n’existaient pas déjà pour eux-mêmes, mais de regarder ensemble et éventuellement de voir, mais chaque fois à partir de plusieurs mondes ».
C’est ce décentrement que Simon Moutaïrou invite le spectateur à réaliser dans Ni Chaînes Ni Maîtres, et c’est ce décentrement que les médias audiovisuels français n’ont pas su faire à l’égard de son film, pas plus qu’à l’égard des enjeux qu’il soulève. Est-il encore possible qu’ils réalisent cet effort, un mois après la sortie du film ? Les débats historiques et critiques qui auraient dû avoir lieu, du type de ceux que le service public avait su organiser en 2023 autour du biopic Napoléon de Ridley Scott, qui n’en méritait pas tant22, n’auront de toutes façons plus lieu maintenant. La réception du film dans les outre-mer, où il est sorti en même temps que dans l’Hexagone, bientôt en Afrique où il va être programmé à partir du mois de novembre, pourrait donner matière à d’intéressants retours sur la façon dont il est reçu par le public, et sur ce qu’il signifie aux yeux des spectateurs qui l’ont vu dans ces territoires, profondément marqués par les stigmates de cette histoire.
Mais c’est probablement trop tard, du moins pour la première exploitation de Ni Chaînes Ni Maîtres. Les grands médias auront raté cet événement, et ce ratage va désormais faire partie de l’histoire de la réception du film, comme la censure de Tamango en 1958 fait aujourd’hui partie de son histoire – parce que le film de John Berry représentait la révolte de captifs africains contre leurs bourreaux blancs sur un navire de traite et qu’il sortait en 1958, c’est-à-dire en pleine décolonisation, alors que la France était enfoncée dans la guerre d’Algérie et la répression au napalm des indépendantistes de l’UPC au Cameroun, Tamango a été interdit par la censure française dans les colonies africaines et les départements d’outre-mer23.
Cette péripétie très significative a d’ailleurs marqué le passage de Tamango au « Masque et La Plume » : programmé dans la séance du 6 février 1958, il n’est évoqué que très brièvement par le critique et futur cinéaste Jacques Doniol-Valcroze, qui sera coupé par le présentateur Michel Polac avant même d’avoir pu expliquer de quoi parle le film parce qu’il a dit que son scénario lui avait valu les honneurs de la censure. Mais, trois semaines plus tard, « Le Masque et La Plume » y revint, et invita même John Berry à venir s’expliquer sur son film pendant plus de dix minutes. « Il fallait souligner une erreur d’optique quand un film sort et disparaît un peu trop vite sans qu’on ait pu souligner l’intérêt de l’entreprise », avouait un peu étrangement Michel Polac à la fin de l’émission.
De cet étonnant repentir il nous reste un échange très éclairant. A Michel Polac qui lui reproche d’avoir « trahi Mérimée », parce qu’il a fait « de Tamango un héros », alors que, dans la nouvelle originelle, il est « un personnage ivrogne et débauché [qui] vend ses semblables », John Berry répond en effet avec aplomb, dans son français légèrement approximatif : « Si vous avez à faire un film sur la Révolution Française ou la Résistance, est-ce que vous pouvez prendre ça comme héros ? moi j’estime qu’on ne pouvait pas ». L’enjeu pour lui n’était pas de faire une adaptation d’une nouvelle de Mérimée, mais de montrer une histoire de révolte dont le héros pourrait être un Noir digne et admirable (très bien joué par Alex Cressan, un étudiant en médecine martiniquais dont ce sera l’unique rôle au cinéma), alors que les Etats-Unis étaient en plein mouvement des droits civiques, et qu’aucune des colonies françaises d’Afrique subsaharienne n’était encore indépendante.
Fallait-il être obligatoirement un Américain exilé pour faire en France en 1958 un film moderne sur l’esclavage et le combat des Noirs pour l’égalité ? Peut-être. Mais plus maintenant. Après les films pionniers d’Euzahn Palcy, Med Hondo, Christian Lara, Guy Deslauriers et Jean-Claude Barny, c’est ce que Simon Moutaïrou a démontré avec Ni Chaînes Ni Maîtres. On ne peut qu’espérer qu’il ne faille pas attendre encore 13 ans pour qu’un nouveau film français s’empare du sujet de l’esclavage, des résistances qu’il a suscitées, et des combats pour son abolition. Il y a encore tant de choses à montrer, tant de récits à déployer, tant de voix longtemps tues à faire entendre. Parce que, en français, en wolof ou en créole(s), c’est notre Histoire qu’elles nous racontent.